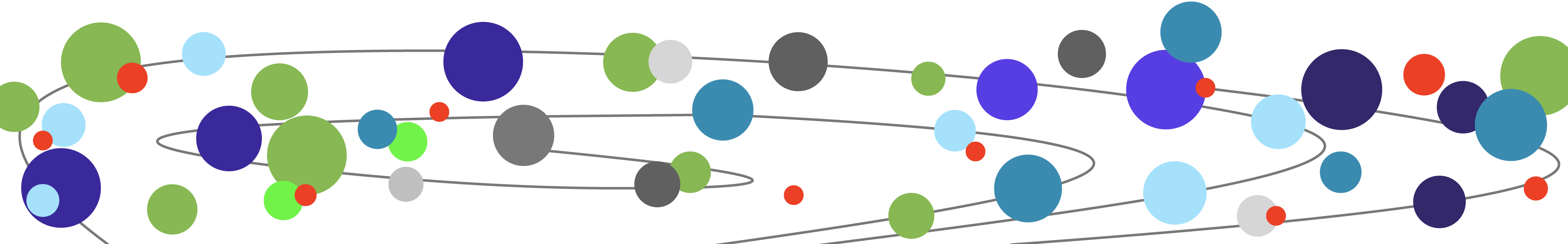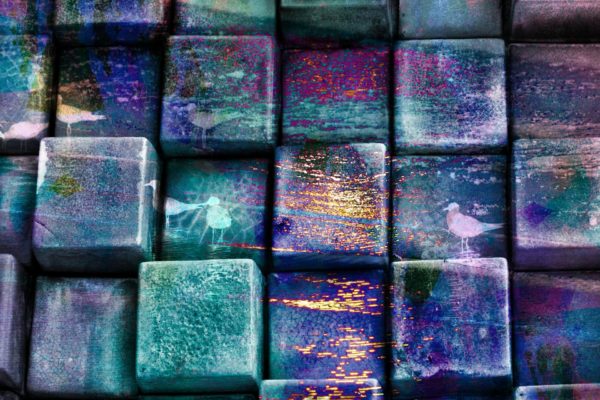Ariane Vidal-Naquet
Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France, responsable scientifique de la journée d’études
L’avant-propos vise à préciser l’objet de ce dossier : Penser ce qui aurait pu être pour mieux éclairer ce qui est. L’uchronie repose sur un exercice fictif d’imagination, une expérience de pensée, ici juridique, qui est une véritable démarche scientifique, dont les linéaments sont esquissés par le présent ouvrage. Cet exercice de pensée permet de renvoyer une image, en quelque sorte en négatif, du droit, à travers ce qu’il aurait pu être, permettant, dans un mouvement réflexif, de mieux l’éclairer et l’appréhender dans son ensemble.
The paper aims to clarify the purpose of the project and its contribution to public law: Thinking about what could have been to better shed light on what is. Uchronia is based on a fictitious exercise of imagination, a thought experiment, here legal, which is a real scientific approach. The present project also tends to give the outlines of legal uchronia. This thought exercise allows us to reflect an image, in a sort of negative, of the law, through what it could have been, allowing, in a reflexive movement, to better illuminate and understand it as a whole.
Penser et donc voir autrement le droit public. Tel est l’objet – et l’ambition – du présent exercice collectif d’imagination juridique. Et si le droit public n’était pas ce qu’il est mais ce qu’il aurait pu être ? Et si l’on comprenait mieux le droit public à partir de ce qu’il n’est pas mais de ce qu’il aurait pu être ? C’est à ce déplacement du regard et peut-être à une nouvelle forme de lucidité que convie le projet, en mobilisant une méthode aussi ancienne que puissante : l’uchronie. Cette expérience de pensée, qui consiste à modifier un évènement du passé pour imaginer et raconter ce qui se serait passé si, est un instrument pour éclairer le droit autrement. Parfois appelée « histoire contrefactuelle » ou « histoire alternative », l’uchronie mobilise un rapport au temps particulier : elle vise à penser et à décrire dans le présent ce qui aurait pu survenir dans le passé, quitte à ce que ce dernier ouvre sur un présent alternatif. Autrement dit, l’uchronie est un regard du présent sur le passé – ici un passé reconstitué – et non pas sur un futur, ce qui la distingue de l’anticipation, qui se passe dans un futur proche, et de la science-fiction.
Le procédé est à la fois très connu – en témoigne le célèbre aphorisme de Pascal sur le nez de Cléôpatre1 – et fort ancien, puisque déjà utilisé par Tite Live, historien de la Rome antique2. Le terme même d’uchronie apparaît au milieu du xixe siècle sous la plume d’un philosophe français, Charles Renouvier, qui publie un ouvrage intitulé Uchronie (L’Utopie dans l’histoire) avec le sous-titre suivant : Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être3. Tel est bien le principe de l’uchronie, dont l’étymologie grecque renvoie à une action qui prend place dans un non-temps. L’exercice consiste à imaginer et à raconter ce qui se serait passé si un fait ne s’était pas déroulé ou s’était déroulé autrement, ainsi que les conséquences qui ont résulté de cette modification. Il s’articule autour de deux opérations : la première consiste à choisir un fait, voire plusieurs, à partir duquel ou desquels l’histoire va changer, considérés comme un point de « scission »4 librement choisi par l’auteur ; la seconde consiste à imaginer, dans le passé, les conséquences qui auraient suivi cette modification, et donc la déviation au sens propre du terme.
Ainsi que Charles Renouvier l’explique dans la postface de son ouvrage, l’uchroniste, comme il l’appelle, se heurte à une entreprise qui est impossible, chimérique même, liée aux « déviations en divers sens et aux inimaginables croisements »5 possibles et à « la multiplicité et l’enchevêtrement des hypothèses »6. L’uchroniste ne prétend pas reconstruire l’histoire et ne cherche nullement à disqualifier les « historiens de la réalité »7, bien que ces derniers, comme le souligne non sans malice Renouvier, n’établissent que des vraisemblances et non des vérités. Néanmoins, et tels sont les mots de la conclusion, l’uchroniste « aura forcé l’esprit à s’arrêter un moment à la pensée des possibles qui ne se sont pas réalisés, et à s’élever ainsi plus résolument à celle des possibles encore en suspens dans le monde »8.
Longtemps considérée comme une fantaisie, une « curiosité littéraire » pour reprendre l’expression de Renouvier9, comme un genre presque mineur, l’uchronie est devenue très à la mode. Sur ce même principe, qui consiste à envisager une autre histoire à partir de la modification d’un évènement du passé, elle se déploie dans de nombreux domaines. En littérature, l’exercice est ancien. Il a été poussé à son paroxysme dans le célèbre ouvrage de Robert Musil, L’Homme sans qualités, qui transpose cet exercice à tous les aspects de l’existence et le transforme en une habitude de pensée et, plus encore, en « une attitude de vie »10. En histoire, le procédé est très largement utilisé, notamment dans le monde anglo-saxon11. Il est également utilisé en économie, où il a donné naissance à une discipline spécifique12. En droit, la démarche est, en revanche, relativement inédite, à l’exception du célèbre article de Georges Vedel, « Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… »13. Elle est au cœur du présent projet qui vise à décliner et à systématiser l’usage de l’uchronie, puisque telle était la consigne, finalement assez vague, adressée aux différents contributeurs : imaginer « ce qui se serait passé si ». Libre à chacun d’entre eux de choisir un point de bascule, un événement charnière – célèbre ou anodin – et d’imaginer ce qui aurait changé, non seulement dans le cours du droit, mais encore dans le discours sur le droit.
Qu’il me soit permis de remercier ceux qui se sont prêtés non pas au jeu – la formule étant réductrice – mais à l’exercice proposé. Car si la démarche peut paraître ludique ou anecdotique, comme une sorte de fantaisie récréative de juristes à la recherche d’une pause dans leurs recherches et leurs enseignements, le présent projet entend prendre au sérieux l’uchronie en tant que méthode scientifique pour mieux penser, imaginer, évaluer, éclairer, voir et même concevoir le droit. Il ne s’agit pas d’un divertissement, encore moins d’une récréation, mais d’une possibilité de « recréation », de « reconstruction » du droit et de la science du droit.
Penser ce qui aurait pu être est un exercice finalement assez rare chez les juristes, dont le travail consiste souvent, la plupart du temps, à se confronter au droit tel qu’il est, à le décrire, le systématiser, le conceptualiser, le critiquer, éventuellement l’anticiper, le prévoir, le façonner…. En revanche, imaginer ce qu’aurait pu être le droit si un ou plusieurs évènements s’étaient déroulés différemment invite le juriste à penser le droit non pas comme une donnée mais comme un construit, non pas comme une évidence mais comme une hypothèse
Penser ce qui aurait pu être, c’est aussi éclairer autrement ce qui est. Ce qui « est » aurait aussi bien pu ne pas être ; et que ce qui « aurait pu être » éclaire, parfois mieux que le réel, ce que le droit est devenu. En ce sens, l’uchronie met le droit à l’épreuve de ses virtualités et projette une autre lumière, décalée, sur notre présent juridique. Elle renvoie une image presque en négatif du droit, à travers ce qu’il aurait pu être, permettant, dans un mouvement réflexif, de mieux éclairer le droit public dans son ensemble.
Les pages qui suivent sont autant de fragments d’un droit qui aurait pu advenir. Elles sont aussi, par contraste, une invitation à mieux comprendre le droit tel qu’il est – et peut-être à mieux le penser pour demain. Tel est l’objet du projet, explorer « le droit du possible », et son apport, déployer « les possibles du droit ».
I. L’objet du projet : le droit du possible
Le projet a pour ambition d’éprouver, par la voie uchronique, ce que l’on pourrait appeler le « possibilisme juridique » : une manière d’aborder le droit non pas comme une donnée figée mais comme un champ de possibilités, d’en dérégler les évidences, d’en éprouver les virtualités, d’en imaginer les bifurcations… bref d’en faire le droit du possible14. Cette notion puise ses racines dans la réflexion littéraire de Robert Musil, auteur de L’Homme sans qualités, pour lequel le « sens du possible »15 consiste à ne jamais s’en tenir à ce qui est mais à envisager ce qui aurait pu être – ou pourrait encore advenir. Ainsi, écrit-il, « L’homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas : ici s’est produite, va se produire, doit se produire telle ou telle chose ; mais il imaginera : ici pourrait, devrait se produire telle ou telle chose ; et quand on lui dit d’une chose qu’elle est comme elle est, il pense qu’elle pourrait aussi bien être autre ». Ainsi pourrait-on définir simplement le sens du possible comme la faculté de penser tout ce qui pourrait être « aussi bien » et de ne « pas accorder plus d’importance à ce qui est qu’à ce qui n’est pas », les différentes possibilités imaginées répondant au concept « d’équipossibilité ». Le possible devient ici une grille de lecture du réel et correspond, comme l’explique Robert Musil, à une « possibilisation » du monde, ici transposée au monde du droit16.
L’uchronie se présente comme l’une des manifestations de ce possibilisme juridique, bien qu’elle s’inscrive dans un rapport différent au temps. Comme l’Homme sans qualités, l’uchroniste est amené à envisager des équipossibilités, des éventualités qui auraient pu se produire mais ne se sont pas produites, démarche qui amène à relativiser ce qui a été pour le ramener au même niveau que ce qui aurait pu être. Mais là où l’Homme sans qualités pense, dans le présent, les possibilités qui pourraient s’ouvrir à lui, l’uchroniste, lui, interroge le passé, y compris jusque dans ses conséquences présentes voire futures. Dans sa démarche, il s’agit bien de « faire droit au possible » : s’astreindre à une expérience de pensée qui consiste à imaginer les possibles non advenus17. Si l’uchronie repose sur le principe d’une « expérience imaginaire », purement spéculative, elle se veut une méthode véritablement scientifique.
A) Le principe uchronique : une expérience de pensée
L’uchronie est d’abord une expérience mentale, une « expérience de pensée » ou « expérience imaginaire » au sens fort du terme. Loin d’un simple divertissement intellectuel, elle s’inscrit dans une tradition méthodologique rigoureuse qui, dès le début du xxe siècle, s’est imposée dans les sciences et la philosophie. Parmi ses théoriciens fondamentaux figure Ernst Mach, physicien et philosophe, dont les travaux sur La connaissance et l’erreur ont fondé une véritable épistémologie de la variation18.
1) La méthode des variations
Face à la complexité du réel – qu’il définit comme un entrelacement d’éléments interdépendants – Mach propose une méthode d’analyse scientifique lui permettant d’étudier « une multiplicité d’éléments dépendant les uns des autres de façon compliquée » : la « méthode des variations ». Cette dernière « consiste à (isoler) étudier pour chaque élément la variation qui se trouve liée à la variation de chacun des autres éléments » et donc à faire varier un paramètre à la fois pour observer les conséquences de cette modification19. Cette « méthode des variations », fondée sur la sélection, l’altération, puis l’observation des effets d’une variable, permet de comprendre les structures causales d’un système complexe. Elle repose sur trois opérations successives : la première consiste à sélectionner des variables, la seconde à modifier la variable et la troisième à observer et apprécier ce qui se produit. Soulignant que la première variation déclenche une réaction en chaîne et amène ainsi à penser les autres variations qui affecteront les autres éléments d’un ensemble complexe, Mach ajoute « qu’il importe peu que ces variations se produisent d’elles-mêmes ou que nous les introduisions volontairement ; les relations seront découvertes par l’observation et par l’expérimentation »20. Cette méthode des variations s’inscrit dans une réflexion critique sur les « concepts de cause et d’effet », que Mach juge « provisoires, incomplets et imprécis »21, et qu’il suggère de remplacer par la notion plus souple et plus dynamique de « fonction ».
Or, cette méthode des variations peut être appliquée de deux manières : par expérimentation physique, en laboratoire, ou par expérimentation mentale – c’est-à-dire en pensée22. Et c’est précisément cette dernière que Mach érige en outil fondamental de la démarche scientifique, non sans avoir souligné sa généralité d’utilisation – pour le poète, l’architecte, le savant, le marchand par exemple –, sa nécessité en tant que préalable à l’expérimentation physique23, voire sa supériorité pour « l’homme arrivé à un développement intellectuel avancé »24. Après avoir insisté sur l’importance de l’abstraction dans le développement de l’esprit scientifique et la nécessité de l’imagination25, Mach s’attarde sur l’expérimentation mentale qui est, insiste-t-il, une pure expérience pensée, un pur exercice imaginaire. Faisant le lien avec la méthode des variations qu’il a défendue auparavant, il poursuit qu’« il est nécessaire de faire varier les circonstances qui influent sur un résultat, et ce qu’il y a de mieux, c’est d’imaginer une variation continue qui passe en revue tous les cas possibles »26. Plus encore, « l’on peut même par la pensée faire décroître et finalement supprimer un ou plusieurs éléments ayant sur un fait une influence quantitative, de façon à ce que les autres circonstances agissent seules ». Loin d’être réservée aux sciences dites dures, l’expérimentation mentale irrigue l’ensemble du champ scientifique : « l’expérimentation mentale, si importante en physique l’est aussi dans toutes les branches de la science »27. Elle est même, ajoute-t-il, « nécessaire pour le développement psychique de l’individu »28, appelant ainsi à généraliser la démarche, voire à l’ériger en véritable mode de vie, ce que fera plus tard l’Homme sans qualités de Musil.
L’uchronie s’inscrit dans cette lignée. Elle consiste à faire varier un fait historique passé – souvent un détail, un moment apparemment insignifiant – ou à neutraliser un fait passé pour en observer les enchaînements alternatifs. Il s’agit donc d’un exercice de projection à partir d’un passé contrefactuel qui obéit à la logique de la méthode des variations : en modifiant une cause, on explore d’autres effets possibles. Ce faisant, l’uchronie rejoint une tradition plus large d’expériences de pensée.
2) Une expérience parmi d’autres
D’autres formes d’expérimentations mentales, plus radicales, ont été conçues pour penser non pas une simple variation dans un monde donné mais l’existence de mondes différents. Ainsi la théorie des mondes possibles envisage une infinité de mondes logiquement concevables, entiers et autonomes. Dans une perspective théologique, la théorie des mondes possibles renvoie à l’idée de l’existence de plusieurs mondes réels qui coexisteraient, tout au moins en pensée, les uns avec les autres et qui permettrait de démontrer ou, plus exactement, de penser la toute-puissance de Dieu et de résoudre le problème du mal. C’est la fameuse théorie développée par Leibniz dans sa Théodicée, qui décrit plusieurs mondes possibles à l’intérieur d’une pyramide, le meilleur des mondes se situant précisément au sommet de la pyramide. L’expérience est ici purement spéculative : si les autres mondes doivent être pensés pour justifier le monde réel, ils n’ont pas d’autre existence que logique. Cette théorie des mondes possibles s’est également développée sous une forme épistémologique, consistant à imaginer d’autres mondes, pures créations mentales permettant de penser une « pluralité épistémologique de mondes possibles »29. Elle a encore été utilisée, dans les années 1950, dans les sciences logiques et modales, afin de tester la valeur aléthique d’une proposition : cette dernière peut être vraie, fausse, contingente, impossible, etc., en fonction des mondes dans lesquels elle est pensée30.
Encore plus vaste, la théorie des mondes parallèles suppose l’existence simultanée de réalités autonomes, coexistant en parallèle sans lien de causalité entre elles avec des possibilités de passage de l’un à l’autre. Ces univers multiples relèvent d’une démarche spéculative encore plus radicale : à chaque choix, à chaque événement, naît un monde nouveau. Cette démarche a été développée en littérature notamment dans la nouvelle de Jorge Luis Borges, Le jardin aux sentiers qui bifurquent, qui décrit plusieurs mondes parallèles qui se superposent les uns aux autres, parfois se croisent. Le roman se présente lui-même comme un labyrinthe : à chaque possibilité de bifurcation est fait le choix de les emprunter tous, ce qui permet d’ouvrir sur plusieurs mondes possibles. Toutes les versions possibles de la réalité sont possibles en même temps. Elle a également été transposée au monde de la physique quantique notamment par le physicien Hugh Everett qui invite à penser plusieurs mondes physiquement possibles afin de résoudre le problème de chat de Schrödinger, avec deux univers parallèles, l’un dans lequel le chat est vivant et l’autre dans lequel il est mort31. Les variations sont multiples, univers ou mondes miroirs, univers de poches, multivers… autant de déclinaisons qui reposent sur des expériences de pensées plus ou moins larges.
Si l’uchronie appartient pleinement à cette tradition des expériences de pensée critiques, elle ne quitte pas le monde réel. Elle ne fabrique pas un autre monde, ne se transpose pas dans un autre monde, mais déplie les possibilités d’un même monde à partir d’un point de bifurcation. Elle ne remet pas en cause la factualité du monde dans lequel elle se déploie ; elle n’en suspend ni le cadre logique ni le cadre chronologique. Elle reste insérée dans la trame des événements, soumise à des exigences de crédibilité, de temporalité, de consistance. Elle ne relève donc ni de la pure fiction ni de l’affabulation. S’inscrivant dans le champ du pensable, elle se présente comme une véritable méthode scientifique.
B) La méthode uchronique : une démarche scientifique
Loin de se réduire à un pur jeu spéculatif, l’uchronie assume une ambition méthodologique forte : celle de participer, à sa manière, à la science et, dans le cas présent, à la science du droit. En cela, elle prolonge les réflexions initiées par Ernst Mach sur la valeur cognitive des expérimentations mentales en les adaptant aux disciplines qui, comme le droit ou l’histoire, ne peuvent se livrer à l’expérimentation physique.
1) L’expérimentation mentale
Dans La connaissance et l’erreur, Mach insistait déjà sur le fait que la pensée scientifique ne se résume pas à l’observation des faits : elle repose aussi, et peut-être d’abord, sur la capacité à imaginer des variations significatives, à mettre à l’épreuve des hypothèses par la seule force de la pensée. Il n’est donc pas nécessaire qu’une expérience se réalise dans le monde physique pour qu’elle produise du savoir. Plus encore, l’expérience de pensée est une méthode d’expérimentation première qui précède, voire devance, l’expérimentation physique, comme l’illustre l’exemple de Galilée pensant la chute des corps avant même de la tester physiquement32. Il n’est pas anodin de relever que cette réflexion se déploie sous la plume d’un philosophe qui est aussi physicien : en plaçant sur le même plan, et même en privilégiant l’expérimentation mentale sur l’expérimentation physique, Mach vient au secours des sciences non expérimentales, plus exactement non expérimentales physiquement33.
Cette volonté de hisser les expérimentations mentales parmi les méthodes scientifiques n’est pas sans conséquence pour les sciences qui, précisément, ne peuvent pas recourir à l’expérimentation physique. L’expérimentation mentale leur offre un substitut à l’expérimentation physique et leur confère, en retour, le statut de science. L’uchronie s’avère par exemple essentielle en histoire, comme en témoignent les réflexions épistémologiques de Max Weber. Dans ses Essais sur la théorie de la science (1906), ce dernier faisait déjà de la pensée contrefactuelle le cœur même de la recherche historique. Pour lui, mesurer la « signification historique » d’un événement, c’est précisément se demander ce qui se serait passé s’il n’avait pas eu lieu34. Parmi les faits, l’historien doit apprécier et retenir ceux dont il estime qu’ils ont eu des effets déterminants dans l’histoire, que Max Weber appelle les faits « causatifs ». Celui-ci entre donc, consciemment ou même inconsciemment, dans une démarche évaluative, une forme de pesée pour écarter les évènements qui n’ont pas pu produire les effets examinés, en retenir un certain nombre, ceux qui offrent des « possibilités objectives », et les hiérarchiser entre eux pour finalement isoler ceux qu’il estime pertinents35. Ainsi, l’expérimentation mentale est au cœur de la démarche de l’historien et confère à l’histoire son statut de véritable science.
2) Les vertus uchroniques
Méthode scientifique, la démarche uchronique présente plusieurs vertus qui contribuent à expliquer son succès et sa déclinaison dans les différentes branches du savoir. Premier avantage, son accessibilité. Comme le souligne notamment E. Mach, il s’agit d’un procédé ouvert à tous et économique, contrairement aux expérimentations physiques : « Nous avons nos représentations sous la main, plus facilement que les faits physiques eux-mêmes, et nous expérimentons avec les pensées, pour ainsi dire, à moins de frais »36. Aucune condition particulière n’est requise, aucune formation spécifique, aucun matériel, l’expérimentation mentale est ouverte à tous. Elle peut s’exercer à n’importe quel moment, dans n’importe quel lieu, à seul ou à plusieurs, qu’il s’agisse de construire à plusieurs une seule expérimentation mentale ou de construire à plusieurs différentes expérimentations mentales. En témoignent, dans le présent ouvrage, les deux variations uchroniques autour de l’arrêt Nicolo qui expérimentent des pensées totalement différentes37.
Second avantage, lié au précédent, les possibilités infinies d’expérimentations mentales qui s’ouvrent à ceux qui les pratiquent, cette « exubérance des idées » évoquée par E. Mach38. La démarche uchronique autorise toute série de variations, d’extravagances même, comme l’illustre la rencontre fortuite de Louise Michel et Louis Rolland sur un bateau imaginée par Mathieu Touzeil-Divina39. Telle est bien la méthode des « variations » dans un ensemble complexe, chère à E. Mach, qui repose sur un ensemble de choix mentaux : quelles variables choisir, c’est-à-dire quel(s) point(s) de divergence retenir ? Comment et jusqu’à quel point la ou les modifier ? Quelles suites imaginer ? Autant d’expériences de pensées qui méritent d’être envisagées dans des ensembles complexes, susceptibles de déclencher des réactions en chaîne, jusqu’à la reconversion professionnelle de Louis Rolland.
Troisième vertu, bien qu’elle puisse s’avérer ambiguë, celle de l’infaillibilité de l’expérimentation mentale, dans la mesure où la réfutabilité s’est imposée, à la suite de K. Popper comme un critère de la scientificité40. Si elle n’est pas directement abordée par E. Mach, la question demeure controversée de savoir si les expériences de pensée peuvent être, comme les expériences réelles, susceptibles d’échouer41 puisque, précisément, elles ne peuvent pas être réfutées par l’observation de certains faits. Comme le relève G. Vedel dans son expérience de rétrofiction, le raisonnement uchronique est infalsifiable au sens propre du terme : aucune opération, aucun test empirique ne permet de le démentir42. À l’inverse, l’on pourrait soutenir que l’expérimentation mentale est, précisément, et par sa nature même, entièrement falsifiable puisqu’elle peut être confrontée à un ou même des milliers de récits alternatifs qui permettent non pas de la valider ou de l’invalider mais d’en mesurer les potentialités et, surtout, d’en éprouve la cohérence.
II. L’apport du projet : les possibles du droit
Derrière ce projet collectif, une ambition : ouvrir un espace réflexif sur le droit public en mobilisant un outil peu utilisé dans la discipline, l’uchronie, pour en faire un véritable instrument de connaissance. Sans consignes rigides ni méthode imposée, les contributeurs se sont prêtés à l’exercice : imaginer des bifurcations, proposer des récits alternatifs, explorer des futurs non advenus qui constituent autant de « petites et grandes uchronies » du droit public. Petites, parce qu’elles naissent parfois d’un événement anecdotique et peuvent apparaitre comme un genre mineur ; grandes par les cadres qu’elles bousculent, les lignes qu’elles déplacent, les perspectives qu’elles ouvrent. Les contributions ici rassemblées offrent un regard autre sur le droit et la science du droit ; elles invitent également à réfléchir sur la façon de faire l’uchronie, qu’il s’agisse de la penser ou de la présenter.
A) L’apport au genre uchronique : « uchroniser »
Ce néologisme renvoie tant à la façon dont l’uchronie se construit, se façonne, ce que l’on pourrait appeler l’art uchronique, et qu’à la façon dont elle se présente, ce que l’on pourrait appeler l’œuvre uchronique : qu’est-ce qu’uchroniser ? Interrogation suscitée et alimentée par les contributions réunies dans le présent ouvrage.
1) Méthodologie uchronique
Si aucune méthode stricte n’a été imposée, les contributions témoignent, de manière implicite mais convergente, d’un socle commun de précautions intellectuelles, qui pourraient constituer les linéaments d’une méthodologie de l’uchronie juridique43, permettant de préserver non seulement la singularité de la démarche uchronique mais aussi sa prétention à la scientificité, souvent contestée. Ces précautions méthodologiques concernent tant la façon de penser l’uchronie que la façon de l’exposer.
Dans la construction de l’uchronie, s’impose d’abord un principe de réalité : il s’agit d’accréditer non seulement la possibilité mais encore la plausibilité, la probabilité d’une histoire alternative44. Ce principe commande un certain rapport aux faits et une proximité avec l’histoire telle qu’elle s’est réellement passée. Les faits ne sont pas remis en cause jusqu’au point de divergence retenu par l’auteur ; ne sont modifiés que les faits strictement nécessaires au déclenchement puis au déroulement de l’uchronie qui, souvent, se trouve elle-même émaillée de nombreuses références à d’autres faits. Deuxième précaution, la crédibilité du récit : la divergence ainsi que les variations qui en découlent doivent permettre de l’admettre pour vrai, d’où la nécessité de respecter un cadre, ici juridique, politique, conceptuel, familier et partagé avec le lecteur45. La troisième renvoie à la cohérence du récit : les règles de temporalité, de spacialité ou même de logique formelle sont globalement respectées, permettant d’inscrire les variations de rester dans l’ordre du pensable46.
Ces précautions de construction s’accompagnent aussi de précautions dans l’exposition de l’uchronie, qui s’inspirent, pour l’essentiel d’un principe de transparence. L’uchronie ne prétend pas se confondre avec l’histoire : elle revendique son artifice. Elle peut annoncer, par exemple, la démarche, et même, s’il n’était extrêmement sérieux, le « jeu du faire semblant », comme en témoigne le titre du présent projet. Certaines contributions indiquent explicitement au lecteur qu’il s’agit d’un exercice47 ; d’autres le font de façon plus implicite, comme une sorte de connivence entre le lecteur et l’auteur48. L’exigence de transparence concerne également les points de divergence, souvent signalés, parfois commentés, permettant de situer l’entrée dans l’uchronie49. Certains auteurs vont jusqu’à expliciter, par exemple en notes de bas de page, les effets d’altération produits par la bifurcation choisie, afin de ne pas tromper le lecteur50. En ce sens, l’uchronie ne ment pas. Elle fait semblant, mais elle le dit.
2) Typologie uchronique
Les contributions réunies ici donnent à voir l’étendue du champ uchronique, tant dans le choix des points de divergence que dans l’ampleur des scénarios déployés.
Le choix du point de divergence est très variable : une guerre évitée, une rencontre manquée, un commissaire du Gouvernement retardé, un article non voté, une décision juridictionnelle contestée, une codification empêchée… L’uchronie ne valorise pas nécessairement de « grands évènements » ; au contraire, elle tend à favoriser, comme pour mieux relativiser l’importance des « grands », les « petits » évènements qui sont de l’ordre accidentel ou même de l’anecdotique. Reste que la plupart de ces points de déviation renvoient à des évènements considérés comme déterminants pour l’évolution du droit dans son ensemble, comme en témoigne le doublé sur l’arrêt Nicolo. À partir de ces points de divergence se déploient plusieurs niveaux de variations. Certaines uchronies se rapprochent de la reconstitution historique, s’attachant à rester très proches des faits connus, par exemple, celle racontée par Nathalie Rubio et Romain Le Bœuf ; d’autres s’en écartent plus franchement, comme la carrière de mentaliste de Louis Rolland ; d’autres, encore rejoignent l’histoire réelle par des effets de miroir, soit qu’elle l’annonce, soit qu’elle la récupère, par exemple le clin d’œil à la QPC dans l’échange entre Marceau Long et Nicole Questiaux proposé par Baptiste Bonnet51 ou encore l’hypothèse de la grippe espagnole en référence à l’épidémie Covid imaginée par Nathalie Rubio et Romain Le Bœuf52.
Cette richesse narrative permet de proposer une typologie des figures uchroniques : des uchronies personnelles, centrées sur une figure – juriste, acteur politique, conseiller d’État comme dans la proposition de Mathieu Touzeil Divina53 ; des uchronies factuelles, à partir d’un événement déterminé, qu’il s’agisse d’une guerre, d’un discours, d’une réforme ; des uchronies normatives, qui reposent sur une modification du droit écrit ou jurisprudentiel, typiquement l’arrêt Arrighi imaginé par Julien Bonnet ; des uchronies conceptuelles, que l’on pourrait rapprocher des concepts fictifs de Wittgenstein54 à l’instar du concept revisité de parlementarisme rationalisé ; académiques, même, lorsqu’elles recomposent le champ scientifique, en imaginant des travaux de recherche, ouvrages, colloques qui n’ont pas eu lieu, comme l’illustrent l’uchronie présentée par Xavier Magnon ou celle de Baptiste Bonnet55.
B) L’apport au droit : éclairer autrement le droit
Le recours à l’uchronie transforme aussi la manière de penser et de faire du droit et renouvelle tant la science que l’épistémologie juridiques.
1) La manière de penser le droit
La démarche uchronique est d’abord un outil de connaissance qui amène à reconsidérer le traditionnel discours sur le droit. Elle permet, en premier lieu, de combattre le déterminisme et de réhabiliter la contingence. Cet objectif, très présent chez E. Mach qui entend remédier à ce qu’il appelle « l’illusion déterministe », est souligné par de nombreux contributeurs56. L’histoire du droit public n’est ni nécessaire ni déterminée : en modifiant le passé, elle nous rappelle que le présent juridique n’a rien de nécessaire. Elle rappelle également l’importance de la contingence : les évènements, les faits, les normes ne sont pas le fruit de la nécessité et auraient pu tout aussi bien ne pas être. L’uchronie invite également à relativiser la causalité et à lutter contre l’illusion mécanique, selon laquelle telle cause entraîne nécessairement tel effet. Telle est l’ambition d’E. Mach, à savoir proposer une réflexion sur les « concepts de cause et d’effet », qui sont des « concepts provisoires, incomplets et imprécis »57. En révélant que les enchaînements que nous croyons logiques sont souvent rétrospectifs, reconstruits a posteriori, l’uchronie invite à mesurer et à relativiser la causalité. Un évènement banal peut produire des effets considérables58 ; à l’inverse, un fait important peut changer sans, qu’au final, rien ne change59.
En ce sens, elle est une invitation à reconsidérer les faits et à retenir une logique non pas explicative mais évaluative ou appréciative60.
L’uchronie permet, en second lieu, de reconsidérer la façon de raconter le droit public. Elle en bouscule la linéarité. La tendance des juristes est grande à présenter comme mécaniques, plus encore inéluctables, les grandes étapes de la construction du droit public. De ce point de vue, les uchronies rassemblées apparaissent comme autant d’accrocs et donc de portes ouvertes vers une autre, plus encore vers d’autres histoires du droit public. Dans le même temps, la démarche uchronique révèle la fragilité du passé. Si la tentation est souvent grande de relire et d’interpréter le passé à la lumière du présent juridique, l’uchronie montre, au contraire, que le passé, tant qu’il n’est pas passé, est un futur, comme le rappelle Paul Ricoeur. Elle est, à cet égard, un récit des possibles non advenus61. La démarche uchronique permet encore de remettre en cause le finalisme ou la lecture souvent téléologique du droit, qui le raconte essentiellement sous la forme d’un progrès, par exemple l’avènement de la Ve République que l’on tend à présenter comme une synthèse ou comme un aboutissement. Plus encore, elle permet de reconsidérer la circularité du droit public, c’est-à-dire la tendance à expliquer le droit de façon autocentrée, fermée sur elle-même. De ce point de vue, l’uchronie invite à considérer d’autres paramètres, un ensemble de fonctions selon Mach, pour éclairer l’histoire du droit public, par exemple des phénomènes économiques62.
2) La manière de faire du droit
Le recours à l’uchronie permet encore de renouveler l’épistémologie juridique, en ce qu’elle enrichit la façon de faire la science du droit. Premier apport, sa vertu imaginative. L’uchronie invite à un décentrement63, voire un « pas de côté »64 : dans l’un comme dans l’autre cas, il s’agit de s’éloigner d’un monde commun pour y revenir ensuite. L’expérimentation est aussi bien celle de « l’écart »65 entre le monde connu et le monde imaginé que celle du retour, ce double mouvement permettant de s’affranchir de la ligne tracée pour mieux y revenir ou y revenir différemment car l’uchronie peut s’avérer une expérience imaginaire dont on ne sort pas indemne66.
Deuxième apport, sa vertu heuristique. Elle est une méthode de connaissance qui permet d’échapper au réel, plus exactement pour ensuite mieux le regarder. Les scénarios alternatifs envisagés par les différents auteurs permettent de voir différemment, de façon oblique presque, le présent et de mieux évaluer, à partir de l’écart uchronique, les maux de la Ve République, les limites de la Ve République ou encore les velléités du Conseil de l’Europe pour ne citer que quelques-unes des thématiques abordées dans le présent ouvrage.
Troisième apport, sa vertu critique, déjà au cœur de la réflexion de C. Renouvier. Si elles ne se veulent pas prescriptives, nombreuses sont les uchronies qui comportent, tout au moins implicitement, une appréciation sur le réel et présentent, en creux, une réflexion sur les façons de changer, d’améliorer ce qui est67. Certaines d’entre elles peuvent être analysées, à rebours, comme autant de regrets de ce qui a été : d’autres alertent, à partir d’une bifurcation, sur ce qui pourrait être, tout particulièrement lorsqu’elles se transforment en dystopie68. Elles sont donc, sous cet angle, autant de manières de parler de ce qui est.
Ce projet collectif se veut le point de départ d’un chantier plus vaste, à la fois méthodologique, épistémologique et critique. En proposant d’introduire l’uchronie dans l’univers juridique, il s’agit d’explorer une manière nouvelle – et peut-être plus radicale – de penser le droit à partir de ses possibilités et de ses déviations. Si les expériences réunies ici ont été menées avec une liberté assumée, elles suggèrent, en creux, les contours d’une méthodologie uchronique. Il serait possible, à terme, d’en fixer les éléments constitutifs : nature du point de divergence, conditions de plausibilité, ancrage historique, cohérence logique, régime d’exposition, etc. L’enjeu ne serait pas d’enfermer la démarche dans un formalisme contraignant mais de lui donner une légitimité scientifique, à la hauteur de son ambition. Car le présent projet entend, précisément, prendre l’uchronie au sérieux et la reconnaître comme un outil de la science du droit, en ce qu’elle permet de mieux connaître, décrire, évaluer le droit.
Penser le droit, c’est penser ce qu’il aurait pu être non pour céder à la rêverie, mais pour mieux exercer un jugement à la fois critique et réflexif sur l’état du droit existant, la façon de le construire et la façon de le présenter. Sans doute pourrait‑on également réfléchir aux usages pédagogiques de l’uchronie, notamment dans la formation des juristes, comme exercice de créativité, comme espace de liberté, comme entreprise de distanciation… et renouer avec l’idée que le droit peut être « la plus puissante des écoles de l’imagination ».
Appliquée dans ce dossier au droit public, l’entreprise mériterait, à l’évidence, d’être déclinée dans toutes les branches du droit, droit civil, droit pénal, droit administratif, droit international public, etc., mais aussi dans d’autres disciplines, par exemple en histoire du droit ou encore en science politique. L’entreprise pourrait également entre généralisée, systématisée même, dans la façon de raconter le droit – telle est la dimension narrative de l’uchronie – et d’inventer le droit – la dimension spéculative – afin de mieux en déployer et mesurer les potentialités. Aussi cette première publication peut être considérée comme un « appel uchronique », susceptible d’être complété par d’autres contributions : un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent expérimenter une autre manière de penser, un esprit de liberté et de créativité et, aussi, une autre forme de lucidité.
1 À ce sujet, voir notamment R.-B. Henriet, L’Histoire revisitée. Panorama de l’Uchronie sous toute ses formes, Paris, Encrage / Les Belles lettres, 2004, 415 p., p. 79 et s.
2 Pour une présentation rapide de l’histoire de l’uchronie, voir L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), L’opportune, Pubp, 2022, p. 12.
3 Ch. Renouvier, Uchronie (L’Utopie dans l’histoire), Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, Paris, Félix Alcan, 1901. Cet ouvrage ne porte d’ailleurs pas le nom de son auteur, qui se contente d’en signer la postface.
4 Pour reprendre l’expression de C. Renouvier, Uchronie (L’Utopie dans l’histoire), préc., p. 411 – également appelés « points de divergence » ou de « bifurcation » ou encore « évènements fondateurs ».
5 C. Renouvier, op. cit. p. 410.
6 C. Renouvier, op. cit. p. 409.
7 C. Renouvier, op. cit. p. 411.
8 C. Renouvier, op. cit. p. 412.
9 C. Renouvier, op. cit., préface p. XV.
10 R. Musil, L’homme sans qualités, Points, t. I.
11 En France, voir notamment U. Bellagamba, « Temps historique et uchronies », in Le Temps – Dixièmes Journées interdisciplinaires Sciences & Fictions de Peyresq, 2016, Peyresq, 470 p. ; voir également L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 34 et s.
12 La cliométrie, citée par Q. Deluermoz et P. Singaravélou, « Explorer le champ des possibles. Approches contrefactuelles et futurs non advenus en histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 59-3, 2022, p. 73.
13 G. Vedel, « Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », RFDC, 1984, p. 719‑751 ; voir également G. Vedel « Post face à un exercice de rétrofiction », Droit, institutions et système politique. Mélanges en hommage à Maurice Duverger, in D. Colas et M. Emeri (dir.), Paris, PUF, 1988, p. 217‑226. Voir également pour un exercice proche, D. Labetoulle, En l’état actuel du droit public français ». Retour (nostalgique ?) sur l’arrêt Arrighi », in Les racines du Droit et des contentieux. Mélanges offerts en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre et J. Benetti, « Et si le Sénat n’existait pas ? », Pouvoirs, n° 159, 2016, p. 5.
14 Pour une formule proche, « l’hypothèse des possibles », voir L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 12.
15 À ce sujet, voir notamment P. Fasula, Musil, Wittgenstein : l’Homme du possible, Thèse de philosophie, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2013 ; J.-P. Cometti, Robert Musil ou l’alternative romanesque, Paris, PUF, 1985, 308 p.
16 Terme emprunté à L. Dahan-Gaida, « L’expérience de pensée comme méthode de variation – De Mach à Musil », Épistémocritique, n° 22, en ligne.
17 Sur un terme proche, voir Q. Deluermoz et P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016.
18 À ce sujet, voir notamment F.-X. Demoures, E. Monnet, « Le monde à l’épreuve de l’imagination. Sur « l’expérimentation mentale », Tracés, 2005, n° 9, p. 37-51. Faisant le rapprochement avec les travaux de Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865, contemporain de C. Renouvier, voir L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 30 et s.
19 E. Mach, op. cit., p. 28.
20 Ibid.
21 E. Mach, op. cit., p. 274-275.
22 E. Mach, op. cit., p. 292 : « Cela ne change rien à l’essence de la méthode des variations que les circonstances concomitantes, qui déterminent les phénomènes, soient trouvées par une modification physique ou par une expérimentation mentale avec des pensées suffisamment adaptées ».
23 E. Mach, op. cit., p. 201.
24 E. Mach, op. cit., p. 197-198 : « en dehors de l’expérimentation physique, l’homme arrivé à un développement intellectuel avancé recourt souvent à l’expérimentation mentale. Ceux qui font des projets, ceux qui bâtissent des châteaux en Espagne, romanciers et poètes qui se laissent aller à des utopies sociales ou techniques, font de l’expérimentation mentale ; d’ailleurs, le marchant sérieux, l’inventeur réfléchi et le savant en font aussi… Mais les premières combinent dans leur imagination des circonstances qui ne se rencontreront pas dans la réalité, ou bien ils se représentent ces circonstances comme suivies des conséquences qui n’ont pas de lien avec elles, tandis que le marchant, l’inventeur et le savant ont comme représentations de bonnes images des faits, et restent dans leurs pensées, très près de la réalité ».
25 E. Mach, op. cit., p. 165 : « Celui qui connaît l’histoire du développement de la science, ou qui a lui-même pris part à la recherche, ne peut douter que le travail scientifique demande une imagination très forte ».
26 E. Mach, op. cit., p. 201.
27 E. Mach, op. cit., p. 209.
28 E. Mach, op. cit., p. 208.
29 À ce sujet, voir notamment J. Schmutz, « Qui a inventé les mondes possibles ? », Cahiers de philosophie de l’université de Caen, 2005, n° 42, p. 9-45.
30 Voir notamment L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 34 et s.
31 A. Barrau, « Peut-on tester les univers parallèles ? », Le Journal, CNRS, Billet.
32 Ainsi, Mach, s’appuyant sur l’exemple des travaux de Galilée, montre que l’expérimentation mentale est même « une condition préalable nécessaire de l’expérimentation physique », op. cit., p. 201.
33 Pour de plus amples développements, voir M. Arcangeli, « Expérience de pensée (A) », dans M. Kristanek (dir.), L’encyclopédie philosophique, 2017 ; voir également F. Demoures, É. Monnet, « Le monde à l’épreuve de l’imagination. Sur « l’expérimentation mentale », préc.
34 Q. Deluermoz et P. Singaravélou, « Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus », préc., p. 62 et 73.
35 À ce sujet, voir notamment J.-M. Fleury, L’histoire, les causes et les possibles, Paris, Collège de France, 2017, étude 1, « Max Weber et l’histoire contrefactuelle ».
36 E. Mach, op. cit., p. 198.
37 B. Bonnet, « Le Droit administratif français sans l’arrêt Nicolo ou Paris sans la tour Eiffel » et R. de Bellecize, « Automne 1989 : Nicolo, le Conseil d’État et l’air du temps » dans ce dossier.
38 E. Mach, op. cit., p. 101.
39 M. Touzeil-Divina, « Et si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger & pour la sauvegarde du service public ? » dans ce dossier.
40 K. Popper, La connaissance objective, trad. J.-J. Rosat, Champs, Essais, 1998, 578 p.
41 À ce sujet, voir M. Arcangeli, « Expérience de pensée (A) », préc.
42 G. Vedel, « Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », préc., p. 747.
43 Évoquant « quelques règles de prudence méthodologique » qu’il énumère : être aussi près que possible des choses telles qu’elles ont été (principe de l’écart raisonnable) ; imaginer le comportement des acteurs aussi proches de ce qu’ils pourraient être (degré de vraisemblance) ; s’interdire d’interroger les acteurs sur ce que les comportements auraient pu être (principe d’extériorité), voir G. Vedel, « Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », préc., p. 720 et 747 – règles de prudence reprises par exemple par C. Geynet-Dussauze, « S’il te plaît… Dessine-moi la Ve République sans article 49, alinéa 3 », ce dossier (« les comportements des acteurs seront supposés en fonction de ce qu’ils furent réellement dans des circonstances similaires » ; « La présente uchronie n’a donc pas vocation à envisager des changements du cours de la vie politique ») ou encore J. Bonnet, « Sans Arrighi », ce dossier (« Première spécificité, l’uchronie d’une prise de décision juridictionnelle suppose de prendre en compte l’ensemble des acteurs ayant participé à la prise de décision »).
44 Comme le dit Julien Bonnet, op. cit., « Raisonner par uchronie autour de cette jurisprudence ne consiste donc pas à envisager un futur fantaisiste et totalement illusoire » ; « Comme toute uchronie, celle concernant “Arrighi” doit se mener avec humilité et précaution ».
45 Évoquant des « lois implicites » notamment celle selon laquelle il convient de maintenir « des éléments référentiels suffisamment précis pour que ces mêmes lecteurs puissent apprécier la cohérence avec le monde connu et l’écart que l’intrigue lui aura fait subir », voir L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 21.
46 Allant jusqu’à un parfait décalage temporel de l’histoire du droit de l’Union européenne avec exactement cent ans de différence dans l’uchronie présentée par R. Le Bœuf, N. Rubio, « Si Victor Hugo avait été entendu… – Fragments d’une histoire européenne », ce dossier.
47 Ainsi B. Bonnet qui indique clairement « Voici donc, de manière très romancée et fictionnelle, l’histoire relue et réinventée » (Le Droit administratif français sans l’arrêt Nicolo ou Paris sans la tour Eiffel, ce dossier) ; P.-Y. Gahdoun, « Commençons la « vraie histoire » pour mieux s’en démarquer ensuite (« Si la crise de 1929 n’avait pas eu lieu… » ce dossier) ; J. Bonnet exposant « Les scénarios d’un avenir qui n’a pas eu lieu » (« Sans Arrighi », ce dossier).
48 Voir par exemple C. Geynet-Dussauze, « S’il te plaît… Dessine-moi la Ve République sans article 49, alinéa 3 », ce dossier.
49 Voir notamment R. Le Bœuf et N. Rubio, op. cit., ce dossier : « Cette appropriation politique et diplomatique du discours prononcé par Victor Hugo n’est pas historique et constitue le point de basculement sur lequel est bâtie cette uchronie ».
50 Voir par exemple la précaution méthodologique annoncée dès les premières notes de bas de page par R. Le Bœuf et N. Rubio, op. cit. : « Les faits servant de trame à la présente contribution sont pour l’essentiel authentiques. Les altérations inhérentes à l’exercice uchronique sont signalées comme telles en notes de bas de page toutes les fois que leur caractère imaginaire n’est pas évident ».
51 B. Bonnet, « Le Droit administratif français sans l’arrêt Nicolo ou Paris sans la Tour Eiffel », ce dossier.
52 R. Le Bœuf, N. Rubio, « Si Victor Hugo avait été entendu… – Fragments d’une histoire européenne », ce dossier.
53 M. Touzeil Divina, « Et si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger & pour la sauvegarde du service public ? », dans ce dossier.
54 Rapprochement fait par L. Dahan-Gaida, « L’expérience de pensée comme méthode de variation – De Mach à Musil », préc.
55 X. Magnon, « Commentaire de l’article du Doyen Louis Favoreu « Le Conseil constitutionnel, 3e chambre du Parlement, ultime raffinement du parlementarisme rationalisé » et B. Bonnet, « Le droit administratif français sans l’arrêt Nicolo ou Paris sans la Tour Eiffel », dans ce dossier ; pour une démarche inverse, voir R. Le Bœuf, N. Rubio, « Si Victor Hugo avait été entendu… – Fragments d’une histoire européenne », dans ce dossier qui indiquent, au contraire, que « Les notes de bas de page se rapportent à la chronologie réelle et ne comportent aucun élément fictif ».
56 En ce sens, voir A. Rouyère qui insiste : « Plus qu’une fiction, l’uchronie est un précieux antidote au fatalisme » « CE Ass., 9 avril 1993, D, n° 138653, Rec. 110, concl. Hubert Legal. La possibilité d’un coup d’audace ? », ce dossier) ; J. Bonnet qui relève que « Refaire le chemin en envisageant un autre avenir recèle donc une force explicative incontestable, grâce à la remise en cause du fait accompli, défini par Charles Renouvier, pionnier de l’uchronie, comme l’illusion de « la nécessité préalable qu’il y aurait eu à ce que le fait maintenant accompli fût, entre tous les autres imaginables, le seul qui pût réellement s’accomplir » (« Sans Arrighi », ce dossier) ; voir également G. Vedel, « Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », préc., p. 747 soulignant que l’uchronie permet de prendre conscience qu’en réalité toutes les hypothèses sont possibles et que donc tout aurait pu se produire.
57 E. Mach, op. cit., p. 274 et 275.
58 Comme le malheureux accident domestique dans l’uchronie de B. Bonnet, « Le Droit administratif français sans l’arrêt Nicolo ou Paris sans la tour Eiffel », dans ce dossier (« Le jour du vote un conseiller d’État plutôt favorable au revirement et proche de Marceau Long dût malheureusement accompagner son fils à l’hôpital pour un bête accident domestique, cette absence fut d’autant plus conséquente que les arguments du maintien de la jurisprudence des Semoules l’emportèrent à une voix près (nous sommes évidemment dans la fiction, dans l’uchronie, mais les indiscrétions laissent à penser que dans la réalité, le revirement Nicolo aurait été arraché dans les mêmes proportions…) ».
59 En ce sens, voir L. Janicot, « Le code général de la propriété des personnes publiques », dans ce dossier, pour laquelle l’histoire du droit des biens publics n’aurait pas été si différente que cela (« il nous semble, en effet, possible de dire que l’histoire du droit des biens publics n’aurait pas été si différente que cela, “le champ des possibles” n’étant pas aussi large qu’on le pensait ») ou encore C. Geynet‑Dussauze qui relève que « l’esquisse uchronique ne s’éloigne donc guère de l’actuelle Ve République : le Gouvernement dispose des moyens nécessaires à l’aboutissement de son programme législatif alors qu’on présente souvent l’art 49.3 comme responsable de tous les maux de la Ve République » (« S’il te plaît… Dessine-moi la Ve République sans article 49, alinéa 3 », ce dossier.
60 Soulignant que l’uchronie valorise un principe non pas explicatif mais évaluatif ou appréciatif, voir L. Dahan-Gaida, « L’expérience de pensée comme méthode de variation – De Mach à Musil », préc, renvoyant notamment à S. Chauvier, Le sens du possible, Paris, Vrin, 2010.
61 À ce sujet, voir notamment Q. Deluermoz et P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, préc., p. 87.
62 Ce que relève notamment P.-Y. Gahdoun, « Si la crise de 1929 n’avait pas eu lieu… », ce dossier (la tendance est grande d’expliquer de façon autocentrée c’est-à-dire fermée sur elle-même l’histoire du droit public, par exemple la séparation des pouvoirs qui serait responsable de l’échec de la Constitution de 1793. On peut en revanche utiliser cette uchronie pour éclairer un phénomène, qui – lui – paraît suffisamment solide : il se trouve que l’économie a joué – et joue encore – sur le droit constitutionnel une influence considérable, bien plus en tout cas qu’on ne le dit en France lorsque l’on présente la succession des différents régimes dans l’histoire politique de notre pays.
63 Terme utilisé par Q. Deluermoz et P. Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, préc., p. 91.
64 Voir L. Bazin, L’uchronie. Histoire(s) alternative(s), préc., p. 11.
65 N. Murzilli, La fiction littéraire comme expérience de pensée, Thèse, 2009, Aix-Marseille Université ; « De l’usage des mondes possibles en théorie de la fiction », Klesis – Revue philosophique, 2012, p. 326‑351, not. p. 339.
66 En témoigne l’uchronie imaginée par L. Burgorgue-Larsen, « Quand la France refuse de ratifier la Convention européenne des droits de l’homme » dans ce dossier transformant la France en un régime autoritaire dirigé par V. Poutine.
67 Comme le souligne J.-E. Gicquel, « Et si le Parlement de la Ve République avait été monocaméral ? » dans ce dossier « Si nul ne peut revenir sur le passé, on peut toujours façonner l’avenir… ».
68 Voir par exemple P. Blachèr, « Moi, présidente de la République », ce dossier.
Ariane Vidal-Naquet, « Avant-propos. Le droit public à l’épreuve de l’imagination », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4598.