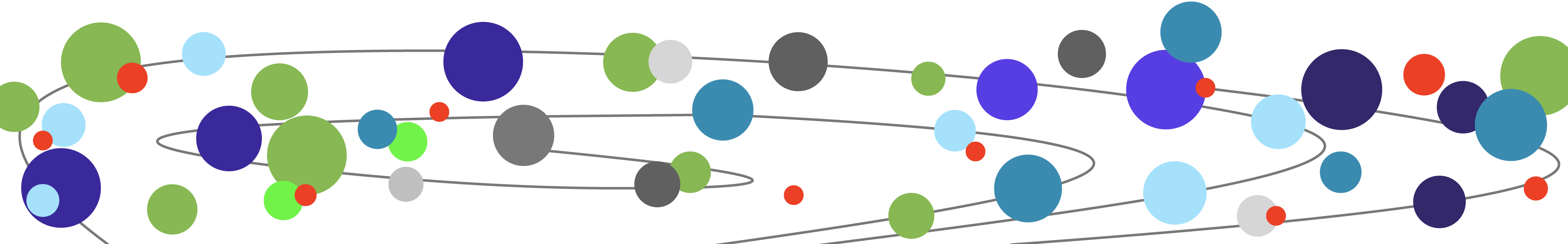Ramu de Bellescize
Université de Lille
Que s’est-il passé au Conseil d’État, le vendredi 20 octobre 1989 ? Deux hommes ont déjeuné, à la buvette du Conseil d’État. Ils ont discuté des nouvelles : un séisme en Californie et un discours de Jacques Delors sur l’Europe, qui prenait le contre-pied d’un discours de Margaret Thatcher prononcé quelques jours plus tôt. Puis ils se sont rendus à une séance de jugement. Vers 18 heures, l’un des deux hommes est sorti du Conseil d’État. Et il a marché en direction de l’Assemblée nationale. En se demandant si le Conseil d’État avait pris la bonne décision.
What happened at the Council of State on Friday, October 20, 1989? Two men had lunch together in the Council of State’s refreshment bar. They discussed the news: an earthquake in California and a speech by Jacques Delors on Europe, which contradicted a speech by Margaret Thatcher given a few days earlier. Then they went to a trial session. Around 6 p.m., one of the two men left the Council of State. And he walked toward the National Assembly, wondering if the Council of State had made the right decision.
La buvette du Conseil d’État n’avait rien du restaurant gastronomique. Elle présentait cependant l’avantage de permettre de déjeuner sans sortir du Conseil d’État. De gagner un peu de temps, quand il venait à manquer. Pierre Lebon regarda le menu : pas de poisson alors qu’on était vendredi. Il commanda une bière, une quiche et une banane.
Avec ça, se dit-il, je ne dormirai pas trop durant la séance de jugement de l’après-midi. Il s’installa à une table. Il n’y avait pas de chaise mais les tables de bar, rondes, étaient surélevées. Cela évitait que les consommateurs y passent trop de temps. La quiche était bonne : la pâte brisée avait été préparée correctement, pour une fois, et l’oignon était bien cuit. Par contre, la bière n’était pas assez fraîche.
Quelqu’un avait laissé Le Monde sur la table. Il le feuilleta. Roger Bambuck, secrétaire d’État chargé de la jeunesse et des sports, avait répondu à une question orale d’un député communiste à l’Assemblée nationale sur l’opportunité de construire un nouveau stade. Selon Bambuck, « Le projet de grand stade en Île-de-France correspondait à une nécessité ». Au moins une bonne nouvelle pensa-t-il. Les passionnés de foot vont avoir un nouveau terrain de jeu. Il tourna la page. Le quotidien rendait compte d’un message de François Mitterrand à George Bush : « Je tiens à vous exprimer mes sentiments de tristesse et de solidarité à l’occasion du terrible tremblement de terre qui vient de frapper San Francisco et sa région. Je vous prie de vous faire l’interprète de mes condoléances personnelles auprès des familles des victimes du séisme ainsi que des autorités de l’État de Californie et des villes touchées par ce drame. » Le séisme avait provoqué la mort de 63 personnes, blessé 3 700 autres et laissé entre 3 000 et 12 000 personnes sans abri.
Le brouhaha commençait à monter dans la buvette. Les membres du Conseil d’État et le personnel arrivaient pour déjeuner.
Un dernier article retint son attention : « Un an après le “discours de Bruges” de Madame Thatcher, Monsieur Jacques Delors réclame un nouvel engagement politique ».
Jacques Delors avait donné, le 17 octobre, un discours à Bruges, dans lequel il prenait le contre-pied de Margaret Thatcher qui, un an plus tôt, dans la même enceinte, à Bruges, s’était élevée avec éclat contre la dérive supranationale que connaissait, selon elle, la construction européenne. Delors réclamait le renforcement de « certains traits fédéralistes » de la Communauté. Il le faisait avec le souci, selon le compte rendu du Monde, de ménager ceux qui, en particulier à Londres, pouvaient redouter un « saut qualitatif » demandé par les partisans de l’intégration. Selon les propres termes de Delors, il n’y avait pas de « complot contre la nation », la Commission se refusant « à provoquer des engrenages insidieux qui conduiraient les États membres là où ils ne voulaient pas aller ». La construction européenne, concluait Delors, avait besoin d’un « nouveau choc politique ». Pour provoquer ce choc, un nouveau traité européen était nécessaire.
François Sinar, un collègue avec lequel on pouvait discuter, posa son plateau sur la table : une tranche de saucisson brioché, une île flottante et un demi.
« J’ai bien peur, dit-il en soupirant, que cet après-midi ce soit un peu long. Ça m’embête, car les vendredis j’emmène mon fils au judo. Ce soir c’est important d’arriver à l’heure : il y a une cérémonie de remise de ceintures. Il vient d’avoir sa ceinture jaune, je voudrais pas rater ça.
— J’ai oublié, répondit Pierre Lebon. Cet après-midi on parle de quoi ? Enfin, on juge quoi ?
— Le requérant, Raoul Georges Nicolo, conteste la régularité des opérations électorales relatives à la désignation des membres de cette curieuse assemblée que l’on appelle l’Assemblée des communautés européennes. Selon lui, les citoyens des départements français d’outre-mer ne devraient pas prendre part au vote. Ils ne résident pas sur le territoire européen.
— Mais enfin, qu’est-ce que ça peut bien lui foutre qu’ils votent ou qu’ils ne votent pas ? Y’en a vraiment qui savent pas comment s’occuper. D’ailleurs, sur le fond, je ne vois pas pourquoi les habitants de Nouvelle-Calédonie, ou ceux de Kerguelen ne voteraient pas. Encore un hurluberlu qui s’imagine que la France se limite à l’hexagone. La France n’est pas un hexagone, mais un archipel, dit-il en haussant la voix. Un archipel. Nous ne sommes pas la Suisse ou l’Afghanistan. D’ailleurs, si ça ce n’est pas un signe du diable. Si je résume, selon Nicolo, pour se mettre en conformité avec le droit européen, la France devrait distinguer entre ses ressortissants hexagonaux et ceux d’outre-mer. Pour l’Europe, ce serait déjà une belle victoire que de parvenir à couper la France en deux, comme si nos territoires d’outre-mer n’étaient pas la France qui se prolonge dans le reste du monde.
— T’as bien raison, répondit François Sinar. Je suis d’accord avec toi. Seulement tu sais bien que la France n’a plus très bonne presse. Il y a ceux qui voudraient la réduire à l’hexagone, comme tu le dis justement, et ceux qui voudraient qu’elle devienne une région de l’Union européenne.
— Et ceux qui voudraient qu’elle disparaisse complètement.
— Au fait, à propos de la séance de cet aprèm, il va y avoir un point de droit à trancher.
— Encore un !
— Oui, mais celui que nous risquons de trancher est plus important que d’habitude. »
François Sinar acheva son saucisson brioché. Il rapprocha l’île flottante.
« Il se pourrait bien, dans cette affaire, que nous ayons à examiner la conformité de la loi française, celle qui détermine la composition du corps électoral pour l’élection de cette pseudo-assemblée européenne, au traité de Rome.
— Mais enfin, ce n’est pas notre rôle de vérifier la conformité de la loi avec un traité international. Tu te rends compte. Et si on examine la loi et qu’elle n’est pas conforme au traité, on fait quoi ? On ne va quand même pas la censurer. Et si la loi a été adoptée après le traité, ça signifie que l’on ne peut plus revenir sur les traités ? Ou plutôt, que l’on ne peut plus revenir sur une interprétation des traités. »
Il commençait à s’énerver.
« Mais c’est impossible. On n’a pas le droit de faire ça.
— T’as pas entièrement tort, répondit calmement François Sinar. Tu n’as certainement pas tort sur le fond. C’est vrai qu’on ne devrait pas se permettre d’écarter une loi parce qu’elle est contraire à un traité. Encore plus s’il s’agit d’une loi postérieure au traité, parce qu’elle montre clairement la volonté du parlement de s’opposer à une interprétation des traités. »
Il hésita un instant.
« Tu sais, j’ai été député dit-il avec un parfum de nostalgie dans la voix. Ça fait longtemps qu’on ne vote plus grand-chose, primauté du droit européen ou non. On représente, un peu, mais pas trop quand même. On ne sait d’ailleurs même pas toujours très bien qui. En principe la France. En principe, j’étais député de la nation. Au jour le jour, plutôt de ma circonscription. Et dans les faits, un peu trop souvent, du parti politique auquel j’appartenais. »
Il but une gorgée de bière.
« En fait, être député c’est un peu tout ça mélangé. C’est un métier que j’ai aimé. Surtout les campagnes, les campagnes électorales : on se balade partout dans la circonscription, on se fait insulter, embrasser, toucher. Assez curieusement, on sent si ça va marcher ou non, si on va être élu ou si ce sera une déroute. Mais je peux te rassurer, la primauté d’un traité européen, sur une loi, qu’elle soit postérieure au traité ou non, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Au moins, on sera dans le sens de l’histoire. Il y a des moments où je me demande si notre métier, c’est pas ça : faire des concessions à l’air du temps. Tout compte fait, ce que l’on appelle la volonté générale, c’est peut-être ça : l’air du temps. Rien de plus, rien de moins. C’est déjà pas mal remarque. Nos lois, expression de la volonté générale, selon l’expression consacrée, sont en fait l’expression de l’air du temps. C’est la même chose pour notre jurisprudence. Seulement, tu imagines les tribunaux rendre des décisions en se fondant sur l’air du temps. L’intérêt général, ça a quand même plus de gueule. »
L’île flottante avait l’air excellente mais Pierre Lebon raffolait des bananes. Il en dégustait au moins quatre par semaine. Et encore, c’était sans compter les bananes séchées et la bière de banane. Dans les bananes, il y a du magnésium et du potassium. Avec des noms comme ça, les bananes, ça ne peut faire que du bien.
François Sinar, intarissable, reprit :
« Ce qui changerait, pour la chambre, se serait la proportionnelle. Alors là je peux te dire que ce serait autre chose que le contrôle de la conformité des lois aux traités européens. Parce qu’avec la proportionnelle, le gouvernement serait obligé de se battre pour obtenir une majorité. Et de se battre sur chacune de ses lois. Là, oui, le parlement redeviendrait un contre-pouvoir. Mais la primauté du droit européen, qu’est-ce que tu veux que je te dise. Si un jour le gouvernement a envie que la France redevienne souveraine, le droit européen, il arrêtera de l’appliquer. C’est pas plus compliqué que ça. Les juges européens pourront bien rendre des arrêts matin, midi et soir, ils pourront condamner la France pour manquement, pour carence, pour tout ce que tu veux, ça n’y changera rien. On ne les appliquera pas ces décisions. Et si vraiment Bruxelles persiste, il n’y aura qu’à couper les vivres. Rien ne nous oblige à payer l’impôt à Bruxelles. Et si vraiment ça s’envenime, les traités européens, on peut en sortir. Jusqu’à nouvel ordre, et même si les partisans de la Communauté européenne essaient de nous faire croire le contraire, un traité n’est pas éternel. Sinon, nous serions encore en train d’appliquer le traité de Troyes de 1420. Leur affaire, aux européistes, c’est l’irréversibilité. Un traité européen et ça y’est : tout est figé pour l’éternité. »
Pierre Lebon le regarda.
« Il va falloir y aller sinon on va être en retard. »
Les deux hommes sortirent de la buvette et marchèrent sur les tapis amarante qui recouvraient les longs couloirs du Conseil.
Pierre Lebon entra le premier. La salle était divisée par une clôture en bois en deux parties inégales : un espace surélevé réservé aux magistrats avec au centre le fauteuil du président et de chaque côté une quinzaine de places pour les magistrats. Un second espace, nettement plus réduit, pour le public et les avocats.
Le public était plus nombreux qu’à l’accoutumée. Il remarqua dans la foule un universitaire dont le manuel de contentieux administratif était sur les bureaux de bon nombre de membres du conseil. Un manuel de droit, parfois, ça peut servir, même s’il ne faut pas en abuser.
Il prit place. Le vice-président entra, les conseillers se levèrent puis se rassirent.
Pierre Lebon balaya la salle du regard. Il ne put s’empêcher de penser à ceux qui les avaient précédés. La salle était située, à peu de chose près, à la place d’une salle de théâtre dans laquelle Molière et sa troupe s’étaient produits. Dans cette salle, Molière fut pris d’un malaise après avoir joué pour la quatrième fois le rôle-titre du Malade imaginaire, mourant le soir même à son domicile de la rue de Richelieu, le 17 février 1673.
L’affaire à juger fut présentée à l’assemblée après quoi le commissaire du gouvernement se mit au centre de la salle et commença à lire ses conclusions.
Pierre Lebon n’écoutait déjà plus que d’une oreille. Son regard se perdit dans la salle. Elle était est typique du style « IIIe République » : des murs dressés de tissus rouges. Disséminé dans les dorures, il aperçut une balance, un sceptre et une main de justice. Avec ça, se dit-il, on ne peut pas dire que les autorités ne fassent pas tout pour que l’on rende de bons jugements.
« En ce domaine, poursuivit le commissaire du gouvernement, votre jurisprudence est constante : en cas de contradiction entre un traité et une loi postérieure, vous faites prévaloir la loi. Cependant, nous pourrions aujourd’hui retenir une autre solution.
« Celle-ci présenterait au moins deux avantages. Le premier serait de nous conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Le second ne vous échappera pas. Les juges pourront écarter une loi au profit du traité, s’ils jugent la loi non conforme. La séparation des pouvoirs serait violée au profit du juge, enfin du droit européen. Mais la séparation des pouvoirs est un principe un tantinet dépassé. Aussi je vous propose de le reléguer au rang de principe inférieur, au profit d’un principe aujourd’hui beaucoup plus important : la primauté du droit européen. Cette primauté du droit européen est aujourd’hui… »
Le commissaire du gouvernement releva la tête.
« J’allais dire, cette primauté du droit européen est au cœur de l’État de droit, mais je me serai mal exprimé. Elle n’est pas au cœur de l’État de droit. Elle est le cœur de l’État de droit. Ainsi, en choisissant la solution de la primauté du droit européen, grâce au Conseil d’État, la société française franchirait une étape supplémentaire, déterminante, capitale, indépassable, vers le triomphe de l’État de droit. »
Pierre Lebon poursuivit son exploration. Au fond de la salle, au-dessus d’une cheminée entourée de deux bibliothèques, il reconnut une peinture de Benjamin Ulmann ayant pour titre Allégorie du droit ou La Justice. Une femme habillée de vert et de rouge tenant les attributs de la justice : une plume dans sa main droite et un livre dans l’autre, permettant de consigner les règles de droit. Au-dessus de la toile, une inscription en latin dans un cartel : « suum cuique », qui signifie « à chacun son dû ».
« Cette solution, aussi séduisante soit-elle, aussi moderne, présente un certain nombre d’inconvénients qui nous conduisent à en préférer une seconde, plus simple, somme toute, puisqu’elle consiste à maintenir votre jurisprudence antérieure : appliquer imperturbablement une loi promulguée, même si elle méconnaît un traité européen ou les actes pris pour leur application. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas le droit de juger une loi, encore moins de l’écarter. Un des actes fondateurs de notre droit républicain, la loi des 16-24 août 1790, fait défense aux juges, sous peine de forfaiture, d’empêcher ou suspendre les décrets du corps législatif. Ce texte a été adopté initialement afin de lutter contre les abus des « parlements », cours souveraines de l’ancien régime, qui refusaient d’enregistrer les lois ou avaient même la prétention de les modifier par des arrêts de règlement. Il serait inconvenant de notre part de nous ériger, comme sous l’Ancien régime, en censeurs de la loi. Les tribunaux doivent appliquer la loi, dès lors qu’elle a été promulguée et publiée. Nous ne sommes pas là pour discuter de sa validité, nous ne sommes pas là pour nous substituer à ceux qui sont censés représenter le peuple. La constitution est parfaitement claire : le parlement représente la volonté nationale. On peut être d’accord avec ce principe, on peut ne pas être d’accord avec lui et considérer qu’il s’agit d’une trouvaille qui ne correspond en rien à la réalité. Seulement c’est la constitution. Si nous voulons abolir ce principe, alors il faut d’abord abolir la constitution. D’autant que celle-ci, dans son titre VIII « De l’autorité judiciaire », n’affirme dans aucune de ses dispositions que la volonté de l’autorité judiciaire doit primer sur celle du pouvoir législatif. »
Les membres du Conseil d’État, le public, écoutaient, attentifs.
« De même, il ne nous appartient pas de courir au-devant des abandons de souveraineté. Il ne nous appartient pas de transformer le parlement français en théâtre d’ombres. Il ne nous appartient pas de nous substituer au peuple français. »
Les mots étaient prononcés distinctement, mais le commissaire du gouvernement ne se départissait pas pour autant de son ton monocorde.
Pierre Lebon sentit son voisin – Jean-Louis Letrier – se crisper. Il le regarda. Il transpirait. Il se souvint d’avoir évoqué avec lui les évolutions de carrière au Conseil d’État. Elles n’étaient pas satisfaisantes, lui avait avoué Letrier. Il se serait bien vu travailler à Bruxelles, pour la Commission européenne, à la Direction des affaires économiques et financières. Il espérait d’autant plus un poste qu’il venait de s’acheter une maison de campagne à Waterloo. En voiture, on pouvait relier les deux villes en moins d’une demi-heure, lorsqu’il n’y avait pas d’embouteillages.
Le commissaire du gouvernement venait de terminer la lecture de ses conclusions. François Sinar fit un clin d’œil à Pierre Lebon. Cela n’avait pas été trop long. Le public se retira.
Le président prit la parole.
« Je vous félicite pour vos conclusions. Elles sont claires. Les membres de l’assemblée ont-ils des remarques ? »
Il y eut un long moment de silence. Jean-Louis Letrier se tourna vers le président.
« Elles sont claires, je suis d’accord, mais elles ne sont pas en harmonie avec celles de la majorité des autres cours de la Communauté européenne, voire des autres cours françaises. En retenant la solution préconisée, nous nous marginalisons et nous créons un obstacle à l’établissement d’un véritable dialogue entre les juges européens. Or c’est ce que nous devons privilégier : le dialogue. En dialoguant, nous créerons des convergences. En créant des convergences, nous facilitons l’harmonisation. En harmonisant, nous permettons l’apparition d’un marché commun au sein duquel la liberté de circulation des biens, des capitaux et des hommes devient réalité. En somme, nous permettons l’apparition d’une véritable Europe : l’Europe de demain, inclusive, au sein de laquelle les frontières nationales ne seront plus que de mauvais et lointains souvenirs. »
Le président fixait l’orateur sans que l’on sache très bien si c’était par intérêt ou par politesse. Jean-Louis Letrier poursuivit.
« Je comprends que certains, dans cette salle souhaitent conserver notre jurisprudence. Le problème est que cette solution se fonde sur des principes qui n’ont plus lieu d’être. La souveraineté, la France, ont déjà cessé d’exister. Le meilleur moyen, le seul, pour conserver ce qui peut encore l’être, est de transférer à l’Europe ce qui subsiste et de l’exercer en commun afin de créer des synergies. »
Habituellement, le président ne rentrait pas dans les débats. Il se contentait de diriger l’assemblée avec assez de brio pour l’emmener là où il voulait l’emmener. Et il y réussissait presque toujours.
Il prit la parole.
« Je vous remercie pour votre intervention. Je vous en remercie d’autant plus que vous nous permettez d’entendre un autre point de vue. Et ce point de vue, figurez-vous que je le partage. Il faut savoir évoluer, il faut nous adapter. La souveraineté de la France est suffisamment entamée et, comme vous le soulignez, le meilleur moyen d’en conserver quelques parcelles est de la transférer et de l’exercer en commun. »
Il s’exprimait comme le commissaire du gouvernement, sur un ton neutre, mesuré, presque comme s’il lisait un texte.
« Encore une fois, je suis entièrement d’accord avec vous. Seulement la solution qui a notre préférence, Monsieur Letrier, présente un inconvénient majeur. Je devrais plutôt dire un risque, voire un danger qui nous interdit de faire prévaloir un traité européen ou un acte pris pour son application, sur la loi démocratiquement votée. Quel est ce danger ? »
Il balaya l’assemblée du regard.
« Un traité permet de fixer un cadre. En ratifiant un traité, nous savons à quoi nous nous engageons. Les institutions européennes, qu’il s’agisse de la Cour de justice des communautés européennes ou de la Commission, ne respectent pas ce cadre. Elles interprètent les traités européens comme bon leur semble, avec une seule préoccupation : renforcer les pouvoirs de la Communauté européenne, au détriment des États. Et peu importe que leur interprétation les conduise à une violation permanente des traités. Concrètement, cela signifie que le droit européen agit exactement comme une charge creuse qui pénètre son objectif en faisant un orifice minuscule, pour finalement faire exploser tout l’édifice.
« Or rien dans la Constitution n’autorise la Cour de justice, la Commission européenne ou le Conseil d’État à délivrer le permis d’inhumer de la France ou de tout autre État européen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter la solution qui, encore une fois, a ma préférence. Car nous ne pouvons pas faire confiance aux institutions européennes pour respecter les traités. Et elles ne les respectent pas. Ces traités constituent un alibi, rien d’autre. Comme la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ils sont les enluminures d’un projet idéologique. Vous pouvez vous amuser à découper un texte, de la manière la plus sophistiquée, en section, en sous-section, en numéro, tout ce que vous voudrez. Vous pouvez juxtaposer des textes et déclarer qu’il s’agit de traités qui se complètent les uns les autres. Tout ça ne fait pas du droit. Encore moins lorsque ces textes sont interprétés par des autorités qui ne sont pas élues. »
Le président marqua un temps de pause.
« L’élection ! S’agit-il d’un bon ou d’un mauvais système ? Je n’ai pas à en juger. À chaque époque son système. Celui-là n’est pas meilleur qu’un autre. Il n’est pas moins bon. Seulement je n’ai vu nulle part que nous avions changé de système. »
Il leva la tête. Son ton devint plus ironique.
« Si c’est le cas, vous voudrez bien venir m’en informer. Quelque chose a dû m’échapper. S’il s’agissait de droit, conclut-il, alors je vous dirai oui, acceptons l’effacement de la loi française devant un autre droit. Seulement là, il ne s’agit pas de hiérarchie des normes, de conformité d’un texte avec un autre. Il s’agit d’assurer la soumission de notre droit avec une idéologie et cela nous n’avons pas le droit de la faire. »
Comme presque toujours, l’assemblée trancha dans le sens des conclusions du commissaire du gouvernement. Et de celui de son président.
Pierre Lebon sortit du Conseil d’État. Un groupe d’une quinzaine de touristes – des écoliers – était devant l’entrée du Conseil d’État. Plusieurs d’entre eux portaient un tote bag bleu et blanc sur lequel était inscrit « Viva Argentina ». Cela laissait peu de doute sur leur nationalité.
Il regarda l’institutrice qui tentait, tant bien que mal, de contenir les écoliers. L’espagnol, il le comprenait plutôt bien. Après l’avoir appris pour le bac, il s’y était remis, quelques années plus tard, pour lire dans le texte, Don Quichotte. Là, il comprenait d’autant mieux que c’était de l’espagnol argentin, un peu plus lent et plus doux que celui parlé en Espagne.
« Martina, Martina, s’écria un écolier. Pourquoi y a-t-il deux drapeaux ? »
Il montrait la porte d’entrée du Conseil d’État.
François Sinar sortit à ce moment-là. Il avait entendu la question. Lui aussi parlait bien l’espagnol.
« À gauche, c’est le drapeau français ; à droite le logo de la Communauté européenne. »
Il salua Pierre Lebon et courut en direction de la station de métro.
« Allez, on y va dit Martina en direction du groupe. »
Pierre Lebon suivit le groupe, d’abord du regard puis en marchant, en gardant ses distances. Il avait envie de se dégourdir les jambes après la séance de jugement et il n’avait pas de remise de ceinture jaune à laquelle assister.
La rue de Rivoli était bondée de touristes. Les écoliers s’arrêtèrent devant un marchand de souvenirs, fascinés par une tour Eiffel miniature scintillante. Martina parvint à détourner leur attention pour les entraîner vers la place de la Concorde. Elle avait gagné contre le marchand de souvenirs, elle perdit contre un marchand de glaces, toujours rue de Rivoli. Pierre Lebon fit comme les écoliers, il s’en offrit une : cassis-framboise. Après tout, pensa-t-il, nous n’avons pas démérité cet après-midi.
Arrivée au niveau de la place de la Concorde, Martina rassembla son groupe, bien trop absorbé par la dégustation de la glace.
Elle sortit son guide.
Regardez les enfants, je vais vous raconter ce qui est arrivé ici. Aujourd’hui vous voyez une belle place, mais le 30 mai 1770 la place a été le théâtre d’un événement dramatique que l’on a appelé « grand étouffement ». Vous avez envie de savoir ce que c’était, cet étouffement ? »
Martina regarda ses élèves. La glace l’emportait encore sur le drame.
Un feu d’artifice avait été tiré en l’honneur du mariage du Dauphin et de Marie-Antoinette. Une fusée est retombée sur la foule. Cela a provoqué une panique. Cent trente-trois personnes sont mortes d’étouffement.Ils se dirigèrent vers le pont de la concorde. Cette fois, Pierre Lebon marcha en éclaireur, devinant où ils se rendaient.
Arrivée au centre du pont, Martina arrêta le groupe, exactement devant lui.
« Vous savez ce que c’est ce grand bâtiment dit-elle à ses élèves ? Regardez-le bien. Vous voyez quoi ?— Douze colonnes, répondit une petite fille.
— Ça te fait penser à quoi ? »
La petite fille hésita.
« C’est comme lorsqu’on achète une boîte d’une douzaine d’œufs.
— J’avais pas pensé à ça, mais tu as raison. »
Martina appela un écolier un peu dissipé qui montait sur la rambarde du pont. Baltazar redescendit et se remit dans le groupe. Au moins, l’écolier était obéissant : dissipé, un peu aventurier, mais obéissant.
Elle sortit une canette de coca cocola de son tote bag et la décapsula. Une gerbe en sortit qui éclaboussa le visage de Pierre Lebon. Le groupe se mit à rire. Martina se précipita.
« Oh, écoutez je suis désolée. J’aurais dû faire attention. »
Elle prit un mouchoir et le passa délicatement sur son visage.
« Merci beaucoup dit Pierre. Vous vous appelez Martina, j’ai entendu vos élèves vous appeler.
— Et vous vous appelez Pierre. J’ai entendu votre ami vous dire au revoir, à la sortie de l’espèce de pavillon ou vous travaillez, celui où on a mis un drapeau et un logo au même niveau.
— Exactement.
— Et vous faites quoi dans votre pavillon ?
— Du droit, enfin en principe.
— Nous, nous arrivons d’Argentine, enfin de Patagonie, et nous visitons la France.
— Hier on a été voir le tombeau de Napoléon.
— Et vous avez aimé ? »
Martina eut l’air embarrassée.
« Disons que c’est un style. Je trouve qu’il aurait mérité mieux. J’espérais aussi voir le tombeau de Napoléon III mais il paraît qu’il est en Angleterre. Par contre, j’ai bien aimé les drapeaux dans la cathédrale Saint Louis des Invalides. Ces drapeaux, si on les observe un peu, c’est une partie de l’histoire de France qui est là. Au moins celle des deux derniers siècles. Mais les petits, rien à faire. J’ai eu beau leur expliquer, ça ne les a pas vraiment intéressés. Vous savez ce qui les a intéressés ? Devant les Invalides, il y des pelouses. Et sur les pelouses, il y a des lapins qui se promènent. Il y en a même beaucoup. Ils ont été bien plus intéressés par les lapins que par le tombeau. Les enfants, toujours curieux, regardaient, un peu intrigués, la conversation entre Martina et Pierre.
— Vous restez quelques jours à Paris demanda soudain Pierre ?
— Oui, mais je suis très occupée par les petits. Il faut faire attention à tout avec eux. Mais demain soir je suis libre, ils vont visiter la tour Eiffel. C’est l’ambassadrice d’Argentine qui les accompagne.
— Et bien alors vous savez ce qu’on pourrait faire ?
— Non.
— Demain soir, rendez-vous ici, sur le pont, à huit heures ? »
Le visage de Martina s’illumina.
« D’accord, alors à demain. »
En regardant Martina s’éloigner en direction de l’Assemblée, un déclic se produisit dans son esprit. Baltasar. C’était le prénom d’un auteur espagnol du xviie siècle qu’il avait dévoré quelques années plutôt : Baltasar Gracián. Après Le Criticon, il avait poursuivi avec L’homme de cour.
Et si la solution à la décision de cet après-midi, celui Raoul Georges Nicolo, était là ? Bien sûr il y avait tous ces beaux principes juridiques, il y avait surtout la démocratie et la souveraineté de la France : la première peut difficilement exister sans la seconde. Ces grands principes, le commissaire du gouvernement les avait rappelés. Il l’avait fait de manière très consciencieuse, en vrai professionnel. Il avait certainement passé beaucoup de temps à rédiger ses conclusions. La solution allait de soi. Il l’avait si bien synthétisée, d’une manière limpide, qu’il méritait d’être félicité. Seulement il manquait quelque chose à ces conclusions. Et c’est le petit Baltazar s’accrochant à la rambarde du pont, qui lui en avait fait prendre conscience.
Le système bureaucratique, dont le Conseil d’État constitue l’un des sommets, ne doit pas chercher à s’opposer. Nous ne sommes pas là pour nous opposer, ou pour résister. Nous sommes là pour accompagner. C’est l’air du temps dont parlait tout à l’heure François Sinar. En tant que quintessence de la bureaucratie, notre rôle est de nous diluer dans l’air du temps, de nous laisser absorber par lui, certainement pas de nous en dissocier. Il faut glisser, accompagner, mais pas s’opposer. Baltasar Gracián a merveilleusement décrit ce phénomène dans L’homme de cour (Oráculo manual y arte de prudencia).
Pour une fois que j’arrive à retenir une date, pensa Pierre : L’homme de cour est paru en 1647. À l’époque, ça a été un best-seller. Le livre décrit, tout au long de trois cents aphorismes commentés, comment triompher en société. La prudence, une certaine dissimulation sont parmi les premiers préceptes enseignés. Il ne faut jamais se découvrir entièrement afin de pouvoir évoluer au gré des circonstances. Ici réside la principale caractéristique de l’homme de cour : toujours aller dans le sens du vent, le meilleur moyen de ne pas se compromettre étant d’accepter la compromission. Toute la difficulté est que l’on ne sait jamais à l’avance dans quel sens le vent va tourner. Pour être un homme de cour il faut donc un certain savoir-faire. Un homme de cour ? Je ne l’ai jamais été pensa-t-il. Je me suis contenté de passer des concours et de les réussir. Des concours difficiles certes, mais pas d’avoir été un homme de cour. De toute façon, le problème ne se pose pas puisque nous avons refusé la primauté des traités sur les lois postérieures. Tout de même. Dans Conseil d’État il y a État. Je veux bien nager dans le sens du courant, mais il y a quand même des limites. Si nous laissons s’effondrer l’État, il va finir par nous tomber dessus.
Mais peut-être, tout compte fait, que nous aurions dû suivre les conseils de Baltasar Gracián se dit Pierre. La prochaine fois pensa-t-il, on pourra se rattraper. L’air du temps ! Nous l’avons trop négligé cet après-midi. Or c’est lui qui fait notre force.
François Sinar avait probablement raison lorsqu’il disait que la solution de l’arrêt Nicolo ne changerait, tout compte fait, pas grand-chose au sort du parlement. En cas de primauté du droit communautaire, il ne coulerait pas mais continuerait à flotter, assez au moins, pour se laisser guider par le courant. Mais certainement pas comme la boîte d’œufs de l’écolière argentine, que l’on ouvre et que l’on casse pour faire une omelette. Les bureaucraties ont ceci de magique, c’est que contrairement à l’homme, elles sont immuables. Elles s’adaptent et, comme un chat, retombent presque toujours sur leurs pattes. La bureaucratie politique n’échappe pas à la règle. Si un jour nous décidons que la loi doit s’effacer devant les traités, l’Assemblée retombera sur ses pattes.
Martina marchait en tête. Il la regarda s’éloigner avec son escouade d’écoliers. Elle se retourna. Lorsque leurs regards se croisèrent, il sut qu’elle serait là, demain soir, au milieu du pont. Demain, samedi, le 21 octobre.
L’escouade traversa la rue et s’arrêta devant l’une des statuts de l’Assemblée, celle de Michel de l’Hospital.
Pierre se tourna vers la Seine et fixa une péniche. Il observa le batelier en train de sortir de sa cabine. Il fit le tour de la cabine et s’assit sur une caisse de bois avant de s’affaler. Le dos collé contre la caisse, il tomba dans une forme de torpeur.
La poupe de la péniche venait de passer le pont. La lumière éclairait le visage du batelier. Il était détendu et heureux. À force d’engourdissement, il avait glissé et était étendu sur le pont de la péniche.
La péniche suivait le lit de la Seine, se laissant doucement guider par le courant. Elle avançait sans laisser de sillon. Lentement, sûrement, bien tranquillement.
Ramu de Bellescize, « Automne 1989 : Nicolo, le Conseil d’État et l’air du temps », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4599.