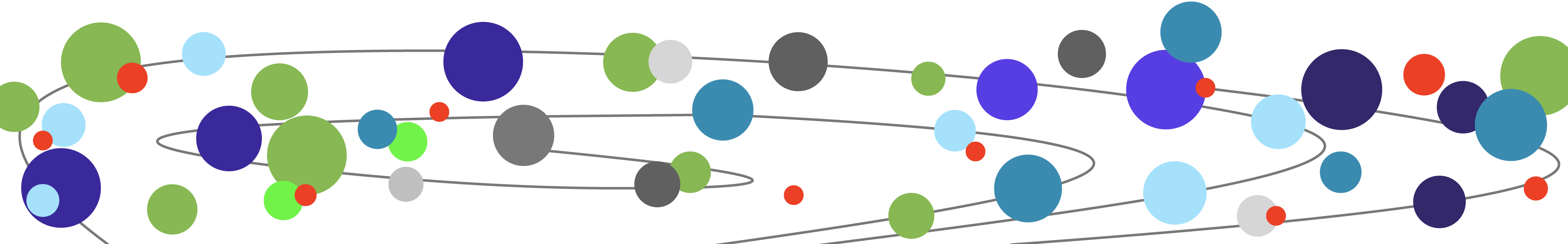Baptiste Bonnet
Professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Doyen de la Faculté de droit, CERCRID-UMR 5137
Que se serait-il passé si la jurisprudence des Semoules avait été confirmée par l’arrêt Nicolo et que le Conseil d’État avait maintenu son refus de contrôler la conventionnalité des lois postérieures à l’entrée en vigueur d’une norme d’origine externe. Une rencontre au sommet au Conseil d’État entre Marceau Long et Nicole Questiaux permet d’avoir une idée des coulisses de ce non-revirement de jurisprudence pourtant attendu. Il s’en est suivi, en toute uchronie, une réforme constitutionnelle intégrant dans le champ des compétences du Conseil constitutionnel le contrôle de conventionnalité de la loi, ensuite d’un comité Vedel au sein duquel les discussions furent aussi houleuses notamment entre Mme Delmas-Marty et le Doyen Favoreu. L’existence même du Conseil constitutionnel en fut discutée, aux motifs d’un potentiel gouvernement des juges.
What if the Semolina case law had been confirmed by the Nicolo ruling and the Council of State had maintained its refusal to review the conventionality of laws subsequent to the entry into force of a standard of external origin? A summit meeting at the Council of State between Marceau Long and Nicole Questiaux provides an insight into the behind-the-scenes of this expected failure to reverse the case law. What followed, in a completely alternate history, was a constitutional reform integrating the control of the conventionality of the law into the Constitutional Council’s scope of competence, followed by a Vedel committee within which discussions were also heated, particularly between Ms. Delmas-Marty and Dean Favoreu. The very existence of the Constitutional Council was discussed, on the grounds of a potential government of judges.
Il s’en est fallu de peu pour que la géante d’acier soit détruite après l’exposition universelle de 1889. Ce qui est aujourd’hui le symbole de Paris et même de la France ne doit son salut qu’à peu de choses. Il en est ainsi, les grandes décisions sont parfois prises sur le fil.
L’arrêt Nicolo, icône absolue des juristes publicistes français, arrêt-phare, arrêt-symbole, parangon de l’édifice des sources du droit administratif et du rôle du Conseil d’État dans la structuration des rapports de systèmes serait-il la tour Eiffel (dont l’architecture est en outre pour partie pyramidale…), du droit administratif, icône qui n’a pas toujours été si solide et qui aurait pu ne jamais voir le jour ou disparaître sans jamais passer à la postérité ? L’arrêt Nicolo aurait-il pu être différent, serait-il plus fragile qu’il n’y paraît ? Comment imaginer un GAJA sans arrêt Nicolo, un cours de droit administratif sans arrêt Nicolo, une politique jurisprudentielle relative aux rapports entre ordres juridiques sans arrêt Nicolo ?
En étant très imaginatif !
Voici donc, de manière très romancée et fictionnelle, l’histoire relue et réinventée :
La doctrine universitaire sait désormais que l’arrêt Nicolo a été arraché de haute lutte par ses partisans au Conseil d’État, Marceau Long en tête, ce dernier ayant distillé au fil des interviews quelques secrets de l’antichambre du vénérable arrêt. Au cours d’un entretien effectué avec l’ancien vice-président du Conseil d’État, l’auteur de ces lignes a appris que l’arrêt Nicolo avait été obtenu à une très courte majorité au Conseil d’État, contre vents et marées, l’obédience à la loi étant encore en 1989 très prégnante et la résistance grande, certains membres « anciens » du Conseil d’État, disons d’autres générations, comme Mme Questiaux étant, par ailleurs, encore présents.
Lors du vote à l’assemblée du Contentieux, il aurait donc pu en être autrement…
Nous sommes, fin 1988-début 1989, Marceau Long fait campagne avec d’autres pour faire sortir le Conseil d’État de l’ornière, de son isolement européen. Selon lui la position de la haute juridiction administrative n’est plus tenable. Isolé parmi les hautes juridictions européennes, la position du Conseil d’État est incomprise, un procès en anti-européanisme est régulièrement instruit, certains estiment que le juge administratif ne respecte pas l’article 55 de la Constitution. La Cour de cassation a cédé à l’appel du Conseil constitutionnel effectué en 1975, le Conseil d’État a résisté dans son arrêt UDT réitérant son refus de faire primer un traité sur une loi postérieure à son entrée en vigueur mais 17 ans après la décision IVG, le blocage engendré par la politique jurisprudentielle de la juridiction administrative en termes d’implémentation du droit européen dans l’ordre interne n’est plus tenable. Marceau Long sait que la réputation de la haute juridiction administrative est en jeu.
Mme Questiaux, revenue au Conseil d’État après des fonctions administratives et politiques de premier plan n’est pas de cet avis, elle campe sur sa position et sur la valeur inextinguible de la jurisprudence des Semoules. Pour elle, le Conseil constitutionnel s’est trompé en considérant que le juge ordinaire devait effectuer le contrôle de conventionnalité de la loi particulièrement lorsque la loi est postérieure à l’entrée en vigueur du traité. Mieux, il a mis le juge ordinaire en porte à faux vis-à-vis du législateur. Mme Questiaux connaît son histoire, elle est d’une époque où le Conseil d’État n’était pas assuré de sa survie, elle sait que le Général de Gaulle aurait pu alors le supprimer et l’a même sérieusement envisagé au moment de l’arrêt Canal, elle sait que le juge administratif a pu construire son édifice jurisprudentiel uniquement au gré d’un respect drastique de sa position, de sa compréhension du rôle de l’administration et plus largement des pouvoirs publics, de son obédience à la norme législative, qu’il n’a ni la volonté ni la possibilité, d’écarter la loi postérieure, ni au profit de la norme internationale, ni au profit de la norme constitutionnelle. Mme Questiaux en fait une règle absolue, immarcescible. Le juge administratif doit savoir respecter la séparation des pouvoirs s’il ne veut pas être la victime de pouvoirs publics considérant que le juge a dépassé les limites de son office. Et ce n’est certainement pas le droit européen, qui vient d’une manière ou d’une autre bouleverser le génie français (elle suit sur ce point le Doyen Carbonnier), qui peut remettre en cause un principe sacro-saint et absolument essentiel à tout l’équilibre institutionnel interne, celui de la séparation des pouvoirs. Le Conseil d’État doit tenir bon, ne pas se soumettre à cette mode européaniste qui vient remplacer la cohérence d’un ordre par des logiques qui mettent à mal la souveraineté nationale et dégrader la hiérarchie des normes.
Une rencontre au sommet et secrète a lieu entre Marceau Long et Nicole Questiaux, dans le bureau du VP du premier étage du Palais royal. Il est 20 h 30, l’ambiance est tendue, chaque protagoniste a le sentiment que l’autre est un quasi-adversaire, pour l’un que le tenant du maintien de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État est un leurre et le signe d’une institution qui n’a pas compris les évolutions de son temps, pour l’autre que la volonté de renverser la jurisprudence des Semoules est un danger, un danger pour le Conseil d’État, un danger pour la souveraineté nationale et une erreur possiblement irréparable.
Voici une partie de leur échange :
Marceau Long : « Madame la ministre, chère Nicole, j’ai aujourd’hui la charge d’une institution qui doit savoir évoluer, notre position n’est plus tenable, comment puis-je expliquer à nos homologues européens et a fortiori aux juges européens que le Conseil d’État ne respecte ni la primauté du droit communautaire, ni sa propre Constitution qui pourtant prévoit la primauté des Traités sur la loi. Les temps ont changé, demain de nouveaux traités vont être adoptés et pousser encore plus loin la construction européenne, après demain peut-être la monnaie unique ! Notre réalité d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. L’imperium de la loi demeure mais s’est largement fissuré. Désormais la loi est entièrement soumise au contrôle de constitutionnalité et toutes choses égales par ailleurs elle l’est également au contrôle de conventionnalité. Je discutais l’autre jour avec Le Doyen Vedel qui envisageait une question de constitutionnalité pour l’avenir permettant d’effectuer un contrôle a posteriori de la loi, c’est vous dire si les choses évoluent. Le Conseil constitutionnel n’a pas souhaité intégrer à son contrôle, le contrôle de conventionnalité, dont acte ! Il nous a confié cette mission, nous ne pouvons plus la refuser, nous y sommes désormais habilités, d’abord par la Constitution elle-même, ensuite par le Conseil constitutionnel et enfin par le droit européen dont nous sommes devenus le juge de droit commun. Et s’il s’agissait d’une opportunité pour le Conseil d’État d’être partie prenante dans la reconstruction vigilante de la hiérarchie des normes ? Chère Nicole, nous n’avons plus le choix, la résistance, compréhensible, justifiée et légitime a duré. Nous devons rester maîtres de notre destin et avancer nous-même et à notre manière, le Conseil d’État ne peut pas être un spectateur des rapports entre ordres juridiques et s’interdire ce que tous les autres juges font. »
Un silence fit suite à cette longue plaidoirie, Madame Questiaux respira profondément et de manière visible et prit la parole très calmement mais avec une détermination peu commune :
« Monsieur le Président, Cher Marceau, j’ai exercé les plus hautes fonctions de l’État pour revenir terminer ma carrière chez moi, au Conseil d’État, grande maison s’il en est. J’ai toujours été au service de l’État et du droit, en tant que Conseiller d’État (ce qui n’empêche en rien mon indépendance) en tant que députée, en tant que ministre. Je sers l’État et mon rôle a toujours été de le préserver. Je crois profondément à sa logique, à sa cohérence, à ses atouts. Je crois que l’État se structure par sa Constitution et que sans séparation des pouvoirs il n’y a pas de Constitution, comme l’a justement affirmé Michel Troper. Admettre aujourd’hui que le juge administratif, serviteur de la loi, peut de sa propre autorité écarter un texte législatif au profit de quelque norme que ce soit, ce n’est pas son rôle. Cela reviendrait à gravement contrevenir à un équilibre des pouvoirs dans lequel le législateur et le juge ont chacun et respectivement leur place, séparée. Cela remettrait en cause la conception qui est la mienne de l’État de droit.
« Quelle responsabilité prendrions-nous, en tant que juge, si nous ne respections plus la volonté du législateur clairement exprimée, si, passez-moi l’expression, Cher Marceau, nous nous asseyons sur l’autorité de la loi ? ! Le législateur légitime, démocratiquement élu, décide de passer outre un engagement international et nous déciderions de l’en empêcher, de contrecarrer sa volonté ? Mais avec quelle légitimité ? Si la loi est postérieure au Traité et donc que le législateur a décidé, en toute de connaissance de cause, de ne pas respecter le Traité, ce n’est pas au Conseil d’État de lui dire qu’il a tort, ou qu’il ne respecte pas l’article 55 de la Constitution. Ce n’est pas le rôle du juge administratif et cela contrevient à l’équilibre toujours précaire que la juridiction administrative a construit de manière séculaire dans ses rapports avec les autres pouvoirs. Le risque est grand d’un glissement qui viendrait bouleverser l’équilibre général, de surcroît au profit d’une norme externe, que nous ne maîtrisons absolument pas, qui souvent vient contrevenir aux principes les plus établis du droit français, sans vergogne sur des fondements hasardeux et par le choix des juges européens dont la légitimité pour ce faire est aussi sujette à caution. Nous avons mis des années à construire le droit administratif, nous avons une responsabilité majeure, le droit européen n’a pas vocation à tout détruire jusqu’aux fondements mêmes de notre État de droit. Demain il viendra contrecarrer jusqu’à l’existence de notre commissaire du gouvernement ! Je me battrai pour que le Conseil d’État ne se soumette pas à une mode et à l’air du temps. Désolée Marceau mais tes arguments ne me convainquent pas du tout. Mes idées sont universalistes, mon engagement pour les droits humains est réel tu le sais, et je reconnais l’apport du droit européen, mais je suis avant tout une juriste et juridiquement ce que tu souhaites n’est pas possible, cela changerait notre place et notre rôle dans les institutions. Nos collègues judiciaires n’ont pas pris la mesure de l’enjeu, ils n’ont pas notre culture de l’État. Quant au Conseil constitutionnel il s’agit d’une instance pas vraiment juridictionnelle, jeune, qui n’a pas notre expérience et qui n’a pas assez mesuré les impacts de sa position. »
La discussion fut passionnée et tendue, chacun campant sur sa position. Il faut dire que les arguments en présence avaient du poids et que chaque protagoniste avait bien saisi les enjeux d’un revirement de jurisprudence du Conseil d’État comme les enjeux d’un maintien de sa position.
L’affaire fut appelée au rôle et le délibéré eut lieu, dans le calme, comme à l’habitude, mais avec une atmosphère relativement inhabituelle, avec la conscience que l’arrêt rendu pouvait entrer dans l’histoire. Chacun s’exprima, les arguments avaient été savamment préparés, affûtés. Chacun pesa autant qu’il le put sur la décision.
Marceau Long s’était assuré de ses soutiens et il pensait qu’il l’emporterait à une ou deux voix près. Le jour du vote, un conseiller d’État plutôt favorable au revirement et proche de Marceau Long dut malheureusement accompagner son fils à l’hôpital pour un bête accident domestique, cette absence fut d’autant plus conséquente que les arguments du maintien de la jurisprudence des Semoules l’emportèrent à une voix près (nous sommes évidemment dans la fiction, dans l’uchronie, mais les indiscrétions laissent à penser que dans la réalité, le revirement Nicolo aurait été arraché dans les mêmes proportions…). Les conclusions brillantes de Patrick Frydman n’y changèrent rien, les enjeux étaient grands.
C’est dire si les avis étaient partagés.
L’arrêt Nicolo, devint donc une confirmation de l’arrêt des Semoules…
Il n’entra ni dans la postérité ni aux Grands arrêts de la jurisprudence administrative. Rendez-vous compte un GAJA sans Nicolo… La diva du droit administratif devint donc et pour longtemps l’arrêt dit des Semoules de France. Plusieurs colloques s’ensuivirent et plusieurs prises de position doctrinales compréhensives vis-à-vis de la position du Conseil d’État furent tenues. Cet arrêt Nicolo confirmatif de la jurisprudence des Semoules, dit en doctrine jurisprudence Nicolo-Semoules, ne choqua pas la plupart des administrativistes, réjouit certains constitutionnalistes de l’époque et conduisit de nombreux civilistes à critiquer vivement la Cour de cassation qui contrairement au Conseil d’État aurait cédé aux sirènes d’un mouvement européaniste incontrôlable ! Les européanistes, vent debout, n’eurent en revanche pas de mots assez durs pour qualifier une juridiction hors de son temps et campée sur des positions anticonstitutionnelles (selon eux) antieuropéennes et même qualifiées parfois de nationalistes ou souverainistes. Un article fut ainsi intitulé : « Quand le Conseil d’État traduit le génie français par un gallocentrisme réactionnaire », le ton était donné… La séquence Nicolo laissa en outre des traces au Conseil d’État et une certaine défiance, inhabituelle dans cette maison entre les pro et les anti-revirement, c’est dire si la question des rapports entre ordres juridiques suscita les passions, pourtant d’habitude rares au Palais Royal, plutôt connu pour sa permanente pondérance…
Le gouvernement et le président de la République ne purent que constater l’aporie du système qui découlait du maintien de la jurisprudence des Semoules et les conséquences que cette situation ne manquerait pas d’avoir sur l’État français du point de vue européen mais ne jugea pas politiquement acceptable, dans le contexte politique de l’époque, de contraindre soit le juge constitutionnel soit le juge ordinaire à effectuer le contrôle de conventionnalité de la loi postérieure en tentant une hasardeuse révision constitutionnelle.
En 1992, alors que la polémique enflait dans les cénacles européens, tant à Luxembourg qu’à Strasbourg, le Doyen Vedel fut tout de même saisi de la question, ou plutôt Le Comité consultatif pour la révision de la Constitution, dit commission ou comité Vedel. Institué le 2 décembre 1992, ce comité chargé de proposer des réformes institutionnelles pour la Ve République dut également plancher sur la question épineuse de la place du droit européen dans la hiérarchie interne des normes et sur les modalités constitutionnelles susceptibles de permettre de rétablir une cohérence d’ensemble dans un contexte maastrichtien dans lequel la France ne pouvait apparaître politiquement comme étant à la traîne du processus d’intégration européenne. Le président Mitterrand et le doyen Vedel eurent d’ailleurs un long échange sur cette question demeuré très confidentiel. On notera la présence opportune de Marceau Long dans ce comité ainsi que celle de plusieurs conseillers d’État, dont le président Braibant. On notera également la présence de Mme Delmas-Marty et du doyen Favoreu. Les débats furent houleux notamment entre ces deux derniers membres.
Lors d’une réunion qui se déroula un samedi matin, Mme Delmas-Marty indiqua :
« On peut toujours ignorer une réalité, en l’occurrence le droit européen et son autorité. Réprouver que ce dernier soit un progrès considérable pour les droits humains particulièrement concernant le Conseil de l’Europe mais également demain et cela a déjà commencé avec les principes généraux du droit communautaire, pour la Communauté européenne ; ne pas comprendre que l’État de droit s’est déployé et est aujourd’hui substantialisé par son arborescence normative, au profit des citoyens. Un nouveau traité communautaire est en cours d’élaboration il va pousser encore davantage le processus d’intégration européenne.
« Cette réalité est ignorée dès lors qu’une loi postérieure à l’entrée en vigueur d’un traité peut continuer à s’appliquer dans l’ordre juridique interne sans que ni le Conseil d’État ni le Conseil constitutionnel ne fassent quoi que ce soit. C’est constitutionnellement aberrant, cela crée un trouble dans l’application de la hiérarchie des normes et vient fragiliser un édifice juridique qui doit désormais s’apprécier dans son sens global, en tant que systèmes interpénétrés et non pas opaques ou étanches les uns vis-à-vis des autres. Le temps du droit interne qui fait face au droit externe est révolu, l’intégration du droit dit externe dans le droit interne est actée, elle était d’ailleurs actée dès la Constitution de 1946 et a fortiori dans celle de 1958. La situation actuelle n’est juridiquement pas correcte, elle ne peut par ailleurs pas perdurer en opportunité. »
Le doyen Favoreu prit la parole :
« Je ne suis pas d’accord avec vous chère collègue, il existe en fait deux hiérarchies des normes, la hiérarchie interne des normes et la hiérarchie européenne des normes. Je ne remets pas en cause la primauté du droit européen particulièrement du droit communautaire, mais cette primauté ne peut discuter le primat constitutionnel dans l’ordre interne. Vous indiquez que notre Constitution consacrerait la primauté du droit international et européen sur la loi, soit, mais elle ne prévoit pas que le Conseil constitutionnel intègre dans son contrôle de constitutionnalité de la loi le contrôle de conventionnalité et pour cause, ce sont deux contrôles bien différents et les normes internationales sont souvent contingentes et peu lisibles du point de vue normatif en droit interne, elles ne peuvent pas constituer une base de référence constitutionnelle. Il me semble qu’il est encore moins du rôle du juge ordinaire, du point de vue du principe de la séparation des pouvoirs de déjuger, si j’ose dire, le législateur. »
François Luchaire ajouta :
« En tout état de cause, la jurisprudence IVG est bien ancrée et je peux vous dire que ce n’est pas demain que le Conseil constitutionnel reviendra dessus, le contrôle du juge constitutionnel sur la loi, doit être dans une démocratie extrêmement circonscrit. »
Le Doyen Vedel prit la parole :
« Chers amis, vous avez tous raison ! le rôle de chaque juge, constitutionnel ou ordinaire n’est pas défini en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité par notre Constitution, qui est le socle suprême d’autorité normative de l’ordre interne. Remédions à cela ! Nos obligations européennes sont réelles et demain elles seront encore plus précises après la ratification du futur traité de Maastricht auquel le président Mitterrand tient beaucoup. Et puis nous avons des bases constitutionnelles tout de même en l’article 55 de la Constitution qui est clair quant à la hiérarchie entre normes externes et normes législatives, il est bien difficile de dire le contraire. Nous devons faire le constat d’une réalité qui ne nous permet plus de camper sur des positions idéologiques ou trop juridistes, peut-être même trop internistes. C’est notre Constitution de 1958 qui donne une habilitation à exercer le contrôle de conventionnalité, mais comme elle ne le fait pas suffisamment clairement il faut l’amender pour indiquer quel juge doit exercer ce contrôle afin de préserver la séparation des pouvoirs par un cadre constitutionnel lisible.
« Je crois qu’il est plus sain que le Conseil constitutionnel exerce à la fois le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, concomitamment, et il me semble qu’il faut qu’il puisse le faire a priori, saisi en ce sens par les autorités compétentes, et a posteriori, saisi en ce sens par les citoyens à l’occasion d’un litige en cours. Nous gagnerons sur toute la ligne, ce sera clair, lisible, cela évitera le maintien dans l’ordre interne d’une loi inconventionnelle, cela évitera certains jeux de cache-cache du législateur vis-à-vis du droit européen, mais sous l’autorité d’un juge qui peut stopper l’autorité de la loi en l’occurrence un juge constitutionnel, pas un juge ordinaire. Cela replacera le citoyen au cœur du jeu et le rapprochera du Conseil constitutionnel qui ne peut pas demeurer comme un cénacle inaccessible au citoyen au moins indirectement. Ce sera une réussite de l’État de droit renouvelé.
« Il me semble qu’il faut donc instaurer une question de constitutionnalité a posteriori et ajouter une disposition constitutionnelle indiquant que le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de conventionnalité de loi dans le même temps que son contrôle de constitutionnalité. Il y aura des inconvénients, le Conseil constitutionnel va devoir maîtriser mieux le droit externe y compris quand il est incertain ou peu lisible mais si la Cour de cassation y parvient, le Conseil constitutionnel avec les moyens adéquats y parviendra ! »
Le 15 février 1993, le rapport du comité fut rendu au président de la République qui en en suivant certaines préconisations fit voter au parlement réuni en congrès une révision constitutionnelle prévoyant la mise en place d’une question de constitutionnalité et un contrôle a priori et a posteriori de conventionnalité exercé par le Conseil constitutionnel concomitamment au contrôle de constitutionnalité.
Les débats furent houleux et la réforme constitutionnelle difficile à obtenir.
La ratification du Traité de Maastricht conforta les tenants de cette réforme dans leur choix, le potentiel conflit entre la loi et le droit européen devant selon eux se régler au niveau constitutionnel.
Finalement la révision constitutionnelle eut lieu et un nouvel article fut inséré dans la Constitution du 4 octobre 1958.
La physionomie du Conseil en changea, le service juridique fut largement étoffé, ses moyens également. Le Conseil dut se déplacer de la rue de Montpensier à l’Hôtel de la marine, place de la Concorde, ses services ayant augmenté de 1993 à 2000 à 108 personnes à l’instar d’autres cours constitutionnelles européennes comme la Corte constitucional italienne.
Le Conseil constitutionnel finit par estimer dans une décision de 2004 qu’une loi inconventionnelle était ipso facto inconstitutionnelle, fusionnant ainsi les autorités, à l’exception des dispositions expresses de la Constitution française dont la suprématie n’était pas impactée par le droit européen.
Le contexte politique changea également, la montée des extrêmes et la focalisation caricaturale sur les questions européennes conduisit à l’élection d’une candidate d’extrême droite à la présidence de la République, qui après moult volte-face et atermoiements décida d’engager, par la voie parlementaire, la sortie de la France de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, considérant que cela était vital pour la souveraineté nationale et que les juges européens étaient dangereux pour la démocratie (sic).
Les membres du Conseil constitutionnel avaient changé entre-temps, plusieurs professeurs de droit ayant été nommés et le professeur Ariane Vidal-Naquet ayant pris la présidence du Conseil constitutionnel.
Étonnamment la nouvelle présidente de la République ne choisit pas le référendum pour légitimer un Frexit large mais la voie parlementaire. Le populisme ambiant, l’antieuropéanisme bas de gamme et un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme mettant en cause la laïcité à la française en condamnant la France du fait de l’application d’une loi interdisant le port des signes religieux à l’Université (au mauvais moment et d’une manière bien maladroite il faut l’admettre), suffit à créer un mouvement entraînant, sur fond d’opinion publique chauffée à blanc contre « l’Europe », un appel quasi général à voter la réforme constitutionnelle.
Une bataille inédite s’engagea alors au Conseil constitutionnel, ce dernier considérant que l’appartenance à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe ne pouvait être remise en cause.
Il est vrai que les déclarations de la présidente de la République sur les juges et sur un certain nombre de droits fondamentaux faisaient froid dans le dos…
Le Conseil constitutionnel se fendit d’une décision très audacieuse dans laquelle il estima qu’en vertu de « l’esprit » de la Constitution, l’appartenance aux deux organisations européennes était désormais une garantie de la démocratie et de la séparation des pouvoirs et qu’elle constituait, par conséquent, le socle du maintien de valeurs fondamentales consacrées par la Constitution française. Par une formule hardie, le Conseil constitutionnel, qualifia la Constitution française de Constitution moniste avec primauté du droit international. La notion de supraconstitutionnalité fit son entrée avec grand bruit dans la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil estima en effet, qu’il avait toujours existé un socle de valeurs supérieures et intangibles qui faisaient de la France un État de droit et que désormais cela signifiait pour l’État français le respect de ses engagements européens comme garde-fou à la remise en cause d’éléments démocratiques essentiels et du principe de la séparation des pouvoirs. Le Conseil ajouta que l’insertion de l’État français dans des organisations internationales d’intégration et de défenses des droits humains était devenue un socle intangible du maintien des valeurs fondamentales de la société française.
Assumant ainsi tout en la créant une supraconstitutionnalité dont l’objet était de contrecarrer la réforme constitutionnelle jugée porteuse de dangers majeurs pour l’État de droit au vu des déclarations fracassantes de la présidente de la République, le Conseil constitutionnel décida d’assumer le considérant suivant (la fin justifiant le moyen) :
« Une réforme constitutionnelle incompatible avec les valeurs essentielles de la Constitution, est contraire aux principes supraconstitutionnels qui constituent son socle intangible et ne peut donc, produire ses effets. »
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil constitutionnel fit le cheminement suivant : à la question de savoir s’il était compétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi constitutionnelle adoptée par le congrès, il répondit pour la première fois par la positive. Estimant que bien que strictement délimité par la Constitution et plus précisément par ses articles 61 et 89, le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle, n’est circonscrit que lorsque le pouvoir constituant s’est lui-même prononcé. Revenant ainsi de manière abrupte sur sa décision du 26 mars 2003 par laquelle le juge constitutionnel s’était estimé incompétent pour statuer sur une demande de contrôle de constitutionnalité de la révision de la Constitution relative à l’organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 mars 2003, le Conseil consacra une distinction discutable entre le Congrès et le peuple français : selon lui seul le peuple français peut s’ériger en pouvoir constituant, une révision constitutionnelle adoptée par référendum empêchant le contrôle du Conseil constitutionnel. Le congrès ne peut pas en revanche être assimilé au pouvoir constituant, le contrôle d’une loi constitutionnelle adoptée par le congrès est donc possible. Une fois cette barrière de l’incompétence du Conseil constitutionnel opportunément levée, le juge constitutionnel a pu tout aussi opportunément consacrer une supraconstitutionnalité qu’il a immédiatement substantialisée par l’implémentation constitutionnelle des entités européennes.
La réaction des juristes fut circonspecte, bien que soulagée (du moins pour l’essentiel d’entre eux), celle des politiques fut furieuse, la présidente de la République parlant même de coup d’État du juge constitutionnel.
L’impasse juridique et politique fut complète et la présidente de la République demanda la suppression du Conseil constitutionnel, rien de moins, évoquant le gouvernement des juges comme l’on pouvait s’y attendre.
Les solutions juridiques à une telle impasse n’étaient pas légion et étaient toutes imparfaites : réformer la Constitution et supprimer le Conseil constitutionnel (et pourquoi pas ?) ; organiser un référendum pour opposer à la supraconstitutionnalité, la souveraineté populaire, le Conseil constitutionnel ne pouvant pas selon la présidence de la République s’opposer à la voix du peuple ; appliquer la réforme constitutionnelle votée par le congrès et squeezer la décision des juges de l’hôtel de la Marine (nous vous rappelons que le Conseil constitutionnel avait déménagé pour s’agrandir notamment du fait de l’entrée des normes internationales et européennes dans le bloc de constitutionnalité).
Heureusement pour le cœur des juristes, l’élection présidentielle suivante porta au pouvoir un européaniste non pas convaincu mais modéré soutenu par une majorité parlementaire suffisante. Ajouté au traumatisme que le casus belli que la précédente réforme constitutionnelle avait généré, cela permit de rétablir la Constitution dans sa forme initiale.
Certains professeurs de droit commentèrent cet épisode houleux de la Ve République comme la démonstration qu’aucun élément juridique et même constitutionnel n’est acquis et que le politique et les évolutions de la société peuvent toujours emporter les plus grandes constructions juridiques, mais que dans un État de droit, quand le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dérapent, il reste le juge, dont les armes ne sont pas si inoffensives. Certains estimèrent que cette crise paroxystique était la conséquence lointaine de la décision du Conseil d’État en 1989 de ne pas revirer sa jurisprudence des Semoules et de refuser d’accepter l’habilitation constitutionnelle à faire prévaloir la norme internationale ou européenne sur une loi postérieure à son entrée en vigueur, la faute de l’arrêt Nicolo en quelque sorte. Ils estimèrent que la hardiesse (pour ne pas dire la rébellion) du Conseil constitutionnel et son acculturation aux normes dites externes, sa capacité à se sentir juge de la constitutionnalité des lois au regard du droit européen, avaient été le lit de la consécration de la supraconstitutionnalité comme moyen de préserver les rapports de systèmes et la place du droit européen dans l’ordre juridique interne. Le Conseil constitutionnel avait fini par s’imprégner d’un monisme à primauté du droit international au point qu’il avait osé purement et simplement s’opposer à une réforme constitutionnelle considérée par lui comme contraire à l’État de droit, signifiant que la sortie des organisations européennes était donc, précisément, un danger majeur pour l’État de droit.
Une légende napolitaine dit qu’un imposant château, le Castel Dell’Ovo reposerait tout entier sur un seul œuf, magique, caché là par le poète Virgile et que si l’œuf était enlevé ou brisé, toute la ville s’effondrerait : Nicolo ou l’œuf magique du système juridique français ?
Baptiste Bonnet, « Le Droit administratif français sans l’arrêt Nicolo. Ou Paris sans la tour Eiffel », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4600.