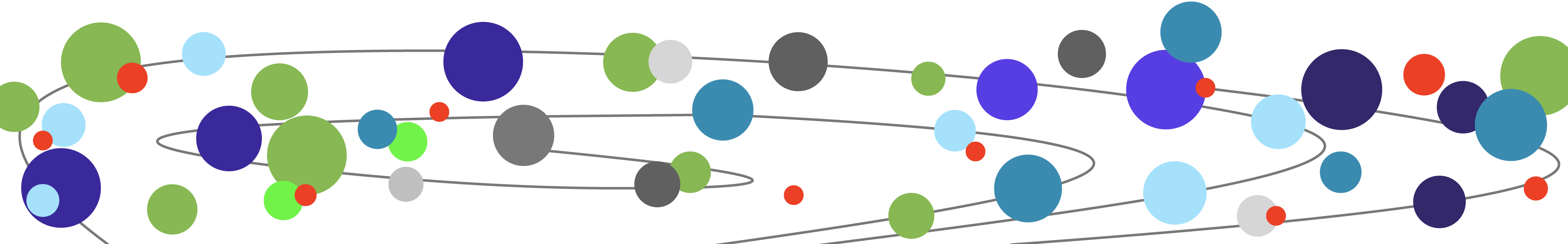Aude Rouyère
Professeur à l’Université de Bordeaux, Institut Léon Duguit (ILD)
La décision rendue par le Conseil d’État le 9 avril 1993 à propos de la responsabilité de l’État dans l’affaire du sang contaminé jouit d’une notoriété qui tient à de multiples facteurs : le caractère hautement sensible et complexe des faits en cause, la teneur de la réponse donnée, l’ampleur et la profondeur des conclusions d’Hubert Legal. L’apport jurisprudentiel au droit de la responsabilité en matière sanitaire n’est pas négligeable, mais sa contribution à la question de la nature de l’obligation pesant sur les acteurs publics en matière de risques sanitaires reste sur la réserve. Il y avait matière à une véritable innovation marquant une rupture, voire un changement de paradigme, dans la manière de concevoir l’action publique en contextes d’incertitude scientifique.
The decision judged by the Conseil d’État on April 9, 1993, regarding the State’s liability in the contaminated blood affair is renowned for multiple reasons : the highly sensitive and complex nature of the facts involved, the substance of the response given, and the breadth and depth of Hubert Legal’s conclusions. The judicial contribution to liability law in the health sector is significant, but its input regarding the nature of the obligation on public actors concerning health risks remains cautious. There was room for genuine innovation marking a rupture, if not a paradigm shift, in the way public action is conceived in contexts of scientific uncertainty.
[…] en situation de risque une hypothèse non infirmée devrait être tenue, provisoirement, pour valide, même si elle n’est pas formellement démontrée1.
Dans sa décision du 9 avril 19932, le Conseil d’État a posé que la responsabilité de l’État peut être engagée par toute faute commise dans l’exercice des attributions relatives à l’organisation générale du service public de la transfusion sanguine, au contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et à l’édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain. En l’espèce, la responsabilité de l’État est établie vis-à-vis de personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) à la suite d’une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 nov. 1984 et le 20 oct. 1985. Le Conseil d’État juge en effet qu’il « appartenait à l’autorité administrative, informée à ladite date du 22 nov. 1984, de façon non équivoque, de l’existence d’un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d’y parer par l’utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d’interdire, sans attendre d’avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux »3.
Dans un contexte marqué par l’apparition de la notion de sécurité sanitaire4, l’abandon de l’exigence d’une faute lourde et l’identification de cette faute dès novembre 1984 ont marqué les esprits et valu à cet arrêt sa notoriété. Si la solution adoptée dans cette affaire hautement sensible marque une avancée incontestable, on ne peut ignorer l’effet de trompe-l’œil qu’elle a produit.
Une solution plus audacieuse, qui eut sans doute semblé inacceptable, apparaît pourtant rétrospectivement envisageable dès cette époque-là. En statuant dans cette affaire sur le fond, le Conseil d’État avait l’occasion de produire une jurisprudence que l’on pourrait qualifier de visionnaire. Si cette virtualité retient l’attention, c’est en raison du bouleversement qu’elle aurait peut-être pu initier en matière de traitement du risque.
Salué comme une étape majeure du droit de la responsabilité, cet arrêt comporte, en effet, une dimension politique indéniable5. L’État doit encore et toujours, apporter la démonstration de sa capacité à opérer des choix stratégiques pertinents en matière de santé publique6.
La relecture, trente ans plus tard, de la motivation de la décision, des conclusions et des commentaires qui l’ont accompagnée incite à imaginer une position juridictionnelle plus radicale et à spéculer sur ses incidences dans la conduite de l’action publique en matière de gestion des risques sanitaires.
Il s’agit donc d’abord de reconsidérer le sens et la portée de cette décision (I) afin d’identifier quelle aurait été l’« autre » réponse possible, et le potentiel de transformation de l’action publique qu’elle aurait pu inspirer (II)
I. Audace ou réajustement du raisonnable ?
Il est nécessaire de rappeler précisément le contexte scientifique et juridique de l’affaire pour prendre la mesure de la décision qui a été rendue par le Conseil d’État. À cet égard, on observe un décalage entre les réflexions très précises, voire méticuleuses, auxquelles elle a donné lieu et le récit qui en a résulté. Et mise en perspective avec celles qui l’ont précédé en première instance et en appel, on constate qu’elle a donné lieu à une présentation amendable à la simple lecture des éléments abondamment décrits et analysés du dossier.
A) Un contexte sanitaire complexe
Dès mai 1982 apparaît une information suggérant un lien entre les transfusions sanguines et le sida. Des personnes dotées d’une autorité scientifique reconnue – tels les professeurs Gallo et Saxinger, du National Cancer Institute (États-Unis) – avaient attiré l’attention sur le risque de propagation, par voie sanguine, de la nouvelle maladie dont les premiers cas cliniques avaient été identifiés l’année précédente. Il convient de citer leurs propos publiés dans la revue The Lancet pour percevoir la manière dont l’hypothèse du risque est posée :
Actuellement, les données relatives au danger de contamination présenté par des donneurs porteurs du virus du Sida ou séropositifs sont encore fragmentaires, mais nous croyons que la réalité de ce danger est suffisamment établie pour identifier d’ores et déjà des catégories de receveurs plus particulièrement exposées, telles les femmes enceintes, et pour mettre en œuvre des procédures en vue d’un examen préliminaire du sang et des produits sanguins7.
Mais ce n’est qu’au premier semestre de l’année 1983 que se manifeste la prise de conscience d’un risque et il est considéré que ce n’est qu’en janvier 1984 qu’il est tenu pour avéré. Ainsi une première circulaire du 20 juin 19838 recommande d’écarter des dons les sujets « à risque » (homosexuels, usagers de drogues injectables, haïtiens, hémophiles et leurs partenaires sexuels). Le résultat obtenu par cette préconisation reste modeste au point qu’une lettre circulaire de janvier 19859 lance un rappel à l’ordre et demande son application stricte. La commission d’enquête du Sénat affirme sans détour que l’inapplication des consignes définies par la circulaire du 20 juin 1983 « traduit l’aveuglement initial de la Transfusion sanguine française face au danger de contamination par le virus du Sida ». Lorsqu’est enfin instauré, à partir du 1er août 1985 le dépistage obligatoire des donneurs de sang, il a été estimé que 45 % des hémophiles français avaient été contaminés par le virus du sida, jusqu’en 1984-198510. En outre, il a fallu attendre le 20 octobre 1985 pour que soit interdite, par voie de circulaire, l’utilisation des produits sanguins non chauffés11.
Le dépistage systématique du virus du Sida chez les donneurs de sang bénévoles aurait-il pu être instauré avant le 1er août 1985 ? La réponse, positive, qui est donnée dans le rapport du Sénat, pointe un manque de célérité dans la mise en place des procédures généralisant le contrôle des dons du sang. Les retards ont concerné la mise au point du test de dépistage par l’Institut Pasteur, l’agrément des tests de dépistage disponibles sur le marché français et la fixation de la date d’entrée en vigueur du dépistage systématique des dons du sang12. Quant à l’origine de ces retards et dysfonctionnements, quatre facteurs sont identifiés, à savoir « la coordination imparfaite d’un processus décisionnel fragmenté », « la différence de perception de l’utilité du dépistage par les acteurs concernés », « l’attention accordée aux enjeux industriels et commerciaux », et « le poids des considérations d’ordre budgétaire »13.
B) Une mise en jeu de la responsabilité de l’État périlleuse
Le Conseil d’État a, dans sa décision du 9 avril 1993, statué en faveur de la responsabilité de l’État sur le fondement d’une faute établie à partir du 22 novembre 1984 et jusqu’au 20 octobre 1985 et non soumise à la condition de gravité eut égard tant à l’étendue des pouvoirs dévolus à l’État qu’à leur finalité. Il revient donc sur ce qui avait été jugé auparavant, notamment sur la question du point de départ de la mise en jeu de la responsabilité de l’État qui retiendra toute notre attention.
1) La « prudence » des premiers juges
Dans trois jugements du 20 décembre 1991, le Tribunal administratif de Paris a admis la responsabilité de l’État pour faute dans l’exercice de son pouvoir de réglementation des produits sanguins et situé cette responsabilité du 12 mars 1985 au 1er octobre 198514. Les juges ont en effet estimé que l’autorité ministérielle avait été, à partir de cette date du 12 mars 1985, informée de « la très forte probabilité de ce qu’en région parisienne tous les produits sanguins préparés à partir des pools de donneurs parisiens étaient actuellement contaminés ». Et ils en ont déduit qu’« en n’édictant pas immédiatement une mesure d’interdiction de distribution desdits produits, en droit ou en fait, l’autorité chargée de la police sanitaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État »15. Ce faisant, le Tribunal n’a pas suivi le point de vue des requérants qui situaient la carence dès une date plus précoce, soit le mois de mai 1983, à partir duquel il était acquis, selon eux, que les produits non chauffés présentaient un risque de contamination. On relève, en outre, que le Tribunal se rallie à la formule de la « faute de nature à » dont on sait qu’elle maintient une sorte d’appréciation tout en marquant l’abandon de la faute dite lourde.
L’argument formulé par le commissaire du gouvernement16 dans ses conclusions au soutien du choix de la date 12 mars 1985 met l’accent sur le rôle de l’évidence ou plus précisément des acquis scientifiques pour cerner la faute17. L’appréciation portée sur ce qui n’a pas été fait durant la période qui s’est écoulée entre 1983 et la date du 12 mars 1985 – « Même si l’on peut reprocher une certaine léthargie administrative, elle n’est pas constitutive d’une faute lourde. Le retard à agir, si on veut ainsi qualifier cette période d’hésitation et de doute partagés avec la communauté scientifique, n’a pas été anormal » – est à cet égard sans équivoque. Le raisonnement est d’ailleurs cohérent, puisque la difficulté inhérente à l’incertitude pourrait justifier cette nécessité d’une faute lourde. On comprend moins la raison qui commande une telle exigence lorsqu’on est passé à une situation de risque certain. Et pourtant le commissaire du gouvernement estime que « les autorités compétentes étaient pleinement averties des risques que comportait le maintien sur le marché de produits dangereux pour la santé publique et que l’absence de mesures appropriées immédiates révèle une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État envers les personnes qui ont été transfusées à partir de cette date ».
Le Tribunal se ralliera au constat de l’absence de faute avant le 12 mars 1985 : « en se bornant, le 20 juin 1983, à édicter, par voie de circulaire, une recommandation relative à la sélection des donneurs de sang, à l’information des donneurs et médecins des centres de transfusion des risques potentiels de contamination, l’autorité administrative n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ». Puis relève « qu’après cette date les connaissances scientifiques se sont constamment approfondies », pour finalement établir la responsabilité de l’État entre le 12 mars et le 1er octobre 1985.
La Cour administrative d’appel de Paris, de son côté, a confirmé par trois décisions du 16 juin 199218, le principe d’une responsabilité de l’État pour carence dans l’usage de ses pouvoirs de réglementation des produits sanguins, tout en estimant que seule une faute lourde était de nature à permettre de retenir la responsabilité de l’État « compte tenu des difficultés inhérentes à l’exercice de ses attributions ». Néanmoins, la date de constitution de la faute demeure celle du 12 mars 1985. Quant à la date de fin de la faute, la Cour retient la date d’adoption de la circulaire formulant une interdiction d’utilisation de produits sanguins non chauffés, soit le 20 octobre 1985.
2) L’« audace » du Conseil d’État
La décision du Conseil d’État tranche avec celles qui ont été rendues précédemment sur la question de la caractérisation de la faute et sur celle de la période de sa réalisation.
Les compétences de l’État en matière de gestion des produits sanguins comportent l’organisation du service, le contrôle des établissements et la réglementation. Seule l’activité de contrôle pouvait donner lieu à hésitation quant à la nature de la faute. Mais le mouvement jurisprudentiel engagé pour l’abandon de la faute lourde19 et son image particulièrement anachronique en matière de santé publique ont conduit à en écarter le principe en la matière. Le Conseil indique ainsi « qu’eu égard tant à l’étendue des pouvoirs que ces dispositions20 confèrent aux services de l’État en ce qui concerne l’organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l’édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu’aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l’État peut être engagée par toute faute commise dans l’exercice desdites attributions »21.
La détermination de la période fautive est celle qui constitue le principal intérêt de cette affaire.
La date de fin de la faute ne pose pas de difficulté particulière. Entre le 1er octobre 1985, date de suppression du remboursement des produits sanguins non chauffés et le 20 octobre 198522, date de l’interdiction de ces derniers, le Conseil d’État, confirmant la position du juge d’appel, retient la seconde qui a le mérite de la clarté.
La date de début de la période fautive est en revanche plus délicate. Alors que le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel ont opté pour celle du 12 mars 1985, date d’une note interne au directeur général de la santé, le Conseil d’État retient celle du 22 novembre 1984, date d’un rapport soumis par un épidémiologiste de la direction générale de la santé à la commission consultative de la transfusion sanguine, qui « consigne » des faits par ailleurs déjà connus dans la sphère scientifique23. Le décalage entre la diffusion d’informations au sein de la communauté scientifique et le moment où celles-ci sont portées à la connaissance de l’administration est constaté par la Haute juridiction et en quelque sorte intégré dans l’analyse de la responsabilité de l’État.
En choisissant une date antérieure à celles des juges du fond, la décision du Conseil d’État, éclairée par les conclusions d’Hubert Legal, a pu sembler particulièrement innovante en matière de gestion des risques sanitaires. L’est-elle autant qu’on a pu le penser ? Ou bien ne s’agit-il pas simplement de l’application d’une exigence classique de prévention à l’égard d’un risque dont l’existence est indiscutable ? C’est à cette seconde lecture, et donc à un regret rétrospectif, que l’on se rallie sans beaucoup d’hésitation. Le Conseil d’État pouvait-il retenir une date encore plus précoce et, à la faveur d’une authentique audace, consacrer une véritable exigence de précaution ? Le scénario imaginé est loin d’être fantaisiste ou irréaliste.
II. L’occasion manquée d’un grand arrêt « disruptif » ?
On ne le dira jamais assez, le droit a horreur du vide. Et en matière de responsabilité, il est plus facile de censurer une action qu’une absence d’action relevant du manquement et qualifiée de carence. La principale difficulté de l’affaire tient en cela et prend une tournure encore plus complexe lorsqu’est en question la teneur même de l’obligation qui pèse sur les autorités chargées de la police sanitaire. Cette problématique détermine le potentiel jurisprudentiel explosif de la décision. Car la voie ouverte par une solution plus radicale dévoile des enjeux qui vont bien au-delà de ceux qui sont attachés au seul mécanisme de la responsabilité de l’État.
A) Une innovation jurisprudentielle à portée de main
La détermination de la faute commise par l’État dans l’exercice de son activité d’encadrement de la transfusion sanguine, et en particulier de police sanitaire, est en l’espèce plus problématique que sa caractérisation.
L’abandon de l’exigence d’une « faute lourde » au profit de « toute faute » comporte une dimension technique, mais également symbolique qui a capté l’attention alors même que le mouvement jurisprudentiel était déjà engagé. Pas d’innovation majeure donc, même si le sujet conserve une part de non-dit puisqu’il n’est pas acquis que « toute faute » soit « de nature à engager la responsabilité de l’État ».
L’identification du manquement est autrement plus embarrassante. Cela suppose de trancher la question de savoir si l’erreur commise est fautive ou pas. Si elle l’est, c’est parce qu’il est établi qu’une obligation a été méconnue. Mais encore faut-il définir l’obligation à laquelle ne s’est pas tenue l’autorité de police sanitaire : prudence, prévention… précaution ? Voilà le cœur du sujet. Or, sur ce point, l’arrêt est finalement assez peu explicite. Hubert Legal avait pourtant exposé l’enjeu de la décision dès les premiers mots de ses conclusions : « La recherche d’une faute objective, qui s’accompagne, dans une démarche de modélisation de l’acte administratif, qui est le propre du droit public, de la définition en creux de ce qu’aurait été, de la part de l’administration de l’État, une réponse acceptable à l’événement, impose une grande prudence face aux perspectives faussées par le passage du temps »24.
1) Le moment de la précaution
La fixation, par la Haute juridiction, d’une date de début de la responsabilité de l’État plus précoce que celle qui avait été fixée auparavant, est-elle véritablement significative quant au type d’obligation mis à la charge de l’État ? Voilà, nous semble-t-il, la question cruciale que posait la décision du Conseil d’État et que l’on reformule aujourd’hui, à la lumière du chemin parcouru en matière de gestion des risques sanitaires25.
Quand Hubert Legal affirme dans ses conclusions : « En ce qui concerne son commencement, notre conviction très ferme est que la date du 12 mars est nettement postérieure à celle à laquelle l’administration avait l’obligation d’intervenir », on pense immédiatement aujourd’hui à la distinction entre une obligation classique de prévention et celle, à l’époque encore peu familière, de précaution.
Il ne relève pas de l’objet de ce propos de développer une analyse du principe de précaution. Rappelons seulement très schématiquement qu’il est défini comme visant une situation dans laquelle l’incertitude porte sur l’existence même du risque26. Ou, pour le dire autrement, l’incertitude n’a pas le même siège dans le cas de la prévention et dans celui de la précaution. La prévention vise une situation dans laquelle l’incertitude porte sur la probabilité et les conséquences d’un risque résultant d’un danger établi. Tandis, et c’est essentiel, que dans le cas de la précaution, l’incertitude porte sur l’existence même du danger et donc du risque qu’il est susceptible d’engendrer.
La littérature multidisciplinaire qui s’est développée avant et après la consécration juridique du principe de précaution, comme le droit positif construit depuis cette dernière, échappent à toute tentative de synthèse. Mais cet exercice de réflexion rétrospéculatif y trouve tout de même un appui27. Ainsi, à la lumière des avancées mais aussi des résistances dans la manière de considérer le risque depuis une trentaine d’années, on peut imaginer un autre parti que celui qui a été adopté par le Conseil. Et, peut-être, une autre manière d’appréhender les hypothèses de risques qui ont émergé depuis cet épisode dramatique.
Pour ce faire, la nécessité de ne pas perdre de vue le « risque que comportent les certitudes forgées a posteriori en fonction d’un état des connaissances qui a beaucoup évolué »28, déjà impérieuse en 1993, l’est a fortiori aujourd’hui. On raisonnera donc en s’efforçant de s’en tenir aux connaissances effectivement acquises à l’époque des faits et telles qu’elles sont restituées dans les décisions juridictionnelles.
La ligne de conduite envisageable à ce moment-là, c’est-à-dire entre 1983 et 1985 est décrite par Hubert Legal en des termes qui posent une sorte de doctrine :
Face à un risque connu comme mortel pour un certain nombre de patients au moins, il serait évidemment irréaliste d’affirmer que seule une certitude scientifique fait obligation d’agir. Entre l’ignorance et une connaissance certaine des mécanismes selon lesquels agit un produit, il y a au moins deux stades : celui de l’accumulation d’indices qui aboutit à la formulation d’une hypothèse et celui où une vérification pragmatique permet de regarder cette hypothèse comme confirmée sans que pour autant les raisons scientifiques de sa validité soient parfaitement élucidées29.
Or, et toujours selon le commissaire du gouvernement, « l’on avait atteint ce stade, en ce qui concerne la transmission du virus de l’immunodéficience par la voie sanguine, au plus tard en novembre 1983 et, en ce qui concerne la possibilité d’inactiver le virus par le chauffage des produits sans en réduire de façon perceptible la valeur thérapeutique, au plus tard en octobre 1984. »
En retenant la date du 22 novembre 1984, le Conseil d’État fait un choix qui, sans la nommer évidemment, relève de la prévention. On peut d’autant plus le penser au vu des conclusions qui, toujours sans viser l’obligation, étayent avec soin la proposition : « Nous estimons qu’au plus tard à cette date une administration convenablement informée et disposant de capacités de décision correspondant à l’importance des pouvoirs qu’elle détenait ne pouvait pas, sans faute, alors qu’il ne s’agissait que de la confirmation d’une alerte lancée depuis plusieurs mois, se borner à laisser les études se poursuivre et les tergiversations intéressées (ou d’ailleurs de bonne foi) perdurer ». Et on en trouve la traduction, dans ces mêmes conclusions, de manière encore plus explicite : « sur le terrain de la faute simple, nous estimons qu’à cette date le risque était suffisamment manifeste pour interdire l’inaction ». Car à cette date et toujours selon les éléments rapportés dans les conclusions « le doute n’était plus permis ». Il est d’ailleurs souligné qu’entre novembre 1984 et mars 1985 – date choisie par les juges du fond – il n’y a pas eu d’évolution très notable des connaissances sur les risques de la transfusion et sur l’efficacité des produits chauffés. Ce n’est donc pas au titre d’une autre obligation pesant sur l’État que la date est avancée de quelques mois mais plutôt parce que rien ne justifiait de retenir la date de mars 1985 à niveau de connaissances égales. Ou, en d’autres termes, parce que dès novembre 1984 l’exigence de prévention commandait à l’autorité de police sanitaire d’intervenir de manière claire et nette30.
L’arrêt du 9 avril 1993 n’apparaît pas ou plus comme une décision audacieuse ou innovante31. Elle consacre une obligation bien connue de prévention, c’est-à-dire de traitement d’un risque dont l’existence n’est pas en cause à la différence de l’obligation de précaution qui est constituée en présence d’un risque dont l’existence relève encore de l’hypothèse32.
2) La possibilité d’une mesure de précaution
Le scénario alternatif consistait donc à situer encore plus tôt la date de début de la carence fautive de l’État. Cette solution ne relève pas d’un point de vue arbitraire, mais repose sur les éléments livrés, dans la décision du Conseil d’État, les conclusions qui l’accompagnent ainsi que dans le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 1992, à propos de la période s’écoulant entre 1983 et 1985. Revenons à la distinction déjà citée33 entre deux stades en matière de risque, « celui de l’accumulation d’indices qui aboutit à la formulation d’une hypothèse » et « celui où une vérification pragmatique permet de regarder cette hypothèse comme confirmée sans que pour autant les raisons scientifiques de sa validité soient parfaitement élucidées ». Hubert Legal semble estimer, on l’a déjà indiqué, que ce second stade avait été atteint dès novembre 1983 en ce qui concerne la transmission du VIH par voie sanguine.
Imaginons alors que le Conseil d’État ait raisonné autrement et estimé que dès le premier stade du risque – celui où « l’accumulation d’indices » aboutit à « la formulation d’une hypothèse » – l’État devait prendre des mesures de police sanitaire. Pour traduire cette obligation relevant d’une exigence de précaution, la date de départ de la carence fautive aurait été située « au plus tard en novembre en 1983 »34 et même dès la circulaire du 20 juin 198335 qui formulait la recommandation d’écarter des dons les sujets « à risque » et qui marque de façon tangible la constitution d’une hypothèse étayée par une « accumulation d’indices » ou en d’autres termes une suspicion étayée et encore non vérifiée36. Cette recommandation révèle la connaissance de l’hypothèse et constitue aussi la faute de l’État en ce qu’il aurait dû prendre une mesure contraignante d’interdiction suivie ensuite d’autres prescriptions de précaution37 puis de prévention.
Une exigence de précaution ainsi consacrée aurait-elle pu relever de « ce que l’on pouvait raisonnablement tenir au fil du temps comme suffisamment établi dans la connaissance générale du phénomène et de ses solutions pour rendre nécessaire la prise de mesures sanitaires »38 ? La question mérite d’être examinée sous deux angles bien différents mais en réalité liés.
La réception effective d’une obligation de précaution en droit positif dépend d’abord du degré d’acculturation à la norme de précaution et de l’acceptabilité de sa mise en œuvre. Rappelons que le principe de précaution est apparu au cours des années 1980 principalement en Allemagne, et n’a acquis le statut de règle de droit applicable en droit français qu’à partir de 199239. Il est indéniable que l’idée d’être à la fois dans l’innovation et dans la précaution n’est pas encore dominante dans les esprits. Certes… mais pas en matière médicale. Et si les médecins ont toujours manifesté une certaine méfiance à l’égard du principe, c’est sans doute en partie parce que cette notion est déjà intégrée dans les règles qui régissent leurs pratiques, notamment d’un point de vue déontologique. Une décision, parmi beaucoup d’autres, témoigne de cette singularité. Examinant la décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 décembre 1999 qui a posé la responsabilité de l’APHP pour faute à propos d’une transfusion sanguine à un hémophile entre le 30 janvier et le 24 septembre 1984, le Conseil d’État a en effet jugé que cette dernière « a pu déduire de ces constatations de fait […] qu’alors même que les risques liés à la transfusion de produits fractionnés et concentrés n’étaient pas encore connus dans toute leur ampleur et que la date des transfusions prescrites […] est légèrement antérieure à la date du 22 novembre 1984 à partir de laquelle la responsabilité de l’État est engagée faute d’avoir interdit la délivrance de ces produits, le service médical hospitalier avait fait courir à M. X… un risque injustifié engageant la responsabilité pour faute » de l’AP-HP40.
La sanction de cette obligation de précaution dépend également du type de faute exigé pour engager la responsabilité d’une personne publique, en l’occurrence ici l’État. Autant l’exigence d’une faute lourde, parce qu’elle suppose un manquement grave, fonctionne mal avec le doute qui caractérise un contexte de précaution, autant la faute dite simple est celle qui peut viser des défaillances moins évidentes à propos de cas plus complexes. L’abandon de la condition de la faute lourde dans la décision du 9 avril 1993 ouvrait ainsi la voie à la consécration d’une norme de traitement du risque plus contraignante41.
Que se serait-il passé alors, si le juge administratif avait osé imposer à l’État une telle exigence de précaution, au moins dans la gestion des risques sanitaires relevant d’une latitude de choix stratégique42 ?
B) L’enclenchement d’un engrenage « vertueux » ?
C’est en s’appuyant sur les propriétés – et fonctions – normative, préventive et même d’anticipation43 de la responsabilité civile, que l’on peut spéculer sur une transformation de l’action publique en situation de risques potentiels. Il s’agit de miser sur l’orientation des comportements « sur un mode intériorisé », ou encore sur un phénomène de « guidage-responsabilisation »44.
Les effets que l’on pourrait prêter à une décision juridictionnelle instaurant une authentique exigence de précaution se situent principalement sur deux plans. Il est probable que cette évolution en matière de responsabilité de l’État dans la gestion d’un risque aurait engagé une mutation des rapports entre science et droit. Il aurait peut-être pu en résulter alors, une réforme structurelle du processus de décision en matière sanitaire ou encore la promotion d’une nouvelle approche du principe de bon gouvernement.
1) Science et action publique
La transformation des rapports entre science et droit est, au fond, le grand enjeu du contentieux jugé en 1993. Il s’agit pour les autorités publiques en charge d’un risque sanitaire de se situer au plus près des connaissances sanitaires et en même temps de savoir s’en affranchir pour produire une décision de gouvernement45. Cette posture suppose un changement dans la manière dont les décideurs publics conçoivent leur intervention normative. Doivent-ils réagir à des informations fournies avec plus ou moins de délai par la communauté scientifique ou provoquer la délivrance de ces dernières à la faveur d’une vigilance continue ? Cette obligation d’acquérir la connaissance, soulignée par M-A. Hermitte46, rendrait possible l’autonomie de la décision administrative par rapport aux critères probatoires de la sphère scientifique. Or le principe de précaution prescrit cette démarche administrative de quête d’informations47. La précaution relève d’une politique de gestion de l’hypothèse d’un risque et non de son appréhension purement scientifique. La Commission européenne distingue ainsi la gestion du risque, acte politique et juridique fixant le niveau acceptable de ce dernier en s’appuyant sur le principe de précaution, et l’évaluation, activité scientifique relevant d’une démarche de prudence définie par la communauté scientifique48. Sans forcer le trait de ce clivage, il s’agit donc de bien identifier ce qui relève de deux pouvoirs et de défendre le principe de leur séparation.
L’expérience récente de la crise sanitaire liée au Covid-19 nous a montré que cette idée n’était pas revendiquée. Bien au contraire, elle nous a donné à voir, presque quotidiennement, la mise en scène d’une imbrication des points de vue, noyant la décision politique et juridique dans l’embarras partagé de l’incertitude scientifique. Il s’agissait manifestement de masquer plutôt que d’assumer un hiatus inévitable entre les multiples avis d’experts et les décisions administratives.
Le cloisonnement est pourtant en principe clairement établi, d’un côté comme de l’autre. Chaque domaine – la science d’un côté, l’action politique et sa traduction juridique de l’autre – revendiquant leur propre rationalité. L’incertitude y est abordée différemment, même si on observe que la controverse scientifique peut user de mises en scène rhétoriques propres à l’argumentation juridictionnelle49.
On relève néanmoins que tout ce qui a été dit, dans et à propos de la décision du Conseil d’État, maintient l’idée que ce n’est que lorsque l’administration est censée être informée que prend corps son obligation d’agir. Or, la carence que l’on suggère de considérer comme fautive prend naissance bien avant le stade de la décision, au niveau de la phase de recueil spontané d’informations en vue de celle-ci. C’est ici qu’apparaît nettement ce qui distingue le scientifique du décideur public. Les incertitudes sont susceptibles de justifier que soit différée l’information de la part des scientifiques. En revanche, elles sont de nature à déclencher une obligation d’action de la part des autorités sanitaires. Ne perdons pas de vue que l’exigence de précaution commande une « stratégie de transition »50, ce que précisément le Conseil d’État ne relève pas et qui aurait pu fonder un manquement dès 1983, voire 1982.
En outre, et comme le remarque M.-A. Hermitte, si l’on veut appliquer le principe de précaution, « il est dans la nature des choses de prendre des précautions qui se révèleront inutiles ». De ce point de vue, il appartient aux juges de situer le comportement fautif sur le terrain de la carence plutôt que sur celui-ci de l’excès de prudence. Ce dernier n’excluant pas la réparation d’un éventuel préjudice sur un autre terrain, débarrassé de la fonction normative du fondement fautif.
Le Conseil d’État pouvait-il prendre l’initiative d’intégrer cette charge dans les obligations pesant sur l’État au début des années 1980 ? On nous objectera qu’à cette période le principe n’était pas formalisé juridiquement. Mais il s’agit ici d’une exigence de précaution et non du principe lui-même, c’est-à-dire une règle de conduite présente dans les normes de la déontologie médicale et de manière plus générale rattachable à une ligne de conduite relevant du bon sens51. Et puis, comme on le sait bien, cela n’aurait pas été la première fois qu’une obligation est rétroactivement applicable du fait d’un revirement de jurisprudence. La fin poursuivie justifie parfois le moyen, en l’occurrence cette forme d’instrumentalisation de la responsabilité civile.
En pointant l’obligation pour l’administration de bâtir sa démarche de surveillance et de traitement du risque, avec la communauté scientifique, mais selon son propre tempo, le juge aurait esquissé une profonde transformation de l’administration elle-même. C’est-à-dire de sa composition, de ses méthodes de travail, de sa capacité à défendre ses choix, fussent-ils encore difficilement acceptés.
2) Le gouvernement de précaution
L’enjeu d’une responsabilité de l’État pour défaut de précaution aurait été de renouveler les repères de l’action politique attendue et acceptable. Ainsi Bruno Latour écrivait-il en 2007, « le principe de précaution, c’est l’émancipation de la politique, enfin libérée de la tutelle où la tenait l’attente indéfinie d’une expertise indiscutable. C’est le retour au sens commun »52.
Ainsi l’effet d’une jurisprudence disruptive aurait peut-être été d’enclencher le retour (?) vers une forme d’évidence. Se prémunir contre une hypothèse de risque n’est-il pas du ressort de la simple prudence ? On peut évidemment refuser pour soi de se ranger à une telle attitude. Mais il est plus discutable de faire de ce refus un principe de gouvernement pour autrui. Dans l’affaire du sang contaminé, les faits en font la démonstration tragique.
Comment apprécier alors les prescriptions induites par cette « autre » décision juridictionnelle, celle qui sanctionnerait un défaut de précaution ? Le chantier est vaste et on se bornera ici à en évoquer certains aspects.
Un État gestionnaire des risques53 pilote une action publique de l’hypothèse. Il lui revient de développer une activité de veille permettant une forte réactivité aux informations nouvelles et une capacité à assurer l’exécution de décisions dont l’acceptabilité est parfois fragile. La structure étatique doit être en mesure de tenir sa position face à la communauté scientifique en s’appuyant sur une légitimité propre54. Mais encore faut-il que cette dernière soit assez solide pour se le permettre…
On ne dressera pas ici un bilan de la réorganisation structurelle profonde qui a été mise en œuvre pour répondre aux dysfonctionnements révélés par l’affaire du sang contaminé. On assiste effectivement à une « refonte des vigilances » qui s’est traduite par la création d’agences nationales dédiées au quadrillage d’une politique de sécurité sanitaire. Mais on observe dans la littérature qui s’attache à suivre cette réforme, des analyses très contemporaines pointant encore la nécessité « d’adapter le système de veille et de vigilance aux “signaux faibles” et aux risques émergents »55.
Ensuite, l’exigence de précaution impose la rapidité et la fluidité dans la mise en œuvre du processus de décision administrative. Or, un des maux dénoncés par les acteurs de la santé publique est la dilution de celui-ci « dans les méandres d’une interministérialité dont le fonctionnement est d’autant moins assuré que les objets sont complexes et incertains »56. Le cloisonnement des ministères et des administrations spécialisées engendre celui des politiques sectorielles57. Le passage « de la connaissance à la décision puis à l’action n’est pas linéaire »58, il est même parfois chaotique, s’étirant jusqu’au délitement de la stratégie définie avec peine. L’État a pris la main sur le traitement des risques, ce qui ne signifie pas qu’il dispose de la latitude nécessaire à l’élaboration d’une politique. Le paradoxe que dénoncent François Ewald et Denis Kessler est à cet égard saisissant : « plus l’État-providence reconnaît l’importance des risques comme matière d’administration, plus il en réduit l’existence dans sa manière de gouverner »59. En fixant la faute de l’État dès 1983 dans l’affaire du sang contaminé, le juge aurait peut-être engagé une dynamique de nature à transformer le travail gouvernemental.
Il faut également poser le problème en ne perdant pas de vue la question de l’acceptabilité du risque. Tout dépend principalement de la méthode choisie pour le traiter60. Une date plus précoce de la période fautive aurait eu pour conséquence d’ouvrir l’indemnisation à davantage de victimes. Cette option aurait-elle contribué à déstabiliser le mécanisme de responsabilité61 ? Elle en aurait accentué la fonction directive au détriment sans doute de la régulation de la charge indemnitaire. Mais cette dernière relève d’une préoccupation de finances publiques qu’il faut poser sur le long terme. Un État qui agit pour maîtriser les hypothèses de risques préserve l’État de contentieux indemnitaires futurs.
Le gouvernement de précaution serait-il celui de la sur-précaution ? L’intégration de l’exigence de précaution dans la conduite des situations de risques est susceptible d’alimenter, outre le contentieux de la carence, celui de l’excès de précaution 62 ? Dans un cas comme dans l’autre, il demeure que pour saisir la faute en lien avec l’exigence de précaution, il faut définir les types d’actions que les acteurs publics doivent entreprendre sur le modèle posé aujourd’hui par l’article 5 de la charte de l’environnement. Gouverner en précaution suppose de conjuguer une action d’acquisition de connaissances complémentaires et une action conservatoire63. La faute de défaut de précaution présente ainsi une singularité qui tient à la pluralité de ses composantes et à son caractère irréductiblement complexe64. Le Conseil d’État pouvait en 1993 saisir ces éléments et s’engager sur la voie d’une sorte de révolution méthodologique et stratégique en matière de gestion des risques sanitaires. S’il ne l’a pas fait c’est aussi parce que cela l’amenait à engager une profonde transformation du droit de la responsabilité civile des personnes publiques et probablement aussi des personnes privées ? C’est bien en ces termes que la doctrine a perçu les enjeux du principe de précaution dans les années 200065.
3) L’inertie d’un modèle ?
Il faut, pour finir, interroger le chemin parcouru depuis 1993. Que s’est-il passé en matière de traitement d’une hypothèse de risque depuis l’affaire du sang contaminé ? Ou plutôt qu’est-ce qui ne s’est pas passé et qu’une autre décision aurait peut-être fait advenir ? La question ne vaut évidemment que pour des cas comparables à celui du sang contaminé c’est-à-dire des situations de « doute légitime »66. Quelques exemples suffiront à tracer une sorte de bref bilan. Globalement, on peut affirmer aujourd’hui qu’il n’y a pas eu d’avancée, c’est-à-dire d’application positive de l’exigence de précaution sur le terrain de la responsabilité civile67.
On peut illustrer l’inertie de la jurisprudence avec l’affaire du Mediator. Car si l’État a été condamné par le Tribunal administratif de Paris en 2014 pour carence fautive dans sa mission de contrôle des médicaments, l’obligation d’agir n’est, encore et toujours, posée qu’en présence de quasi-certitudes scientifiques quant aux risques présentés par la substance en cause68. En retenant comme date de départ de la responsabilité celle de la « vérification pragmatique » de l’hypothèse69 ou encore de quasi-certitude de l’existence du risque, le Tribunal procède à une transposition de la solution de 199370 qui sera ensuite confirmée par le Conseil d’État71.
Les contentieux relatifs à l’amiante en apportent également la démonstration. On évoquera seulement les décisions du Conseil d’État de 200472 et notamment celles qui constatent que l’État a commis une faute en n’intervenant qu’en 1977, mais, dans le cadre du contrôle de cassation effectué, ne se prononcent pas sur l’identification du moment à partir duquel l’État aurait dû prendre des mesures de police sanitaire73. La réponse donnée en 2001 par la Cour administrative d’appel de Marseille restant pour le moins évasive : la faute est située à « l’époque » du « milieu des années 1950 » alors même qu’est retracée la connaissance et reconnaissance progressive des pathologies liées à l’amiante dès 190674. Plus tard, on observe que le traitement du risque lié à la présence de fibres courtes d’amiante demeure dépendant de données scientifiques précises75.
On parvient alors au terme de ce propos à l’éternelle question : que faut-il tenir pour acquis et plus précisément de quoi sont faites les données dites acquises de la science ? Et pour qui sont-elles « acquises » ? Déjà omniprésentes au début des années 1980 dans le cas du sang contaminé, ces interrogations restent à clarifier76. Il faut toutefois relever que l’obligation qu’a l’administration de se tenir au courant de l’évolution des données scientifiques relatives à un risque a été consolidée par la jurisprudence, notamment dans l’affaire du Médiator. On peut y voir le fondement d’une décision publique inscrite dans la vigilance et une certaine autonomie, voire dans une temporalité maîtrisée77. Obligations dont on attend toujours une consécration tangible.
La décision de 1993 n’est pas seulement une occasion manquée, c’est aussi encore aujourd’hui, une référence de solution raisonnable. Cet exercice de rétrofiction n’a de sens que si on réévalue ce standard en construisant une prospective exigeante à l’égard des hypothèses de risques qui nous entourent. Plus qu’une fiction, l’uchronie est un précieux antidote au fatalisme78.
1 Hubert Legal, conclusions sur CE Ass., 9 avril 1993.
2 CE Ass., 9 avril 1993, n° 138653, Rec. 110, concl. H. Legal, AJDA, 1993, p. 344, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; D., 1994, p. 63, obs. P. Terneyre et P. Bon ; D., 1993, p. 312, concl. H. Legal ; RFDA, 1993, p. 583, concl. H. Legal. Sur l’office du juge, on soulignera que le Conseil a décidé que « dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ».
3 On relève que le Conseil d’État a jugé « qu’en estimant que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde commise dans le contrôle des établissements de transfusion sanguine et l’édiction de la réglementation destinée à assurer la qualité du sang humain et que l’État pourrait être partiellement exonéré de la responsabilité ainsi encourue en raison de fautes commises par des établissements de transfusion sanguine, la Cour administrative d’appel de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit ».
4 En 1992, la notion de « sécurité sanitaire » a été conçue au ministère de la Santé lors de l’élaboration de la réforme du système de transfusion sanguine, cf. D. Tabuteau, Les contes de Ségur, les coulisses de la politique de santé (1988-2006), Ophrys, 2006, et du même auteur notamment, La sécurité sanitaire, réforme institutionnelle ou résurgence des politiques de santé publique ?, Presses de Sciences-Po, Les Tribunes de la santé, 2007/3, n° 16.
5 Cf. sur ce point notamment, P. Duran, « La responsabilité administrative au prisme de l’action publique », RFAP, 2013/3, n° 147.
6 Voir le Rapport public du Conseil d’État, Responsabilité et socialisation du risque, 2005, p. 277 : « Parallèlement, la légitimité de la puissance publique pour opérer des choix en vue de limiter ou d’éviter des risques est contestée, ce qui se traduit par une présence accrue des organisations non gouvernementales et des associations pour faire valoir leurs analyses et leurs vues ».
7 Cf. le rapport de la commission d’enquête du Sénat, Le système transfusionnel français en vue de son éventuelle réforme, Rapport n° 406 (1991-1992) de M. Claude Huriet, fait au nom de la commission d’enquête, déposé le 12 juin 1992.
8 Circulaire de la Direction Générale de la Santé publique du 20 juin 1983 relative à la prévention de l’éventuelle transmission du Sida par la Transfusion sanguine (DGS/3B n° 569).
9 Lettre circulaire DGS 3B/80 du 16 janvier 1985.
10 Cf. le rapport de la commission d’enquête du Sénat précité.
11 Circulaire DGS/3 B/142 du 20 octobre 1985 relative au dépistage et à l’information des donneurs de sang porteurs d’anticorps anti-LAV et à l’utilisation de divers produits sanguins. Précédemment, le 23 juillet 1985, le ministre de la Santé avait adopté un arrêté supprimant le remboursement des produits sanguins non chauffés à partir du 1er octobre 1985.
12 Circulaire DGS/3 B/142 du 20 octobre 1985 relative au dépistage et à l’information des donneurs de sang porteurs d’anticorps anti-LAV et à l’utilisation de divers produits sanguins. Précédemment, le 23 juillet 1985, le ministre de la Santé avait adopté un arrêté supprimant le remboursement des produits sanguins non chauffés à partir du 1er octobre 1985.
13 Idem.
14 Date d’entrée en vigueur de l’arrêté 23 juillet 1985, supprimant le remboursement des produits sanguins non chauffés, cf. supra.
15 TA Paris, 20 décembre 1991, M.-D., M. G. et M. B, V. concl E. Stahlberger, RFDA, 1992, p. 552.
16 On reprend l’appellation de l’époque.
17 Concl. E. Stahlberger, op. cit., supra.
18 Le ministre des Affaires sociales ayant fait appel de ces jugements : CAA Paris, 16 juin 1992, Ministre des Affaires sociales et de l’Intégration c/ MM. X., Y. et Z, concl. G. Dacre-Wright, LPA, 24 juillet 1992, p. 8 ; AJDA, 1992, p. 678, note L. Richer.
19 Voir notamment CE Ass., 10 avril 1992, M. et Mme V., Lebon p. 171, concl. H. Legal.
20 Cf. les dispositions du Code de la santé publique en vigueur mentionnées dans l’arrêt.
21 On renvoie aux conclusions de Hubert Legal dans lesquelles il est affirmé que « le préjudice subi par les victimes est né de la délivrance de produits impropres à être utilisés sans compromettre gravement leur santé. Face à ce type de péril sanitaire, les pouvoirs dont, dans l’urgence, l’État disposait sont les pouvoirs de police de la délivrance des produits ».
22 Circulaire du 20 octobre 1985 publiée au Bulletin officiel du ministère, cf. supra.
23 Le Conseil d’État indique « qu’il résulte de l’instruction que le risque de contamination par le virus VIH par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l’efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu’il était admis à cette époque qu’au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d’immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l’issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 nov. 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ».
24 Cf. supra.
25 On recommande la lecture de l’ouvrage remarquable de M.-A. Hermitte, Le sang et le droit. Essai sur la transfusion sanguine, Seuil, 1996 et notamment les développements consacrés à la décision du Conseil d’État. Voir également du même auteur, « Le principe de précaution à la lumière du drame de la transfusion sanguine en France », in O. Godard (dir.), Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1997 et du même auteur en collaboration avec V. David, « Évaluation des risques et principe de précaution », LPA, 30 nov. 2000, n° 239, p. 23.
26 Ph. Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution : rapport au Premier ministre, Odile Jacob, Paris, 2000.
27 On se bornera donc, parmi une bibliographie immense, à citer les études qui s’inscrivent directement dans le questionnement ici développé par rapport à la décision du Conseil d’État.
28 Cf. H. Legal, op. cit. supra.
29 Idem.
30 On note que dans le rapport du Conseil d’État de 2005 précité, il est souligné que « S’agissant du contentieux de la responsabilité, aucune décision n’a jusqu’à présent reconnu explicitement l’engagement de la responsabilité sur le fondement de la méconnaissance du principe de précaution. Le juge administratif se réfère au “risque prévisible” (CE, 9 avril 1993, M. D.) » (p. 283).
31 Ce point de vue était déjà exprimé avec une grande perspicacité par M.-A. Hermitte dans son ouvrage précité Le sang et le droit. Essai sur la transfusion sanguine, not. p. 306 et s.
32 Cf. Ph. Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution : rapport au Premier ministre, op. cit., supra.
33 Cf. H. Legal, op. cit., supra.
34 Cf. H. Legal, op. cit., supra.
35 Circulaire de la Direction Générale de la Santé publique du 20 juin 1983 relative à la prévention de l’éventuelle transmission du Sida par la Transfusion sanguine (DGS/3B n° 569), op. cit. supra.
36 La circulaire du 20 juin 1983 s’ouvre sur la phrase suivante : « Le syndrome d’immunodépression acquise représente un risque nouveau et grave pour la santé qui pourrait être dû à un agent infectieux dont la transmission par le sang et les produits dérivés du sang a pu être suspectée mais non établie ».
37 Ainsi notamment le 29 septembre 1984 sont parus dans The Lancet (la principale revue scientifique internationale de haut niveau sur la transfusion) des résultats concluants de tests sur le chauffage, voir également les autres alertes lancées en octobre 1984, cf. Les conclusions de H. Legal et le rapport de la commission d’enquête du Sénat précité.
38 On reprend la formule utilisée par H. Legal en faveur néanmoins d’une date plus tardive, op. cit., supra.
39 Le principe figure dans le Traité de Maastricht, puis dans la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et enfin dans la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
40 CE, 29 mai 2002, n° 217265, inédit.
41 Voir ainsi le raisonnement mené par H. Legal : « il faut supposer qu’en déterminant les dates de début et de fin de la période où il y a eu faute la cour a tiré les conséquences de son exigence d’une faute lourde ; sans doute avec d’autres exigences aurait-elle envisagé les faits différemment ».
42 On précise que dans le rapport du Conseil de 2005 précité, cette perspective est loin de recueillir l’assentiment : « On voit bien les risques d’une recherche systématique de la carence fautive : une conception trop large d’une telle carence consacrerait l’interprétation maximaliste du principe de précaution, transformé en principe rétrospectif qui conduirait à condamner tout comportement qui n’aurait pas choisi l’interdiction ou l’abstention face à un risque ».
43 Cf. notamment l’étude de C. Thibierge, « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité », RTDC, 1999 n° 3, p. 561 et s.
44 Voir notamment l’étude de P. Lascoumes, « La précaution comme anticipation des risques résiduels et hybridation de la responsabilité », L’Année sociologique, 1996, 46 n° 2, p. 359.
45 Cet art du gouvernement « qui exige intuitions et prises de risques calculés, contre la temporalité de la preuve scientifique », M.-A. Hermitte, op. cit. supra, p. 302. Parmi une somme considérable d’études, voir notamment J-M. Pontier, « La puissance publique et la prévention des risques », AJDA, 2003, p. 1752 ainsi que les références mentionnées. Voir également O. Godard, « L’ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision », in O. Godard (dir.), Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, INRA, 1997, p. 37.
46 M.-A. Hermitte, op. cit. supra, p. 309.
47 Cf. article 5 de la Charte de l’environnement : « […] les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques […] ».
48 Communication (COM (2000) 1 final) sur le recours au principe de précaution.
49 Cf. R. Encinas de Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTDC, 1998, n° 2, p. 287.
50 M.-A. Hermitte, op. cit., supra, p. 310.
51 Il faut garder à l’esprit les données, scientifiques et médicales mais aussi les résistances qui se sont manifestées, cf. notamment le rapport de la commission d’enquête du Sénat op. cit. supra : « D. Les résistances extérieures au système transfusionnel : une incapacité à comprendre et un refus de réagir », p. 114 et suiv. Sur cette idée de bon sens, cf. infra.
52 B. Latour, « Vive l’audacieux principe de précaution ! L’expertise indiscutable avant l’action est illusoire. Réponse à Claude Bébéar », Le Monde, 5 novembre 2007.
53 Voir notamment sur cette question, l’étude de Chr. Noiville, « Principe de précaution et gestion des risques en droit de l’environnement et en droit de la santé », LPA, 30 novembre 2000, n° 239, p. 39.
54 Parmi la somme d’études consacrées à cette question, voir O. Godard, « L’ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision », in Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, op. cit., supra.
55 Voir notamment la contribution de K. Ouldamar et A.-M. Gallerand, « La sécurité sanitaire en France : de l’affaire du sang contaminé à la réforme des vigilances », Santé publique, p. 517, 2019, 4, vol. 31.
56 W. Dab et D. Salomon, « De l’expertise à la décision : un hiatus à combler », in Agir face aux risques sanitaires. Pour un pacte de confiance, Presses universitaires de France, 2013.
57 W. Dab et D. Salomon, « L’État dépassé », in Agir face aux risques sanitaires. Pour un pacte de confiance, op. cit., supra.
58 Idem.
59 F. Ewald et D. Kessler, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, 2000, 2, n° 109, p. 55.
60 On renvoie à l’ouvrage de Chr. Noiville, Du bon gouvernement des risques. Le droit et la question du « risque acceptable », Presses universitaires de France, 2003.
61 Voir notamment J.-B. Auby, « Le droit administratif dans la société du risque. Quelques réflexions », in Rapport du Conseil d’État de 2005 précité, et « L’évolution du traitement des risques dans et par le droit public », Revue européenne de droit public, vol. 15, n° 1, 2003, p. 169.
62 M. Franc, « Traitement juridique du risque et principe de précaution », AJDA, 2003, p. 360.
63 Cf. article 5 de la charte : « procédures d’évaluation des risques » et « adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
64 La faute de non mise en œuvre d’une procédure d’analyse du risque constitue un manquement à une obligation procédurale de nature à fonder une responsabilité, voir notamment CAA Marseille, 10 janvier 2005, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche c/ Société Durance Crau, AJDA, 2005, p. 1248, note P. Moreau.
65 Voir notamment, D. Mazeaud, « Responsabilité civile et précaution » in La responsabilité à l’aube du XXIe siècle, bilan prospectif, colloque, Resp. et Ass. juin 2001, n° 6 bis ; M. Deguergue, « La responsabilité administrative et le principe de précaution », Revue juridique de l’environnement, n° spécial 2000, p. 105 ; Y. Jegouzo, « De certaines obligations environnementales : prévention, précaution et responsabilité », AJDA, 2005, p. 1164.
66 Cf. l’étude de G.-J. Martin, « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? », AJDA, 2005, p. 2222, ainsi que les références citées.
67 Cf. le bilan dressé par A.Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », AJDA, 2015, p. 510. Voir également H. Belrhali, Les grandes affaires de responsabilité de la puissance publique, LGDJ, 2021.
68 TA Paris 3 juill. 2014, n° 1312345/6, AJDA, 2014, p. 2490, note S. Brimo ; RFDA, 2014, p. 1193, note J. Petit ; RDSS, 2014, p. 926, note J. Peigné ; A. Van Lang, op. cit., supra. Solution confirmée ensuite
69 Selon la formule de H. Legal précitée.
70 Cf. J. Petit, op. cit. supra.
71 Voir ensuite la confirmation de cette solution, notamment CAA Paris, 2 juill. 2015, n° 14PA04138 ; CAA Paris, 31 juill. 2015, n° 14PA04082 et n° 14PA04146 et CE, 9 novembre 2016, n° 393902 et n° 393904, concl. J. Lessi.
72 CE Ass., 3 mars 2004, n° 241150, 241151, 241152 et 241153, concl. E. Prada-Bordenave, RFDA, 2004, p. 612 ; AJDA, 2004, p. 974, chron. F. Donnat et D. Casas.
73 Voir les décisions n° 241150 et 241152 précitées.
74 CAA Marseille, 18 octobre 2001, n° 00MA01665 : « dès cette époque, les pouvoirs publics ne pouvaient plus ignorer que l’exposition professionnelle aux fibres d’amiante présentait des risques sérieux pour la santé des personnes concernées ».
75 CE, 26 févr. 2014, n° 351514, Association Ban Asbestos France. Cf. notamment l’étude de A. Van Lang, « Principe de précaution : exorciser les fantasmagories », op. cit., supra et les références mentionnées. Voir également plus généralement, S. Brimo, « Les potentialités du contentieux de la carence administrative en matière de santé et d’environnement », AJDA, 2021, p. 1256.
76 Sur ces questions notamment, voir A. Jacquemet-Gauché, « Le juge administratif face aux connaissances scientifiques », AJDA, 2022, p. 443.
77 Voir les conclusions de J. Lessi sur CE, 9 novembre 2016, n° 393108 à propos du Médiator : « il appartient à l’administration de se tenir informée, de vérifier les informations émanant des laboratoires, et de se donner les moyens de générer elle-même l’expertise visant à enrichir l’état des savoirs » avec un rappel de ce que déjà en 2004 figurait cette prescription (ainsi CE, 3 mars 2004, n° 241152, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Thomas (Cts).
78 « Ce qui relevait auparavant du fatalisme peut désormais relever de la carence fautive » M.‑A. Hermitte, Le sang et le droit. Essai sur la transfusion sanguine, op. cit., supra.
Aude Rouyère, « CE Ass., 9 avril 1993, D, n° 138653, Rec. 110, concl. Hubert Legal. La possibilité d’un coup d’audace ? », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4601.