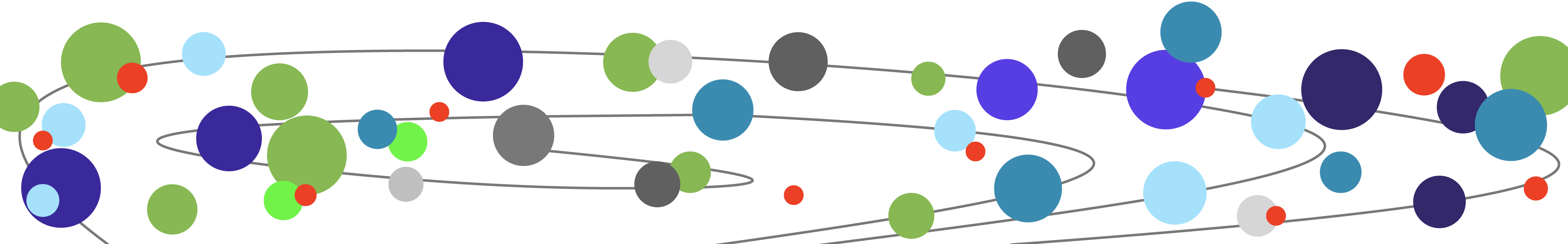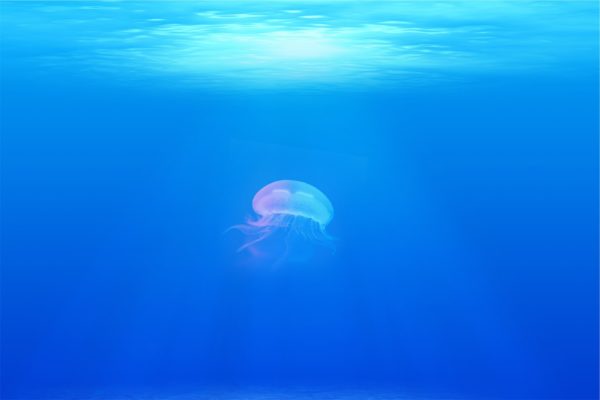Jean-Éric Gicquel
Université de Rennes
L’intérêt de l’existence d’une seconde chambre au sein du Parlement a constamment soulevé des questionnements mais aussi son lot de contestations politiques. À cet égard, les volontés de suppression de droit ou de fait du Sénat en France ont eu régulièrement dans le passé l’occasion de franchir le cap théorique. L’objet de la présente étude sera d’imaginer qu’une telle réforme ait un jour réussi et qu’un Parlement monocaméral ait été institué sous la Ve République ».
The purpose of having a second chamber within Parliament has consistently raised questions and its share of political challenges. In this regard, past attempts to legally or effectively abolish the French Senate have regularly moved beyond the theoretical stage. The aim of this study is to imagine that such a reform had one day succeeded and that a unicameral Parliament had been established under the Fifth Republic.
Se lancer dans l’argumentation uchronique ou contrefactuelle est un exercice qui invite à l’humilité – n’est pas le Doyen Vedel qui veut1. Convenons immédiatement que réfléchir à l’évolution d’une Ve République sans Sénat est d’autant plus délicat que la conjecture en droit constitutionnel positif est foncièrement hasardeuse. Napoléon n’affirmait-il pas qu’« aucune constitution n’est restée telle qu’elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances » ? C’est ainsi que relativement à la nouvelle Constitution apparue en 1958, Marcel Prélot y avait discerné l’émergence d’une « République sénatoriale »2. Tout le laissait penser à l’époque. En effet, dans l’esprit des Pères fondateurs, le Sénat avait vocation à occuper une fonction régulatrice au sein du Parlement à l’instar de la vision prônée jadis par Montesquieu selon laquelle « le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher ». L’office du Palais du Luxembourg, dont le collège électoral était alors proche de celui du président de la République, consistait à agir tel un contrepoids sur lequel pouvait s’appuyer l’Exécutif, face à une Assemblée nationale dont on craignait, malgré la rigoureuse rationalisation établie par la Constitution du 4 octobre 1958 (ci-après C), les goûts à l’indiscipline et à la rébellion auxquels elle s’était enivrée sous les Républiques précédentes3. Aussi, le Sénat était-il la pièce maîtresse de la politique d’endiguement du Palais-Bourbon, puisque ce dernier ne peut réviser seul la Constitution (art. 89 C) et qu’il a besoin du soutien du Gouvernement pour disposer du dernier mot en matière législative (art. 45 al. 4 C). Autrement dit, dans l’expectative d’être confronté à un Palais-Bourbon turbulent, indocile et fougueux, l’Exécutif pouvait compter sur la présence du Sénat pour le ramener à la raison. « Ah ! si nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir un Sénat dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une assemblée trop envahissante parce que trop divisée » argumentait en ce sens Michel Debré en 19584. Or, cette ingénierie a été rapidement frappée d’obsolescence par le fait d’évolutions propres à chaque organe. Tout ceci est bien connu : tandis que l’Assemblée nationale, par le miracle du fait majoritaire survenu brutalement à l’automne 1962, renonçait à son autonomie et aux coups d’éclat en se soumettant docilement à la tutelle gouvernementale, le Sénat basculait, quant à lui, « dans l’adversité »5 face au pouvoir gaulliste et ce à un tel point que le Général tenta, sans succès, d’imposer par la voie du référendum en 1969 son capitis deminutio6. Personne n’aurait pu, en 1958, prédire un tel déroulement. On comprend, dans ces conditions, toutes les difficultés de l’exercice contrefactuel visant maintenant à imaginer une Ve République sans Sénat.
En filiation avec les constitutions de 1791 et 1848 et quelques homologues étrangères (grecque, portugaise, scandinaves, etc.), l’article 34 de la Constitution de 1958 aurait donc disposé, dans sa version originelle, que « la loi est votée par l’Assemblée nationale » et, au fil de révisions, l’article 24C indiquerait aujourd’hui que « l’Assemblée nationale vote la loi. Elle contrôle l’action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques ». Se pencher sur les effets institutionnels et politiques induits par de telles formulations implique un double questionnement.
I. Il convient d’abord de s’interroger sur ce qui ne ce se serait pas passé si le Sénat n’avait pas été créé en 1958
À première vue, on songe ici à toute une série d’actes, de faits et d’évènements n’ayant pas eu « logiquement » la possibilité d’exister au sein de cette Ve République parallèle. Sans Sénat institué en 1958, point d’accusation de « forfaiture »7 formulée par Gaston Monnerville en 1962 ; de tensions politiques avec l’Exécutif en 1984 à propos de l’école libre et en 2018 lors de l’affaire Benalla ; de critiques virulentes portées à son encontre8, de travaux universitaires consacrés à son étude9, etc.
Au-delà de cette perspective, les dynamiques propres au monocamérisme et au bicamérisme peuvent être évoqués. À cet égard, l’alanguissement d’une assemblée unique privée d’alter ego tranche avec l’émulation entre deux chambres soumises à une compétition permanente dissimulant des enjeux de pouvoir et de prestige (voir les appellations connotées de chambres basse et haute). Ici, chaque Palais a le souci de démontrer qu’il est autant (voire plus) légitime, performant et transparent que l’autre même si la charge de la preuve incombe davantage au Sénat que l’Assemblée nationale puisque cette dernière est délestée du fardeau à devoir justifier le bien-fondé même de son existence. Le bicamérisme, parce qu’il n’est pas une solution innée, a constamment suscité des préjugés depuis 178910. Dans cette joute à fleurets plus ou moins mouchetés, chaque chambre ne peut rester indifférente aux réorganisations internes, modifications du règlement ou de l’instruction générale du bureau, voire aux modernisations du site Internet effectuées de l’autre côté. Ce sont autant d’exemples à ne pas suivre11 ou, au contraire, d’aiguillons en faveur de leur transplantation12. La révision du règlement de l’Assemblée nationale du 4 juin 2019 a été, à cet égard, topique tant l’influence du Sénat a été visible à de nombreux endroits. C’est ainsi qu’ont été repris par le Palais-Bourbon des mécanismes sollicités depuis 2015 au Palais du Luxembourg : d’une part, le droit pour le groupe minoritaire ou d’opposition ayant obtenu la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, d’opter entre le poste de président ou de rapporteur13 ; d’autre part, la procédure de la législation en commission pour les textes techniques et consensuels afin d’alléger la séance publique14. Dans un registre inverse, l’apathie de l’Assemblée nationale à l’égard de certaines dérives et insuffisances normatives tranche avec l’activisme du Sénat entendant pleinement assumer le rôle du porte-parole du Parlement soucieux du processus de dégradation de la loi. C’est ainsi, qu’en sus de la mise en place, en 1972, d’un contrôle sur la mise en application des dispositions législatives par voie réglementaire15, l’attention du Palais du Luxembourg se porte, depuis 2020, sur le recours soutenu aux ordonnances de l’article 38C allant de pair avec un tarissement de leurs ratifications. Parmi les multiples actions entreprises16, on retiendra le dépôt inédit d’une proposition de loi visant à ratifier l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État afin de contraindre le ministre de la Fonction publique à venir s’expliquer en hémicycle sur le contenu de l’ordonnance, ce qu’il fera le 6 octobre de la même année. Pour terminer, dans une société parcourue d’une lancinante remise en cause de la démocratie représentative, deux assemblées sont en meilleure position qu’une unique chambre centralisant l’intégralité des critiques. Afin de diluer le poison de la vindicte antiparlementaire17, chaque Palais a intérêt à louer ses propres qualités et se défausser sur l’autre en exagérant ses travers. L’un mettra en avant son indépendance à l’égard de l’Exécutif, l’absence d’élus « godillots » ou « playmobils » (pour reprendre une expression apparue sous la XVe législature) et les bienfaits de la tempérance ; l’autre se présentera tel l’anti-modèle du conservatisme, de la gérontocratie et des privilèges indus. Bref, autant de parades et de jeux d’acteurs que ne pourrait solliciter une assemblée unique.
II. Il est ensuite nécessaire de se questionner sur ce qui se serait passé si le Sénat n’avait pas été créé
L’exercice contrefactuel est ici plus exigeant. Concernant, d’abord, l’orientation du régime de la Ve République dans une dimension présidentialiste, il est à souligner que celle-ci a pu s’effectuer sans le concours du Sénat et, même mieux, nonobstant l’opposition de celui – voir, à cet égard, l’emblématique saisine du Conseil constitutionnel effectuée, en 1962, par le président du Sénat afin de faire invalider la réforme constitutionnelle fondamentale souhaitée par le Général de Gaulle18. Nul besoin d’insister sur le fait que le Monarque républicain, l’Hyperprésident ou Jupiter, soit ce chef de l’État déterminant la politique de la Nation (indépendamment de ce que laisse croire l’article 20C) doit obtenir le soutien d’une majorité solide, cohérente et disciplinée à l’Assemblée nationale. Le régime présidentialiste de la Ve République s’articule autour d’un cercle de confiance entre l’Élysée, Matignon et le Palais Bourbon – soit le bloc majoritaire – auquel n’est pas impérativement convié le Sénat.
Ceci conduit cependant à se pencher sur les inconvénients générés par l’absence d’une seconde chambre assurant une fonction de « contre-pouvoir (et de) « stabilisateur (des) institutions »19 face à ce trio majoritaire. En contrepoint des déficiences et excès concevables avec une chambre unique asservie à l’Exécutif20, on perçoit alors, dans une version modernisée de la théorie de la séparation des pouvoirs, tous les avantages induits par la présence modératrice d’une chambre échappant au diktat majoritaire. Celle-ci est en capacité 1°) de faire entendre sa voix en matière législative en opposant la raison à la passion (voir infra), 2°) de s’opposer aux révisions constitutionnelles voulues par un Exécutif impulsif et impatient et 3°) de demander au Gouvernement (et, implicitement, au président de la République) de rendre des comptes d’une façon plus exigeante que ne le fait une Assemblée nationale caporalisée21. Du Sénat se confrontant au Général de Gaulle dans les années 1960, à celui s’élevant contre Emmanuel Macron depuis 2017, en passant par les mésententes avec les dirigeants socialistes à partir de 1981, la haute assemblée a régulièrement eu l’occasion de déployer son action dans une logique de checks and balances afin de canaliser les dérives de blocs majoritaires peu prompts à l’autocritique.
L’argumentation est séduisante. Elle n’en reste pas moins biaisée. Une assemblée parlementaire, parce qu’elle est un organe politique, est conceptuellement incapable d’assurer une fonction neutre et impartiale de contre-pouvoir22. Or, après avoir subi l’ostracisme du Général de Gaulle puis l’indifférence de ses successeurs, le Sénat n’a pu échapper aux affres de la bipolarisation et de l’embrigadement majoritaire à compter de 1981. La période où l’on raisonnait seulement en termes de groupes parlementaires est révolue et la summa diviso classique (majorité / oppositions(s)) a fini par s’imposer aussi au Palais du Luxembourg. Ceci le conduit inexorablement à pratiquer (in)consciemment la sélectivité partisane dans l’étendue des exigences qu’il entend imposer aux détenteurs de l’autorité du moment. Personne n’est dupe. L’orientation politique du bloc majoritaire détermine largement le degré de bienveillance et d’exigence dans l’accueil qu’il prodigue même si, par tradition, il répugne à la posture manichéenne et sait aussi se comporter tel un allié intransigeant ou un adversaire compréhensif de l’Exécutif. Reste que cette variabilité d’attitudes est largement à sens unique. Aux dérèglements structurels (induits par une domination, quasiment sans partage depuis 1958, d’une majorité de droite composite et hétéroclite au Palais du Luxembourg23) se surajoutent de nouveaux détraquements visibles depuis 2017 (avec un Sénat devenant le bastion d’anciens partis de gouvernement (les Républicains, le Parti socialiste) tombées en déliquescence à l’Assemblée nationale). Inévitablement, les périodes variables de (més)entente entre l’Exécutif et le Sénat entraînent des fluctuations dans les taux de réussite d’une commission mixte paritaire24, d’une révision constitutionnelle25 et dans la vigueur du contrôle effectué par les commissions d’enquête sénatoriales26. Curieux contre-pouvoir, celui qui prétend agir de manière institutionnelle alors qu’il en module l’intensité des effets au gré des circonstances politiques !
Ensuite, relativement au processus de fabrique de la loi, il est communément reconnu27 que le dialogue bicaméral par le processus répétitif d’échanges survenus lors des différentes étapes permet une confrontation et une maturation des idées engendrant, in fine, des effets bénéfiques sur la qualité du produit final28. On retrouve ici, en filigrane, les avantages de la répartition des tâches conceptualisée par Boissy d’Anglas en 1795 (la chambre basse incarnant l’imagination de la République et la chambre haute, la raison de la République). Si l’Exécutif de plus en plus enclin à vouloir soumettre le Parlement aux exigences de réactivité et d’immédiateté de l’action politique (« le rythme de conception des lois doit savoir répondre aux besoins de la société » affirme ainsi le président Macron29) verrait de nombreux avantages à la présence d’une assemblée unique, il est à penser que le bicamérisme doit être préservé afin de juguler le processus de dégradation continue de la norme législative30. Certes, il arrive (plus ou moins fréquemment selon les périodes – voir supra) que la discussion bicamérale tourne, en réalité, au dialogue de sourds lorsque chaque assemblée décide de se draper dans l’intransigeance. Pour autant, le Sénat est, davantage que l’Assemblée nationale, en situation d’exiger du Gouvernement que celui-ci se justifie et cherche à le convaincre sur le bien-fondé de l’intervention législative et les formulations initialement retenues dans le projet de loi. Au Palais du Luxembourg, les arguments d’autorité ne rencontrent guère d’écho et certaines mesures juridiques ne peuvent être brandies (passage en force de l’article 49 al. 3C ; dissolution de l’art. 12C), Quant à la possibilité de donner le dernier mot donné à l’Assemblée nationale (art. 45 al. 4C), une procédure sollicitée, depuis 1958, seulement pour un texte sur huit31, elle n’est en rien antinomique avec la capacité de la seconde chambre d’avoir pu peser sur la rédaction finale de la loi32. Certes, un Parlement monocaméral, plus enclin à l’autosatisfaction en raison de l’absence d’altérité, peut, afin de rendre la discussion législative plus performante, prévoir une succession de délibérations33 et même insérer des éléments de « bicamérisme dans le monocamérisme »34, afin de susciter une disputatio interne. Il n’en reste pas moins que la structuration du Parlement en deux assemblées distinctes et dotées d’une composition dissemblable est globalement bénéfique au processus de fabrique de la loi.
En conclusion, une autre voie de réflexion aurait pu être empruntée. Et si le Sénat que nous connaissons depuis 1958 avait connu une évolution différente ? Indépendamment des perspectives d’un Sénat-croupion émergeant suite au référendum contrefactuel positif de 1969 ou d’un Sénat acceptant, à l’imitation de son homologue italien en 2016, une révision constitutionnelle réduisant significativement ses prérogatives35, on songera surtout à une situation institutionnelle où l’alternance politique au Palais du Luxembourg aurait eu droit de cité, de manière régulière en raison d’une transformation du mode d’élection de ses membres. Si nul ne peut revenir sur le passé, on peut toujours façonner l’avenir…
1 « Rétrofictions : Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », in O. Duhamel et J.-L. Parodi (dir.), La Constitution de la Ve République, 1985, p. 133. Rajoutons, pour faire bonne mesure, que l’exercice auquel nous nous risquons a déjà été tenté avec succès (J. Benetti, « Et si le Sénat n’existait pas ? », Pouvoirs, n° 159, 2016, p. 5).
2 M. Prélot, Pour comprendre la nouvelle Constitution, Le Centurion, 1958, p. 51. Voir aussi J. Gicquel, « Sur la République sénatoriale de 1958 », Mélanges Jean-Louis Hérin, Mare & Martin, 2020, p. 99.
3 Du reste, cette crainte était justifiée puisque le soutien initial de l’Assemblée nationale à l’égard du Gouvernement ne cessa de s’étioler jusqu’à ce que l’irréparable (l’adoption d’une motion de censure en application de l’article 49 al. 2C) fût commis le 4 octobre 1962.
4 M. Debré, Discours au Conseil d’État du 27 août 1958, Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, 1991, p. 258.
5 J. Georgel, Le Sénat dans l’adversité, Éd. Cujas, 1967.
6 Voir le projet de loi, soumis au peuple, annexé au décret n° 69-296 du 2 avril 1969, instituant un Sénat assurant « la représentation des collectivités territoriales et des activités économiques, sociales et culturelles » et cantonné à une fonction consultative dans les domaines législatif et constitutionnel.
7 G. Monnerville, Discours au Congrès du Parti radical, 29 septembre 1958.
8 Voir à cet égard, L. Jospin, alors Premier ministre, faisant état de l’existence d’« une anomalie parmi les démocraties » (Entretien, Le Monde, 21 avril 1998) ; C. Bartolone, président de l’Assemblée nationale, se prononçant en faveur de la « fin du bicamérisme sous cette formule » (H. Bekmezian, Conflit ouvert entre les palais de la République, Le Monde, 30 janvier 2015).
9 Pour une littérature récente, voir notamment P. Avril, « Une heureuse anomalie : le Sénat », Mélanges Jean-Louis Hérin, Mare & Martin, 2020, p. 25 ; R. Ghevontian, « Haro sur le Sénat ! Bonne ou mauvaise querelle ? », Mélanges Michel Verpeaux, Dalloz, 2020, p. 279 ; P. Klimt, Le Sénat français : entre continuité et mutations, Thèse Rennes 1, 2020 ; B. Morel, Le Sénat et sa légitimité, Dalloz, 2018 ; J. de Saint-Sernin, Système majoritaire et bicamérisme sous la Ve République, Dalloz, 2019 ; J.-J. Urvoas, Le Sénat, PUF, 2019 ; Le Sénat, pour quoi faire ?, Pouvoirs n° 159, 2016.
10 K. Fiorentino, La seconde chambre en France dans l’histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), Dalloz, 2008. Inversement, les efforts permanents du Sénat pour répondre aux accusations et reproches notamment dans le domaine communicationnel sont à mettre en exergue : voir, par exemple, le colloque tenu au Sénat le 17 avril 2014, Le bicamérisme à la française : un enjeu pour la démocratie, site internet du Sénat.
11 Ainsi, à titre d’illustration, alors que l’Assemblée nationale a décidé de nommer une personnalité indépendante pour assurer les fonctions de déontologue (art. 80-2 RAN), le Sénat a préféré constituer un comité de déontologie composé de huit sénateurs (art. 91 sexies RS).
12 Voir J.-E. Gicquel, « Quelques remarques sur le mimétisme bicaméral », Mélanges Jean-Louis Hérin, op. cit., p. 96.
13 Art. 143 al. 3 et 145 al. 5 du règlement de l’Assemblée nationale.
14 Art. 107-1 à 107-3 du règlement de l’Assemblée nationale.
15 Pour le dernier rapport annuel : Doc. Parl. n° 645, 27 mai 2021.
16 Changement d’appellation, en 2020, d’une délégation du bureau compétente pour le « travail parlementaire, le contrôle et le suivi des ordonnances ; modification du règlement par résolution du 1er juin 2021 (voir le commentaire in J.-E. Gicquel, JCP, Ed G., n° 30-34, 26 juillet 2021) ; mise en ligne, sur le site du Sénat, d’un outil exhaustif de suivi des ordonnances en 2021.
17 Voir A. Vidal-Naquet et P. Jensel-Monge, L’antiparlementarisme, Mare & Martin, 2022.
18 Conseil constitutionnel, n° 62-20 DC, 6 novembre 1962, Élection du chef de l’État, Rec. 27.
19 G. Larcher, Vœux aux corps constitués, 14 janvier 2020, Public Sénat. Voir aussi V. Boyer, « Sénat, contre-pouvoir au bloc majoritaire ? », RFDC, n° 85, 2011, p. 41 et J.-P. Marichy, « Le Sénat, un contre-pouvoir ? », in François Mitterrand et la fonction présidentielle. Colloque du Club Vauban, Economica, 1986, p. 49.
20 À propos de l’établissement du présidentialisme en Turquie dotée d’un Parlement monocaméral, voir A. Fistickci, Le présidentialisme : étude de droit constitutionnel comparé France / Turquie, Thèse Caen, 2021.
21 D’une manière presque caricaturale, l’affaire Benalla en 2018 a mis en évidence les différences de consistance et de sérieux des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale et de son homologue du Sénat – deux commissions dotées des prérogatives d’une commission d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
22 On songera à la doctrine, développée par Benjamin Constant, du pouvoir « neutre » ou « régulateur » incarné par le monarque (in Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, éd. établie par H. Grange, Paris, Aubier, 1991, p. 390). Pour une recherche récente : A. Braun, Le pouvoir régulateur du régime politique. Étude d’une notion de droit constitutionnel institutionnel, Thèse Nancy, 2019.
23 G. Carcassonne, avec son sens inégalé de la formule, rappelant que « quand la gauche perdait tout, elle perdait tout ; quand la droite perdait tout, elle gardait le Sénat », in La Constitution, Seuil, 11e éd., 2013, p. 142.
24 100 % de CMP conclusives entre 2002 et 2012 contre 63,5 % entre 2017 et 2022. Direction de la séance du Sénat, op. cit., p. 126.
25 Le cycle des réussites (neuf lois constitutionnelles adoptées entre 2002 et 2012 : Lois constitutionnelles du 25 mars 2003 (Mandat d’arrêt européen) ; du 28 mars 2003 (Organisation décentralisée de la République) ; du 1er mars 2005 (Traité établissant une Constitution pour l’Europe) ; du 1er mars 2005 (Charte de l’environnement) ; du 23 février 2007 (Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie) ; du 23 février 2007 (Responsabilité du président de la République) ; du 23 février 2007 (Interdiction de la peine de mort) ; du 4 février 2008 (Traité de Lisbonne) ; du 23 juillet 2008 (Modernisation des institutions)) tranche avec celui des échecs observé depuis 2012 (voir l’infortune des projets de lois constitutionnelles du 14 mars 2013 (Démocratie sociale ; Incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil constitutionnel ; Conseil supérieur de la magistrature ; Responsabilité juridictionnelle du président de la République et des membres du Gouvernement) ; du 31 mars 2015 (Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires) ; du 23 décembre 2015 (Protection de la Nation) ; du 9 mai 2018 (Démocratie plus représentative, responsable et efficace) ; du 29 août 2019 (Renouveau de la vie démocratique) et du 20 janvier 2021 (Préservation de l’environnement). La litanie des échecs a toutefois cessé avec l’adoption d’une réforme consensuelle le 8 mars 2024 (liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse).
26 Voir, plus particulièrement, les commissions d’enquête sur l’affaire Habache en 1992, les 35 heures en 1997 et l’affaire Benalla en 2018.
27 Pour une étude plus approfondie voir P. Türk, « Le Sénat : une assemblée de bons légistes ? », Pouvoirs, n° 159, 2016, p. 65.
28 Voir, à cet égard, la rubrique « La loi en construction » présente sur les sites des assemblées permettant, depuis 2020, d’avoir une vision fine de l’apport de chaque chambre.
29 E. Macron, JO, Congrès, déb., 3 juillet 2017, p. 6.
30 Voir notamment Conseil d’État, Rapports publics EDCE n° 43, 1991 et n° 57, 2006, Doc.Fr.
31 Direction de la séance du Sénat, op. cit., p. 126. Une nouvelle, au gré des périodes politiques, des amplitudes variables sont discernables : 0 % de lois visées entre 2002 et 2011 ; 24 %, en moyenne, depuis 2012.
32 Il est, en effet, à rappeler que, d’une part, le dernier mot ne concerne que les articles restant en discussion (c’est-à-dire ceux n’ayant pas été adoptés conformes par les deux assemblées) et, d’autre part, que le texte final peut éventuellement être modifié par les amendements adoptés au Sénat en nouvelle lecture et repris par le Gouvernement ou les députés (art. 45 al. 45C).
33 Voir, par exemple, les trois lectures d’un texte législatif imposées au Danemark (art. 41 de la constitution du 5 juin 1953) et sous la IIe République (art. 41 de la constitution du 4 novembre 1848).
34 Titre de l’article de D. Breillat in Mélanges Patrice Gélard, Montchrestien,1999, p. 347. En Norvège, jusqu’en 2007, une navette était organisée au sein de l’assemblée unique (Storting) entre le Lagting (composé de 25 % des députés) et l’Odelsting (75 % des députés). Son abandon a été effectué en 2007 en raison des effets délétères de l’esprit partisan. I. Nguyen-Duy, « L’abolition du bicamérisme norvégien », RDP, 2008, p. 921.
35 Finalement, le projet de loi constitutionnelle visant notamment au « dépassement du bicamérisme paritaire » a été repoussé par le peuple italien le 4 décembre 2016.
Jean-Éric Gicquel, « Et si le Parlement de la Ve République avait été monocaméral ? », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4607.