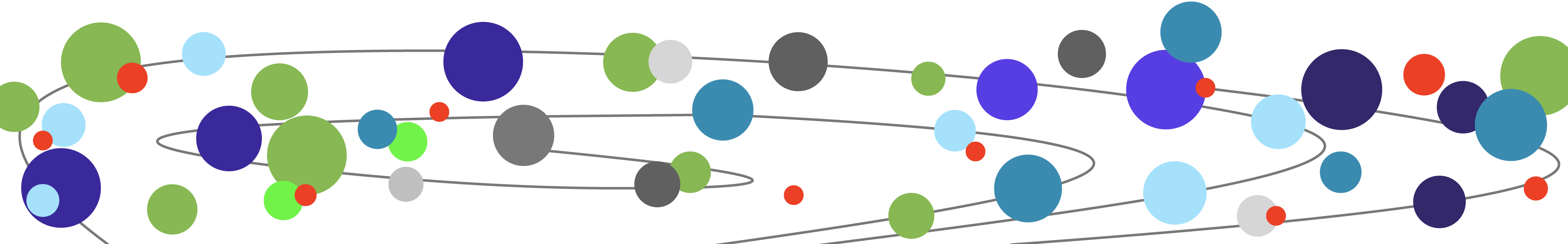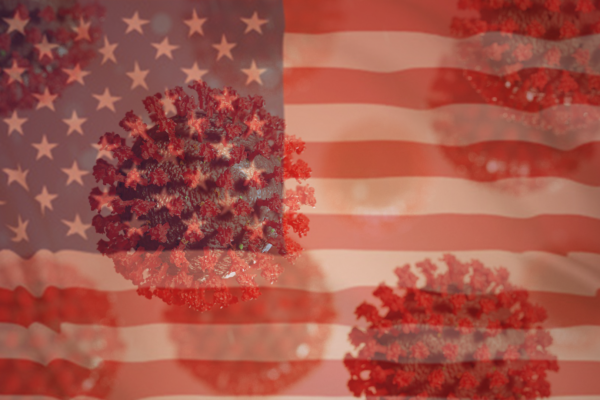Marie Glinel
Maître de conférences en droit public à l’Université Lyon II Lumière
A priori, le droit de l’Union européenne est perçu comme hybride, s’il n’est pas appréhendé à travers l’influence qu’exerce sur lui la tradition de Common Law (la langue anglaise de travail, la structuration des administrations, la formation des juristes). Or, pour éviter de se fonder sur des éléments contingents de comparaison, cette étude se situe au niveau des structures mentales de chaque tradition juridique pour analyser leur influence sur les définitions européennes du biodroit. Et contrairement à toute attente, ces dernières sont essentiellement influencées par le droit romano-germanique. Cette étude révèle que les structures de chaque tradition juridique sont identifiables autant que leurs influences, très localisées, sur les définitions européennes du biodroit. En effet, c’est le raisonnement par « système » et non pas « problème » qui s’impose dans la majorité des définitions délivrées. C’est notamment visible à travers le recours à des définitions « intensives » qui s’inscrivent dans un réseau de définitions par inclusion et exclusion ou encore à travers une jurisprudence priorisant l’interprétation du droit sur l’appréciation des cas, comme le ferait un juge de Common Law pour évaluer la pertinence de l’application d’un précédent ou la distinction des faits.
S’il est vrai que des nations et des groupes dans une société établissent fréquemment un contact entre eux, il n’est pas vrai qu’ils créent […] ce faisant, un “métadiscours” commun1.
Sur le continent européen, deux traditions juridiques2 coexistent sans se confondre, et ce n’est pas nouveau : le droit romano-germanique et la Common Law3. La coexistence de ces deux traditions juridiques radicalement différentes empêche a priori toute émergence d’un modèle juridique uniforme et cohérent en droit de l’Union européenne (ci-après « droit de l’Union »). Pourtant, l’intégration de l’Union comme objectif et l’autonomie du droit de l’Union comme outil, ont permis l’édification progressive d’un modèle hybride sans être mixte4, au-delà de cette rationalité juridique a priori duale. L’une et l’autre tradition juridique ont façonné la structuration du droit de l’Union, et en particulier celle des définitions juridiques, qui apparaissent dès lors comme le lieu de cette disputatio.
Cependant, rechercher les traces de tradition juridique dans la construction du droit de l’Union européenne n’est pas une entreprise aisée. En effet, comment rechercher l’expression de l’irréductible identité d’une tradition juridique ? Quel est le véritable « lieu » où l’influence peut être valablement identifiée ? Est-ce davantage l’État qui influence, ou bien des paramètres encore plus contingents, tel que les gouvernants, le droit positif, la manière de faire du droit, la langue, la formation des juristes ? Aussi, la distinction des traditions juridiques n’est pas si manichéenne que cela. Si traditionnellement, la jurisprudence est la marque de la Common Law, et la codification celle du droit romain, il n’en reste pas moins qu’il existe des lois en Common Law et des précédents jurisprudentiels dans la tradition romaine. Il est ainsi quasiment impossible de recenser de manière exhaustive et certaine toutes les manifestations de chaque tradition juridique, a fortiori en ce qu’elles ont influencé le droit de l’Union. Or, si cette entreprise, qui consiste à identifier l’irréductible identité de chaque tradition, s’avère difficile, « l’impossibilité absolue de comparer a un caractère très exceptionnel»5. Cette difficulté provient du choix du lieu d’émission de la recherche, c’est-à-dire le plan sur lequel seront étudiées les différences entre ces deux traditions. Il aurait été possible de choisir de les comparer vis-à-vis du droit positif (français et anglais6 par exemple), ou vis-à-vis de l’influence exercée par la diplomatie à travers les gouvernements britanniques et français, ou enfin vis-à-vis de l’influence exercée par la formation7 des juristes dans les universités françaises et anglaises. Ce sont des plans d’étude résolument concrets, et dont il est pourtant difficile d’inférer une quelconque typologie des différences entre les deux traditions. En effet, le droit anglais emprunte quelques fois à la tradition romano-germanique et vice-versa, tout comme l’influence diplomatique d’un État ou bien encore l’influence des formations sont difficiles à percevoir à travers une étude strictement juridique. L’impossibilité d’étudier sur ce plan l’influence des traditions juridiques implique, soit d’abandonner l’entreprise, soit de la poursuivre sous une autre perspective. À un niveau supplémentaire d’abstraction, il est possible d’envisager l’étude de cette influence en termes de « structure fondamentale »8 de chacune de ces traditions juridiques. Ces structures désignent ce qu’il y a d’irréductible dans l’identité d’une entité, ses propriétés intrinsèques. Elles désignent également une « manière de penser » l’objet à travers ce qui fonde son récit. Les structures juridiques fondamentales et profondes qui caractérisent les deux traditions, leur épistémologie propre, sont celles qui, dès lors, retiendront notre attention.
Pour étudier les différences de structuration mentale des deux traditions juridiques, et plus spécifiquement leur influence en droit de l’Union, il est essentiel là aussi d’identifier le lieu de réception de l’analyse, celui au contact duquel l’hypothèse sera éprouvée. Le but de cette démarche est d’identifier l’outil juridique qui offrirait une étendue sur laquelle étudier cette influence. Cet outil juridique devrait être commun aux deux traditions juridiques, ou au moins ne pas être inconnu à l’une des deux. Cela exclut notamment l’étude de la « qualification » qui, en tant qu’opération du raisonnement juridique, est relativement étrangère au juriste de Common Law. Cet outil enfin doit être suffisamment riche et conséquent pour constituer une étendue sur laquelle étudier cette influence, qui raconte quelque chose sur la manière dont l’objet est perçu par le droit. En cela, la définition juridique9 apparaît comme un outil juridique idoine à propos duquel étudier l’influence des traditions juridiques. La définition décrit le monde, à travers des mots choisis pour ce faire, dans le cadre d’une culture, d’une civilisation qui entend projeter sur chaque objet défini une existence et, quelques fois, une utilité ou une fonction. La définition juridique10 est l’interface entre le fait et le droit et qui décrit le monde. Les mots qui la composent « (prescrivent) la signification d’un terme »11, d’un concept qui désigne la chose. Elle est reliée au phénomène générique qu’il faut doter de critères d’identification. La définition est l’opération cruciale qui permet d’orienter la consistance d’un énoncé normatif en déterminant les critères de rattachement d’un fait à ce dernier. Le choix du type de définition et de certains critères de définition renseigne donc sur la conception que se fait l’auteur du réel qu’il observe. L’activité processuelle que produit la définition en fait une « catégorie modale »12, dont l’étude de l’influence des traditions juridiques permet de clarifier, en partie, les déterminants.
Cela implique, sur le plan méthodologique, plusieurs clarifications. Tout d’abord, pour étudier l’influence des traditions juridiques sur les définitions du droit de l’Union, il était essentiel de choisir un terrain sur lequel éprouver les hypothèses : c’est le droit du vivant qui a été choisi. Ici, le droit du vivant est entendu au sens de la matière vivante humaine d’une part et de son aboutissement en « innovation biomédicale »13 d’autre part. Dans ce domaine, l’enjeu est de taille, dans la mesure où la réalité nommée et définie évolue souvent plus rapidement que le cadre juridique. De plus en plus sophistiqués, modifiés, améliorés, les objets du biodroit nécessitent un encadrement juridique « mutatif ». À cette fin, différentes notions juridiques ont été choisies parmi les différentes législations de droit de l’Union en matière de biodroit ou droit du vivant14. Le biodroit occupe une place singulière dans le paysage du droit de l’Union, dans la mesure où c’est bien l’émergence d’un droit de l’Union qui a fait naître plusieurs de ses objets. Cette remarque ne concerne évidemment pas tous les objets du biodroit, mais en concerne suffisamment pour qu’elle soit formulée. Seule l’adoption d’une approche déductive15 permet de savoir « quoi chercher » dans les définitions observées. Dès lors, il devenait important d’identifier en amont les caractéristiques des traditions juridiques, pour en retrouver les traces parmi les exemples du droit positif. Si des traces de différentes cultures sont perceptibles16, celles-ci s’expriment à des niveaux et sur des objets différents. L’un des intérêts de cette contribution est de constituer une grille de lecture des lieux de l’influence des traditions juridiques sur les définitions européennes du biodroit. Le résultat de l’étude ne conduit pas à une opposition des définitions liée à des traditions juridiques différentes. L’objet de cette étude n’est pas une comparaison des définitions anglaises (a priori dominées par la tradition de Common Law) et des définitions françaises (a priori dominées par la tradition romano-germanique). Bien au contraire, cette étude prend acte de l’impossibilité d’inférer des définitions de droit positif actuel une quelconque caractéristique typique des traditions évoquées.
L’enjeu d’une telle recherche est double. D’une part, il s’agit d’identifier si l’une des deux traditions juridiques l’a emporté sur l’autre. Cela interroge la durabilité des traditions juridiques17, leur actuelle ou supposée étanchéité. Et, en cela, c’est un souci18 partagé qui tente d’être apprivoisé : celui de la dilution des cultures juridiques dans le bouillon encore inabouti de l’uniformisation des droits à l’échelle de l’Union européenne19. D’autre part, et c’est une préoccupation bien plus concrète, il s’agit d’envisager ce qu’implique une telle influence dans la structuration mentale du droit de l’Union d’aujourd’hui en matière d’encadrement du droit du vivant, pris dans ses dimensions de matière vivante et d’innovation biomédicale. L’un des enjeux majeurs du biodroit réside dans la manière dont les ordres juridiques anticipent ou réagissent à de tels objets. Cette étude entend répondre en affirmant que l’influence prépondérante de la tradition romano-germanique en droit de l’Union se traduit par des définitions fonctionnelles permettant de projeter un projet sur l’objet défini.
Le but de cette contribution est d’étudier comment les définitions du biodroit se positionnent vis-à-vis des « structures mentales » des deux traditions juridiques du continent européen, et plus spécifiquement à un niveau de concrétisation supplémentaire, ce que cela implique au regard de l’encadrement des innovations en droit de l’Union. Pour une partie de la doctrine20, l’influence des traditions juridiques est duale et agit sur deux niveaux qui ne se rencontrent pas. D’un côté, les éléments « visibles » d’un système juridique, que sont des éléments structurels comme les concepts ou les institutions, donneraient un avantage à la tradition romano-germanique. De l’autre côté, les éléments « invisibles » du système juridique, qui constituent des éléments culturels comme la manière de raisonner ou de concevoir les droits, donneraient un avantage à la tradition de Common Law21. Or, cette étude entend démontrer que l’influence de la tradition romano-germanique persiste, justement, à travers la manière de raisonner et de concevoir le droit de l’Union. L’identification des caractéristiques des traditions juridiques de Common Law et de droit romano-germanique dans leurs structures cognitives (I), permet d’établir une typologie à partir de laquelle lire l’influence romano-germanique sur la forme et le contenu des définitions du biodroit (II).
I. L’identification des caractéristiques des traditions juridiques à l’intérieur des définitions juridiques
Pour identifier les caractéristiques des traditions juridiques qui ressortent dans les définitions européennes du biodroit, il est essentiel de débuter par l’identification du niveau où seront étudiées les caractéristiques des traditions juridiques : les « structures cognitives » (A). Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’aborder le lien entre ces caractéristiques et la définition juridique (B), avant d’étudier les effets de telles caractéristiques (C).
A) Choisir le lieu de l’étude de l’influence : les « structures cognitives » des traditions juridiques
La première difficulté de cette étude provient de l’identification des caractéristiques pertinentes de chaque tradition juridique22. De nombreux paramètres intéressants pourraient être étudiés, mais à travers les lentilles de la sociologie, de l’anthropologie, de la science politique ou encore celles de la géographie, et non celles du droit23. Or, pour être pertinents dans le cadre de cette étude juridique, les paramètres retenus doivent pouvoir être étudiés en droit, que ce soit dans le cadre d’une étude de dogmatique juridique ou de science du droit24. À cette première difficulté s’ajoute celle de la contingence, de l’incertitude, de l’impossibilité d’inférer de certains paramètres une quelconque influence sur le droit de l’Union. En effet, bien que les traditions juridiques restent distinctes, il n’en reste pas moins que, ponctuellement et dans certains domaines, leurs différences s’atténuent pour laisser place à une forme d’hybridation25. Le droit de l’Union ajoute à cela un phénomène d’harmonisation qui lui est inhérent. De la même manière, certains ordres juridiques tels qu’ils fonctionnent actuellement empruntent à des traditions juridiques qui leur sont a priori ataviquement contraires. C’est notamment le cas de la force de la jurisprudence en droit administratif français. Le découpage des différences entre ces traditions juridiques, à ce niveau de concrétisation, ne saurait être si caricatural. Et à ce titre-là, il n’est pas lisible, et il n’est pas possible d’en inférer des résultats probants, car ceux-ci ne seraient que conjoncturels26.
Dès lors, pour établir une typologie mobilisable dans cette étude des différences entre ces deux traditions juridiques, il est essentiel de se situer à un degré d’abstraction supplémentaire, plus structurel que conjoncturel. C’est la raison pour laquelle c’est la « manière de penser le droit » qui a été retenu dans cette analyse. Il s’agit de la recherche des deux « modes de traitement des problèmes juridiques »27 qui existent à travers la Common Law et la tradition romano-germanique, les « structures cognitives… qui ont déterminé les conditions dans lesquelles a pu se constituer le savoir juridique »28. Penser l’influence des traditions juridiques à travers leurs structures cognitives « typiques »29, permet de partir d’un axiome, celui qui consiste à penser que « le juriste italien continue à réfléchir le droit et la connaissance du droit à l’italienne »30 car ces juristes « viennent à la compréhension du droit munis d’un dispositif aussi complexe qu’unique de précompréhension »31. Choisir d’étudier les structures plutôt que les conjonctures a donc un sens. La conjoncture est une « liaison d’évènements concomitants dans une situation donnée […] généralement attribuée, au moins en partie, au hasard »32. Ce qui en relève ne saurait fournir suffisamment d’éléments dans le cadre de cette étude. En revanche, étudier les structures cognitives qui ont façonné une manière de penser, permet de remonter aux sources d’une pratique et à ce qui la caractérise irréductiblement, en dehors des contingences et du hasard des hybridations. Cela permet aussi et surtout d’assumer méthodologiquement les limites auxquelles aurait pu exposer une telle entreprise. Étudier la structure du mode de raisonnement permet de revenir à la racine d’une « attitude » juridique pour en extraire les caractéristiques typiques qui peuvent être observées dans les pratiques actuelles. Ce sont les caractéristiques structurelles qui demeurent quand les éléments conjoncturels s’hybrident et, in fine, s’évanouissent.
B) Associer les clefs de l’influence : les caractéristiques des traditions et des définitions juridiques
La « manière de penser le droit » relève de la structuration mentale des idées. C’est notamment le cas lorsqu’un juriste français ou allemand « pense son droit comme système33 »34 à l’opposé du juriste anglais qui, lui, pense par problème. Comme le souligne P. Legrand « chargé d’intervenir dans le désordre des faits pour résoudre des litiges, le (juriste) de Common Law ne voit pas comment sa systématisation contribuerait de quelque manière que ce soit à l’assister dans ce qui reste, à ses yeux, une tâche tout à fait pratique »35. La logique de Common Law est inductive, empirique et pragmatique36. La réflexion juridique est menée cas concret par cas concret, dans l’objectif de rétablir une forme d’ordre pour résoudre un problème37. À l’inverse, la logique romano-germanique est déductive, systématique et abstraite38 et en cela, permet le développement d’une réflexion portant sur l’établissement d’un ordre spécifique composé de catégories abstraites. Il en découle que le droit de tradition romano-germanique produit une norme générale, universelle et abstraite pour former un ensemble cohérent, fermé, où toute question de droit doit pouvoir être résolue par l’interprétation d’une règle existante39. À l’inverse, la Common Law produit des normes casuistiques, et forme un système ouvert, où l’enjeu est la détermination de la « méthode » qui permettra de résoudre une question précise. Les catégories sont créées, dans cette tradition, à partir de cas concrets qui se sédimentent, se diversifient et se précisent au cours des décisions rendues. Lorsque le juriste en Common Law produit un récit à travers des cas singuliers (approche idiographique40), celui de tradition romaine produit une règle générale et universelle (approche nomothétique41).
Ces caractéristiques des traditions juridiques trouvent un écho dans la distinction entre les définitions extensives ou par énumération, et les définitions intensives ou par genre et espèce. La définition intensive est matérialisée par l’énonciation des caractéristiques et des critères de reconnaissance de l’objet défini42. Comme définition par « genus et diferentiam » (genre et différence), ce type de définition situe un mot vis-à-vis d’un genre auquel il appartient puis situe ce même mot vis-à-vis d’autres mots dont il se différencie par l’espèce de ses caractéristiques. Ce modèle de définition appartient de manière typique à la tradition romano-germanique où les ramifications entre genre et espèce édifient un système normatif et « nomothétique » d’ampleur. Ce type de définition ne peut s’épanouir que dans un cadre de pensée de type « système » dans la mesure où il nécessite une présentation des notions juridiques en relation d’inclusion et d’exclusion les unes avec les autres. La définition extensive « consiste à circonscrire une notion générale par l’énoncé de la liste de ses éléments constitutifs »43, ce qui permet de nommer chaque objet, singulièrement. Recourir à ce type de définition permet de « remédier à un trop haut degré de généralité et d’abstraction »44 propres quant à eux aux définitions intensives présentes dans les traditions de droit romain. La définition par énumération permet avec certitude de rattacher l’objet défini et expressément énuméré à la notion qui y est rattachée, ce qui résout le problème par l’exemple et au cas par cas. Ce mode de définition est en cela pragmatique et permet de résoudre un problème concret, ce qui sied particulièrement à la structuration du droit en Common Law.
Ces deux types de définitions – intensive et extensive – appartiennent au genre des définitions informatives45. Elles désignent toutes deux l’essence des choses. Parmi les définitions informatives, il est possible de trouver également les définitions ontologiques, qui sont des définitions réelles « qui cherchent à correspondre à une réalité […], une vérité ontologique »46. Ces définitions s’attachent à décrire le plus sobrement possible le réel observé, ce qui s’éloigne sensiblement de l’entreprise menée par le recours à d’autres types de définitions. C’est le cas des définitions stipulatives47 qui prescrivent la fonction des choses. Elles sont des définitions nominales qui « (proposent) des découpages conventionnels du monde »48 évalués à l’aune d’une « fonction, une utilité, une pertinence, une finalité, un caractère opératoire »49. Ces définitions stipulatives50 ne sont pas rares en droit, et se reconnaissent à leur capacité à « s’écarter en tout ou partie des représentations habituelles de la réalité des choses »51, car le but de leur formulation, souvent arbitraire, est de « remplir certaines fonctions »52 notamment par le jeu des fictions juridiques53. Ce type de définition présente des limites et la plus délicate serait sans doute celle de s’écarter trop librement de la réalité désignée, de sorte qu’il devient important de prendre en compte « a minima les représentations dominantes du sens des mots »54. Ces deux types de définition racontent deux manières très différentes de décrire le monde, et dont les effets sont assez considérables.
C) Informer les effets de l’influence : défragmentation et anticipation normative
La distinction des structures cognitives permet de comprendre que de manière irréductible, la Common Law privilégiera toujours « l’individualisation et la particularisation »55 là où la tradition romano-germanique privilégiera « les valeurs de généralisation et d’uniformisation qu’autorise la voie commune du commandement législatif »56. Ces deux voies empruntées par les deux traditions juridiques concrétisent une tendance à la défragmentation empruntée par la voie romano-germanique et une tendance à la fragmentation empruntée par la voie de la Common Law. En effet, la défragmentation produit et est le produit d’une généralisation et d’une uniformisation, alors que la fragmentation produit et est le produit d’une individualisation et d’une particularisation des situations. Cela signifierait alors que le recours à des cadres de pensée romano-germanique traduirait un phénomène de systématisation concrétisé en droit de l’Union par une défragmentation, à savoir une harmonisation et une uniformisation des normes nationales.
Par ailleurs, dans la tradition romano-germanique, la structuration du droit par la codification et les ramifications par catégories juridiques constitue un roman juridique où les juristes « s’adonnent avec ferveur à l’édiction de normes juridiques visant à anticiper les litiges qui pourraient survenir »57. Les structures qu’édifient, en amont, les règles écrites dans les divers États de la tradition romaniste « rendent les évènements plus faciles à prédire et à interpréter »58. À l’inverse, le juriste de Common Law « ne prétend jamais anticiper sur l’avenir. Il attend le litige, le résout, et attend le prochain litige »59. En matière de biodroit, cette dichotomie a d’autant plus d’intérêt. Les objets de ce domaine étant en perpétuelle évolution, l’enjeu majeur réside dans la génération d’un droit capable d’anticiper les innovations biomédicales. Les structures cognitives de la Common Law permettent de trouver les ressources pour résoudre le problème lorsqu’il se présente, à l’inverse de celles de la tradition romano-germanique qui instituent un système ramifié à l’aide de catégories fondées sur des notions définies de manière suffisamment abstraites pour intégrer en leur sein des objets qui n’existent pas encore mais seraient susceptibles de s’y rattacher.
II. L’application des caractéristiques des traditions juridiques aux définitions du biodroit
Pour mener cette étude, et éprouver au contact du droit positif cette hypothèse de classification des définitions juridiques en fonction des traditions juridiques, onze définitions issues du domaine du biodroit ont été retenues. Pour disposer d’un panel suffisamment représentatif, certaines notions retenues désignent des substances d’origine humaine (sang, cellules, tissus…) tandis que d’autres désignent des produits ou des médicaments (médicaments de thérapie innovante, immunologiques, biotechnologiques…). Ces définitions peuvent être classées à travers la typologie effectuée plus haut, et cette classification a une signification et illustre la prépondérance de la tradition romano-germanique. En effet, si les définitions de médicaments sont extensives et en cela relèvent davantage d’une tradition de Common Law (A), il n’en reste pas moins que la tradition romano-germanique est prépondérante à la fois dans la définition intensive des substances d’origine humaine (B) et, de manière plus étonnante, dans la définition prétorienne de l’embryon humain (C).
A) La définition extensive de notions initialement européennes : les médicaments et produits d’innovation biomédicale
Le recours à des définitions extensives est essentiellement réservé à des notions inédites issues du droit de l’Union, et illustre l’influence assez résiduelle de la Common Law. En effet, la notion de médicament biologique est définie comme « un produit dont la substance active est une substance biologique » et comprenant « les médicaments immunologiques et les médicaments dérivés du sang et du plasma humains… les médicaments de thérapie innovante » 60. De la même manière, la notion de médicament de thérapie innovante est définie à travers l’énumération limitative de tous les objets qui composent cette catégorie, à savoir « l’un des médicaments à usage humain suivants : – un médicament de thérapie génique tel que défini dans l’annexe I, partie IV de la directive 2001/83/CE ; – un médicament de thérapie cellulaire somatique tel que défini dans l’annexe I, partie IV de la directive 2001/83/CE ; – un produit issu de l’ingénierie tissulaire tel que défini au point b »61. C’est la même chose pour la notion de médicament immunologique, définie comme « tout médicament consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes » et parmi lesquels les vaccins sont des « i) agents utilisés en vue de provoquer une immunité active telle que le vaccin anticholérique, le BCG… ; ii) agents utilisés en vue de diagnostiquer l’état d’immunité… ; agents utilisés en vue de provoquer une immunité passive… »62. Enfin, la notion de médicament issu de certains procédés biotechnologiques est définie comme des produits « issus de l’un des procédés biotechnologiques suivants : – technologie de l’acide désoxyribonucléique recombinant, expression contrôlée de gènes codant pour des protéines […], méthodes à base d’hybridomes et d’anticorps monoclonaux, médicaments vétérinaires […] destinés principalement à être utilisés comme améliorateurs de performance »63. Ces définitions extensives ou par énumération permettent a priori un rattachement concret, facile et évident des objets appréhendés à la catégorie de rattachement et, en cela, éloignent les opérations de qualification qui suscitent abstraction et généralité64. Ces définitions par extension ont toutes un point un commun : elles portent sur des objets que le droit de l’Union a fait exister en les nommant et en les définissant. Cela peut signifier que la construction d’une notion autonome permet à l’Union européenne de s’extraire d’une précaution d’abstraction qui lui permettrait une plus grande maîtrise de son objet. En effet, elle maîtrise de bout en bout la chaîne des significations que peut recouvrir cet objet qu’elle a créé en droit, nommé, défini, illustré et doté d’un régime harmonisé. Cette stratégie de dénomination n’est pas du tout partagée dans le cadre de notions qui existent déjà en droit interne.
B) La définition intensive de notions déjà définies en droit interne : les « substances d’origine humaine »
Parmi les définitions retenues, certaines sont formellement identifiables comme définitions intensives « par genre et différence » et toutes définissent des concepts existant déjà dans la plupart des droits internes. C’est très singulièrement le cas du sang, des cellules et des tissus. Il faut ajouter à cette liste également des notions, n’existant qu’en droit de l’Union, mais décrivant un concept déjà existant dans certains droits nationaux : la substance d’origine humaine et la matière biologique. L’autre caractéristique des définitions du sang, des tissus et des cellules est l’évolution de leur contenu entre les versions initiales des années 2000 et la version de la proposition de règlement SoHO de 2022.
La définition juridique du sang a fait l’objet d’une évolution substantielle. Dans la directive de 2002, le sang est défini comme « le sang total prélevé chez un donneur et transformé à des fins soit de transfusion soit de fabrication »65, alors que dans la proposition de règlement SoHO de 2022, le sang est « le liquide circulant dans les artères et les veines, qui apporte de l’oxygène aux tissus du corps et les débarrasse du dioxyde de carbone »66. Cette remarque suit également la définition du composant sanguin qui passe d’un « composant thérapeutique du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma), qui peut être obtenu par différentes méthodes »67 à « un composant du sang tel que les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma, qui peut être séparé de celui-ci »68. La définition des tissus et la définition des cellules évoluent de la même manière. En effet, dans la version de 2003, les cellules sont « des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées entre elles par un tissu conjonctif »69 et les tissus désignent « toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules »70. À l’inverse, dans la version de 2022, la cellule est « une masse de cytoplasme, avec ou sans noyau, délimitée par une membrane cellulaire. Généralement de taille microscopique, les cellules sont la plus petite unité structurelle et fonctionnelle d’un organisme »71 et le tissu est « un groupe de cellules qui fonctionnent ensemble en tant qu’une unité »72.
L’évolution de ces définitions est spectaculaire. Et cette impression est confirmée par la disparition des définitions dans la version finale du Règlement, adopté le 13 juin 202473. Le contenu de la définition évolue, en partant de la mise en valeur des fonctions projetées sur l’objet défini74 à la mise en valeur de ses caractéristiques ontologiques, intrinsèques75. S’il est difficile d’identifier la raison d’une telle évolution, il est possible néanmoins d’expliquer les potentialités que permet chacune de ces définitions. Une définition « fonctionnelle » (comme celles de 2002 et 2003) définit l’objet à travers les fonctions qui lui sont assignées. La détermination fonctionnelle ou fonctionnaliste de l’objet défini se manifeste notamment par la mention de la modification de l’objet pour une finalité donnée76, ou par l’utilisation de l’objet ou le but qui lui est assigné77. La détermination de l’utilité et de la fonction d’un objet replace ce dernier dans le projet de son auteur. Cela reconstitue le lien entre l’utilité d’un objet et la finalité que lui assigne le sujet. Par ce biais, l’auteur de la qualification maîtrise la destination de l’objet. À l’inverse, la définition ontologique met l’accent sur les éléments bio-véridiques qui caractérisent l’objet, ses caractéristiques biologiques. Ce type de définition est biologiquement satisfaisant, mais juridiquement assez indéterminé, à défaut de finalité assignée. Ainsi, a priori, ce type de définition ne permet pas à son auteur primaire (celui qui choisit d’assigner cette définition à ce mot) de maîtriser la destination de l’objet défini par la définition elle-même. En revanche, il en va tout autrement de la latitude78 dont dispose l’auteur de la qualification secondaire (celui qui applique la définition posée). Ce dernier maîtrise la destination de l’objet défini car, à défaut de finalité strictement définie en amont, ce sont toutes celles qu’il imagine en aval qui s’appliqueront à cet objet.
L’autre caractéristique des définitions retenues est leur nature intensionnelle par genre et différence. En effet, chacune est caractérisée par l’énumération de caractéristiques propres à l’objet défini, sans la médiation d’une liste d’exemples. Telle une mise en abîme de la définition « par genre et espèce », il est possible de classifier dans cette typologie, à la fois les espèces que désignent sang, tissu et cellule, mais également le genre qui inclut ces espèces : substance d’origine humaine et matière biologique. Si toutes ces notions entretiennent une relation de genre et espèces, il n’est donc pas étonnant qu’elles se trouvent définies les unes par rapport aux autres, et surtout de la même manière, à savoir de manière intensionnelle. Concernant les « genre », la matière biologique est définie comme une « matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique »79, et la substance d’origine humaine est définie comme « toute substance prélevée du corps humain, qu’elle contienne ou non des cellules et que ces cellules soient vivantes ou non, y compris les préparations à base de SoHO issues de la transformation d’une telle substance »80. Concernant les « espèces », il est renvoyé aux définitions plus haut retranscrites81. Toutes ces notions appartiennent à un système cohérent gravitant autour d’un genre (la substance d’origine humaine) qui se décline selon trois espèces (sang, tissu, cellule) et où la notion de prélèvement et de transfusion a une importance pour déterminer l’origine et l’utilisation de ces espèces. Il est important de noter que ces définitions désignent des objets qui sont déjà définis dans la plupart des droits internes. Il est possible de voir dans cet acte la manifestation d’une « maturité assez forte pour s’assumer » et un « élément d’émancipation, d’autonomisation du droit qui peut par-là échapper à ceux qui en avaient traditionnellement la maîtrise »82. La prépondérance de la tradition romano-germanique se traduit ici par le recours à des définitions réticulaires83 et conceptuelles qui font « système ». Et cette prépondérance s’exerce en particulier sur des notions qui existent déjà dans le droit positif de certains États membres. Dès lors, le recours aux structures de la tradition romano-germanique permet à l’Union une maîtrise plus grande des objets qu’elle appréhende selon ses propres paramètres.
C) L’influence romano-germanique d’une définition pourtant prétorienne : l’embryon humain
Il est important de noter l’exemple atypique de la définition de l’embryon humain. À titre liminaire, il convient de préciser que l’embryon humain appartient bien au genre des « substances d’origine humaine », si l’on prend en considération le fait qu’il est qualifié comme tel dans le Règlement SoHO du 13 juin 2024 qui dispose que « les embryons sont considérés comme des SoHO reproductrices »84. À défaut de définition légale, comme les notions précédemment étudiées, l’embryon humain est désigné dans la directive relative aux inventions biotechnologiques85 et est défini par la Cour de justice de l’Union européenne dans deux arrêts d’ampleur en 2011 et 201486. Ces deux définitions prétoriennes se contredisent à trois ans d’intervalle. Dans l’affaire Brüstle de 2011 « constitue un “embryon humain” tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer »87, alors que dans l’affaire Stem Cells de 2014 « un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un “embryon humain”, au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain »88.
Pour autant, vu sous l’angle de cette étude, son traitement est très singulier. Ce revirement de jurisprudence très appuyé, incite a priori à classer la situation dans les cadres de la Common Law, en raison précisément de la place qu’a pris la Cour de justice dans cette opération, pour résoudre un problème concret qui lui était posé. Or, cette opération ne s’apparente en rien à une opération de Common Law. Si cela avait été le cas, le juge aurait dû examiner les faits et identifier s’il y avait ou non identité factuelle entre ce cas et une autre situation comparable. En cas d’identité factuelle, il aurait dû appliquer la solution du précédent Brüstle. En cas de défaut d’identité factuelle, il aurait dû « distinguer » les faits pour se libérer du précédent. Quand le juge rend sa décision, et est face au choix de mobiliser ou non un précédent, il évalue s’il doit privilégier l’intégrité de l’édifice juridique ou bien l’équité de sa décision, quand bien même cela fragiliserait la cohérence de sa jurisprudence89. Si la Cour avait agi conformément à la tradition de Common Law, elle serait partie de l’appréciation des faits, et non de l’interprétation du droit, comme l’aurait fait un juge de tradition romano-germanique, et comme elle l’a fait en l’espèce. En plus, en interprétant la directive 98/44, la Cour définit l’embryon de manière manifestement stipulative, en ce qu’elle s’est écartée de la réalité biologique de l’embryon humain pour le décrire de manière plus arbitraire90. La décision juridictionnelle en Common Law « ne peut être considérée indépendamment des faits sur lesquels elle a porté »91, à l’inverse de la décision juridictionnelle en tradition romaniste, où les faits « n’ont jamais marqué qu’un point de départ permettant à la Cour de s’en servir comme marchepied sur la voie de la formulation d’une proposition normative »92. En agissant ainsi, la Cour a illustré un tropisme davantage romano-germanique du droit de l’Union européenne, pour définir une réalité (l’embryon) déjà appréhendée dans les droits internes, à défaut d’y être définie dans la majorité des cas. La dimension stipulative de la définition accentue à la fois la maîtrise des finalités de l’objet et l’autonomisation de la notion d’embryon recherchées par l’Union.
En initiant cette étude, l’un des résultats attendus était d’aboutir à la démonstration de la prégnance de la Common Law dans la structuration des définitions. En effet, l’influence de « l’univers » anglo-saxon paraît assez évidente, que ce soit notamment à travers la langue de travail et de communication, les méthodes de travail ou la formation des juristes93 alors même que les États de Common Law sont très minoritaires dans l’Union européenne. Pourtant, et contrairement à cette attente, l’influence de Common Law est assez résiduelle en matière de définitions européennes du biodroit. En effet, cette dernière est circonscrite aux notions autonomes ou qui n’existent qu’en droit de l’Union. Ici, leur définition par extension permet à l’Union de maîtriser la finalité de l’objet nommé et de répondre à un problème concret posé. À l’inverse, l’influence du droit romano-germanique est clairement prégnante en ce qui concerne les définitions de notions qui existent déjà en droit interne, qui ont déjà un sens commun ou juridique. Ces notions recouvrent essentiellement les cas de substances d’origine humaine (sang, cellule, tissu). Ici, les définitions sont intensionnelles, et les notions entretiennent des relations d’inclusion et d’exclusion qui fondent un système, abstrait. L’enquête menée sur les traces de l’influence des traditions juridiques sur cette parcelle du droit de l’Union européenne aboutit à la mise en lumière de comportements bien identifiables. En effet, le raisonnement par problème ne rencontre pas les mêmes situations que le raisonnement par système. S’ils sont identifiables, ces comportements sont imputables aux structures cognitives de l’une et l’autre des traditions, et la prépondérance de l’influence romano-germanique nous incite à penser qu’effectivement, ces traditions ne se confondent pas dans un « métadiscours commun»94.
1 P. Feyerabend, Farewell to Reason, éd. Verso, 1987, p. 274.
2 Voir notamment É. Carpano et E. Mazuyer, Les grands systèmes juridiques étrangers, Lextenso, 2009 ; L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, LGDJ, 1983 ; G. Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, LGDJ, 2011 ; R. David et C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Dalloz, 2002 ; M. Fromont, Grands systèmes de droits étrangers, Dalloz, 2009 ; R. Legeais, Grand systèmes de droit contemporains. Approche comparative, Litec, 2008 ; P. Legrand, Le droit comparé, PUF, « Que sais-je ? », 2011 ; R. Senoussi, Introduction au droit comparé, Dunod, 2008 ; M. Reimann, International Encyclopedia of Comparative Law, Brill | Nijhoff, 2020.
3 La première tradition (romano-germanique) se développe à travers une classification typologique des notions, ce qui signifie que les catégories, souvent d’origine légale, sont stabilisées et fonctionnent selon une relation hiérarchique d’inclusion, d’exclusion et de complémentarité. La seconde (Common Law) se développe quant à elle à travers une classification généalogique qui valorise l’origine de l’objet classifié et produit une diversification progressive des objets à travers le temps.
4 Notons que l’Écosse bénéficie d’un particularisme en raison de l’influence romaine qu’elle connut jusqu’au xixe. Ce particularisme tient à la survivance d’un type de droit civil non codifié issu du Corpus Juris Civilis associé à la survivance d’un type de Common Law antérieur au Traité d’Union de 1707. En cela, l’Écosse peut être classifiée dans les systèmes juridiques mixtes.
5 R. Legeais, Grands systèmes de droit contemporains. Approche comparative, Litec, 2008, p. 255.
6 Les exemples « français » et « anglais » sont empruntés ici, en raison de leur statut de représentant idéal des traditions romano-germanique et de Common Law et ce, malgré le « Brexit ».
7 Notons d’ailleurs que cette étude est elle-même menée dans le cadre d’une recherche française, de droit public, ce qui n’exclut pas de potentiels tropismes d’analyse en dépit de toutes les précautions prises.
8 La notion même de « structure fondamentale » ici employée n’est pas entièrement étrangère à la manière dont l’emploie Bernard Lahire à propos, non des traditions juridiques, mais des sociétés humaines (B. Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, coll. Sciences sociales du vivant, La Découverte, 2023). Bien que dans la présente contribution, le sens ne soit pas le même, la notion de « structure fondamentale » a pu également être employée dans le cadre précis de Common Law, pour désigner des caractéristiques constitutionnelles qui ne sauraient être révisées ou revues par le législateur.
9 Précisons d’emblée que l’étude de la « définition juridique » passera inévitablement par l’étude du « concept juridique » défini.
10 Voir notamment les travaux d’Alain Rey, « Polysémie du terme définition », in La définition, Colloque du Centre d’étude du lexique, Larousse, coll. Langue et Langage, 1990 ; C. Wolmark, La définition prétorienne. Étude en droit du travail, thèse Univ. Perpignan, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 1997 ; V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 2022, Dalloz ; C. Eisenmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », APD, 1966, p. 33 ; D. Truchet, « Les définitions législatives », in R. Drago (dir.), La confection de la loi, PUF, 2005, p. 193.
11 X. Bioy, « Quelles lectures théoriques de la qualification ? », inM. Nicod (dir.), Les affres de la qualification, LGDJ, Presses de l’Université Toulouse I Capitole, 2015, p. 20.
12 P. Amselek, « Les fonctions normatives ou catégories modales », Philosophiques, vol. n° 33, n° 2, 2006, p. 391-418.
13 Pour de plus amples développements sur cette notion « d’innovation biomédicale », il est fait ici référence aux deux contributions réalisées par Aurélie Mahalatchimy et Éloïse Gennet.
14 Les notions retenues sont : le sang, le composant sanguin, le tissu, la cellule, l’embryon, la matière biologique, la substance d’origine humaine, le médicament de thérapie innovante, le médicament biologique, le médicament immunologique, les médicaments issus de certains procédés biotechnologiques.
15 Cela suppose le rejet d’une approche inductive, qui serait partie de l’identification de définitions juridiques, pour en induire des caractéristiques spécifiques. Une approche déductive part quant à elle des caractéristiques des définitions et de chaque tradition juridique pour en retrouver les traces dans le matériau d’analyse.
16 Voir les travaux d’Hélène Ruiz Fabri, « Principes généraux du droit communautaire et droit comparé », in Droits, Revue française de théorie juridique, 2007, p. 127-142 ; H. Ruiz Fabri, « Le droit comparé et l’internationalisation du droit : Introduction », inJean du Bois de Gaudusson (dir.), Le devenir du droit comparé en France, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 83 et. s.
17 Voir notamment les travaux de S. Glanert, « La langue en héritage : réflexions sur l’uniformisation des droits en Europe », RIDC , vol. 58, n° 4, 2006, p. 1231-1247 ; S. Glanert, « L’européanisation des droits au risque de la littérature-monde », Revue internationale d’études juridiques, vol. 64, n° 1, 2010, p. 1-59.
18 Voir notamment, à propos du souci suscité par la possible dilution des traditions juridiques les travaux de P. Legrand, « Antivonbar », Journal of Comparative Law, 2006, n° 1, p. 13 ; P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, 1996, p. 779 ; Y. Lequette, « Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen de M. von Bar », Dalloz actualité, 2002, p. 2202 ; E. Descheemaeker, « Faut-il codifier le droit privé européen des contrats ? », McGill Law Journal, 2002, n° 47, p. 791.
19 Voir notamment les projets « Lando » et « Von Bar » : O. Lando (dir.), Principes du droit européen des contrats, trad. par G. Rouhette, Société de législation comparée, 2003 ; Christian von Bar, « Le groupe d’études sur un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, 2001, p. 127 ; Chr. Von Bar et O. Lando, « Communication on European Contract Law: Joint Response of the Commission on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code », European Review of Private Law, 2002, n° 10, p. 379.
20 Spécifiquement pour M.-C. Ponthoreau, « Droit comparé et théorie juridique », inJean du Bois de Gaudusson (dir.), Le devenir du droit comparé en France, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 51-68.
21 C’est notamment le cas du style discursif, narratif et analytique de rédaction judiciaire qu’a adopté la Cour de justice, ainsi que l’autorité du précédent dans la solution rendue et la force du juge dans l’interprétation du droit, sans parler en outre de la langue de travail et d’écriture anglaise dans la rédaction des actes juridiques.
22 Pour M.-C. Ponthoreau, par exemple, il est important de s’interroger sur l’objet de la comparaison, c’est-à-dire « les concepts juridiques, les règles de droit positif, les discours juridiques ou bien les structures cognitives » (M.-C. Ponthoreau, « Le droit comparé en question(s) », RIDC, n° 1, 2005, p. 16).
23 C’est le cas notamment de l’étude de l’influence des formations universitaires des juristes, de l’influence des gouvernements, de celle des droits positifs.
24 Le discours de la science du droit est ici entendu comme recouvrant toutes les études théoriques dont l’objet est aussi bien le droit que le discours de la dogmatique sur le droit.
25 Pour des travaux sur l’hybridation des cultures et traditions juridiques, voir notamment M. Delmas-Marty, « Réflexions sur le rôle du droit comparé dans le contexte de l’internationalisation pénale », inY. Aguila (dir.), Quelles perspectives pour la recherche juridique ?, Presses universitaires de France, 2007, p. 205-212 ; M. Delmas-Marty, Critique de l’intégration normative. L’apport du droit comparé à l’harmonisation des droits, coll. Les voies du droit, Presses universitaires de France, 2004 ; M. Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné. Les forces imaginantes du droit, Seuil, 2006, spéc. Chapitre III consacré à « l’unification par hybridation », p. 101-129 ; M.-C. Ponthoreau, « Trois interprétations de la globalisation juridique : approche critique des mutations du droit public », AJDA, 2006, p. 20 ; T. Rambaud, Introduction au droit comparé. Les grandes traditions juridiques dans le monde, coll. Quadrige, Presses universitaires de France, 2017, spéc. Chapitre II consacré au « rapprochement des grandes traditions juridiques dans le monde », p. 281-336.
26 Qu’il soit permis ici de préciser que le constat de l’impossibilité d’étudier l’influence des traditions juridiques et donc de comparer leur influence ne joue que dans le cadre de « cette » étude et n’entend pas tirer de conséquences générales sur l’efficacité éprouvée des méthodes plus classiques, notamment fonctionnelles, de droit comparé. Loin de nous l’idée de faire montre ici d’un « scepticisme qui ne laisse place qu’à l’impossibilité de comparer à cause de l’incommensurabilité des différences » (M.‑C. Ponthoreau, « Le droit comparé en question(s) », RIDC, n° 1, 2005, p. 24).
27 R. Pound, The Spirit of Common Law, Francestown, NH, Marshal Jones, 1921, p. 1.
28 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 781.
29 M.-C. Ponthoreau, « Le droit comparé en question(s) », RIDC, n° 1, 2005, p. 24.
30 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 799.
31 Ibid.
32 Cnrtl, définition de « conjoncture ».
33 Voir notamment J. Dabin, La technique de l’élaboration du droit positif, Bruylant, 1935.
34 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 780.
35 Ibid., p. 782.
36 Voir notamment, sur le développement de ces traits essentiels : O. Wendell Holmes, The Common Law, Brown & Co., 1881 ; S. Glanert, « Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous sont tenus », in P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Presses universitaires de France, 2009 ; A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003 ; M. van Hoecke, « Raisonnement juridique et droit comparé », in Y. Cartuyvels (dir.), Le droit malgré tout, Presses universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2018, p. 53-75 ; P. Legrand et G. Samuel, Introduction au Common Law, coll. Repères, La Découverte, 2008, spéc. Chapitre V relatif aux « Perspectives théoriques », p. 88-101.
37 Voir notamment P. Legrand et G. Samuel, Introduction au Common Law, coll. Repères, La Découverte, 2008, spéc. Chapitre IV relatif au « Panorama épistémologique », p. 59-87.
38 Voir entre autres références : É. Carpano et E. Mazuyer, Les grands systèmes juridiques étrangers, Lextenso, 2009 ; G. Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, LGDJ, 2011 ; R. David et C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Dalloz, 2002 ; M. Fromont, Grands systèmes de droits étrangers, Dalloz, 2009 ; R. Legeais, Grand systèmes de droit contemporains. Approche comparative, Litec, 2008 ; P. Legrand, Le droit comparé, PUF, « Que sais-je ? », 2011 ; S. Glanert, « Comparaison et traduction des droits : à l’impossible tous sont tenus », inP. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Presses universitaires de France, 2009.
39 A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, spéc. Chapitre II relatif à « La Common Law », p. 39-66.
40 En grec, « idios » signifie le singulier, donc « idios » et « graphos » signifie l’étude du cas singulier.
41 En grec, « nomos » signifie la norme générale.
42 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et sciences du droit, coll. Méthodes du droit, Dalloz, 2022, p. 328.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Au sens où l’entend V. Champeil-Desplats, (Idem., p. 325). L’auteur inclut dans cette catégorie les définitions par genre et différence, par la fonction, conceptuelle, par énumération, lexicale, ostensives.
46 Ibid.
47 Les définitions stipulatives « proposent d’utiliser un terme préexistant d’une façon nouvelle, proposant d’utiliser un terme de manière plus précise […] établissent comment utiliser un terme sous un angle nouveau » (V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et sciences du droit, op. cit., p. 303).
48 Ibid., p. 331.
49 Ibid., p. 326.
50 Voir également M. Troper, « Pour une définition stipulative du droit », Droits, n° 10, 1989, p. 101.
51 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et sciences du droit, op. cit., p. 332.
52 Idem., p. 331.
53 Voir notamment Y. Thomas, « Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits, 1995, p. 52-63 ; J.-L. Bergel, « Le rôle des fictions dans le système juridique », Revue de droit de McGill, n° 4, 1988, p. 361 ; G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, Thèse, Univ. Perpignan, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 1997 ; Ph. Woodland, Le procédé de la fiction dans la pensée juridique, Thèse, Univ. Paris 2, 1981 ; J. Dabin, La technique d’élaboration du droit positif, Bruylant, 1935, p. 275 ; O. Cayla, « Le jeu de la fiction comme ci et comme ça. La fiction », Revue française de théorie juridique, n° 2, PUF, 1995.
54 Ibid.
55 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 794.
56 Ibid.
57 Ibid., p. 796.
58 Ibid., p. 797. Pierre Legrand évoque à ce sujet les travaux du philosophe M. Oakeshott, qui distingue deux « formes de moralité » (M. Oakeshott, Rationalism in politics, Methuen, 1962, p. 61-70). D’un côté, il existe une moralité « rationnelle et articulée » proche de la tradition romaniste, qui débute par la détermination d’une règle à suivre, qui débouche sur les fins souhaitables et réalisables par le respect de cette règle. Cette moralité se construit sur un mode déductif, où les règles précèdent les pratiques. D’un autre côté, il existe une moralité, plus proche de la tradition de Common Law, fondée sur l’adoption de comportements qui ne se réfèrent pas à une règle abstraite mais bien à des habitudes concrètes. Cette moralité se construit sur un mode quasi inductif, au moins non déductif, où les « constantes sont le produit de la pratique ».
59 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 795.
60 Annexe I-3.2 Directive 2003/63/CE de la Commission, modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et l’Annexe I du Règlement (CE) n° 1084/2003 de la Commission, du 3 juin 2003, concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente d’un État membre pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires.
61 Article 2.1.a du Règlement (CE) n° 1394/2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante.
62 Article 1.4 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
63 Annexe A du Règlement (CE) 2309/93 du Conseil établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments.
64 C’est a priori le cas, car c’est ce à quoi l’on peut logiquement s’attendre étant donnée la clarté avec laquelle ces objets sont désignés in extenso dans la liste. Cependant, cela n’exclut pas les difficultés de rattachement.
65 Article 3.a de la Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE.
66 Article 3.1 de la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2022 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine, COM(2022)338, dit « SoHO »
67 Article 3.b de la directive 2002/98/CE.
68 Article 3.2 de la Proposition de Règlement « SoHO ».
69 Article 3.a de la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humaines.
70 Article 3.b de la directive 2004/23/CE.
71 Article 3.3 de la Proposition de Règlement « SoHO ».
72 Article 3.4 de la Proposition de Règlement « SoHO ».
73 Le malaise que suscitent de telles définitions est confirmé car, il est important de le noter, les définitions des notions de sang, tissus, et cellules prévues dans la proposition de règlement SoHO du 22 juillet 2022 ont disparu et ne font pas partie de la version finale du Règlement SoHO adopté le 13 juin 2024. Leur disparation en cours de procédure et au cours des négociations illustre l’embarras qu’elles suscitent, le consensus qu’elles ne parviennent pas à générer. Seulement, pour les besoins de la présente étude ayant eu lieu avant l’adoption du Règlement définitif du 13 juin 2024, il sera ici fait uniquement référence aux définitions issues de la proposition de Règlement du 22 juillet 2022.
74 Par exemple « le sang total prélevé chez un donneur et transformé à des fins soit de transfusion soit de fabrication » (directive 2002/98).
75 Par exemple « le liquide circulant dans les artères et les veines, qui apporte de l’oxygène aux tissus du corps et les débarrasse du dioxyde de carbone » (Proposition de Règlement « SoHO »).
76 Le composant sanguin « peut être obtenu par différentes méthodes » (directive 2002/98), les « cellules d’origine humaine sont isolées » (directive 2004/23).
77 Le sang est prélevé « à des fins soit de transfusion soit de fabrication de médicament » (directive 2002/98).
78 Il faut néanmoins préciser que certaines dispositions, en particulier celles relatives aux objectifs et aux champs d’application des règlementations adoptées, encadrent cette maîtrise, et la latitude laissée par ces dispositions est variable.
79 L’article 2.1.a de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
80 Article 3.1 de la Proposition de Règlement « SoHO ».
81 Pour rappel, le sang est « le sang total prélevé chez un donneur et transformé à des fins soit de transfusion soit de fabrication », les cellules sont « des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées entre elles par un tissu conjonctif » et les tissus désignent « toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules », le tissu est « un groupe de cellules qui fonctionnent ensemble en tant qu’une unité ».
82 B. Brunessen, « Les catégories juridiques établies par le traité de Lisbonne : un mal nécessaire ? », in B. Brunessen (dir.), Les catégories juridiques du droit de l’UE, Bruylant, 2016, p. 20.
83 Les définitions sont organisées dans une sorte de réseau, d’où leur dimension « réticulaire ».
84 Article 3.3 du Règlement (UE) 2024/1938 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE.
85 Article 6 de la Directive 98/44/CE.
86 CJUE, 18 octobre 2011, Brüstle, C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669 ; CJUE, 18 décembre 2014, Stem Cells, C-364/13, ECLI:EU:C:2014:2451.
87 CJUE, 18 octobre 2011, Brüstle, C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669, §38.
88 CJUE, 18 décembre 2014, Stem Cells, C-364/13, ECLI:EU:C:2014:2451, §38.
89 Th. Acar, « La théorie du droit de R. Dworkin : une théorie pédagogique à l’égard des juges », in V. Champeil-Desplats (dir.), Pédagogie et droits de l’homme, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014, p. 167-180, §35 ; R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, coll. Léviathan, Presses universitaires de France, 1995, p. 201.
90 En effet, quel manuel de biologie nous apprendrait que « constituent un “embryon humain” tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer » (CJUE, Brüstle) ?
91 P. Legrand, « Sens et non-sens d’un Code civil européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 48, n° 4, 1996, p. 789.
92 Ibid.
93 Nous renvoyons pour cela aux développements plus hauts, qui font la part des choses entre les déterminants qu’il était possible et impossible de prendre en considération dans une étude juridique.
94 P. Feyerabend, Farewell to Reason, Londres, Verso, 1987, p. 274.
Marie Glinel, « L’influence des traditions juridiques sur les définitions européennes du biodroit », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4184.