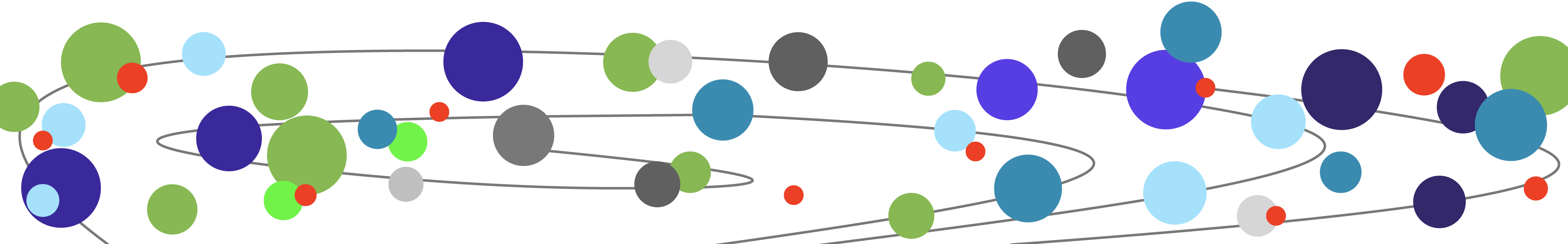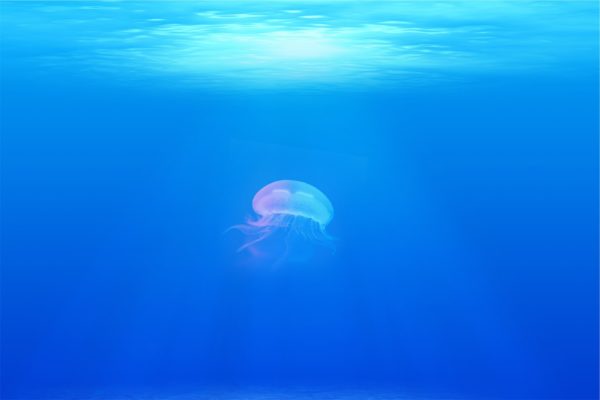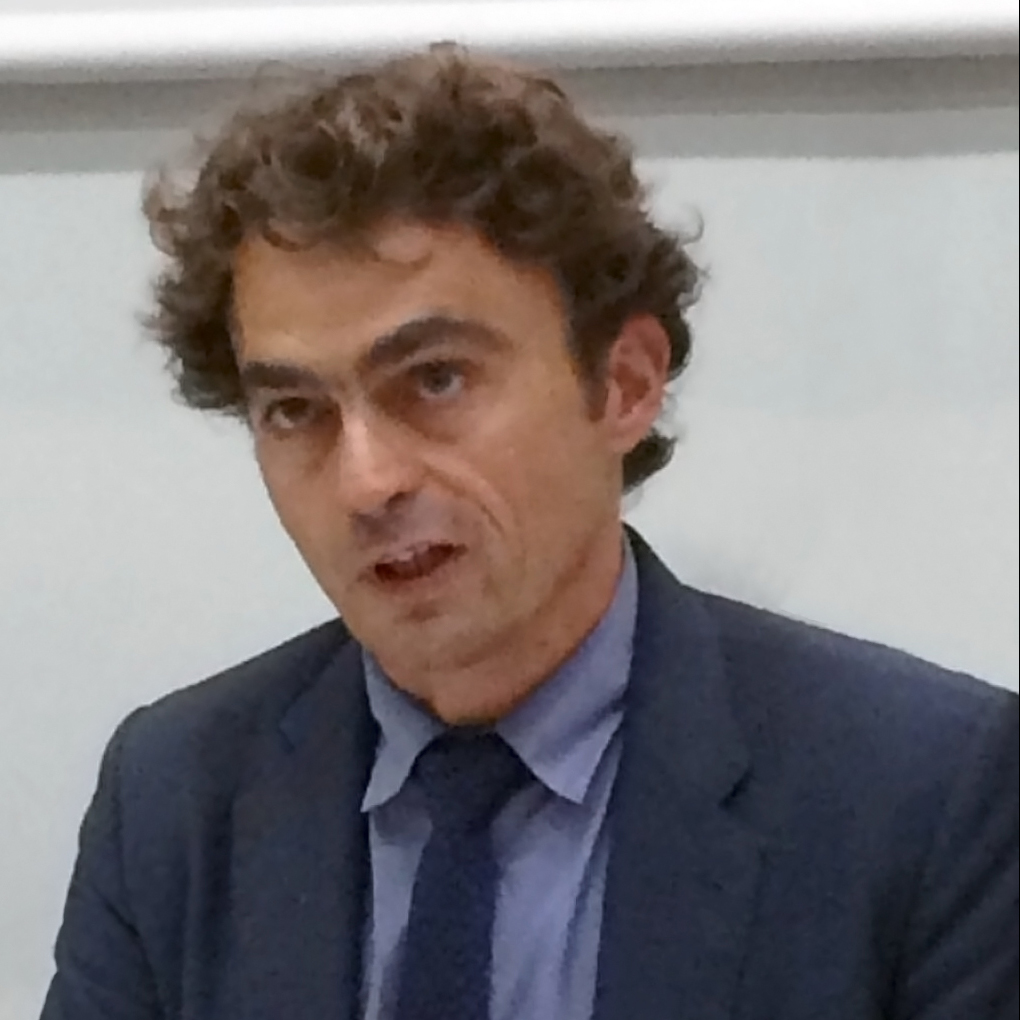
Xavier Magnon
Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France
Pour commencer par un lieu commun, la formule d’Albert Camus, à propos du philosophe du langage Brice Parain, semble devoir naturellement s’imposer : « mal nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde »1. Précisément, toute la difficulté dans le domaine du biodroit2 consiste à nommer les choses. Nommer les choses dans le biodroit dépend précisément de l’état de la science médicale que le droit entend saisir. Cette dépendance des concepts du droit aux concepts scientifiques, autres que ceux de la science juridique, créée une première difficulté quant aux possibilités qu’a le droit de réguler les comportements dans ce domaine. L’on ajoutera encore que le temps du droit et de la production de celui-ci n’est pas le même temps que celui de la science médicale. Ces deux temps sont dissociés au point que l’on peut parfaitement envisager que le droit saisisse à un moment donné une pratique dans le domaine du biodroit qui, au moment même où elle est saisie par le droit, a subi des évolutions du fait du progrès scientifique. Cette dissociation des temps du droit et de la science est un facteur qui accroît les difficultés de nommer les pratiques du biodroit et d’encadrer ces pratiques.
Techniquement, la question décisive que soulève la production du droit pour réglementer des comportements dans un domaine particulier consiste à saisir la réalité de ces comportements pour pouvoir les contraindre dans un sens déterminé. La qualification juridique du réel qu’il s’agit de réglementer est alors décisive, tout particulièrement dans le domaine du biodroit. Elle conditionne une application effective des règles, conformes aux objectifs poursuivis pour celui qui les pose. Il appartient au droit de saisir de manière satisfaisante des pratiques dans le domaine du biodroit, en reprenant, le cas échéant, les concepts que ce domaine scientifique mobilise, pour parvenir à les encadrer en fonction des objectifs qu’il poursuit. Mobiliser le bon concept ou, du moins, le concept adapté, permet de garantir un domaine d’application satisfaisant de la règle de droit.
Dans cette opération de qualification juridique du réel, trois types de concept sont mobilisables : des concepts juridiques, issus du droit positif (des concepts proprement juridiques, des « concepts du droit ») ou de la science du droit (des concepts de la science du droit, les « concepts sur le droit »), des concepts scientifiques ou des concepts communs. Les concepts juridiques ne correspondent à aucune réalité déterminée. Ils visent à qualifier des situations réelles pour les inscrire dans des énoncés prescriptifs visant à les permettre, les interdire ou les rendre obligatoires. La « propriété » est un concept juridique qui ne correspond à aucune réalité physique, même si elle entend saisir cette réalité. Elle permet de désigner les relations d’obligation, d’interdiction et de permission, entretenues entre des personnes à propos de biens qui, eux, sont bien réels. Les concepts scientifiques sont ceux qui sont fournis par d’autres sciences que la science du droit et qui visent à désigner et décrire les objets qu’elles étudient. Le droit peut utiliser ces trois types de concepts pour saisir un comportement. Si le concept juridique est propre au droit, ce dernier peut également mobiliser dans les énoncés prescriptifs qu’il produit des concepts communs, c’est-à-dire issus du langage courant, comme le « vol » ou le « meurtre », par exemple, ou à des concepts scientifiques, l’article R1232-1 du code de la santé publique mobilise à cet égard des concepts scientifiques pour pouvoir constater la mort (« absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée » ; « abolition de tous les réflexes du tronc cérébral » ; « absence totale de ventilation spontanée »). Parmi ces différentes possibilités, cette dernière situation semble devoir concentrer la réflexion au regard du sujet, lorsque le droit mobilise des concepts scientifiques. Toute la question est de savoir dans quelle mesure le droit doit mobiliser les concepts scientifiques et comment il doit le faire pour encadrer de manière efficace les comportements dans le domaine du biodroit.
Dans ce contexte, il faut souligner que les différentes interventions de ces journées d’étude ont mis en évidence deux questions essentielles, même si la première a sans doute été plus présente que la seconde.
En premier lieu, même si certains y verront une évidence, il convient de souligner la dimension axiologique de l’encadrement des comportements en matière de biodroit. Le droit n’est évidemment pas neutre lorsqu’il saisit ces comportements et c’est bien une question subjective, idéologique, de valeurs, qui conditionne la manière dont il s’agira de régir l’activité du biodroit. Ce sont des valeurs et non pas la science qui commandent le contenu des règles applicables au domaine du biodroit. Pour le dire autrement, la science ne prescrit a priori aucune manière d’encadrer l’activité scientifique (en dehors, bien sûr, des exigences épistémologiques), c’est au producteur des normes d’encadrement que de déterminer, en fonction de finalités souhaitables des comportements déterminées, en fonction de valeurs, la manière dont il s’agit d’encadrer ces comportements. À la liberté totale de la science que d’étudier des objets du réel, en dehors des règles épistémologiques qu’elle s’impose, le droit encadre cette liberté en vue de parvenir à certaines fins et de protéger certaines valeurs.
En second lieu, la question de l’usage de la science pour trancher des questions morales, l’on peut penser ici à l’embryon et à la détermination du début de la vie, a également été mise en évidence. Cet usage peut permettre d’objectiviser des questions d’ordre axiologique. La science est mobilisée pour neutraliser ou pour masquer les choix moraux. Il reste que, précisément, le discours scientifique ne tranche pas les questions des valeurs, c’est ce que l’on peut ranger derrière le principe de non-cognitivisme dans le domaine éthique3, mais seulement la question du vrai, quelles que soient les conceptions de la vérité que l’on retient4. La question de la détermination du début de la vie lorsqu’elle conditionne l’interdiction d’une interruption volontaire de grossesse n’est pas une question d’ordre scientifique, mais bien une question axiologique, quel que soit le niveau de sophistication de l’identification des différents stades d’évolution de l’embryon par la science.
Dans un tel contexte, trois acteurs essentiels apparaissent : les autorités productrices de normes, qui mobilisent le langage du droit, la science qui a pour objet d’étudier le droit, la science du droit, qui développe un langage sur le droit et les discours scientifiques des sciences dites dures, que l’on pourra qualifier de sciences causales pour les opposer à la science du droit qui n’est pas une science de la causalité5.
Parmi les différents discours produits par ces acteurs, deux langages visent à décrire le réel tel qu’il est, ceux de la science du droit et des sciences causales, un troisième, le langage du droit, entend agir sur le réel, il prescrit des comportements. Ainsi, les deux premiers présentent une dimension objective, une dimension analytique et/ou causale, le troisième se caractérise par une dimension subjective et prescriptive. Il reste qu’il existe une autonomie entre les trois discours dans le sens où aucun type de ces trois discours ne s’impose aux autres. Plus précisément, le langage du droit est indépendant de ceux de la science du droit et des sciences causales. Il peut soit reprendre, soit ignorer les concepts produits par les sciences.
Sous l’angle conceptuel, il existe ainsi trois niveaux de concepts, qui ne se recouvrent pas nécessairement et qui n’ont pas forcément à se recouvrir. Dans un tel cadre, il appartient sans doute à la science du droit de faire le lien entre le droit et les discours scientifiques, de décrire et d’analyser les rapports entretenus et les rapports possibles entre ces deux types de discours, tout en construisant des concepts autonomes, mobilisables d’un point de vue normatif pour encadrer les pratiques scientifiques. Ces différentes dimensions méritent d’être combinées à partir des usages des concepts dans le domaine du biodroit en général (I) et dans le contexte de la fragmentation/défragmentation du droit de ce dernier (II).
I. Sur l’usage des concepts dans le domaine du biodroit en général
La question, telle que nous l’avons identifiée, consiste à mettre en évidence ce que peut dire la science du droit sur l’usage des concepts scientifiques par le droit.
Une question préalable doit être posée : le droit doit-il définir ? En général, comme plus particulièrement pour le domaine du biodroit, le droit se doit de définir les concepts qu’il mobilise pour saisir le réel. Dès lors qu’il utilise des concepts, qu’ils soient propres, scientifiques ou communs, il sera d’autant plus efficace, à saisir le réel et à agir sur celui-ci (le droit visant à prescrire des comportements) que le réel qu’il entend saisir par un concept est précisément déterminé. Le droit sera considéré comme efficace lorsqu’il est respecté. Il sera d’autant plus respecté, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’il saisit de manière précise et donc intelligible les situations qu’il entend réglementer. Dans le domaine du biodroit la question est d’autant plus décisive que l’efficacité de la règle, et la raison pour laquelle elle a été posée, dépendent précisément de la précision des comportements, des pratiques, qu’il s’agit de saisir. À un critère près, un adjectif près, utilisé par l’énoncé prescriptif qui entend saisir un comportement, ce sont tout un ensemble de pratiques qui peuvent échapper à l’application de la règle. L’article L 1211-1 du code de la santé dispose, par exemple, que :
« La cession et l’utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l’importation et l’exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci.
Pour que la règle puisse être efficace conformément à la volonté du législateur, chaque mot est ici décisif. Le domaine d’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier et celles du livre II première partie du Code civil dépend de la détermination précise des comportements saisis. Les « éléments » et les « produits » du corps humain sont tous les deux visés. À l’évidence, enlever l’un ou l’autre réduit considérablement le domaine d’application des dispositions du code de la santé visées. Il est ensuite question « d’activités afférentes à ces éléments et produits » « y compris l’importation ou l’exportation de ceux-ci ». Dans la seconde formule, la précision apportée à la première permet d’éviter une difficulté d’interprétation de la première. Ce n’est pas seulement le « marché » intérieur français qui est concerné, mais également le « marché » extérieur. La précision évite l’exclusion du domaine d’application de la règle tout un champ de l’activité visée par la réglementation. Le code de la santé prévoit enfin que ces activités « doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires ». Il finalise strictement à trois cas la permission de l’exercice d’activités liées à la cession et l’utilisation des éléments et produits du corps humain.
L’article L 531-1 du code de la santé publique sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) définit précisément ce qu’il saisit :
Au sens du présent titre, on entend par :1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.
Lorsque le législateur définit un organisme comme une « entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique », il use d’un langage scientifique précis pour désigner l’objet de la réglementation qu’il entend poser.
Cette précision du langage n’empêche pas que soient mobilisés des termes présentant un certain degré d’indétermination ou, pour le dire autrement, des termes « vagues », c’est-à-dire qui sont à l’origine du paradoxe sorite ou paradoxe du tas de sable6. Les termes de « tas de sable » sont vagues parce que l’on ne sait pas déterminer a priori, pour décrire la réalité qui se cache derrière cette formule, combien de grains de sable sont nécessaires pour constituer un « tas de sable », ni combien il faut en enlever à un « tas de sable » pour qu’il ne soit plus qualifié de « tas de sable ». Lorsque le code de la santé précise qu’un OGM est un « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles » (nous soulignons), l’adjectif « naturelles » peut apparaître comme étant vague. Ce qui relève de la nature des choses ou du naturel est tout sauf une question évidente à résoudre même si, et c’est la caractéristique du vague, l’on sera à peu près certain, que, lorsqu’une plante naît de la combinaison de deux autres plantes sans aucune intervention humaine, il existe une recomposition naturelle, et que la création d’une cellule en laboratoire grâce à une manipulation génétique n’est pas une recomposition naturelle. En revanche, l’on pourra discuter sur le fait de savoir si une greffe d’un arbre sur un autre arbre d’une espèce différente est une recomposition « naturelle ». L’usage d’un terme vague contribue à rendre relativement indéterminé le domaine d’application de la règle. Le vague doit encore être distingué de l’ambigu. Un mot ambigu est un mot qui peut recevoir plusieurs significations alors que « le terme vague ne reçoit qu’une seule signification, mais “cette signification n’est pas suffisante pour déterminer pour chaque objet dans le monde si le terme s’y applique ou ne s’y applique pas” (Moeschler et Reboul 1994 : 374) »7. L’usage de termes vagues n’est pas problématique en lui-même dans la mesure où il permet une adaptabilité de la règle aux différents contextes concrets d’application. Il garantit également une applicabilité plus large de la règle à des situations difficilement déterminables a priori.
Dans le domaine du biodroit, l’autre question décisive est celle de savoir quelles définitions le droit doit-il retenir ? Dans quelle mesure est-il contraint par les concepts scientifiques ? Doit-il les reprendre dans son propre langage et dans la signification qu’ils ont dans le domaine scientifique dans lequel ils sont mobilisés ? Il faut sans doute à la fois rappeler que les concepts scientifiques peuvent faire l’objet de controverses, de sorte que le droit peut se retrouver face à un choix lorsqu’il entend reprendre un concept scientifique, le choix de retenir l’une des significations, non unanime, dans un champ scientifique donné. Dans le prolongement, les évolutions scientifiques font que certains concepts évoluent, dans le sens d’une plus grande acuité de la description des objets, ce qui peut, en l’occurrence, rendre obsolète l’utilisation à un moment donné par le droit d’un concept scientifique qui aurait évolué. Toutefois, il n’est pas certain que l’évolution d’un concept scientifique affecte l’efficacité de la règle juridique. L’évolution traduit une progression dans la connaissance, qui peut rester sans incidence sur la volonté d’encadrer certains comportements et ne pas affecter l’efficacité de la règle qui s’appuierait sur le concept ancien. Le progrès scientifique est indépendant du droit. Il est possible que, malgré l’évolution du concept, sa formulation antérieure suffise pour poursuivre les objectifs de celui qui produit une réglementation, ce dernier concept étant toujours pertinent quant aux comportements qu’il s’agit d’encadrer.
Si les sciences proposent une nouvelle définition des « OGM », distincte de celle retenue par l’article L 531-1 du code de la santé publique, il n’est pas forcément nécessaire d’adapter cette dernière définition, du droit, à la nouvelle, scientifique, dès lors que l’ancienne permet d’encadrer les comportements que l’on souhaite régir. Le qualificatif de « naturelle », déjà évoqué, mobilisé pour désigner des OGM, peut recevoir une signification différente en fonction de l’état des sciences, du moins le supposerons-nous pour l’exemple, cependant le domaine de la réglementation portant sur les OGM demeure pertinent dès lors que la volonté de l’auteur de cette réglementation entend soumettre à des normes spécifiques tout ce qui n’est pas une recomposition naturelle. Le domaine d’application de la règle demeure toujours pertinent au regard de la volonté du législateur, quelles que soient les évolutions du concept dans la science. Le droit peut toujours librement intégrer ou ne pas intégrer les concepts scientifiques dès lors que le concept qu’il propose permet de saisir les comportements qu’il souhaite encadrer. Le concept du droit s’autonomise par rapport au concept scientifique.
De manière synthétique, l’on pourra soutenir qu’en matière de biodroit, le droit semble d’autant plus devoir prendre en compte les définitions scientifiques, dès lors qu’il entend régir ce domaine d’activité, sans pour autant qu’il soit contraint de les reprendre telles quelles. L’objectif du droit n’est pas de mobiliser des concepts scientifiques les plus aboutis, mais seulement d’en mobiliser certains qui permettent d’obtenir les résultats qu’il souhaite quant à l’encadrement des comportements. La production de concepts autonomes, bien que liée aux concepts scientifiques dont ils ne pourraient pas s’éloigner sous peine de ne pas saisir son objet, doit être de mise. Il appartient au droit de construire de manière équilibrée des concepts en prenant en compte à la fois les concepts scientifiques, mais également les objectifs de la réglementation. Les producteurs de droit doivent bien identifier les techniques et pratiques scientifiques qu’ils entendent régir, identifier parmi les éléments qui la composent ceux qui posent des problèmes axiologiques et donc qui méritent d’être encadrés et poser des concepts autonomes propres à garantir la finalité poursuivie par la réglementation.
II. De l’usage des concepts dans le domaine du biodroit face à la fragmentation/défragmentation du droit
Le droit peut choisir trois tendances dans la réglementation de l’innovation relative au biodroit : soit développer une réglementation spéciale, variable selon chaque type d’activité à réglementer, soit développer une réglementation générale couvrant de manière transversale différentes activités, soit combiner les deux. De là, en cas de réglementation spéciale, une fragmentation du droit et, en cas de réglementation générale, une défragmentation du droit. Dans la production d’une réglementation en matière de biodroit, la solution la plus simple consiste à réglementer de manière spéciale, fractionnée, en fonction des différents types d’activités, telles qu’elles sont déterminées par des concepts scientifiques, et des comportements que l’on entend obtenir. Pour élaborer une réglementation des OGM et de la recherche sur les embryons humains, il est a priori logique de prévoir deux types différents de réglementation pour chacune de ces activités, ce que fait en l’occurrence le code de la santé publique en France. La solution est ici immédiate puisqu’il suffit de prendre en compte les pratiques possibles dans chacun de ces domaines et de déterminer celles que l’on entend permettre, interdire et, pourquoi pas, rendre obligatoire. L’analyse est fractionnée, à l’instar de la réglementation élaborée. Il est toutefois possible de proposer une réglementation commune, malgré la différence de situations, pour obtenir des comportements comparables dans les deux domaines visés.
Pour éclairer cette dernière situation, sans doute convient-il de préciser la manière dont le langage du droit mobilise ses propres concepts et ceux de la science pour encadrer les comportements en matière de biodroit.
Pour déterminer les comportements visés par la réglementation, le droit ne saurait totalement s’extraire des définitions scientifiques des pratiques qu’il s’agit d’encadrer, même s’il garde une marge d’appréciation pour délimiter son domaine d’application. En opportunité, le droit ne saurait s’abstraire des pratiques qu’il encadre, sans se soucier de ce que sont ces pratiques, telles qu’elles sont identifiées par ceux qui en sont à l’origine. La connaissance des concepts scientifiques descriptifs des pratiques est incontournable. Sur l’identification de ces pratiques, il est difficile de ne pas reconnaître une fragmentation de celles-ci et donc une fragmentation nécessaire du droit quant à l’identification des situations qu’il souhaite encadrer. Il s’agit là d’une question de domaine d’application de la règle, qui est dépendante de la réalité, des réalités, qu’elle doit saisir et donc de la manière dont cette réalité est décrite par les concepts scientifiques. Lorsqu’il s’agit de réglementer les OGM ou la recherche sur l’embryon, le droit se doit de déterminer la manière dont la science définit ces concepts pour déterminer son domaine d’application. Ces concepts sont ceux qui saisissent le réel pour lui attacher des règles et que l’on pourrait ainsi qualifier de concepts de saisie du réel.
Les concepts juridiques interviennent après, pour établir les règles applicables aux domaines d’application préalablement déterminés. C’est ici que l’on peut défendre une autonomie totale des concepts du droit, ainsi qu’une défragmentation du droit. En effet, des concepts communs du droit sont mobilisables de manière unitaire pour réglementer plusieurs catégories de comportements. Il faut alors rechercher le commun dans les finalités que l’on entend donner à la réglementation posée. Tel est le rôle de la science du droit ici que de mettre en évidence ce qu’il y a de commun dans la manière de réglementer des domaines différents pour rendre possible une réglementation commune. Plusieurs éléments communs sont susceptibles d’être identifiés pour pouvoir défragmenter, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’objet de la réglementation (permettre, rendre obligatoire, interdire), la conditionnalité de l’activité en matière de biodroit au respect de certaines finalités (préservation de la santé, protection de l’environnement…), la différenciation de la réglementation en fonction de la finalité des comportements encadrés (recherche, commerce), la transparence des pratiques encadrées et les mécanismes de contrôle et de sanction des pratiques (évaluation, pénalisation). L’on touche ici des questions de légistique et donc de technique de réglementation et de structuration et de présentation communes des règles applicables à un domaine d’activité donné. L’élaboration d’une grille générale d’encadrement des comportements à partir de laquelle raisonner pour régir une activité peut s’avérer utile : quel domaine réglementer ? S’agit-il de permettre, d’interdire ou de rendre obligatoire ? Quelles finalités imposer à ces activités ? Quelles finalités de ces activités faut-il encadrer ? Comment connaître ces activités ? Comment garantir le respect de la réglementation ? Il s’agit de questions communes auxquelles il convient de répondre, quels que soient les domaines qui seront réglementés.
Sous cet angle, il faut d’abord revenir sur la manière dont le droit peut encadrer les comportements : il rend obligatoire, interdit ou permet. Le choix entre chacune de ces catégories d’énoncé déontique dépend de la finalité poursuivie par le producteur de la règle. Ce dernier peut interdire des comportements (le clonage humain, par exemple), les rendre obligatoires (imposer certains protocoles par exemple pour la recherche sur l’embryon) ou les permettre et, sans doute, les permettre sous certaines conditions (l’usage des OGM dans le respect de l’environnement). Dans cette perspective, il est possible d’unifier autour de ces trois catégories d’énoncés déontiques, ce qui sera permis, interdit ou obligatoire dans différentes situations. La règle sera la même, tout en s’appliquant à des domaines différents, précisément identifiés.
Les règles de permission conditionnée paraissent devoir occuper le cœur de la réflexion. Là encore la mobilisation de concepts juridiques communs est possible, des concepts généraux d’encadrement des comportements du réel.
Des concepts vagues, et subjectifs, comme « utilité commune », « dignité humaine », « santé publique » peuvent être mobilisés pour imposer une certaine finalité à certaines pratiques afin d’en conditionner l’exercice. Cette dimension échappe totalement à la science, elle relève de l’activité normative d’encadrement des comportements. Il s’agit de conditionner à la poursuite d’une finalité souhaitable certaines activités, tout en laissant une marge d’appréciation sur la détermination des situations concrètes susceptibles d’entrer sous le concept qui concrétise cette finalité.
L’on peut penser encore que des règles communes sont susceptibles d’être posées selon la finalité des pratiques de biodroit et distinguer en premier lieu ce qui relève de la recherche et ce qui relève du commerce. L’on peut penser, dès lors qu’il s’agit de réglementer les pratiques du biodroit, qu’une liberté plus importante peut être accordée aux pratiques en lien avec la recherche que pour celles qui renvoient aux échanges commerciaux. Sans doute, convient-il de ne pas considérer cette frontière comme étant étanche, bien au contraire. Tout progrès scientifique pose la question de la commercialisation de ses applications pratiques. Autrement dit, en laissant une plus grande liberté à la science qu’à l’activité commerciale, cette dernière peut parfaitement récupérer cette liberté lorsqu’il s’agira de développer les prolongements commerciaux d’une découverte scientifique. Alors que la science parvient à développer des organes humains, des organoïdes, à partir de cellules souches, même si cette pratique n’a été permise que pour la recherche, il est certain que la question de la commercialisation de cette pratique se posera un jour.
Même si l’on quitte ici la question des concepts pour appréhender des obligations communes susceptibles d’être identifiées dans l’ensemble du domaine du biodroit8, l’obligation de transparence des activités encadrées constitue un objectif commun dont les modalités peuvent être variables ou ne pas l’être d’ailleurs. Cette visibilité des pratiques de biodroit apparaît comme un objectif souhaitable pour les mettre à jour et les porter à la connaissance.
Enfin, s’éloignant de la même manière des concepts9, la question du contrôle et de la sanction du respect de la réglementation est décisive. Il faut l’envisager de manière large quant à ses modalités de concrétisation. L’activité, ce qui peut également concrétiser l’objectif de préservation de la transparence, peut être soumise à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable, faire intervenir des organes indépendants (comité d’expert, comité éthique, autorité administrative, juge…) et/ou appeler l’adoption d’un régime pénal de sanction.
À ceux qui s’inquiéteraient de ce qu’une telle manière de procéder, réglementer de manière commune et générale plusieurs domaines, serait néfaste, voire impossible, car il ne serait pas possible de saisir la complexité du réel, il faut rappeler que la loi demeure une norme générale et abstraite qu’il convient de concrétiser à des cas particuliers. La fragmentation n’est pas dans la règle, mais dans son application concrète, cas par cas, le juge intervenant, en cas de désaccord sur l’application de la règle générale et abstraite dans un cas déterminé, pour trancher la question en posant une norme individuelle et concrète. Autrement dit, l’existence de règles générales n’empêche pas une adaptation de celles-ci aux cas concrets d’application. La mobilisation par la règle générale de concepts juridiques vagues permet précisément une adaptation de la règle aux circonstances de l’espèce, pour adopter au mieux la règle au réel et, plus précisément, aux situations concrètes dans lesquelles la règle générale et abstraite a vocation à s’appliquer. La généralité et l’abstraction offrent une marge d’appréciation aux organes d’application, ceux qui ont des activités dans le domaine du biodroit, et aux organes de sanction, comme les juridictions. Si cette marge d’appréciation n’est que la conséquence de l’usage volontaire de termes vague pour étendre les cas d’application de la règle, elle n’en présente pas moins des risques de détournement de la règle. D’où l’importance, sans doute, dans le domaine du biodroit, de multiplier les organes et les moyens de contrôle et de sanction au-delà de la seule sphère juridictionnelle (comité d’éthique, d’experts, autorité indépendante).
Cette appréhension commune de la réglementation des innovations dans le domaine du biodroit exige un effort de construction et d’analyse synthétique et systématique des situations. Elle est incontestablement la plus contraignante, car elle exige la mobilisation de concepts généraux transversaux. Il est donc parfaitement possible de réordonner les règles fragmentées du biodroit dans le sens d’une défragmentation à partir d’une réflexion sur ce qu’il y a de commun dans l’ensemble de ces règles. Tel est sans doute le rôle de la science du droit que de mettre en évidence ces éléments communs. La défense de cette dimension commune, d’une défragmentation de la réglementation de biodroit, semble devoir s’imposer au regard d’une plus grande lisibilité et pour une plus grande efficacité de cette réglementation.
1 A. Camus, « Sur une philosophie de l’expression », compte-rendu de l’ouvrage de Brice Parain, Recherches sur la nature et la fonction du langage, Gallimard, in Poésie 44, n° 17, p. 22.
2 Nous nous en tiendrons, sans nous interroger sur la définition du concept, à cette domination générique, « biodroit », pour désigner toutes les activités entrant sous cette dénomination et dont certaines ont pu être abordées dans les différentes interventions.
3 Ce principe a pu être formulé de la manière suivante, à propos du juste, par Hans Kelsen : « il est vain d’essayer de trouver une norme du comportement juste valable de manière absolue sur la base d’une entreprise rationnelle, c’est-à-dire d’une norme excluant la possibilité qu’un comportement contraire puisse être considéré comme juste » (H. Kelsen, Qu’est-ce que la justice ?, suivi de Droit et morale, respect. 1953 et 1960, préface de V. Lasserre, Markus Haller, 2022, p. 89). Ainsi, « le problème des valeurs est d’abord et avant tout le problème des conflits de valeurs. Et ce problème ne peut être résolu avec les moyens de la connaissance rationnelle. La réponse à cette question est toujours un jugement qui, en fin de compte, sera déterminée par des facteurs émotionnels et qui, pour cette raison, sera hautement subjectif. Autrement dit, il s’agit alors d’un jugement valable uniquement pour le sujet jugeant et il est, en ce sens, relatif » (op. cit., p. 34)
4 Voir sur cette question, pour une synthèse pédagogique, en particulier des conceptions de vérité-correspondance, vérité-cohérence et vérité-utilité : J. Ladrière, « La vérité et ses critères », Revue théologique de Louvain, n° 18, 1987, p. 147-170.
D’une manière générale, l’on peut considérer avec K. Popper qu’« afin de clarifier ce que nous faisons quand nous sommes à la recherche de la vérité, nous devons être capables, au moins dans certains cas, de donner des raisons qui nous permettent de prétendre intuitivement que nous nous sommes rapprochés de la vérité ». Il propose un concept de « vérissimilitude » qui renvoie à « la notion de meilleure approche, ou de meilleure approximation de la vérité ou de proximité plus grande avec la vérité » (La connaissance objective, trad. J.-J. Rosat, Champs, Essais, 1998, p. 103).
5 Selon une perspective normativiste, alors que le domaine de l’analyse des faits repose sur le principe de causalité, qui fait que si des conditions sont réunies alors quelque chose advient nécessairement ; le domaine des normes repose sur le principe d’imputation, en vertu duquel si des conditions sont réunies alors quelque chose doit advenir.
6 Et qui, par ailleurs, « manquent de frontières précises » et « admettent des cas limites » (P. Brunner, Le vague – De l’usage évaluatif d’un terme en français et en allemand à la reconstruction d’un concept, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III–/Ludwig-Maximilians – Universität München, Thése, dact., p. 27, citant Keefe, Theories of Vagueness, Cambridge University Press, 2000).
7 P. Brunner, Le vague – De l’usage évaluatif d’un terme en français et en allemand à la reconstruction d’un concept, op. cit., p. 49, citant elle-même J. Moeschler, A.Reboul, Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, Seuil, 1994).
8 À moins de considérer que le concept de transparence, selon une approche normative, c’est-à-dire à partir des contraintes que la transparence impose, est un concept de la science du droit qui doit être intégré dans la manière d’encadrer des activités. La transparence est un concept sur le droit qui vise à mettre en évidence l’importance de la visibilité des activités que l’on souhaite réglementer.
9 À moins de considérer, comme nous l’avons fait dans la note précédente, que les concepts de « contrôle » et de « sanction » sont des concepts de la science du droit et que toute réglementation d’une activité se doit d’intégrer des éléments qui concrétisent ces exigences de contrôle et de sanction.
Xavier Magnon, « De l’usage des concepts dans le droit biomédical. La part de la science du droit », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4186.