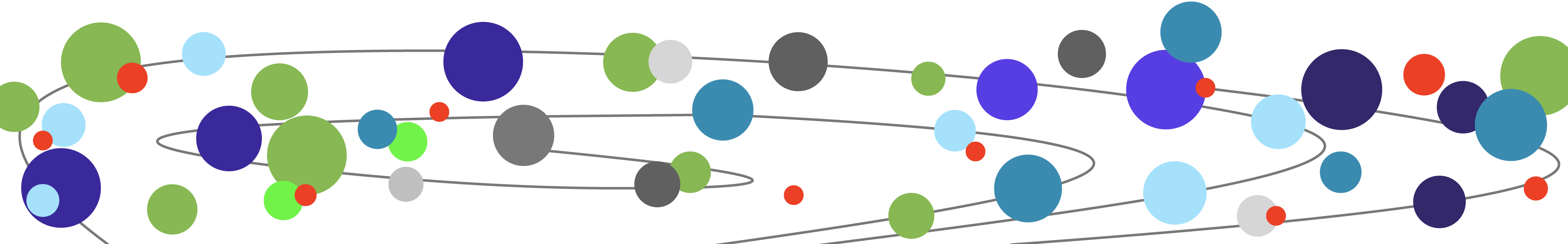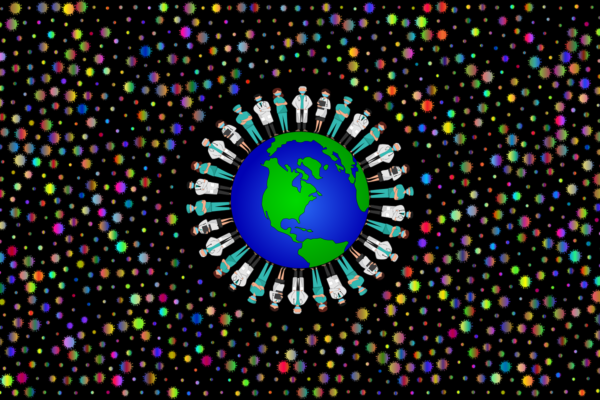Xavier Bioy
Vice-doyen de l’École de droit de Toulouse, Co-directeur du master « Droit des libertés », Co-directeur du master « Éthique – Soin et recherche »
Issue du droit français de 1994, la référence juridique à l’espèce humaine apparaît aussi en droit du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Tantôt pour isoler la santé humaine de la santé vétérinaire, tantôt pour désigner le partage d’un génome, enfin comme synonyme d’humanité au sens que lui donnent les textes internationaux. Le recours à un terme issu des communautés scientifiques (mais lui aussi discuté) paraît ainsi fragmenté et inadéquat, autant qu’il prend le risque de « biologiser » les catégories juridiques.
On croyait dépassée la référence éthique et juridique à la personne humaine. Pourtant, le Comité consultatif national d’Éthique (CCNE), dans le cadre de modifications ciblées du génome, transmissibles à la descendance humaine, et face à l’ampleur des incertitudes techniques et scientifiques quant aux conséquences à court et long termes se prononce sur ce fondement en faveur d’un moratoire international préalable à toute mise en œuvre. En effet, ces incertitudes techniques et scientifiques seraient-elles réduites, demeurerait la question éthique majeure d’un soin individuel ne relevant pas d’une démarche eugéniste de transformation de l’espèce humaine1.
À l’issue du tableau figurant en annexe, l’expression « espèce humaine » est utilisée à la fois en droit interne (code civil et code pénal), en droit du Conseil de l’Europe (Convention d’Oviedo2) et en droit de l’Union européenne (UE) (tous niveaux d’instruments ; règlement, directive, résolution, rapport… ; et dans les domaines du marché/santé, environnement, recherche…).
Mais surtout, elle l’est dans plusieurs registres (descriptif de l’état des savoirs scientifiques, normatif/performatif pour faire exister légalement une ou plusieurs notions juridiques), différents à chaque fois. Plusieurs définitions, plusieurs objets ou referens, semblent exister donc. En outre, la définition qui semble émerger de chacun de ces emplois ne paraît pas toujours apte à produire les effets normatifs attendus, la notion d’espèce qui s’en dégage paraissant inadaptée à la régulation visée.
Un concept, une finalité politique ou une définition, inclus formellement dans un corpus juridique, présentent une dimension normative, même si celle-ci se présente comme la simple réception par le droit de données scientifiques, coutumières, corporatives, sous les traits du « fait ». Les savoirs et savoir-faire, qui relèvent des experts scientifico-techniques, deviennent en droit des éléments de la norme instituée. Il peut s’agir alors de deux finalités : soit, d’abord, d’une manière d’instituer, de juridiciser, de « performer » en établissant une vérité légale, par exemple en définissant un objet (un embryon « est » ceci ou cela), ou en désignant une communauté de sachants habilités à dire la vérité scientifique (est médicalement établi tout ce que fait ou dit un médecin) soit, ensuite, de normer la manière de produire ce type de données (par ex. régime d’autorisation des établissements de recherche ou de soin). Si les textes juridiques semblent souvent reprendre ce que la communauté des scientifiques tient pour vrai, ils ne redisent pas seulement une vérité, ils l’imposent à tous les destinataires de la norme. Les termes juridiques sont alors des « doubles » normatifs d’un supposé réel.
Inversement, on peut observer que les milieux de la recherche peuvent tenter d’imposer un nouveau terme, pour isoler, spécifier, engendrer, une nouvelle « réalité ». Ce phénomène, vraie stratégie, a cours, par exemple, dans le domaine de la génétique non humaine. Les lobbys de l’agroalimentaire ont récemment forgé le concept de « germoplasme » pour tenter d’imposer leurs propres définitions d’une réalité, à dessein d’obtenir la reconnaissance de nouveaux droits, notamment en termes de brevets. Ce terme désigne « toute forme stockée de la diversité génétique propre à une espèce (collection de semences, de cultures, de tissus, etc.) », et cherche à pousser le jurislateur à créer un régime juridique de protection spécifique, c’est-à-dire d’appropriation du patrimoine génétique3. Le terme n’est, à ce jour, pas repris par le CNRS4 ou par l’INRA, mais s’impose peu à peu ailleurs5.
C’est pourquoi un même terme (dénomination du concept), en droit, peut renvoyer aussi bien à sa ou ses significations normatives qu’à d’autres issues des usages par telle ou telle communauté d’interprètes (scientifique, profane, politique…). Une notion scientifique ne « devient » pas juridique. Elle fait l’objet d’une référence en droit, laquelle recoupe ou non ce qui est admis dans les communautés. Chaque communauté dispose ainsi de notions propres, portées ou non par une terminologie commune. C’est pourquoi il est plus facile de parler de « notion », laquelle, par convention de langage, renvoie à une production issue de l’expérience d’une communauté donnée et construite à partir des usages du langage, dans un paradigme disciplinaire. Ainsi, les notions juridiques sont comprises comme ayant une fonction normative et ne sont pas seulement constatives ou descriptives. C’est en tout cas ce que la théorie des actes de langage permet de montrer6. On peut toutefois, le plus souvent, travailler à dégager une signification commune, que l’on peut nommer « concept » et qui se trouve dans la philosophie son espace disciplinaire (un concept est d’abord philosophique et la philosophie ne produit pas des « concepts scientifiques » même s’il existe une communauté de sachants en philosophie). Ainsi un concept, plutôt général, a priori, et déductif des intuitions (cf. Kant7) autant que des idées pures. Un concept peut donc correspondre avec une ou plusieurs notions existantes dans une communauté de sens donnée. On peut bien sûr parler de « concept juridique », mais, il est préférable de dire qu’un concept ne se situe pas dans une discipline sectorielle, mais qu’il les transcende toutes et sert d’outil interdisciplinaire. Une notion juridique n’est que la déclinaison d’un concept, comme l’espèce l’est au genre. Ainsi, il faut le concept d’accord de volonté pour identifier les notions de contrat et de consentement dans leurs nombreuses déclinaisons juridiques. C’est sous cette réserve qu’on se pliera ici à un usage commun (mais discutable) de l’expression « concept juridique » (comme si les notions de droit s’appropriaient et réduisaient le concept universel).
Quant aux définitions (la proposition formée d’un énoncé linguistique visant à identifier une réalité déterminée), il s’agit d’un effort d’identification et de limitation des sens et significations d’un terme par référence à d’autres, supposés mieux établis. Il existe donc des définitions adoptées et communes à plusieurs interprètes et, à nouveau, les « sources » juridiques peuvent tenter d’en imposer une pour circonscrire leur portée normative. Mais, le plus souvent, il reviendra à la doctrine8 d’établir, a posteriori, dans la combinaison des textes et de leurs interprétations successives (déterminant notamment l’extension de la notion), les frontières de la notion désignée par le mot, faisant des définitions des éléments évolutifs, au point parfois de changer de concept… (le terme « contrat » désignant en réalité un acte unilatéral…9).
La discipline académique du droit (« science du droit ») permet donc de déterminer par quels processus un terme, un concept, une affirmation selon laquelle quelque chose « est » (une « vérité »), a pu circuler entre les corpus scientifiques, médicaux, politiques, philosophiques et juridiques. Elle peut ainsi révéler, expliquer, clarifier, la pluralité de notions désignées par un même terme. C’est ainsi que l’on peut entendre la « fragmentation » comme des usages et finalités différentes d’un même terme, renvoyant ainsi à plusieurs notions/concepts juridiques. C’est le cas de la formule « espèce humaine » dont l’usage par la communauté scientifique n’est pas fixé, pas plus que les usages juridiques.
I. Une référence en apparence commune à l’« espèce humaine »
L’apparition de la référence à l’espèce humaine pourrait apparaître anecdotique ou conjoncturelle. Née en France en 1994 et reprise ensuite en 1997 par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne10, elle vise, sans doute, à la fois, à mettre un nom sur la valeur protégée par l’intangibilité du génome et à lui donner une apparence scientifique, au moins objective. En 1994, le législateur se situait sur le terrain même de l’eugénisme qu’il s’agissait de combattre. La double création de l’interdit de la modification transmissible du génome et de la catégorie des « crimes contre l’espèce », qui en réprime la violation, semblait appeler aussi une nouvelle rhétorique. Celle-ci a été conditionnée par les premiers enjeux : l’encadrement du diagnostic préimplantatoire et des thérapies géniques. Depuis, l’essor de la génomique et les arbitrages appelés par le développement de l’usage des Organismes génétiquement modifiés en santé humaine ont densifié l’enjeu.
Depuis leurs premiers écrits du xixe, les partisans du darwinisme social ont ancré leur sélection mélioriste dans les données de la toute jeune discipline génétique et la mise en avant de son objectivité. Pour le dénoncer ou pour le fonder, l’eugénisme raciste invoque le sérieux et la vérité du savoir académique11. L’espèce humaine n’est donc pas qu’une figure ou une allégorie, elle est le nom d’une vérité qui installe l’humain dans l’ensemble du vivant, plus, elle en fait une vérité légale incontestable et fondatrice des crimes les plus punis de notre code pénal. Il ne s’agit donc pas d’un gadget, mais de l’apothéose de la théorie de l’évolution, dans un monde où elle est concurrencée par le créationnisme. Il s’agit en somme de la volonté de sortir d’un discours allégorique propice à l’idéologie pour « durcir » la légitimité de la norme. Or, il n’est pas certain que cette construction soit elle-même solide ; elle fait l’économie de la manière dont les communautés scientifiques nomment et « racontent » leurs observations avec leur propre vocabulaire, en fonction de leurs conceptions. Ainsi, l’usage du terme « espèce » n’est pas univoque dans les « sciences du vivant », selon les objets étudiés et les points de vue adoptés, entre la biologie, l’éthologie, l’anthropologie, entre médecine et génétique.
Parler d’espèce humaine n’aurait alors sans doute qu’une faible validité scientifique. Le Petit Robert indique tout d’abord que l’idée d’espèce a, dans un premier temps, reposé sur la « révélation de Dieu », sur l’apparence sensible des choses avant de devenir l’apparence commune à plusieurs individus, permettant de constituer, par association, une catégorie. L’« espèce humaine », à un instant T qui serait aujourd’hui, ne serait, pour certains, qu’une étape de l’évolution de sapiens et non une originalité absolue. L’association des deux concepts d’espèce et d’humanité suscite des réserves. On trouve fréquemment chez les paléontologues et généticiens l’idée que notre espèce n’est pas « l’espèce humaine », mais Homo sapiens dont sont issus tous les humains actuels, selon plusieurs souches ayant remplacé les hominidés préexistants. Mais Homo erectus et Homo neandertalensis méritent le qualificatif « humain » : le premier était « parfaitement droit, il avait un gros cerveau et était capable de fabriquer et d’utiliser des outils de pierre raffinés »12. On peut génétiquement identifier par analogie un individu comme humain ; mais cela n’implique pas « une » espèce humaine ; l’idée d’humanité étant irréductible aux données génétiques. Il y a toujours, en fond, l’idée culturelle d’isoler l’humain, le réflexe culture contre nature, en dépit de la possibilité de trouver des traits dont l’addition conjoncturelle serait spécifique à nos populations contemporaines, entre lesquelles subsistent aussi des différences notables, même en médecine.
Par ailleurs, fonder l’espèce sur le génome ne fait pas l’unanimité. Certaines caractéristiques génétiques sont certes spécifiques à l’espèce, non pas dans leur expression, mais dans leur structure. Ainsi en est-il du nombre de 46 chromosomes porteurs d’au moins trois milliards de paires de bases ou nucléotides, c’est-à-dire des unités d’information réparties selon des séquences, mais seuls 1 à 2 % du génome nous séparent du chimpanzé.
Par ailleurs, pour les nominalistes, la connaissance que nous avons de notre génome a été réalisée à partir du séquençage de plusieurs premiers génomes « humains ». Le Human genome project13 a notamment révélé le génome humain à partir de celui d’un de ses fondateurs (James Watson) et le programme « privé » Celera a fait de même (Craig Venter). Des donneurs anonymes ont été impliqués, mais, pour des raisons techniques, la séquence publiée proviendrait d’un seul des donneurs « anonymes » alors que le projet mentionnait une limite de 10 % de séquence du même individu.
Ainsi, pour ce qui est de l’Homme, la première séquence du génome humain, annoncée à grands cris médiatiques fin 2000, n’était en rien une séquence complète. La partie « séquençable » du génome humain comprend 2,9 milliards de paires de bases. Il existe plusieurs stratégies pour ce séquençage. Elles ont été l’objet d’une vive concurrence dans les années 1990 entre secteur privé et secteur académique. La première séquence complète et sans lacunes d’un génome humain a été établie deux décennies après que le Human Genome Project ait produit la première ébauche de séquence de ce génome.
Tout cela pour dire que cette poignée d’individus a été d’abord considérée comme « humains », par choix et évidente décision de les rendre représentatifs de toute « l’espèce ». Il y a toujours une décision conventionnelle à partir de laquelle on a choisi l’objet étudié.
En réalité, malgré ces incertitudes liées à la diversité des communautés scientifiques, les branches de la médecine ont su construire des outils de diagnostic et de thérapie génique. La génomique se sépare de la seule génétique en partant du principe que l’on en sait assez sur ce qui est commun aux humains (fusse cela commun aussi avec les animaux mammifères et au-delà) pour commencer à trouver les sources des pathologies, de la reproduction, etc. La distinction utile aux usages médicaux entre « santé humaine » et « usages vétérinaires » n’a pas besoin de fondements scientifiques plus poussés. Elle se base sur l’existence de besoins en santé des humains et sur les connaissances utiles ; elle part des pratiques de la communauté médicale et des biologistes associés et non d’un dogme évolutionniste qui arrêterait les frontières d’un groupe de populations génétiquement spécifiques. Les textes créent un cercle vertueux de renvois dans lequel le terme essentiel « humain » n’est jamais défini. L’activité médicale que cherchent à encadrer les textes juridiques (« la santé humaine ») renvoie à « corps humain » et « espèce humaine », donc aux usages médicaux sans définition préalable du groupe des sujets concernés. Implicitement, la référence demeure donc une pratique sociale (nous savons tous que tel ou tel individu est « humain ») et non un critère technique ou scientifique.
En résumé, la référence à « l’espèce humaine » est un construit des communautés scientifiques qui n’est pas univoque ni vraiment stabilisé. D’un côté, la référence à l’espèce n’est pas consensuelle, de l’autre, l’idée de spécifier une espèce humaine accroît la difficulté par celle d’arrêter le concept « d’humain ». Dès lors, l’effort scientiste de nos législateurs pourrait être vain. Il s’agit d’un trompe-l’œil ; certes utile puisqu’il répond à un besoin de régulation sociale des pratiques génétiques. Mais il n’a que l’apparence d’un ancrage dans les sciences du vivant et trouve plutôt dans le construit des communautés de médecins, une forme d’objectivation qui fonde l’interdit recherché : les médecins ne doivent pas artificialiser la mutation des informations portées par le matériel génétique. On ne doit pas modifier le génome des humains. Cette formulation aurait suffi, mais l’hubris de nos législateurs les a conduits à renouer avec des réflexes scientistes remontant aux fondements de l’eugénisme d’A. Carrel.
II. Des usages juridiques en réalité fragmentés de la référence à l’espèce humaine
La notion d’espèce renvoie donc à des données biologiques qui « spécifient » des différences objectivables (obtenues à partir du séquençage de génomes considérés comme humains). Mais, au-delà de ce premier sens, une diversité appert. Trois usages pour deux significations.
A) Trois usages
• Une première série d’usages, en droit et politiques de santé, procède par une forme d’abus de langage ou d’emphase inutile, qui remplace « humains » par « espèce humaine » et vise seulement à se démarquer de la médecine vétérinaire, et tenir compte, non pas tant des spécificités de l’humain que de l’autonomie de sa médecine, sans nécessairement se fonder sur une différence idéologique ontologique. Il semble que le droit de l’Union se contente d’utiliser ainsi la notion d’espèce pour désigner la partie spécifique objectivable de la santé humaine par opposition à la santé vétérinaire (ce sont deux chefs de compétences distincts de l’UE). Ici ce sont les usages finaux et non les objets qui déterminent la qualification. Les mentions les plus nombreuses se rencontrent dans le droit de l’Union européenne, mais dans des textes de nature technique et d’exécution. En particulier pour s’assurer de l’innocuité de produits de consommation qui pourraient menacer la santé humaine. Il peut s’agir de prions (pour la prévention de l’ESB14), de molécules chimiques pouvant attenter à la fertilité… Ces emplois visent à distinguer les humains d’autres vivants pour tenir compte d’un métabolisme particulier. Le sens ici est donc celui de la biologie et de la santé et n’emploie pas de dimension métaphorique ou symbolique. Quoique contenu dans un texte de nature normative et juridique, le concept est un de ceux des disciplines biologiques. On peut y rattacher les mentions de l’espèce dans le cadre de programmes de formations qui tendent à éduquer à la biologie humaine. Ici, la spécificité humaine est objectivée par des éléments génétiques ou épigénétiques utilisés comme tels, sans autre dimension que « scientifique », comme fait de connaissance consensuelle.
Ex. C’est le cas de la plupart des textes de droit de l’Union et des textes français de transposition. Ainsi des normes de santé publique qui, en droit de la chimie ou de la consommation, se préoccupent de prévenir les risques pour la « fertilité de l’espèce »15. La même tournure est utilisée pour apprécier « la toxicité pour la reproduction, telles que des études épidémiologiques et des études de cas concernant l’espèce humaine, des études portant spécifiquement sur la reproduction »16. Pour encadrer la recherche sur les effets de la chimie, l’Union désigne la femme comme composante de l’espèce humaine comme les femelles le sont d’autres espèces17. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) reprend ces formules18. Si le thème de la reproduction peut produire une association d’idées, il ne s’agit pas de l’enjeu d’intégrité de l’espèce, mais de la santé reproductive de ses membres. Dans le même sens, pour promouvoir l’étude de la génétique, le Code de l’éducation français19 se croit obligé d’inscrire au programme « l’unicité et la diversité des individus qui composent l’espèce […] humaine (génétique, reproduction) ». La médecine tient compte des connaissances des aptitudes communes aux humains, sans chercher à protéger l’espèce, mais utilise tout de même ce terme20.
On retrouve la volonté de séparer l’humain de l’animal dans l’article 13, paragraphe 1, du règlement REACH (Registration, evaluation, authorization of chemicals) qui prévoit que « en ce qui concerne la toxicité pour l’espèce humaine, les informations sont produites autant que possible par d’autres moyens que des essais sur des animaux vertébrés », ou que « dans bien des cas, le lapin albinos est plus sensible que l’espèce humaine aux substances irritantes ou corrosives pour l’œil »21. La proximité entre espèces peut conduire à parler encore d’espèce humaine22. L’expression « espèce humaine » est ainsi utilisée lorsqu’il est question de zoonose comme l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)23. Il s’agit de tenir compte des spécificités physiologiques humaines connues par la médecine, pour la santé humaine et non de protéger l’espèce en tant qu’entité collective génétiquement identifiée
Il semble que l’on puisse rattacher à ce groupe d’usages les textes qui régissent la recherche sur l’embryon humain, non pas comme élément à utiliser, comme protocole impliquant des embryons, mais comme objet du savoir même. Par exemple les protocoles « ayant pour finalité l’étude de l’analyse des effets du peptide FEE cyclique sur le développement préimplantatoire des embryons dans l’espèce […] humaine. […] »24. Dans ce cas, il s’agit d’étudier la santé et non de protéger l’espèce.
• D’autres usages visent à juridiciser la génétique comme un ensemble d’objets biologiques et informatifs spécifiques à l’humain. La régulation juridique semble ici s’attacher à donner une catégorie juridique à une supposée spécificité qui attend que l’on garantisse son intégrité contre une modification transgénérationnelle. En l’occurrence, cela concerne d’abord la porte d’entrée qu’est l’embryon, porte sur les cellules souches ou sur les thérapies géniques, sur le matériel biologique humain lui-même. C’est dans cet esprit que le législateur français a innové en fondant l’intégrité de l’espèce et en la garantissant par les crimes contre l’espèce.
Ex. Ainsi, l’article 16-4 du Code civil français : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine »25 et les Articles 214-1 à 215-3 du Code pénal punissant les crimes contre l’espèce humaine (clonage reproductif, eugénisme) et font ainsi référence à la reproduction sexuée comme « marque » de l’espèce humaine ! Il en va de même de la Convention d’Oviedo (parfois citée comme source d’inspiration par la Cour européenne des droits de l’Homme) dont l’alinéa 10 du Préambule se dit convaincu « de la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissant l’importance d’assurer sa dignité ».
• D’autres enfin, se veulent synonymes d’humanité comme groupe d’individus, d’êtres humains, mais en visant les générations à venir, comme élément performatif qui les ferait prendre en compte comme sujets de droit déjà là, comme intérêts futurs juridiquement protégés. La dimension est en outre clairement collective et semble se distinguer peu des notions connues comme le patrimoine commun de l’humanité. C’est ici la protection de l’environnement qui peut être mise en avant comme condition de la qualité de vie ou de survie de ces futurs individus26. Il s’agit alors d’inscrire l’humanité dans son environnement en mettant en avant sa propre existence biologique (cela rappelle les derniers écrits de biopolitique de Foucault27). Il s’agit d’effacer l’humanisme politique pour user d’une uniformisation de l’appartenance de toutes les espèces au monde du vivant.
Ex. Des exemples en sont fournis par une résolution du Sénat qui estime que « le changement climatique constitue, en ce sens, une menace existentielle pour l’espèce humaine et les civilisations qui la composent, ainsi que pour les espèces animales et végétales qui peuplent la planète »28. Mais aussi par l’objet social d’une association apprécié par le Conseil d’État comme « accompagner les changements spirituels, intellectuels, culturels, scientifiques, technologiques, politiques, sociaux et économiques nécessaires au respect et au développement de la vie de la planète, de l’espèce […] humaine et autres espèces vivantes »29. Tournure reprise par le Conseil constitutionnel qui évoque « une méconnaissance de l’intégrité de l’embryon et du patrimoine génétique de l’espèce humaine ainsi que du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine »30.
Le droit de l’Union le fait aussi significativement. Certaines sources officielles, néanmoins non normatives, mêlent l’intérêt d’étudier la génétique humaine avec les enjeux environnementaux de l’humanité : « Le climat et le changement climatique et ses conséquences sont maintenant considérés comme étant probablement le plus grand défi lancé à l’espèce humaine pour les toutes prochaines décennies l’espèce humaine possède une composante génétique et beaucoup de maladies résultent directement du dysfonctionnement d’un ou de plusieurs gènes. »31. Ou encore, faisant de toute politique écologique un enjeu anthropique : « Dans la mesure où l’espèce humaine fait partie de son environnement, cette politique favorise la protection sanitaire à long terme de la population »32 ; surtout face au changement climatique33.
Comme d’autres font des produits dangereux pour chaque humain, pris individuellement, des produits dangereux pour l’espèce dans son ensemble…34. L’Union utilise un ton prophétique pour vanter ses projets qui ont « permis de faire connaître aux populations locales les approches positives qui sous-tendent la politique environnementale de l’Union européenne ainsi que les bénéfices que celle-ci procure également à l’espèce humaine, à l’environnement et à la nature »35.
Si on ne tient pas compte du premier groupe, ou si on le rattache au second, qui ne vise pas vraiment l’espèce, mais plutôt la « santé humaine », les différents usages se ramènent à deux significations principales.
B) Deux significations
Dans l’ensemble des usages retenus, l’impression est donnée d’une récupération de données scientifiques qui s’imposeraient au droit : soit comme identification d’un objet à protéger, soit comme élément à prendre en compte pour l’efficacité des politiques publiques. La même ambiguïté est à l’œuvre dans l’avis 138 du CCNE36 relatif à l’eugénisme qui aborde l’espèce à la fois dans la perspective des sciences et du darwinisme social et à la fois comme élément juridique issu des lois de 1994. Prenant l’eugénisme pour objet, lequel transpose à l’humain les techniques de sélection mobilisées en élevage animal, l’analyse juridique confond le construit scientifique et le construit juridique et semble normer le second avec le premier… une forme de droit doublement « naturel ».
Mais, les usages en droit interne ou dans la Convention d’Oviedo apparaissent immédiatement plus normatifs, ils tendent à instituer l’humain, individuellement et collectivement, comme intérêt protégé, mais défini par la génétique comme ancrage scientifique symbolique. On a ici des éléments plus travaillés par les sources de droit, qui mobilisent une volonté normative, plus exactement performative (au sens que ces normes font exister en droit une notion autonome de « l’espèce », en la nommant), instituant un ou plusieurs collectifs, dont la composition vise à une adaptation à la finalité régulatrice particulière. Une portée doublement performative, car, d’une part, par le droit, l’État fait le choix d’imposer légalement une figure débattue au sein des communautés scientifiques, et, d’autre part, il donne force légale à une catégorie à laquelle seront attachés des effets de droit.
À l’inverse, les usages en droit de l’Union semblent redondants et synonymes des termes qui désignent des collectifs existants, en santé, en environnement, ou pour la régulation des droits fondamentaux.
On peut alors proposer de distinguer :
– Signification 1 (« collective ») : Il s’agit de désigner des groupes humains en vue de donner un objet à des politiques publiques sanitaires, environnementales ou à la protection des consommateurs. La biologie humaine est alors distinguée de la biologie animale. Soit parce qu’on teste sur l’animal avant l’homme (dimension normative), soit parce qu’on observe des différences de vulnérabilités de santé (dimension empirique). Cela n’empêche pas de voir que l’espèce humaine est confrontée aux mêmes défis environnementaux. La dominante est donc plutôt constative et la notion d’espèce n’est pas l’enjeu, mais l’outil d’autre chose.
– Signification 2 (« spéciste ») : On crée juridiquement la notion d’espèce, distincte des notions d’ « humanité » utilisées dans le jugement de Nuremberg (« crimes contre l’humanité), par les textes de l’Unesco relatifs aux « patrimoines de l’Humanité, ou encore de la Convention de Montego Bay sur les ressources marines…), du traitement « avec humanité » (droit humanitaire, Convention européenne des droits de l’homme) ou de « famille humaine » (Déclaration universelle des droits de l’homme). Il s’agit de protéger l’intégrité du génome humain (contre les modifications génétiques transmissibles) autant que d’interdire des procédés de tri ou de discrimination organisés. La dominante est clairement normative.
À ce titre, la diversité des formulations retenues par le droit français et, conséquemment par le Conseil de l’Europe, souffre une critique que le droit de l’Union n’encourt pas nécessairement.
1. On comprend que la signification 1 (« collective » et biologisante) trouve son origine dans le mode de formulation de la répartition des compétences entre UE et États membres et que le discours normatif des politiques de l’Union reprend des discours experts en recherche, en santé, en écologie. On retrouve un trait (voire un travers technocratique) courant.
2. On comprend que la signification 2 (« spéciste ») se veut plus normative, performative pour instituer une valeur en vue de fonder et poser des interdits. La vérité scientifique y est plus fragile et plus instrumentalisée, car, d’une part, la notion scientifique d’espèce est elle-même un construit confus ; d’autre part, l’espèce humaine n’y apparaît plus dans sa spécificité biologique face à l’animal (la reproduction sexuée objet de l’interdit du clonage reproductif n’est pas une spécificité humaine et si le clonage est interdit chez l’homme il est techniquement et juridiquement possible chez l’animal, tout comme l’eugénisme).
C) Trois critiques
On aura peine à percevoir la nécessité d’isoler la régulation par le recours à la notion d’« espèce » de celle, plus générale, des droits fondamentaux et de l’emploi de la notion générale et générique d’« humanité », instituée au tournant de la Seconde Guerre mondiale pour légiférer sur les défis géopolitiques d’alors : la paix, le développement, la protection des droits de l’Homme, l’écologie. L’ajout de la notion d’espèce à cet ensemble peut être regardé comme infondé (les disciplines scientifiques ne retiennent pas unanimement une définition et un usage uniques de la mention de l’espèce), hasardeuse (la spécificité humaine sur les sujets régulés est inexistante ; la référence à une supposée vérité scientifique introduit une nouveauté discutable, voire dangereuse), et inefficace (ces normes se trouvent en pratique sans effet sur les objets visés).
1) Critique commune aux deux significations
Le développement des références à l’espèce pose problème, non seulement dans les termes de l’incrimination du clonage reproductif, mais encore dans le principe même de la juridicisation de la notion d’espèce37. En effet, la notion d’espèce, hors du droit, ne se laisse pas cerner aisément, ce qui constitue un premier handicap pour le juriste. La définition biologique forme un ancestral champ de bataille entre scientifiques, plus précisément entre essentialistes (il existe un minimum d’universaux recombinés sous le nom d’espèce) et nominalistes (l’espèce est une association conventionnelle d’objets zoologiques donnés (« taxons »)38. L’idée d’espèce comporte dès lors de nombreuses dimensions selon le regard que l’on porte et les critères retenus : un regard a posteriori insiste sur la ressemblance des individus, tandis qu’a priori on lie les individus entre eux par la descendance. Le critère de l’interfertilité joue généralement le premier rôle39 : « L’espèce représente une division du genre qui regroupe un ensemble d’individus, qualitativement identiques, selon une série de critères fixés ; l’espèce humaine rend compte de l’ensemble des hommes qui répondent aux critères suivants : caractères anatomiques (le développement du cerveau ; la pilosité ; le développement du nez, du menton ; la forme du tronc, de la tête du thorax, de l’abdomen et des membres…), caractères physiologiques (la nutrition et la reproduction) et fonctions relationnelles (la sensibilité, la motricité, la locomotion, le psychisme), en particulier »40. L’espèce se compose de groupes de population ayant des marqueurs communs avec des fréquences différentes. Les scientifiques parlent de polymorphisme41. Parler d’espèce humaine n’aurait alors sans doute qu’une faible validité scientifique. Le droit, quand il se saisit de cette notion, ajoute donc certainement une dimension morale importante, celle qui serait l’apanage de l’humanité. Ce critère supplémentaire se lit difficilement : la non-sélection des individus pour l’eugénisme, la reproduction sexuée garantissant l’aléa génétique pour le clonage.
Le second problème naît alors de la rencontre des deux concepts d’espèce et d’humanité. On peut génétiquement identifier par analogie un individu comme humain ; mais cela n’implique pas « une » espèce humaine ; l’idée d’humanité étant irréductible aux données génétiques. Figer, en droit l’espèce, ne trouve guère d’écho en biologie humaine où la diversité des origines génétiques et des mutations caractérisant les différentes populations défie l’établissement d’une stabilité ou d’une intégrité de « l’espèce ». Les « distances génétiques » permettent ainsi de dater les séparations dont sourdent les groupes humains.
La science n’est pas apte à affecter à l’humanité sa place dans le vivant : « l’humanité n’est pas un état, un privilège, une espèce ou une caractéristique mesurable. Elle est un projet (ou un “procès”), une création sans cesse inachevée et toujours menacée. En ce sens on peut dire qu’elle n’est pas héréditaire même si elle prend appui sur des capacités physiologiques particulières »42. À l’inverse, le droit se surprend à exposer des dispositions non normatives, mais justifiant ses normes. Ainsi, l’article 3 de la Déclaration universelle sur le génome précise que « le génome humain, par nature évolutif, est sujet à des mutations ». Il s’agit alors d’intégrer au discours juridique, formellement entendu, des éléments constatifs, déclaratifs, issus d’un creuset « académique » commun, qui fournissent des motifs, des explications, encore une fois, en réalité, une forme de légitimation pseudoscientifique, participant de cet effort d’objectivation recherché. Lors d’une phase contentieuse, les juges, à commencer par le Conseil constitutionnel, ont tendance à « neutraliser » ces éléments, jugés verbeux, et non significatifs de la présence d’une norme. Le juge les ignore, les prive de force performative. Mais l’effet inverse pourrait se produire. On le voit parfois en matière environnementale, le juge mobilise à son tour des préambules de ce style pour asseoir ses propres conclusions. Ils passent du statut de constat factuel (du sein pour reprendre la terminologie allemande associée aux écrits de Kelsen), à celui d’objectifs normatifs (du sollen).
L’idée de nature43 demeure très présente en dépit de l’absence du terme. Ainsi que l’écrit Jean-Claude Guillebaud : « aujourd’hui il s’agit de renaturaliser l’homme en réévaluant – à la baisse – son statut et ses droits. L’homme n’est plus désigné que comme un élément parmi d’autres de l’ordre naturel, un “élément” qui doit s’autolimiter dans son action et renoncer à l’orgueil prométhéen »44. On retrouve une nature humaine telle que la conçoivent les biologistes, une animalité supérieure. Cette dernière contraste avec la « nature humaine » des philosophes, qu’ils l’attachent à une cosmologie classique ou qu’ils la fondent en raison.
L’éminente dignité de l’humanité n’entretient pas de lien direct avec la notion d’espèce, même si l’intégrité de celle-ci peut indirectement protéger la dignité de la personne en instituant l’intangibilité du génome. En fait, la référence à l’espèce humaine sous couvert d’une référence objective et scientifique entend réellement institutionnaliser la notion d’espèce humaine et lui associer un critère qui n’en est pas un : le hasard de la reproduction sexuée. Le prétendu normal et le normatif se partagent la scène du droit en vue de nous faire prendre, par effet d’annonce, une évidence morale pour une évidence scientifique et inversement. Or, ni l’une ni l’autre n’emportent la conviction.
Distinguer l’humain de l’animal paraît un donné scientifique qui corrobore la dominante culturelle de l’humanisme politique. Le droit de l’UE tend, par le même mécanisme, à rapprocher écologiquement le destin humain et celui de son environnement. Mais il s’agit du même construit stabilisé.
2) Critique de la signification 1
Quoique plus commun, le mésusage opéré par des discours technocratiques se fondant sur des discours émanant des communautés scientifiques n’en est pas moins révélateur de biais cognitifs et de performations juridiques implicites qui tentent d’imposer des représentations « biologisantes ». Tenir compte des réalités empiriques (biologiques ou sociales) en vue de l’efficacité des politiques publiques ne doit pas masquer le construit des qualifications qui déterminent les compétences des institutions, ni le caractère construit et hétérogène des discours et qualifications « scientifiques » qui portent tantôt sur la définition de ce qu’est une espèce, tantôt sur ce qui fait l’originalité de l’espèce humaine (que ce soit génétique, épigénétique ou éthologique).
Le génome est par nature évolutif, en recombinaison permanente d’une génération à une autre. Il est en outre spécifique à chaque individu. Le stabiliser au niveau de l’ensemble des humains résulte d’un double construit scientifique et juridique. À cela s’ajoute la difficulté de saisir ce qui différencie, ce qui spécifie l’humain. Si la génétique parvient à le cerner (à partir d’un périmètre de « l’humain » qui n’est pas, à l’origine, donné par la génétique), encore faut-il que ce soit utile aux fins de la régulation juridique. Or, le principe d’intangibilité du génome est une norme choisie et non un donné à respecter puisque, justement, le génome est évolutif. L’interdit ne porte pas sur l’évolution, mais sur son caractère artificiel. Les deux crimes contre l’espèce (eugénisme et clonage reproductif) n’ont en fait aucun rapport avec la préservation du génome. L’interdiction de l’eugénisme prévient la sélection des personnes et l’interdiction du clonage protège l’aléa génétique. D’un côté, aucun de ces deux objets n’est spécifiquement humain, de l’autre, d’autres principes juridiques comme le principe de non-discrimination pourraient jouer. L’intangibilité du génome n’a pas besoin de la figure de l’espèce et du coût symbolique d’une biologisation en trompe-l’œil.
3) Critique de la signification 2
La figure de l’espèce participe au mouvement de juridicisation des figures collectives de l’humanité. Elle s’ajoute à « l’humanité » comme ensemble des êtres humains à un instant donné (Droit international), et comme titulaire de patrimoines (des biens ou territoires exclusifs de souveraineté, qu’il s’agisse d’espace, de fonds marins, de continents…), mais aussi « l’humanité » au sens du droit humanitaire, ou du droit pénal international c’est-à-dire considération et dignité. Or, ces figures, elles aussi, suffisent à fonder les interdits associés à la figure de l’espèce qui apparaît donc aussi incertaine, dangereuse, qu’inutile.
Étudiant le crime contre l’humanité, Mme Delmas-Marty pose d’entrée de jeu que l’humanité s’entend non pas de l’espèce humaine au sens de sciences naturelles, mais de la « famille humaine » au sens du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme45. Ce faisant elle oppose explicitement culture et nature, l’homme des droits de l’homme et celui des biotechnologies : « protéger l’humanité en tant que telle, c’est d’abord, me semble-t-il accepter, la séparation entre l’homme des droits de l’homme et l’homme biologique ». Or, les crimes contre l’espèce procèdent exactement à l’inverse, mettant l’homme de la nature en avant pour protéger l’homme des droits. À ce titre on préfèrera la formulation retenue à l’article 1er de la Déclaration universelle de l’Unesco sur le génome humain et les droits de l’homme adoptée le 11 novembre 1997 qui pose que « le génome humain sous-tend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité ». Cette formulation insiste sur ce que la génétique révèle de commun sans porter préjudice à la portée normative de ce propos en renvoyant à une hypothétique « espèce ».
Ce qui sépare les crimes contre l’espèce des crimes contre l’humanité est ce qui sépare l’homme biologique de l’homme des droits de l’homme, l’humanité au sens génétique ou au sens normatif. Plus qu’une nuance, la confrontation des deux incriminations permet de mesurer la spécificité de l’appel à l’espèce et de mettre en garde contre ce qu’elle amène avec elle. L’incrimination du clonage a semble-t-il négligé la prise en compte de l’individu en tant que personne. Envisagé par « le haut » de l’espèce, la personne du cloné a été réduite à son mode de « venue au monde » au détriment de son existence future. À ce titre, la première proposition de M. Mattei d’un « crime contre la dignité de l’homme » eut été préférable46. Le but du crime contre l’espèce n’est donc pas d’abord une protection de l’espèce, mais un moyen exceptionnel de lutte contre les discriminations et les hiérarchies fondées sur l’identité génétique ou épigénétique.
Les crimes contre l’espèce humaine constituent une intervention nouvelle et particulièrement prégnante de l’État « dans l’établissement d’un ordre procréatif, ou, si l’on préfère, dans une réglementation des naissances, immixtion qui entre en conflit non seulement avec les principes fondamentaux du libéralisme politique, mais aussi, et plus profondément encore avec la vision de l’homme qui a présidé à la construction des démocraties modernes. »47. On ne contestera pas en soi le passage du normal au normatif, qui relève du choix politique, mais on peut s’interroger sur la construction volontaire de ce normal qui se veut d’emblée normatif. La référence reste à un prétendu modèle naturel. Le parallèle peut être opéré avec le droit de la procréation médicalement assistée. Ce dernier, jusqu’à la loi de bioéthique de 2021, n’a eu de cesse que de maintenir les apparences d’un engendrement naturel, malgré l’usage de techniques qui ne traitent pas l’infertilité, mais la contournent. Avec la « PMA pour toutes », le mythe est abandonné et l’on admet une reproduction artificielle pour tous (même si l’interdit de la gestation pour autrui conduit parfois à justifier l’exclusion des couples d’hommes par leur impossibilité « naturelle » à procréer seuls !). Cet abandon progressif du naturalisme comme fond de légitimité contraste avec la figure de l’espèce.
Les crimes contre l’espèce humaine seraient en ce sens les derniers avatars d’un déterminisme génétique encore dominant, d’une naturalisation de la culture48. La juridicisation de la notion d’espèce humaine pourrait ainsi se lire à la lueur des raisonnements de la sociobiologie où les gènes expliquent et expriment l’humaine condition49. À la réflexion on doit être très réservé face à l’adhésion du législateur à une naturalisation des catégories juridiques, notamment pour les raisons qui font de la biologisation des sciences humaines une vaine entreprise50.
Indiquons, pour conclure, que les termes « espèce humaine » n’apparaissent pas, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, dans le Règlement SoHO de 202451. Il utilise de manière récurrente dans la version française, les termes d’« application humaine » et d’« origine humaine ». Ainsi, une « substance d’origine humaine » ou « SoHO » est « toute substance prélevée du corps humain, qu’elle contienne ou non des cellules et que ces cellules soient vivantes ou non, y compris les préparations à base de SoHO issues de la transformation d’une telle substance. » Il utilise tout de même une terminologie plus proche du registre biologique que civil, évoquant la qualité de « progéniture issue d’une procréation médicalement assistée ». Alors que certaines définitions des SoHO semblent se détacher de la question des usages pour re-biologiser davantage (le sang et dérivés), ce n’est pas le cas de la référence à « l’humain » qui n’est pas explicitée dans sa spécificité ou son isolement de l’animal. Cette distinction n’est pas elle-même un enjeu du texte.
Annexe
Tableau des usages (analyse générale du droit en intégrant les dispositions abrogées)
| Corpus droit interne | Objectifs | Définition | Pertinence |
| Code civil Article 16-4 | Protéger l’intégrité du génome | Principe d’intégrité du génome Interdit naissance d’un humain génétiquement modifié, mais pas la recherche (chimères) | Définir l’espèce par la génétique, l’intangibilité du génome lors de la transmission, sacralisation de l’aléa génétique |
| Code pénal Articles 214-1 à 215-3 | Protéger l’intégrité du génome | Crimes contre l’espèce humaine : clonage reproductif, eugénisme, référence à la reproduction sexuée | Idem |
| Code de procédure pénale Article 2-17 | Exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l’espèce | Idem | |
| Convention d’Oviedo Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine | Protéger l’intégrité du génome | Convention d’Oviedo : Préambule, al. 10 : Convaincus de la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissant l’importance d’assurer sa dignité | Néant (cité par Cour EDH ) |
| Transposition Droit de l’Union Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée | Prévenir les risques pour la fertilité de l’espèce | Catégorie 2 : Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine. […] humaine. […] | |
| Code de l’éducation Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l’éducation. | Éduquer à la génétique | Unicité et diversité des individus qui composent l’espèce […] humaine (génétique, reproduction) | Effectif |
| Arrêté du 14 décembre 2023 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Aéronautique » | Compétence en biologie humaine de techniciens | Préciser l’ordre de grandeur des domaines fréquentiels des ondes sonores (audibles par l’espèce humaine) et ultrasonores. | Effectif |
| Agence de la Biomédecine (ABM) Décision du 12 novembre 2020 portant autorisation de protocole de recherche sur l’embryon humain en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique Décision du 20 décembre 2017 portant autorisation de protocole de recherche sur l’embryon humain en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique | Recherche sur l’embryon de l’espèce humaine, développement préimplatatoire | […] demande d’autorisation, le protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité l’étude de l’analyse des effets du peptide FEE cyclique sur le développement préimplantatoire des embryons dans l’espèce […] humaine. […] | Effectif |
| Conseil d’État, 1re sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 335358, Inédit au Recueil Lebon | Objet d’une association, appréciation de l’intérêt à agir | Accompagner les changements spirituels, intellectuels, culturels, scientifiques, technologiques, politiques, sociaux et économiques nécessaires au respect et au développement de la vie de la planète, de l’espèce […] humaine et autres espèces vivantes et manifestations de vie | |
| Sénat Session ordinaire de 2021-2022 Résolution adoptée en application de l’article 34-1 de la Constitution Résolution visant à affirmer la nécessité d’un accord ambitieux lors de la COP26 de Glasgow permettant de garantir l’application effective de l’Accord de Paris sur le climat | Prévenir les changements climatiques | Que le changement climatique constitue, en ce sens, une menace existentielle pour l’espèce humaine et les civilisations qui la composent, ainsi que pour les espèces animales et végétales qui peuplent la planète | Espèce entendue comme humanité dans dimension diachronique (environnementale) Visée performative |
| Conseil constitutionnel Décision 2021-821 DC – 29 juillet 2021 – Loi relative à la bioéthique – Conformité | Recherches sur l’embryon – Création de chimères | […] Il en résulterait une méconnaissance de l’intégrité de l’embryon et du patrimoine génétique de l’espèce humaine ainsi que du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 27. […] | Non violée |
| Corpus Droit de l’union | |||
| Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) | Éviter les tests sur l’animal | L’article 13, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit que, en ce qui concerne la toxicité pour l’espèce humaine, les informations sont produites autant que possible par d’autres moyens que des essais sur des animaux vertébrés 3.2. Interprétation des résultats L’extrapolation à l’humain des résultats d’études d’irritation oculaire menées sur des animaux de laboratoire n’est valable que dans une certaine mesure. Dans bien des cas, le lapin albinos est plus sensible que l’espèce humaine aux substances irritantes ou corrosives pour l’œil. | Distinguer l’homme de l’animal |
| Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 3.7.2.3.1. Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) | Évaluer dangers pour la reproduction de certains produits de consommation | Toutes les informations disponibles contribuant à la détermination de la toxicité pour la reproduction, telles que des études épidémiologiques et des études de cas concernant l’espèce humaine, des études portant spécifiquement sur la reproduction, ainsi que des études subchroniques | Spécifier santé humaine |
| Règlement (UE) n° 900/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) | Cadre technique des tests vétérinaires en vue de comparer avec santé humaine Choix de femelles pour métabolisme de la femme ( !) | On a normalement recours à des mâles. Dans certains cas, le recours exclusif à des femelles peut être justifié, par exemple si l’essai porte sur des médicaments qui concernent spécifiquement la femme dans l’espèce humaine, ou si l’étude porte spécifiquement sur le métabolisme féminin. En cas de différences significatives entre les sexes en matière de toxicité ou de métabolisme, on utilisera à la fois des mâles et des femelles. | Spécifier santé humaine |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009. Enviro Tech (Europe) Ltd contre État belge. Demande de décision préjudicielle: Conseil d’État – Belgique. Environnement et protection des consommateurs – Classification, emballage et étiquetage du bromure de n-propyle en tant que substance dangereuse – Directive 2004/73/CE – Directive 67/548/CEE – Devoir de transposition. Affaire C-425/08. | Substances toxiques pour la reproduction | Catégorie 1 : « substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine » | Santé humaine |
| Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain | Essais sur l’animal pour évaluer Toxicité embryo/foetale et toxicité périnatale | Bien que ces essais n’aient jusqu’à présent qu’une valeur prévisionnelle limitée en ce qui concerne la transposition des résultats à l’espèce humaine, on estime qu’ils permettent de recueillir des informations importantes | Santé humaine contre animale |
| Règlement (CE) n° 746/2008 de la Commission du 17 juin 2008 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles | Prévenir risque de transmission de l’ESB vers l’humain | L’EFSA ne peut exclure que des agents d’EST autres que ceux de l’ESB soient transmissibles à l’homme, étant donné : | Distinction homme/animal |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 9 septembre 2011. République française contre Commission européenne. Police sanitaire – Règlement (CE) nº 999/2001 – Protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles – Ovins et Caprins – Règlement (CE) nº 746/2008 – Adoption de mesures d’éradication moins contraignantes que celles prévues antérieurement – Principe de précaution. Affaire T-257/07. | Risque de la transmissibilité à l’homme des EST affectant des caprins ou des ovins autres que l’ESB. | Ces modèles n’intègrent toutefois pas des caractéristiques génétiques humaines qui ont une grande incidence sur la sensibilité relative aux maladies à prions. Ils ont également leurs limites lorsqu’il s’agit de calculer quels pourraient être les résultats dans des conditions naturelles, notamment en raison de l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine | Distinction homme/animal |
| Premier rapport sur l’état de la science et de la technologie en Europe, COM(88)647 final Non normatif | Analyse du génome | 4.40 Chacune des 10 billions des cellules du corps humain contient environ 100 000 gènes. La somme totale de ces gènes constitue ce que l’on appelé le génome humain. La connaissance du génome humain sera aussi indispensable à la médecine de demain que celle de l’anatomie humaine l’a été à la médecine d’aujourd’hui. La majorité des maladies affectant l’espèce humaine possèdent une composante génétique et beaucoup de maladies résultent directement du dysfonctionnement d’un ou de plusieurs gènes. La connaissance de l’ensemble du génome permettrait d’identifier rapidement l’origine de ces dysfonctionnements et de détecter les prédispositions héréditaires aux différentes affections. Dans le domaine de l’ agriculture et de l’agro-industrie, par ailleurs, l’ étude au niveau moléculaire du patrimoine génétique des micro-organismes et des espèces animales d’ intérêt économique constitue un élément essentiel aux travaux sur la biologie de base des plantes mentionnés plus haut ( i ) Le climat et le changement climatique et ses conséquences sont maintenant considérés comme étant probablement le plus grand défi lancé à l’espèce humaine pour les toutes prochaines décennies l’espèce humaine possèdent une composante génétique et beaucoup de maladies résultent directement du dysfonctionnement d’ un ou de plusieurs gènes. | Approche de l’espèce par la génomique. Lien avec enjeux climatiques. |
| Document d’orientation sur le champ d’application et les obligations essentielles du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 2021/C 13/01 C/2020/8759 | Régime d’étude du microbiote humain. | Bien qu’il soit associé aux êtres humains et essentiel au bien-être et à la survie de l’espèce humaine, le microbiome humain représente une ressource génétique de nature non humaine. Le microbiote humain doit donc être considéré comme distinct des ressources génétiques humaines, étant donné qu’il se compose d’organismes différents et distincts. […] Étant donné le caractère unique du microbiote propre à chaque être humain et le rôle joué par le microbiote dans la santé humaine, l’étude du microbiote en tant que tel est considérée comme étant en dehors du champ d’application du règlement APA de l’Union européenne. | Définition de l’espèce par le génome, mais exigences éthiques spécifiques en cas de liens spécifiques entre organismes non humains et humains. |
| Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié | Risque pour la santé humaine des herbicides | À classé, le 20 mars 2015, le glyphosate comme un carcinogène probable pour l’espèce humaine | Santé humaine |
| Avis du Comité économique et social européen sur l’« Évaluation à mi-parcours du programme LIFE » (avis exploratoire) | Directement contribué à produire des réussites immédiates et tangibles. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été possible de sauver d’une extinction imminente certaines espèces menacées, protégées par le droit de l’Union, grâce à des projets financés par le programme LIFE permis de faire connaître aux populations locales les approches positives qui sous-tendent la politique environnementale de l’Union européenne ainsi que les bénéfices que celle-ci procure également à l’espèce humaine, à l’environnement et à la nature. | Association de l’espèce humaine et des autres espèces dans la protection de l’environnement | |
| Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2013 sur le projet de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, COM(2012)0242 | Radioactivité, protection de l’environnement | Dans la mesure où l’espèce humaine fait partie de son environnement, cette politique favorise la protection sanitaire à long terme de la population. Étant donné que les organismes sont sensibles à l’irradiation interne et externe, davantage de ressources devraient être consacrées à l’examen rigoureux de l’incidence des rayonnements ionisants tant sur l’espèce humaine et que sur l’environnement. | Insertion de l’espèce dans son environnement |
| Avis du Comité des régions sur les « Stratégies régionales de réponse au changement climatique dans l’UE s’inspirant de l’exemple des régions de montagne » | Changement climatique | Si le changement climatique est le plus grand défi posé à la capacité d’adaptation de l’espèce humaine que celle-ci ait jamais eu à relever, il n’est toutefois qu’un indicateur partiel d’une crise plus complexe de l’environnement et de l’humanité | Insertion de l’espèce dans son environnement |
| Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Examen de la politique environnementale 2008 COM(2009) 304 final | La politique européenne devrait continuer à combiner la législation et les instruments et initiatives volontaires, pour modifier les comportements et faire progresser la prise de conscience des problèmes nouveaux qu’il nous faut affronter désormais en tant qu’espèce humaine | Insertion de l’espèce dans son environnement | |
1 Comité consultatif national d’éthique (2020). Avis 133 : Enjeux éthiques des modifications ciblées du génome : entre espoir et vigilance, 46 p. (voir p. 38).
2 Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164), Oviedo, 4.IV.1997.
3 B. Dondero et F. Neveu, « Inventer des mots pour créer du droit ? Dialogue entre un juriste et un linguiste à propos de « germoplasme », un néologisme qui bouscule la génétique », Gazette du palais, 2017, n° 3, p. 14-15.
4 [https://www.cnrs.fr/fr/actualite/pourquoi-des-acteurs-de-la-recherche-soutiennent-une-nouvelle-legislation-europeenne-sur].
5 Not. FAO (Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture).
6 P. Amselek, Théorie des actes de langage, éthique et droit, Paris, PUF, 1986.
7 Critique de la Raison pure, Analytique des concepts, 1re déduction transcendantale, AK, IV, 79, p. 182.
8 La doctrine, la dogmatique, qui ne peuvent accéder au statut de « science », mais relèvent tout de même d’une démarche académique de recherche d’un accord intersubjectif concernant le « vrai ».
9 Par exemple pour les « contrats de plan État-Région ».
10 Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JOUE n° 225 du 21 août 2001.
11 E. Mayr, « Espèce », in Patrick Tort (dir.), Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, T. 1 (A-E), PUF, 1996, p. 1392.
12 B. Sykes, Les sept filles d’Eve : Génétique et histoire de nos origines (trad. P.-E. DAUZAT), Albin Michel, 2001, p. 141.
13 Human genome project ou projet Génome humain (PGH, ou HGP pour l’anglais Human Genome Project) est un programme lancé fin 1988 et achevé en 2003 en vue d’établir le séquençage complet de l’ADN du génome humain. Il est suivi du programme ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements).
14 Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
15 Directive 2001/59/CE, op. cit.
16 Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) No 1907/2006, JOUE, 31 décembre 2008, p. 1, pt. 3.7.2.3.1 ; Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JOUE, L 311 du 28 novembre 2001.
17 « On a normalement recours à des mâles. Dans certains cas, le recours exclusif à des femelles peut être justifié, par exemple si l’essai porte sur des médicaments qui concernent spécifiquement la femme dans l’espèce humaine, ou si l’étude porte spécifiquement sur le métabolisme féminin. En cas de différences significatives entre les sexes en matière de toxicité ou de métabolisme, on utilisera à la fois des mâles et des femelles. » Règlement (UE) No 900/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) No 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1-849.
18 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2009. Enviro Tech (Europe) Ltd contre État belge. Demande de décision préjudicielle – Conseil d’État – Belgique : « substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine ».
19 Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l’éducation.
20 Arrêté du 14 décembre 2023 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Aéronautique » qui entend préciser l’ordre de grandeur des domaines fréquentiels des ondes sonores (audibles « par l’espèce humaine ») et ultrasonores.
21 Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1-849.
22 « Bien qu’il soit associé aux êtres humains et essentiel au bien-être et à la survie de l’espèce humaine, le microbiome humain représente une ressource génétique de nature non humaine. », Document d’orientation sur le champ d’application et les obligations essentielles du règlement (UE) No 511/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 2021/C 13/01 , C/2020/8759.
23 « qu’il convient de tenir compte des limites de ces modèles, entre autres en ce qui concerne l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles. », Règlement (CE) No 746/2008 de la Commission du 17 juin 2008 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) No 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 9 septembre 2011, République française contre Commission européenne.
24 Décision de l’Agence de la biomédecine du 20 décembre 2017 portant autorisation de protocole de recherche sur l’embryon humain en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique ; Décision de l’Agence de la biomédecine du 12 novembre 2020 portant autorisation de protocole de recherche sur l’embryon humain en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.
25 Il poursuit : « Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »
26 Cons. const., QPC, 27 oct. 2023, n° 2023-1066, Assoc. Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs].
27 « Ce qu’on pourrait appeler le “seuil de modernité biologique” d’une société se situe au moment où l’espèce entre comme enjeux dans ses propres stratégies politiques. L’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu’il était pour Aristote : un animal vivant et de plus capable d’une existence politique ; l’homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant est en question. » M. Foucault, in Histoire de la sexualité, t.1, La volonté de savoir, Gallimard, 1977.
28 Session ordinaire de 2021-2022 : Résolution adoptée en application de l’article 34-1 de la Constitution – Résolution visant à affirmer la nécessité d’un accord ambitieux lors de la COP26 de Glasgow permettant de garantir l’application effective de l’Accord de Paris sur le climat.
29 Conseil d’État, 1re sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 335358.
30 Décision 2021-821 DC – 29 juillet 2021 – Loi relative à la bioéthique, § 26.
31 Premier rapport sur l’état de la science et de la technologie en Europe, COM(88)647 final.
32 Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2013 sur le projet de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, COM(2012)0242.
33 « si le changement climatique est le plus grand défi posé à la capacité d’adaptation de l’espèce humaine que celle-ci ait jamais eu à relever, il n’est toutefois qu’un indicateur partiel d’une crise plus complexe de l’environnement et de l’humanité », Avis du Comité des régions sur les « Stratégies régionales de réponse au changement climatique dans l’UE s’inspirant de l’exemple des régions de montagne». Voir aussi, Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Examen de la politique environnementale 2008, COM(2009) 304 final.
34 « le glyphosate comme un carcinogène probable pour l’espèce humaine », Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié.
35 Avis du Comité économique et social européen sur l’« Évaluation à mi-parcours du programme LIFE» (avis exploratoire).
36 Du 20 mai 2021.
37 P. Descamps, Un crime contre l’espèce humaine ? Enfants clonés, enfants damnés, Les empêcheurs de tourner en rond, 2004.
38 E. Mayr, op. cit., p. 1392.
39 H. Atlan, « Personne, espèce, humanité », in Comités d’éthique à travers le monde, Tierce-médecin-INSERM, 1989, p. 186.
40 P. Rouger, L’empreinte humaine. De l’éthique à la génétique, Mercure de France, 1992, p. 59-60.
41 Plus d’une trentaine de systèmes permettent d’établir des éléments d’identité biologique.
42 J.-C. Guillebaud, Le principe d’humanité, Points, Seuil, 2001, p. 84.
43 Pour le constat d’un retour du droit naturel dans les considérations relatives au clonage : X. Bioy, « L’usage de l’idée de nature en droit constitutionnel », in D. Rousseau et A. Viala (dir.), Le droit, de quelle nature ?, Montchrestien, 2010. D. Lecourt, Humain, post humain, PUF, Science, histoire et société, 2003, p. 106.
44 J.-C. Guillebaud, op. cit., p. 62.
45 M. Delmas-Marty, « L’interdit et le respect : comment définir le crime contre l’humanité ? » in M. Colin (dir.), Le crime contre l’humanité, Érès, 1996, p. 19.
46 « Pour moi, le clonage reproductif est, au niveau de la personne, l’équivalent de ce qu’est le crime contre l’humanité au niveau collectif », voir le rapport de Francis Giraud (n° 128 (2002-2003) au nom de la Commission des Affaires sociales.
47 Ph. Descamps, op. cit., p. 14.
48 P. Pharo, L’homme et le vivant : Sciences de l’homme et sciences de la vie, PUF, Science, histoire et société, 2004, p. 17 : l’auteur stigmatise les courants de la sociobiologie, du fonctionnalisme cognitif et de la psycho-anthropologie évolutionnaire comme approches strictement causalistes et biologiques des aptitudes humaines.
49 Voir not. E. O. Wilson, La sociobiologie, Le Rocher, 1987 ; P.-H. Gouyon, J.-P. Henry, J. Arnould, Les avatars du gène. La théorie néodarwienne de l’évolution, Belin, 1997.
50 M. Delmas-Marty, « Interdire et punir : le clonage reproductif », RTDH 2003, p. 439. S.-J. Gould, Mismeasure of Man, New York, Norton & Company, 1981, p. 97.
51 Règlement (UE) 2024/1938 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE, JOUE L1938, 17.7.2024.
Xavier Bioy, « Fragmentation et usages bioéthiques de la référence à “l’espèce humaine” », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4184.