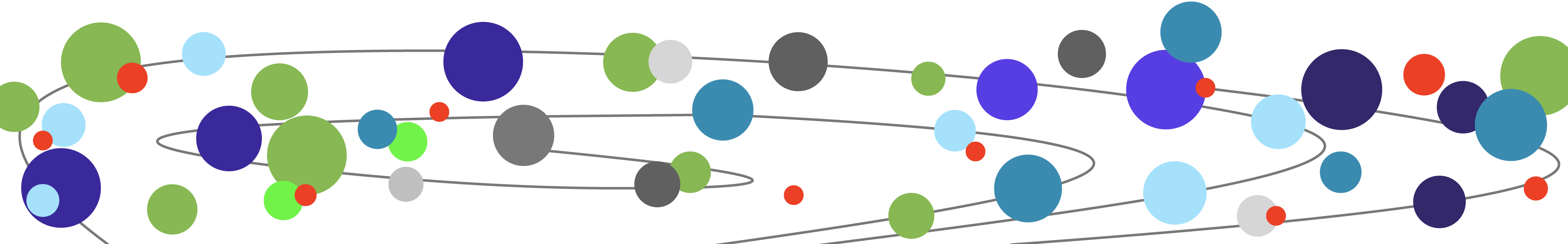Valentine Delcroix
Doctorante, Aix-Marseille Univ, CNRS, DICE, CERIC,
Aix-en-Provence, France
Au stade des balbutiements législatifs de la mise en œuvre de l’approche « une substance, une évaluation », cet article propose d’apprécier l’articulation d’un concept juridique de « substance » unitaire à une pluralité de régimes juridiques de produit, tels que ceux relatifs aux médicaments, aux produits phytopharmaceutiques, aux produits biocides, aux denrées alimentaires et aux produits cosmétiques, autour de deux hypothèses centrales. La première établit l’unité du concept juridique de « substance » dans la définition « scientifique » qui en est donnée en droit positif. La seconde expose le caractère unique du concept juridique de « substance » à travers la défragmentation des régimes qu’il amène.
La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques (ci-après « la stratégie »)1, adoptée par la Commission européenne en 2020, vise à réformer le cadre réglementaire européen applicable aux produits chimiques en intégrant l’approche dite « une substance, une évaluation » (ci-après « l’approche »), conformément à l’objectif de mieux protéger la santé et l’environnement introduit dans le pacte vert pour l’Europe2. Dans la stratégie, la Commission emploie alternativement les notions de « substance », de « substances chimiques » et de « produits chimiques » et les tient pour synonymes afin de nommer l’objet du réel à l’égard duquel elle a vocation à s’appliquer, objet qu’elle postule ainsi uniforme. Les propositions législatives élaborées par la Commission à la suite de la stratégie mettant en œuvre l’approche entretiennent ce flou terminologique3. Seule la proposition relative à l’établissement d’une plateforme de données commune sur les produits chimiques, prévoyant la mise en place d’un répertoire des « vocabulaires contrôlés »4, relève les préoccupations des parties prenantes quant à l’absence de définition commune pour certains termes, dont celui de « substance », et l’usage de « termes différents pour un même concept » entre les différents textes législatifs5. Outre les difficultés pratiques qui peuvent être engendrées du fait de l’absence d’une définition commune de « substance » pour les acteurs économiques et les organes administratifs de l’Union chargés de l’évaluation des substances, comme celle spécifiée dans ladite proposition liée à l’interopérabilité des données, l’incertitude entourant la dénomination de l’objet à l’égard duquel la réforme vise à s’appliquer constitue plus largement une antinomie législative. L’introduction par la Commission de l’approche « une substance, une évaluation » vise précisément à « simplifier et consolider le cadre juridique ». En effet, ce cadre, dispersé dans près de 40 instruments législatifs et fonctionnant selon le modèle d’évaluation substance par substance, a montré ses limites en termes d’efficacité6. Une même substance peut être soumise à plusieurs évaluations selon qu’elle entre dans la composition de tel ou tel produit relevant de tel ou tel régime. Or la réforme peut-elle accomplir ses promesses légistiques sans initialement s’entendre sur la signification d’un concept juridique unique s’adressant à un corpus de législations fragmenté ?
Face à la pluralité de termes employés, cet article propose de choisir de dénommer « substance » le concept juridique auquel renvoient la stratégie et, plus généralement, les législations du droit de l’Union concernées par la réforme, pour deux raisons principales. Premièrement, la dénomination de « substance » comme concept pour identifier l’objet auquel le droit fait référence s’impose en raison de la particularité que son emploi suggère par rapport à ceux de « substances chimiques » et de « produits chimiques » dans la stratégie. La Commission utilise la notion de « substance » comme étant l’élément partagé par les différents produits alors qu’elle a davantage recours à la notion de « produits chimiques » pour englober et se référer à tous les régimes juridiques spécifiques de produits. Des qualificatifs sont alors ajoutés à la notion de « substance » afin de caractériser des cas particuliers, passant outre les catégories de produits, au regard des effets non désirés qu’elle cause sur la santé et l’environnement, tels que « substances toxiques », « substances préoccupantes », « substances chimiques dangereuses » et « substances chimiques nocives ». Ces variations terminologiques présentes dans la stratégie ne relèvent pas simplement d’un esthétisme linguistique puisqu’un constat identique peut être dressé s’agissant des versions anglaise et allemande de la stratégie7, qui ont respectivement recours aux notions « chemicals » et « Chemikalien » d’une part, et « substance » et « Stoff » d’autre part. Toutefois, la troisième occurrence « substances chimiques » dans la version en français se trouve absorbée par celle de « produits chimiques » en anglais et en allemand. L’expression « substances chimiques » semble davantage relever de la tautologie : d’un côté, elle est assimilée à celui de « substance » dans la stratégie en français, de l’autre elle est remplacée par les traductions de « produits chimiques » en anglais et en allemand. L’hésitation principale dans la dénomination du concept semble dès lors résider entre « substance » et « produits chimiques ». L’usage du terme « substance » dans la formulation de la nouvelle approche apparaît distinctif car il est employé au singulier et induit une signification particulière : le délaissement d’une logique réglementaire fonctionnant par catégories de produit afin d’outrepasser la pluralité des régimes juridiques existants. Deuxièmement, il convient de retenir l’appellation « substance » au regard de la systématicité de son emploi, par rapport aux termes de « substances chimiques » et de « produits chimiques », dans les actes législatifs créant des régimes de produits. La notion de « substance » constitue en effet un critère commun de qualification des produits. Dès lors, la dénomination de « substance » l’emporte sur celle de « produits chimiques » puisqu’elle tend à dépasser la seule conceptualisation de l’objet réel sous la forme d’une marchandise8, d’une catégorie de produit mise en circulation sur le marché intérieur, nécessairement corrélée d’une vision fragmentée du droit entraînant une étude par la doctrine en silos : les « substances » relèvent tantôt du droit de l’environnement9 tantôt du droit de la santé10, sans jamais véritablement être appréhendées conjointement11. Pour ces deux raisons, la première relative à la signification spécifique du terme au regard de l’usage qui en est fait dans la stratégie et la seconde correspondant à l’usage du terme dans les législations instituant des régimes de produits différents faisant de la notion un élément commun aux catégories de produits, il a été choisi de dénommer « substance » le concept juridique mobilisé par le droit de l’Union européenne.
Cet article vise ainsi à questionner la coexistence d’un même concept juridique de « substance » avec une diversité de régimes juridiques de produit. Ni la stratégie ni les propositions législatives ne définissent ce qu’il convient d’entendre par « substance », bien qu’une telle définition existe en droit positif. Cette définition, par sa nature que l’on peut qualifier de « scientifique », pourrait servir de définition de référence et permettre ensuite au concept d’être étendu pour constituer d’autres notions. Le concept juridique de « substance » tirerait son unité de l’appropriation d’une définition que l’on retrouve en chimie, qui s’inspire elle-même plus largement du concept commun de « substance », renvoyant selon son sens étymologique à la « réalité d’une chose » (I). L’existence d’un concept juridique de « substance » unique permettrait dès lors de défragmenter non seulement la procédure d’évaluation, s’agissant de l’objectif officiellement poursuivi, mais aussi indirectement les régimes juridiques de produit, de manière à faire circuler in fine les normes et désenclaver les domaines de l’environnement et de la santé (II).
I. L’unité du concept juridique de « substance » garantie par une définition « scientifique »
Il convient de rechercher l’unité du concept juridique de « substance » dans la définition « scientifique » qui en est donnée dans le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (ci-après « règlement REACH »)12. En s’inspirant d’une définition retenue en chimie, celle-ci pose deux critères constitutifs d’une « substance » en droit : l’origine, d’une part, et la composition, d’autre part (A). Par cette définition dite « scientifique », ce qui est admis comme étant une « substance » peut être étendu et constituer le point de départ à partir duquel d’autres notions sont établies en droit de l’Union européenne de l’environnement et de la santé, comme celles de « résidus » ou encore de « substance active » (B).
A) Les critères d’une définition « scientifique »
La définition du terme « substance » dans le règlement REACH peut servir de définition de référence en droit positif. Certains régimes juridiques effectuent des renvois directs à la définition posée par le règlement REACH, tels que les régimes relatifs aux produits biocides et aux polluants organiques persistants13. D’autres régimes juridiques procèdent à des renvois implicites en reprenant en tout ou partie la définition, à l’instar du régime relatif aux produits cosmétiques dans le premier cas14 et du régime relatif aux produits phytopharmaceutiques dans le second cas15. Comme le relève l’avocate générale Mme Eleonor Sharpston, dans ses conclusions relatives à l’arrêt PPG et SNF / ECHA, « la notion de “substance” est la principale notion utilisée pour définir le champ d’application du règlement REACH »16. La définition qui en est donnée est « la pierre angulaire du règlement REACH, puisque les substances constituent l’objet principal de ses dispositions »17. Une « substance » y est définie à l’article 3, paragraphe 1, de la manière suivante : il s’agit d’« un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ». Il en ressort deux critères de définition : un premier relatif à l’origine et un second relatif à la composition d’un élément chimique. La définition donnée en droit positif a évolué et est désormais considérée par les services de la Commission comme étant « bien établie dans le droit de l’Union depuis 20 ans »18. Le critère de l’origine a précédé celui de la composition dans l’identification d’une « substance ». Initialement, la directive 67/548/CEE définissait à l’article 2, paragraphe 1, les « substances » comme étant « les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie »19. Une telle définition, dressée à partir du seul critère de l’origine, était également donnée dans la directive 2001/83/CE instaurant le régime relatif aux médicaments20. Le critère de la composition a par la suite été ajouté par la directive 92/32/CE et repris par les actes législatifs postérieurs21. Selon le juge de l’Union, l’ajout de ce critère permet à la notion de « substance » de couvrir « non seulement les éléments chimiques ayant une structure moléculaire unique, mais également ceux composés de plusieurs constituants, lesquels font […] partie intégrante de cette substance »22. Dès lors, l’ECHA a pu considérer qu’une substance possédait certaines propriétés intrinsèques lorsque l’un de ses constituants les possédait en prenant en compte « le pourcentage et les effets chimiques de la présence d’un tel constituant »23. La définition du règlement REACH peut être qualifiée de « scientifique » dans le sens où l’objet réel décrit comme étant une « substance » à partir de ces deux critères coïncide avec la définition qui en est donnée en chimie, s’agissant d’une « matière chimiquement bien individualisée »24. Bien que le terme de « produit chimique » renvoie plus précisément dans le domaine de la chimie à « une substance obtenue artificiellement »25, la distinction faite entre les deux termes doit être amoindrie en ce qu’ils sont présentés comme étant des synonymes. En précisant d’où elle provient, d’un état naturel ou d’un processus de fabrication, et de quoi elle peut être composée, éventuellement d’un additif ou d’une impureté à l’exclusion d’un solvant, la définition donnée par le règlement REACH permet d’« individualiser » une « substance ». La définition « scientifique » correspond finalement à la « réalité chimique d’une chose », constituant la base à partir de laquelle d’autres notions découlent.
B) L’extension du concept de « substance »
L’intérêt d’avoir fourni en droit positif une définition « scientifique » de la notion de « substance » réside dans la faculté de cette dernière à être étendue, qui peut l’être dans trois cas de figure. Premièrement, le concept de « substance » peut être étendu sur un plan quantitatif, c’est-à-dire lorsqu’il est question de saisir juridiquement une pluralité de substances dans un seul et même objet du réel. À cet égard, suivant une logique fragmentée des régimes, les législations ont recours à des terminologies différentes, mais ces termes sont tous définis à partir de la notion de « substance ». Par exemple, le règlement REACH définit un « mélange » comme étant « un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus »26. Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques désigne par le terme « préparation » : « les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques ou adjuvants »27. La notion d’« association » renvoie dans le règlement relatif aux médicaments vétérinaires à « toute substance ou association de substances qui remplit au moins l’une des conditions suivantes […] »28. Deuxièmement, le concept de « substance » peut être étendu sur un plan qualitatif en raison de l’attribution d’une caractéristique supplémentaire, d’une utilisation ou d’un rôle spécifiques nécessitant d’appréhender la « substance » distinctement. Ce peut être, par exemple, un « résidu » qui, dans les régimes relatifs aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, correspond à une substance spécifiquement identifiée au regard de l’ajout de l’attribut de reliquat29. Par ailleurs, il peut s’agir, au titre du règlement REACH, de la notion d’« intermédiaire » qui correspond à « une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation d’une autre substance »30. Dans ses conclusions relatives à l’arrêt PPG et SNF / ECHA, l’avocate générale Mme Eleonor Sharpston précise que la détermination d’un « intermédiaire » part nécessairement de la notion de « substance » : « il convient d’abord d’identifier la substance, et ensuite d’examiner ses utilisations afin de vérifier si elle répond à la définition de l’“intermédiaire” »31. Un dernier exemple peut être cité s’agissant de l’extension du concept de « substance » au regard du rôle qu’elle a dans la composition d’un produit : il s’agit de la notion de « substance active », qui a fait l’objet – plus ou moins directement – de plusieurs renvois préjudiciels32 visant à clarifier les liens qu’entretient ladite notion à celle du produit régi par une réglementation sectorielle33. Une « substance active » est identifiée comme étant un composant qui exerce une action spécifique, suivant la fonction qu’un produit est supposé remplir34. Ainsi, en donnant au concept juridique de « substance » une définition « scientifique », le législateur de l’Union dispose d’une base qui lui permet de se référer au même objet réel à partir duquel il modèle d’autres types de qualification dans les législations sectorielles de produit. La « réalité chimique d’une chose », déterminée à partir des deux critères posés par la définition « scientifique » du règlement REACH, garantit au concept juridique de « substance » son unité.
II. L’unicité du concept juridique de « substance » révélée à travers la défragmentation des régimes
Le concept juridique de « substance » a de particulier sa faculté à rendre compte des mouvements de construction du droit autour de l’objet réel qu’il saisit, sous l’angle de la fragmentation et de la défragmentation du droit de l’Union européenne35. Initialement, suivant l’objectif de l’établissement d’un marché intérieur assurant les libertés de circulation, les régimes juridiques ont été créés à partir des seules catégories de produit, une « substance » n’étant qu’un élément de qualification d’un produit. La régulation de l’objet « substance » a dès lors été nécessairement fragmentée : chaque régime a été instauré suivant une fonction spécifique reconnue à chaque « substance » (A). Néanmoins, l’introduction de l’approche « une substance, une évaluation » dans la stratégie témoigne dorénavant d’une volonté inverse, celle de défragmenter le cadre de l’évaluation scientifique par le biais du concept juridique de « substance ». Eu égard à l’importance de l’avis scientifique adopté à l’issue de l’évaluation scientifique dans la prise de décision36 et des nouvelles dispositions envisagées visant à harmoniser les avis scientifiques relatifs à une même « substance » pris au titre des différentes législations, la défragmentation de cette première phase de l’adoption d’une décision peut avoir pour conséquence de défragmenter la seconde, celle de la gestion des risques par l’institution politique chargée de fixer le niveau de risque inacceptable pour la société. Le concept juridique de « substance » aurait finalement d’unique sa capacité à uniformiser les régimes juridiques en faisant circuler entre eux les normes juridiques adoptées (B).
A) L’initiale spécialisation fonctionnelle des régimes
Chaque législation instituant un régime de produit a pour base juridique, seule ou complétée, l’article 114 du TFUE37. Le législateur de l’Union a élaboré, sur le fondement de sa compétence relative au rapprochement des législations, des régimes spéciaux et autonomes38 de produit concourant au développement des politiques de protection de l’environnement et de la santé, justifiées par l’existence de mesures nationales disparates susceptibles de compromettre l’objectif du marché intérieur39. Alors que chaque produit est défini dans les régimes juridiques y afférents, les catégories juridiques de produit peuvent se chevaucher et créer des conflits de qualification. À cet égard, le juge de l’Union a eu notamment à connaître de renvois préjudiciels en interprétation des dispositions posant les définitions de produit40 et de recours en manquement dans le cadre desquels une qualification erronée d’un produit a constitué une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges au sens de l’article 34 du TFUE41. Bien que l’opération de qualification d’un produit soit guidée par le principe de « non-cumulation »42, ce contentieux de la qualification est révélateur de la proximité des catégories juridiques des produits dits « frontières » et de la difficile distinction faite entre eux43. La fragmentation du droit de l’Union s’est réalisée sous la forme d’une « spécialisation fonctionnelle »44 des régimes, en ce que les « substances », en étant inévitablement appréhendées à travers des catégories juridiques de produit, sont distinguées au regard de leur destination45. Une « substance » destinée à produire certains effets emporte la qualification d’un produit au regard de la fonction qui lui est attribuée. En ce sens, l’arrêt BASF rendu le 10 mai 2001 illustre de façon exemplaire l’articulation de la définition « scientifique » d’une « substance » à celle de produit phytopharmaceutique, par l’intermédiaire de la notion de « substance active »46. La Cour de justice a répondu à la question d’interprétation de la juridiction de renvoi que la notion de « produit », au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, « comprend les éléments et leurs composés chimiques tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ». Cette spécialisation fonctionnelle des régimes est nécessairement accompagnée d’une « spécialisation téléologique » des régimes : parce que ces produits ont des fonctions propres en raison du fait que les « substances » qui les composent sont destinées à avoir certains effets à l’égard de la santé humaine et/ou de l’environnement, les régimes poursuivent des objectifs propres en ce qui concerne ces « biens protégés par l’ordre juridique »47. En effet, alors que chacun de ces régimes a pour but commun l’amélioration du marché intérieur, un morcellement s’est produit entre les régimes qui visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine48, ceux qui visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement49 et ceux qui visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement50. Si le fonctionnement des régimes est similaire en ce qu’ils prévoient, pour chaque « substance » emportant le critère fonctionnel de qualification du produit, une phase d’évaluation des risques confiée à un organe d’experts puis une phase de gestion des risques au cours de laquelle la Commission adopte une norme juridique autorisant ou non la mise sur le marché du produit, les exigences et conditions requises diffèrent en raison des finalités différentes qu’ils poursuivent. Une même substance est alors susceptible d’être évaluée différemment au titre des législations sectorielles si elle entre dans la composition de différents produits51. Or, au vu des incohérences et redondances engendrées, ce modèle d’évaluation « substance par substance », s’inscrivant dans une logique fragmentée des régimes, est en passe d’être remplacé52.
B) L’inédite unification téléologique des régimes
L’approche « une substance, une évaluation » proposée par la stratégie vise à défragmenter la procédure d’évaluation commune aux différents régimes juridiques de produit à travers l’harmonisation de la méthode d’évaluation choisie, d’une part, et des résultats obtenus, d’autre part. Premièrement, s’il existe des incertitudes quant au type d’évaluation visé53, à savoir qu’il s’agisse d’évaluer les dangers ou les risques d’une substance, l’approche entend supplanter le modèle d’évaluation « substance par substance » par une méthode opérant par « groupes de substances présentant des similitudes structurelles ou fonctionnelles »54. Sans avoir déterminé, pour le moment, « le moyen pertinent de définir le groupe de substances », le changement de la méthode d’évaluation vise à « éviter que des substances dangereuses ne soient remplacées par d’autres substances susceptibles d’être interdites »55. L’idée sous-tendue est de prévenir les situations de substitution regrettable et ainsi de « mieux protéger la santé humaine et l’environnement » dans le cadre de l’ambition « zéro pollution » énoncée dans le pacte vert et reprise dans la stratégie56. De plus, la nouvelle approche favorise la centralisation de l’évaluation au profit des agences de l’Union, étant un gage de transparence et de crédibilité scientifique, en opérant une réattribution des tâches d’évaluation auparavant exécutées par d’autres organismes, tels que des comités ou groupes d’experts, des services de la Commission ou encore des contractants57. Les propositions législatives adoptées par la Commission mettant en œuvre l’approche viennent clarifier les responsabilités incombant aux agences en matière d’évaluation scientifique au titre des législations existantes. Elles laissent entrevoir la mise en place d’une répartition de l’évaluation des substances selon qu’elles relèvent des responsabilités incombant à l’Agence européenne des produits chimiques, en tant qu’agence généraliste58, ou selon qu’elles relèvent d’agences spécifiques, telles que l’Autorité européenne de sécurité alimentaire ou l’Agence européenne des médicaments, au regard de l’expertise et des ressources qu’elles détiennent59. L’approche entend ainsi uniformiser sur un plan organique la procédure d’évaluation scientifique des substances. Deuxièmement, l’approche « une substance, une évaluation » suggère d’harmoniser les méthodologies d’évaluation des substances entre les régimes juridiques60 en vue notamment d’éviter l’adoption d’avis scientifiques divergents pour une même substance61. À cet égard, plusieurs dispositions renforçant la cohérence entre les avis scientifiques adoptés entre agences sont prévues dans les propositions législatives62. Eu égard à l’influence que peuvent avoir les avis scientifiques dans l’appréciation par le décideur des éléments factuels lors de l’adoption d’une mesure de gestion des risques, l’harmonisation des avis scientifiques à travers la mise en œuvre de la nouvelle approche permet « une prise de décision plus rapide, plus cohérente et plus prévisible »63. Par conséquent, l’harmonisation de l’évaluation d’une substance a pour effet indirect d’harmoniser in fine la décision adoptée sur la base d’un avis scientifique lui-même harmonisé. S’il s’agit là d’une conséquence non expressément recherchée par l’approche « une substance, une évaluation », elle constitue en revanche le résultat attendu par une autre approche introduite par la stratégie, dite « approche générique de la gestion des risques ». Celle-ci vise spécifiquement à déclencher de façon automatique l’adoption de mesures de gestion des risques prédéterminées pour les substances les plus nocives, présentes notamment dans les produits de consommation. La défragmentation de la procédure d’évaluation grâce au concept juridique de « substance » a pour conséquence d’unifier les régimes juridiques relatifs aux produits afin de faire circuler indirectement la norme juridique adoptée pour une « substance », en vue d’assurer une protection de la santé et de l’environnement plus effective.
Pour conclure, cet article, consacré à la question de savoir de quelle manière peut s’articuler un concept juridique singulier de « substance » à des régimes juridiques pluriels de produit, a développé deux hypothèses. La première hypothèse consiste à considérer que le concept juridique de « substance » tire son unité d’une définition « scientifique ». En effet, en renvoyant par les deux critères de définition posés dans le règlement REACH, de l’origine et de la composition, à la « réalité chimique d’une chose », le concept de « substance » trouve de nombreuses extensions en droit de l’Union européenne de l’environnement et de la santé. La seconde hypothèse souligne la potentialité unique du concept de « substance » à défragmenter des régimes juridiques de produit fonctionnellement spécialisés. En poursuivant l’objectif de « mieux protéger la santé humaine et l’environnement », l’approche raisonnant à partir du concept de « substance » l’érige en catégorie générale hiérarchisant des sous-catégories de produit64.
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Vers un environnement exempt de substances toxiques, COM(2020) 667 final, du 14.10.2020.
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final, du 11.12.2019.
3 Trois propositions législatives ont été faites le 7 décembre 2023 par la Commission, à savoir : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme de données communes sur les produits chimiques, fixant des règles visant à garantir que les données qu’elle contient sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et définissant un cadre de surveillance et de prospective pour les produits chimiques, COM(2023) 779 final ; Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 401/2009, (UE) n° 2017/745 et (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la réattribution de tâches scientifiques et techniques et améliorant la coopération entre les agences de l’Union dans le domaine des produits chimiques, COM(2023) 783 final ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la réattribution de tâches scientifiques et techniques à l’Agence européenne des produits chimiques, COM(2023) 781 final.
4 L’article 12 de ladite proposition précise que le répertoire envisagé sera établi et géré par l’Agence européenne des produits chimiques. Selon l’article 2, paragraphe 9, de la proposition ces « vocabulaires contrôlés » correspondent aux « ensembles normalisés et organisés de mots et d’expressions présentés sous forme de listes de termes ou de thésaurus et de taxonomies, dont la structure hiérarchique est composée de termes plus génériques ou plus spécifiques ».
5 COM(2023) 779 final, p. 12, préc. note n° 3.
6 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Conclusions du bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH) et défis, lacunes, faiblesses recensés, COM(2019) 264 final, du 25.6.2019.
7 L’on se cantonne aux trois langues de travail admises en pratique à la Commission, bien que toutes les langues officielles de l’Union européenne fassent foi, selon l’article 17, paragraphe 5, du règlement intérieur de la Commission, C(2000) 3614, JO L 308 du 8.12.2000, p. 26. Voy. sur ce point : A.-L. Sibony, « La traduction en droit positif : les régimes linguistiques en droit communautaire », in A. Bailleux et al. (dir.), Traduction et droits européens : enjeux d’une rencontre. Hommage au recteur Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Presses Universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2009, p. 69-108.
8 E. Fisher, « Chemicals as regulatory objects », Review of European, Comparative & International Environmental Law, 23(2), 2014, p. 163-171.
9 P. Thieffry, Traité de droit européen de l’environnement et du climat, 4e édition, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 785-879 (le chapitre IX de l’ouvrage est consacré aux « substances et organismes dangereux ») ; L. Krämer, EU environmental law, 7th edition, London, Sweet & Maxwell, 2011, p. 223 (les « substances » sont envisagées dans l’ouvrage dans le chapitre 6 relatif aux « produits »).
10 C. Blumann, L. Dubouis, N. Rubio, Droit matériel de l’Union européenne, 9e édition, Paris, LGDJ, 2024, p. 307-309.
11 Certes des études soulèvent l’objectif conjoint de protection de la santé et de l’environnement du règlement n° 1907/2006 dit « REACH » autour de la notion de « risques sanitaires et environnementaux » posés par les substances mais il n’est pas questionné en tant que champ d’étude par la doctrine. Voy. par exemple : T. Berger, L. Maxim, « L’accès aux informations environnementales et sanitaires et ses obstacles : le cas des substances chimiques », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, 13, 2021, p. 133‑145 ; J.-N. Jouzel, P. Lascoumes, « Le règlement REACH : une politique européenne de l’incertain. Un détour de régulation pour la gestion des risques chimiques », Politique européenne, 1(33), 2011, p. 185‑214.
12 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1-849.
13 Article 3, paragraphe 2, a), du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1-123 ; Article 2, paragraphe 3, du règlement du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, JO L 169 du 25.06.2019, p. 45-77.
14 Article 2, paragraphe 1, b), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59-209.
15 Article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1-50.
16 Conclusions de l’avocate générale Mme Eleonor Sharpston, présentées le 6 juillet 2017, PPG et SNF / ECHA, aff. C-650/15 P, ECLI:EU:C:2017:527, pt. 53.
17 Commission Staff Working Document, General Report on REACH, accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions in accordance with the Article 117(4) REACH and Article 46(2) CLP, and a review of certain elements of REACH in line with Articles 75(2), 138 (3) and 138(6) of REACH, SWD(2013) 25 final, 5.2.2013, p. 17 ; Conclusions de l’avocate générale Mme Eleonor Sharpston, présentées le 6 juillet 2017, PPG et SNF / ECHA, préc. note n° 15, pt. 53.
18 SWD(2013) 25 final, préc. note n° 16, p. 17.
19 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1-98
20 Article 1, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67-128 : « substance : toute matière quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être – chimique, tels que les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse ».
21 Article 2, paragraphe 1, a), de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 154 du 5.6.1992, p. 1-29 ; Article 2, a), du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, JO L 84 du 5.4.1993, p. 1-75 ; article 2, paragraphe 1, a), de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1-68 : « les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».
22 CJUE, ord., 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a. / ECHA, aff. C-287/13 P, ECLI:EU:C:2014:599, pt. 33 ; CJUE, ord., 4 septembre 2014, Rütgers Germany e.a. / ECHA, aff. C-288//13, ECLI:EU:C:2014:2176, pt. 39.
23 Trib. UE, 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a. / ECHA, aff. T-93/10, ECLI:EU:T:2013:106, pt. 83 ; Trib. UE, Trib. UE, 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a. / ECHA, aff. T-94/10, ECLI:EU:T:2013:107, pt. 105.
24 P. de Menten, Dictionnaire de chimie. Une approche étymologique et historique, Bruxelles, De Boeck, 2013, s.v. « substance chimique », p. 280.
25 Ibid., s.v. « produit », p. 249.
26 Article 3, paragraphe 2, du règlement REACH, préc. note n° 11 et article 2, paragraphe 1, a), du règlement (CE) n° 1223/2009, préc. note n° 13.
27 Article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, préc. note n° 14.
28 Article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, JO L 4 du 7.1.2019, p. 43-167.
29 Deux règlements sectoriels définissent le terme « résidu » : Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1107/2009, préc. note n° 14 : « une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d’origine animale, l’eau potable ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction » ; Article 3, paragraphe 1, h), du règlement (UE) n° 528/2012, préc. note n° 12 : « une substance présente dans un ou sur des produits d’origine végétale ou animale, dans les ressources en eau, dans l’eau potable, dans les denrées alimentaires, dans les denrées alimentaires pour animaux ou ailleurs dans l’environnement, qui résulte de l’utilisation d’un produit biocide, y compris les métabolites et les produits de dégradation ou de réaction d’une telle substance ».
D’autres directives sectorielles et documents préparatoires ne font qu’évoquer le terme, comme « résidus pharmaceutiques » : Considérant 6 de la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 348 du 31.12.2010, p. 74-99 ; Considérant 15 de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau, JO L 226 du 24.8.2013, p. 1-17 ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement, COM(2019) 128 final, du 11.3.2019.
30 Article 3, paragraphe 15, du règlement REACH, préc. note n° 11.
31 Conclusions de l’avocate générale Mme Eleonor Sharpston, présentées le 6 juillet 2017, PPG et SNF / ECHA, préc. note n° 15, pt. 57 : « Le raisonnement repose sur le syllogisme suivant : tous les intermédiaires sont des utilisations de substances, mais seules certaines utilisations de substances sont intermédiaires ; par conséquent, une substance peut avoir des utilisations aussi bien intermédiaires que non intermédiaires ».
32 CJUE, 1er mars 2012, Söll, aff. C-420/10, ECLI:EU:C:2012:111 (produits biocides) ; CJUE, 19 juin 2014, Bayer CropScience, aff. C-11/13, ECLI:EU:C:2014:2010 (produits phytopharmaceutiques) ; CJUE, 15 janvier 2015, Forsgren, aff. C-631/13, ECLI:EU:C:2015:13, (médicaments) ; CJUE, 1er octobre 2019, Blaise e.a., aff. C-616/17, ECLI:EU:C:2019:800 (produits phytopharmaceutiques) ; CJUE, 19 décembre 2019, Darie, aff. C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140 (produits biocides) ; CJUE, 14 octobre 2021, Biofa, aff. C-29/20, ECLI:EU:C:2021:843 (produits biocides).
33 CJUE, 29 juillet 2019, EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland, aff. C-359/18, ECLI:EU:C:2019:639, pt. 37 : « […] les termes “médicament” et “substance active” couvrent deux notions distinctes, définies à l’article 1er de la directive 2001/83. La substance active est un composant d’un médicament, elle ne saurait être confondue avec le médicament lui-même. »
34 Article 3, paragraphe 1, c), du règlement (UE) n° 528/2012, préc. note n° 12 : « une substance ou un micro-organisme qui exerce une action sur ou contre les organismes nuisibles » ; CJUE, 15 janvier 2015, Forsgren, aff. 631/13, préc. note n° 31, pt. 24 : « la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011 (JO L 174, p. 74), a modifié l’article 1er de la directive 2001/83 en ce sens que la notion de « substance active » – laquelle doit être entendue au sens de « principe actif » (arrêt Massachusetts Institute of Technology, EU:C:2006:291, point 21) – y est définie comme étant « toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’utilisé pour sa production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, [de] corriger ou [de] modifier des fonctions physiologiques, ou d’établir un diagnostic médical » ; CJUE, 1er octobre 2019, Blaise e.a., aff. C-616/17, préc. note n° 31, pts. 53 et 54 : « l’article 3 de ce règlement, qui a pour objet de définir un certain nombre de notions aux fins de celui-ci, ne comprend pas de définition du terme « substance active » […] il ressort de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 que les substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, doivent être considérées comme étant des substances actives, au sens de ce règlement ». Voy. les conclusions de l’avocate générale Mme Julianne Kokott, présentées le 17 octobre 2019, Darie, aff. C-592/18, ECLI:EU:C:2019:880, pt. 22.
35 La fragmentation du droit renvoie à la situation dans laquelle plusieurs normes et institutions se chevauchent pour un même problème donné. La défragmentation du droit renvoie aux moyens de mise en cohérence des régimes fragmentés pour plus d’efficacité. Voy. M. A. Young, « Introduction : the productive friction between regimes », in M. A. Young (dir.), Regime interaction in international law: facing fragmentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 1-4 ; S. Maljean-Dubois, D. Pesche, « Introduction générale : Circulations de normes et réseaux d’acteurs. La gouvernance internationale de l’environnement entre fragmentation et défragmentation », in S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des droits [En ligne], Aix-en-Provence, 2017.
36 Voy. par exemple : Trib. UE, 21 février 2024, PAN Europe / Commission, aff. T-536/22, ECLI:EU:T:2024:98 ; V. Delcroix, « Pesticides », RJE, 49(2), 2024, p. 507-508.
37 Les régimes relatifs aux aliments, aux pesticides et aux médicaments ont également été adoptés sur un fondement de santé publique ; les régimes relatifs aux aliments et aux pesticides ont de surcroît été adoptés sur le fondement de la politique agricole commune.
38 Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, Document A/CN.4/L.682 et Add.1, 13 avril 2006.
39 Voy. à cet égard : V. Michel, Recherches sur les compétences de la communauté, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 238-248.
40 Voy. par exemple : CJUE, 13 octobre 2022, M2Beauté Cosmetics, aff. C-616/20, ECLI:EU:C:2022:781 ; CJCE, 5 juin 2005, HLH Warenvertriebs GmbH et Orthica BV, aff. jtes C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, ECLI:EU:C:2005:370 ; Europe août-sept. 2005, n° 289, note A. Bouveresse, « Relation entre denrée alimentaire et médicament ».
41 Voy. par exemple : CJCE, 29 avril 2004, Commission / Allemagne, aff. C-387/99, ECLI:EU:C:2004:235 ; CJCE, 29 avril 2004, Commission / Autriche, aff. C-150/00, ECLI:EU:C:2004:237 ; Europe juin 2004, n° 199, note D. Simon, « Les compléments alimentaires vitaminés sont-ils des médicaments ? » ; CJCE, 15 novembre 2007, Commission / Allemagne, aff. C-319/05, ECLI:EU:C:2007:678 ; Europe janv. 2008, n° 11, note E. Bernard, « Relation entre denrée alimentaire et médicament ».
42 CJCE, 16 avril 1991, Upjohn / Farzoo, aff. C-112/89, ECLI:EU:C:1991:147, pts. 30-32 : « Si, en conséquence, il n’est pas exclu que, dans les cas douteux, la définition du produit cosmétique soit rapprochée de celle du médicament avant qu’un produit soit qualifié de médicament par fonction, il n’en demeure pas moins qu’un produit qui présente le caractère d’un médicament ou d’une spécialité pharmaceutique n’entre pas dans le champ d’application de la directive 76/768 et est soumis aux seules dispositions de la directive 65/65, précitée, et de celles qui l’ont modifiée. Cette conclusion est, d’ailleurs, la seule qui soit conforme à l’objectif de protection de la santé publique que poursuivent l’une et l’autre directives, dès lors que le régime juridique des spécialités pharmaceutiques est plus rigoureux que celui des produits cosmétiques, compte tenu des dangers particuliers que peuvent présenter celles-ci pour la santé publique et que ne présentent généralement pas les produits cosmétiques. Dans ces conditions, alors même qu’il entrerait dans la définition de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768, un produit doit, cependant, être tenu pour un “médicament” et être soumis au régime correspondant s’il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies, ou s’il est destiné à être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. »
43 Voy. par exemple : GROW.A.5, Guidance Document on the demarcation between the cosmetic products directive 76/768 and the medicinal products directive 2001/83 as agreed between the Commission services and the competent authorities of Member States, 04.10.2005, p. 1-2 et 9-10.
44 M. A. Young, « Introduction: the productive friction between regimes », in M. A. Young (dir.), Regime interaction in international law: facing fragmentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 7.
45 Article 3, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 528/2012, préc. note n° 12 : un produit biocide est « destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles » ; Article 2, paragraphe 1, a), du règlement (CE) n° 1223/2009, préc. note n° 13 : un produit cosmétique est « destiné à être mis en contact » avec certaines parties du corps humain « en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles » ; Article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE, préc. note n° 16 et CJCE, 16 avril 1991, Upjohn / Farzoo, aff. C-112/89, ECLI:EU:C:1991:147, pt. 15 : un médicament est défini de deux manières : selon un critère de présentation, la substance ou composition « possède des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines » ou selon un critère fonctionnel, lorsqu’elle est « administrée à l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l’homme » ; Article 2, paragraphe 1, a), b), c), d), et e), du règlement (CE) n° 1107/2009, préc. note n° 14 : un pesticide est destiné à « protéger les végétaux contre les organismes nuisibles », à « exercer une action sur les processus vitaux des végétaux », à « assurer la conservation des produits végétaux », à « détruire les végétaux » ou encore à « freiner ou prévenir la croissance indésirable des végétaux ».
46 CJCE, 10 mai 2001, BASF, aff. C-258/99, ECLI:EU:C:2001:261.
47 TPICE, 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health / Conseil, aff. T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209, pt. 147 (alimentation des animaux – transfert de résistance aux antibiotiques de l’animal à l’homme) ; TPICE, 11 septembre 2002, Alpharma / Conseil, aff. T-70/99, ECLI:EU:T:2002:210, pt. 160 (alimentation des animaux – transfert de résistance aux antibiotiques de l’animal à l’homme) ; Trib. UE, 9 septembre 2011, France / Commission, aff. T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444, pt. 76 (encéphalopathies spongiformes transmissibles) ; Trib. UE, 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a. / Commission, aff. T-475/07, ECLI:EU:T:2011:445, pt. 147 (produits phytopharmaceutiques) ; Trib. UE, 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a. / Commission, aff. T-31/07, ECLI:EU:T:2013:167, pt. 144 (produits phytopharmaceutiques) ; Trib. UE, 17 mai 2018, Bayer CropScience / Commission, aff. T-429/13, ECLI:EU:T:2018:280, pt.121 (produits phytopharmaceutiques) ; Trib. UE, 17 mai 2018, BASF Agro e.a. / Commission, aff. T-584/13, ECLI:EU:T:2018:279, pt. 70 (produits phytopharmaceutiques) ; Trib. UE, 20 septembre 2019, PlasticsEurope / ECHA, aff. T-636/17, ECLI:EU:T:2019:639, pt. 97 (produits chimiques) ; Trib. UE, 17 mars 2021, FMC / Commission, aff. T-719/17, ECLI:EU:T:2021:143, pt. 74 (produits phytopharmaceutiques).
48 Considérant 2 de la directive 2001/83/CE, préc. note n° 16 ; Article 1 du règlement (CE) n° 1223/2009, préc. note n° 13.
49 Article 1, paragraphe 1, du règlement REACH, préc. note n° 11.
50 Article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, préc. note n° 14 ; Article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, préc. note n° 12.
51 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Conclusions du bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH) et défis, lacunes et faiblesses recensées, COM(2019) 264 final, du 25.6.2019.
52 COM(2020) 667 final, préc. note n° 1.
53 La Commission, dans la stratégie, emploie différentes expressions : « évaluations de la sécurité chimique », « évaluations des risques » et « évaluations des dangers/risques ». Voy. COM(2020) 667 final, préc. note n° 1. Le Parlement s’est référé à l’approche « une substance – une évaluation du risque », puis en anglais à « one substance – one hazard assessment », qui prête à confusion puisque le terme « hazardous » est principalement employé dans la législation relative aux produits chimiques pour désigner en français les « dangers » d’une substance et non ses « risques ». Alors que l’évaluation des dangers d’une substance cherche à identifier les propriétés intrinsèques d’une substance, indépendamment de son utilisation, l’évaluation des risques détermine précisément quels sont les risques d’une substance pour une utilisation donnée. Voy. la résolution du Parlement européen sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques, P9_TA(2020)0201, du 10.7.2020, pt. 37 ; les conclusions de l’avocate générale Mme Juliane Kokott, présentées le 20 avril 2023, Global Silicones Council e.a. / ECHA, aff. C-559/21, ECLI:EU:C:2023:321, pt. 60. Le Conseil vise quant à lui les deux types d’évaluation. Voy. les conclusions du Conseil sur la stratégie de l’Union européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, du 15.3.2021, pt. 3.
54 COM(2020) 667 final, préc. note n° 1.
55 COM(2019) 264 final, préc. note n° 6.
56 COM(2019) 640 final, préc. note n° 2 ; COM(2020) 667 final, préc. note n° 1.
57 Proposition de règlement dit « omnibus » relative à la réattribution de tâches scientifiques et techniques et améliorant la coopération entre les agences, COM(2023) 783 final, préc. note n° 3.
58 À cet égard, la stratégie de 2020 a prévu l’élaboration d’une proposition législative en vue de renforcer la gouvernance de l’ECHA. Voy. notamment : Call for evidence on a proposal for a basic regulation of the European Chemicals Agency, Ref. Ares(2022)6299774, du 12.9.2022.
59 Le groupe d’expert « une substance, une évaluation » a identifié, dans un document adopté lors de sa 2e réunion, quatre principes directeurs pour la réattribution des tâches scientifiques et techniques : 1) un critère organique (la réattribution est faite au profit d’une agence ayant pour mission l’évaluation de la sécurité des substances) ; 2) un critère fonctionnel (la réattribution est faite en fonction de l’objectif principal des travaux des agences sur les produits chimiques, en prenant en compte l’utilisation de la substance dans les produits spécifiques, la voie d’exposition évaluée et le type de secteur couvert) ; 3) un critère de cohérence (la réattribution est faite au regard des activités effectuées par les agences, c’est-à-dire que de nouvelles missions d’évaluation sont attribuées au regard de l’existence de missions similaires) ; 4) un critère d’utilité (la réattribution doit procurer un avantage à l’Union, de sorte qu’il ne s’agit pas uniquement d’effectuer un transfert de responsabilité). Voy. Expert Working Group on One Substance, One Assessment (E03792), 2-3 June 2022, Guiding principles for (re-)attribution of scientific and technical work, Doc/05/AP.3.
60 Proposition de règlement relative à l’établissement d’une plateforme de données communes sur les produits chimiques, COM(2023) 779 final, préc. note n° 3 ; Agenda of the 4th meeting of the Expert Working Group on One Substance, One Assessment (E03792), 21-22 February 2024, Ref. Ares(2024)771638, du 1.2.2024 ; J. Oltmanns, M. Mecherey, M. Schwarz, Z. Manžuch, M. Hayleck, K. Heine, « Mapping of data requirements and assessment methodologies linked to the regulatory frameworks and remits of the relevant agencies (ECHA, EFSA, EMA) and EC scientific committees (SCCS and SCHEER). Final Report », EFSA supporting publication, 20(12), 2023.
61 COM(2019) 264 final, préc. note n° 6.
62 Article 139 de la proposition du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et établissant des règles régissant l’Agence européenne des médicaments, modifiant le règlement (CE) n° 1394/2007 et le règlement (UE) n° 536/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 726/2004, le règlement (CE) n° 141/2000 et le règlement (CE) n° 1901/2006, COM(2023) 193 final, du 26.4.2023 ; Article 1, paragraphe 2, de la proposition de règlement omnibus, COM(2023) 783 final, préc. note n° 3.
63 Voy. COM(2020) 667 final, préc. note n° 1 et considérant n° 1 de la proposition de directive, COM(2023) 781 final, préc. note n° 3.
64 Voy. sur la définition de « classification hiérarchisée » : J.-L. Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ. 1984, p. 265.
Valentine Delcroix, « Le concept de “substance” en droit de l’Union européenne de l’environnement et de la santé », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4177.