
Lucie Delabie
Professeur à l’Université de Picardie
Résumé : Cet article traite de la répartition des pouvoirs entre le président et le Congrès en cas de conflit armé impliquant les États-Unis. Loin d’avoir disparu avec la prohibition du recours à la force armée depuis 1945, ce sujet anime toujours les débats des praticiens et des théoriciens américains, notamment dans le contexte des guerres irrégulières contemporaines. La pratique institutionnelle révèle une prévalence du rôle présidentiel dans la conduite de la guerre (via les pouvoirs inhérents détenus par le président en tant que chef des armées). Certes, la War Power Resolution et le pouvoir budgétaire du Congrès assurent un rééquilibrage au profit du pouvoir congressionnel. Mais celui-ci reste d’autant plus fragile que les contrôles externes sur la conduite des hostilités sont parcellaires, qu’il s’agisse de celui exercé par le pouvoir judiciaire (Cour Suprême) ou par les instances internationales (Conseil de sécurité de l’ONU).
La Constitution américaine est le résultat de la guerre. Celle de l’indépendance menée par les colonies vis-à-vis du monarque britannique. Déjà en 1777, les Articles de la Confédération – première constitution au nouveau pays pour garantir une union perpétuelle entre les treize États fédérés – attribuent au Congrès le pouvoir exclusif sur la guerre et sur les affaires étrangères. Face à l’échec de la Confédération, un nouveau projet de constitution est adopté en septembre 1787, qui deviendra la Constitution des États-Unis, aujourd’hui encore en vigueur. La guerre y est aussi mentionnée, à quatre reprises, dont trois fois à propos des pouvoirs du Congrès1. Selon la section 8 de l’Article 1, ce dernier a notamment la compétence de « déclarer la guerre », de « lever et d’entretenir les armées » et d’entretenir une marine, et enfin « d’établir les règles pour le gouvernement et la régulation des forces terrestres et navales »2. Le Congrès est, semble-t-il, l’autorité première à exercer ses pouvoirs en la matière. Mais il n’est pas le seul. S’il n’est pas fait expressément référence au terme « guerre » concernant le pouvoir exécutif, les Pères fondateurs ont néanmoins inscrit dans la Constitution, à l’article II, section 2, que la fonction de commandant en chef de l’Armée et de la Marine des États-Unis revenait au président, qui dispose à ce titre de l’armée et possède l’initiative et la conduite des opérations militaires.
Le texte constitutionnel encadre ainsi les pouvoirs présidentiel et congressionnel en matière de guerre, leur fournissant, pour reprendre les termes de Louis Henkin, « un arsenal formidable » en la matière3. Reste à identifier comment se répartissent ces pouvoirs. C’est sans doute l’un des débats les plus anciens et les plus vivaces qui animent tant la doctrine constitutionnaliste et internationaliste américaine que les membres du Congrès et les représentants de l’Exécutif américain depuis le milieu du xxe siècle.
Une telle préoccupation peut sembler paradoxale alors même que la guerre, communément entendue au sens du droit international comme le recours à la force armée impliquant des hostilités étendues et un personnel militaire important entre deux États, est prohibée par la Charte des Nations Unies et ce, conformément à son article 2 § 44. De son côté, la Cour suprême des États-Unis a rapidement adopté une conception large de la guerre, estimant notamment que des hostilités qui s’inscrivent dans le cadre d’un « conflit externe armé entre certains membres de deux nations », bien que non déclaré comme « guerre », en est bien une5, ce qui permet d’inclure tout déploiement de forces armées américaines en territoire étranger, indépendamment de la durée de ce déploiement. Quoi qu’il en soit, le recours à la guerre étant exclu de la conduite des relations internationales, les rôles prévus par le texte constitutionnel ne devraient plus aucunement être distribués depuis 1945. De fait, le Congrès américain, excepté dans le cas de l’Irak en 1991 et en 20026, n’a plus jamais officiellement déclaré la guerre depuis la fin du second conflit mondial7. En principe, même le cas de « short of war », c’est-à-dire un recours à la force limitée qui n’engendrerait pas un état de guerre, est interdit8.
Mais limiter l’analyse de la guerre dans le système constitutionnel américain à cette seule affirmation reviendrait à ignorer la réalité des rapports internationaux. L’énoncé d’une règle d’interdiction de la guerre n’en fait pas pour autant disparaître l’existence ; l’actualité de l’agression de l’Ukraine par la Russie, quand bien même le mot guerre est volontairement évité par les autorités russes, en est l’exemple criant. D’ailleurs, les États-Unis, en s’appuyant sur le texte constitutionnel s’impliquent dans cette guerre qui ne dit pas son nom, comme dans d’autres depuis 1945. Car l’interdiction du recours à la force en droit international n’exclut pas l’existence d’intervention de forces armées à l’étranger, ce qu’ont fait les États-Unis à plusieurs reprises : en Corée, au Vietnam, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, au Panama…
Cette tendance a été renforcée par les guerres irrégulières et les conflits impliquant des acteurs non étatiques. La « guerre » menée contre le terrorisme depuis les années 2000 montre à quel point ce terme renvoie à des réalités très hétérogènes dans l’usage de la coercition. Alors qu’elle est interdite, la guerre est partout, en particulier dans le discours politique. Cet usage sémantique contraste d’ailleurs singulièrement avec les pratiques nationales qui ne mobilisent pas la déclaration de guerre dans leur sphère domestique. Pour autant, la ligne de démarcation entre la guerre et les autres usages de la force armée est floue, et l’usage de la force pour des objectifs de politique étrangère peut imperceptiblement devenir un engagement national dans la guerre9. La pratique américaine en la matière est la manifestation éclatante de la résurgence de la guerre et de l’émergence d’une forme de guerre permanente, en raison notamment de l’état de choc qu’ont constitué les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et cela, indépendamment des questions bipartisanes entre démocrates et républicains qui guident la politique américaine.
Certes, les récents présidents américains ont émis le souhait de mettre un terme aux guerres sans fin, en retirant notamment les dernières troupes américaines d’Afghanistan et en privilégiant le recours à une « diplomatie intelligente » plutôt qu’aux armes intelligentes10. De tels choix n’effacent toutefois pas les interrogations suscitées par la conduite de la guerre par les États-Unis, quelle qu’en soit la forme (notamment par des frappes ciblées), et ce à plusieurs niveaux. D’abord, au regard de la lettre mais aussi de l’esprit de la Constitution américaine, il reste de nombreuses zones grises quant à la répartition des rôles respectifs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans l’exercice des « war powers » prévus constitutionnellement. Tandis que cette question a pu être moins vive dans d’autres États11, elle reste outre-Atlantique, source des nombreuses interprétations du texte constitutionnel et de la pratique institutionnelle quant à la capacité d’action complémentaire entre le président et le Congrès dans la conduite de la guerre. Outre les difficultés liées à l’identification des autorités compétentes, se pose la question des limites dans lesquelles s’exercent les war powers du point de vue du système constitutionnel américain et de la conduite de la politique juridique extérieure des États-Unis. D’une manière générale, la pratique révèle la prévalence du rôle du président dans l’initiative de conduite des hostilités (I) en dépit d’une volonté ponctuelle du Congrès de reprendre la main (II) ; son action n’est pas hors de contrôle (III).
I. Entre la lettre et l’esprit : la prévalence du rôle présidentiel dans la conduite de la guerre
« The division of authority between the President and Congres is the most controversial an intractable issue in the Constitutional law of the US foreign relations »12. La remarque de Louis Henkin se vérifie au regard des débats qui ressurgissent presque systématiquement au sein de la doctrine dès qu’il s’agit de déployer des troupes américaines à l’étranger, de procéder à des frappes ciblées, de soutenir des alliés dans un conflit13. Tandis que les uns défendent le rôle central du Congrès, au regard du pouvoir de « déclarer » la guerre qui lui est octroyé par la Constitution14, les autres tiennent un discours « pro-exécutif » visant à soutenir le rôle premier du président en tant que commandant en chef de l’Armée15. La lecture combinée des dispositions constitutionnelles ne permet pas une réponse claire à la question du partage des pouvoirs entre les deux autorités (A). Selon certains observateurs, il en ressort plutôt la volonté d’instaurer un système flexible dans l’exercice de ces pouvoirs de guerre pour s’adapter aux réalités du monde moderne16, au sein duquel le président joue un rôle de premier plan (B).
A) La quête infructueuse des origines des pouvoirs de guerre respectifs du président et du Congrès
La doctrine est divisée sur l’intention des Pères fondateurs de la Constitution lors de la rédaction du texte. Au vu du contexte de rédaction, il semble qu’ils aient souhaité octroyer au président un rôle d’exécutant, une fois que le Congrès avait usé de son pouvoir exclusif de déclarer la guerre17. À l’époque en effet, compte tenu de l’importance octroyée au pouvoir de déclarer la guerre alors que celle-ci était un mode de règlement des différends licite entre États, il paraissait inenvisageable de le laisser au Sénat ou au président18. Ce dernier aurait plutôt vocation à exercer un rôle purement opérationnel, celui de conduire la guerre. Telle est l’hypothèse en tout cas défendue par les partisans qualifiés de « pro-congrès »19, qui trouvent un appui dans les propos d’Alexander Hamilton qui, bien que favorable à des pouvoirs présidentiels larges, dépréciait l’importance de la clause de commandement en chef de l’armée20. Les propos tenus par Abraham Lincoln renforcent cette hypothèse : « le texte de la Constitution donnant le pouvoir de guerre au Congrès était dicté, comme je l’ai compris, par l’impératif suivant : les rois ont toujours entraîné leurs peuples dans des guerres qui les ont appauvris, tout en prétendant généralement qu’elles étaient faites pour leur bien. Notre convention a compris qu’il s’agissait là de l’une des plus grandes formes d’oppression, et a fait en sorte qu’il ne fût pas dans le pouvoir d’un seul homme d’opprimer ainsi tous les autres »21. Face au risque de dérives du pouvoir présidentiel, les Fondateurs auraient donc voulu le restreindre, en matière de guerre, à un rôle opérationnel. Et l’octroi du pouvoir de déclarer la guerre au Congrès peut dans cette perspective être compris comme la volonté d’assurer un contrôle par celui-ci du pouvoir présidentiel.
Cependant, tous les interprètes du texte constitutionnel n’en font pas cette lecture. Selon John C. Yoo, par exemple, Alexander Hamilton, dans les positions qu’il défend concernant la constitution de Virginie, insiste moins sur le pouvoir du Congrès de financer la guerre que sur celui de la déclarer. Pour l’auteur, il ressort par ailleurs des propos de James Madison que les débats entre fédéralistes et antifédéralistes portaient plus sur les pouvoirs de guerre qu’à proprement parler sur l’autorité détentrice du pouvoir de déclencher la guerre22. En tout état de cause le Congrès aurait le pouvoir de « déclarer » la guerre, pas celui d’« autoriser » les hostilités23. Il est intéressant de souligner à cet égard que la formulation retenue dans le texte constitutionnel – le pouvoir du Congrès de « déclarer » la guerre24 – est différente de celle qui avait été retenue dans les articles de la Confédération et selon lesquels il était prévu que le Congrès « fait la guerre ». Cette différence terminologique serait le reflet d’une volonté de limiter les pouvoirs du Congrès lors de l’adoption de la Constitution de 1787.
Cette querelle interprétative de la loi fondamentale n’est pas résolue et sans doute ne le sera-t-elle jamais. C’est donc vers la pratique institutionnelle qu’il faut se tourner afin de mieux saisir comment se manifeste le partage des pouvoirs de guerre entre le président et le Congrès.
B) La pratique institutionnelle (living constitution) : le déséquilibre au profit du président
En pratique, bon nombre d’engagements militaires américains à l’étranger n’ont pas été pris sur la base d’une autorisation du Congrès, qu’il s’agisse des guerres indiennes du xixe siècle, des interventions en Corée, au Vietnam, à Cuba, dans les Balkans (Bosnie-Herzégovine en 1995, Serbie en 1999), en Somalie, en Syrie, en Libye, au Pakistan, en Irak. Dans ces situations, c’est le président des États-Unis qui, en vertu de sa fonction de Commander in chief, a pris l’initiative et conduit les opérations militaires (1). Le pouvoir exclusif qu’il détient en matière de politique étrangère renforce son autorité (2).
1) Les pouvoirs inhérents liés à la fonction de commandant en chef des armées
En vertu de l’article II de la Constitution, « le président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis »25. En outre, il « veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis »26. C’est sur ce dernier fondement que le président peut prendre des executive orders et donner des directives aux administrations fédérales pour garantir l’exécution fidèle de la loi27. La théorie des pouvoirs implicites du président a permis d’interpréter largement ces dispositions constitutionnelles et d’asseoir le pouvoir exclusif du chef de l’exécutif 28. La Cour suprême a depuis longtemps reconnu ces pouvoirs implicites dans l’affaire In re Neagle en 189029, après avoir estimé, quarante ans plus tôt, que le président ne disposait que de pouvoirs militaires30.
Depuis lors, les pouvoirs d’exception du président sont fréquemment invoqués en cas de situation urgente en réponse à une attaque contre les États-Unis. Dans une telle situation, celui-ci a le devoir d’utiliser tous les moyens pour repousser l’invasion, y compris en envoyant des forces armées à l’étranger. Ce pouvoir a été admis très tôt par la Cour suprême : « If a war be made by invasion of a foreign nation, the president is not only authorized but bound to resist force by force »31. En tant que tel, ce fondement ne fait pas débat aux États-Unis32. C’est aussi sur le fondement de ces pouvoirs que plusieurs présidents américains ont élaboré des directives de commandement à l’intention des forces armées alors même que le texte constitutionnel prévoit l’établissement de « règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre et de mer »33. La Cour suprême, dès 1842 reconnaît ce pouvoir au président34. Ainsi Lincoln promulgua-t-il par exemple en 1863 les règles de la Commission Lieber35 en tant que commandant en chef de l’Armée. C’est également ce qui a permis de justifier les opérations militaires menées à l’étranger sans nécessiter l’obtention d’une déclaration de guerre de la part du Congrès sans même attendre une ratification de celui-ci autorisant l’envoi de forces armées. Tandis que Lincoln agissait dans l’attente de ratification du Congrès, d’autres présidents ont revendiqué ces pouvoirs indépendamment de toute sollicitation parlementaire.
À l’argument de commandement en chef s’ajoute souvent celui d’une résolution adoptée par l’organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales qu’est le Conseil de sécurité. Harry Truman décidera par exemple de l’intervention en Corée sur la seule base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies36. Plus récemment Barak Obama a agi en Libye sur ce seul fondement au nom de la stabilité au Moyen-Orient37. Lorsqu’une telle résolution ne peut fonder une intervention, le pouvoir exécutif a aussi pu s’appuyer sur le droit de légitime défense, prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Les arguments d’intervention humanitaire ou de protection des ressortissants américains ont également pu être avancés pour justifier certaines interventions sans demander l’autorisation du Congrès, à l’image de l’intervention à Grenade38. Au Panama, G. W. Bush a justifié l’action devant le Congrès à la fois sur le fondement de la légitime défense et sur la protection des Américains contre un danger imminent39. En pratique, les pouvoirs du président en matière de guerre se trouvent renforcés par le monopole que celui-ci détient dans la conduite de la politique étrangère.
2) Des prérogatives renforcées par le monopole de la conduite de la politique étrangère
Les pouvoirs du président sont confortés par le pouvoir exclusif qu’il détient dans la conduite de la politique étrangère américaine, reconnu par la Cour suprême en 1936 dans l’affaire United States v. Curtiss-Wright Exports et selon laquelle il est le « seul organe du gouvernement fédéral dans le champ des relations internationales »40. La frontière entre la conduite de la politique étrangère et la conduite des hostilités est ténue et l’on ne peut comprendre le pouvoir militaire du président qu’en relation avec ses fonctions dans la conduite de la diplomatie américaine qui peuvent le conduire à des initiatives unilatérales en matière internationale, que cela relève de l’économie, à l’image des décisions prises par Nixon eu égard au système de Bretton Woods en 1971 ; de l’environnement, avec le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sous la présidence de Donald Trump ; ou bien encore du recours à la force, comme l’illustre l’engagement de troupes en Irak par G. W. Bush ou les décisions de procéder à des frappes ciblées sur le territoire d’États étrangers au nom de la lutte contre le terrorisme, ce qui constitue une pratique commune à plusieurs présidents américains41. Aussi le pouvoir exclusif du président en matière de politique étrangère vient-il conforter les initiatives qu’il peut prendre quant à des interventions armées, qui, si elles ne sont pas formellement qualifiées d’actions de guerre, mobilisent les forces armées des États-Unis, à l’image du Vietnam42. Ce pouvoir lui permet d’exercer un contrôle entier et exclusif sur la conduite même de la guerre, durant laquelle il a aussi le pouvoir de négocier et de ratifier des accords d’armistice mettant fin aux hostilités, de conclure des accords portant non seulement sur la conduite de la guerre mais aussi sur les dispositions postconflit sur le plan territorial et politique43.
Il faut bien le reconnaître, le Congrès n’a pas toujours opéré une forte résistance aux initiatives du président, que les interventions soient de longue ou de courte durée et ce, même si en principe une guerre, même courte, suppose un accord du Congrès, au moins a posteriori44. Force est de constater que dans la plupart des guerres dans lesquelles les États-Unis ont été impliqués, le Congrès a délégué par avance des pouvoirs quasi illimités au président ou a accepté de ratifier a posteriori son action45. Si les parlementaires ont, à diverses occasions, fait valoir le pouvoir qui était le leur d’autoriser le recours à la force armée, ils ont plus souvent opté pour la voie du compromis avec les autorités exécutives. Cette tendance est caractéristique de la séparation des pouvoirs telle qu’elle est appréhendée outre-Atlantique. Le phénomène guerrier n’y échappe pas.
II. Les hésitations du Congrès, entre reconquête du pouvoir de guerre et recherche du consensus
Deux autorités, une dualité, qui s’est manifestée tout particulièrement après le conflit du Vietnam46. Tandis que le Congrès cesse d’être conciliant, le président a revendiqué plus d’autonomie dans la conduite des hostilités. Jusqu’aux années 1970, les incertitudes quant à l’interprétation du texte constitutionnel avaient permis au chef de l’exécutif d’exercer un rôle prédominant dans la conduite des hostilités tandis que le Congrès n’avait que très rarement usé de son pouvoir de « déclarer » la guerre. À partir de 1973, ce dernier tenta de réagir en adoptant la War Powers Resolution47 (1) sans que cela ne suffise en pratique à limiter les actions présidentielles en matière militaire face aux nouvelles formes que prennent les conflits contemporains (2). Reste au Congrès le pouvoir budgétaire (3) qui lui permet d’exercer un certain contrepoids face au pouvoir présidentiel.
A) Une reconquête partielle du pouvoir congressionnel par l’adoption de la War Powers Resolution
Après l’épisode du Vietnam et la propension du président à prendre des initiatives indépendamment de l’accord du Congrès, les parlementaires américains ont souhaité contenir les pouvoirs de l’exécutif48 par l’adoption de la War Powers Resolution, désormais codifiée au chapitre 33 du Titre 50 de l’US Code49. Par ce texte, le Congrès réaffirme sa compétence constitutionnelle dans le domaine militaire, en prenant le contre-pied complet des prétentions de l’Exécutif forgées depuis de nombreuses années. L’objectif est de clarifier cette zone grise existant dans le partage des pouvoirs prévus par le texte constitutionnel50.
La résolution prévoit trois hypothèses dans lesquelles le président peut engager les forces des États-Unis au combat : l’exigence d’une autorisation a priori du Congrès par une déclaration de guerre, une autorisation législative spécifique, ou une compétence déléguée au président en cas d’urgence nationale consécutive à une attaque contre les États-Unis, ses possessions, ses territoires ou ses forces armées. Dans ce dernier cas, au-delà de 60 jours, en cas d’absence d’autorisation parlementaire, le président doit mettre fin à l’engagement des troupes. Tandis que Nixon annonce, le 30 avril 1970, le déploiement de troupes contre des positions communistes présumées au Cambodge comme un prolongement des actions menées au Vietnam51, il émet son veto à la résolution adoptée par le Congrès52, suscitant un débat sur le point de savoir si, pour une déclaration de guerre, le veto législatif est possible53. Le veto sera finalement dépassé et la résolution validée mais sa légalité reste largement discutée.
En pratique, les conditions posées par cette résolution ont donné lieu à des interprétations variées de la part du pouvoir exécutif qui ne s’y est pas toujours conformé. Son caractère obligatoire n’a par ailleurs jamais été pleinement reconnu par les présidents américains54, dont certains ont même mis en cause la constitutionnalité55. Les tensions entre le président et le Congrès se sont également manifestées lors de la justification des frappes de représailles contre les armes chimiques utilisées par le régime syrien de Bachard Al Assad en avril 2018. Le président Obama avait alors agi sur le fondement de son pouvoir de commandement en chef56 sans qu’une notification ou autorisation du Congrès n’ait été initiée. En 2020, Donald Trump posait quant à lui son veto à une résolution du Congrès, fondée sur la War Powers Resolution, visant à limiter les actions du pouvoir exécutif en Iran57 après une frappe ciblée ayant tué le général Soleimani en Irak58. D’autres présidents ont sollicité le Congrès sur la base d’une autorisation sans nécessairement en respecter les limites posées, à l’image de l’intervention américaine en Irak en 2003 pour laquelle George W. Bush a cherché à obtenir l’autorisation du Congrès59.
Si cette War Powers Resolution visait à clarifier la répartition des pouvoirs législatif et exécutif, elle n’y parvient pas tout à fait en raison de l’absence de précisions quant au seuil à partir duquel une notification ou une autorisation du Congrès s’impose au président. La détermination de ce seuil dépend de l’interprétation donnée au terme « hostilités », auquel renvoie la résolution sans en définir le sens60. Le pouvoir exécutif l’a interprété comme des échanges actifs de feu entre les États-Unis et les forces ennemies61. Ce faisant, l’on observe que pour les principales interventions américaines menées, d’une durée assez longue, le Congrès a quasi systématiquement procédé à des autorisations. Ce fut le cas pour le Vietnam62, la guerre du Golfe, l’Afghanistan, l’Irak en 200363. Mais en cas d’opérations plus brèves, comme au Panama64, en Somalie, en Haïti, en Libye, en Syrie, au Kosovo65, en Irak en 199866, le Congrès n’a pas été sollicité67. L’argumentaire du pouvoir exécutif dans le cas libyen illustre bien le seuil retenu, celui selon lequel les opérations militaires ne sont pas suffisamment étendues par leur nature, leur champ d’application et leur durée pour constituer une « guerre » requérant une autorisation du Congrès en vertu de la clause de déclaration de guerre68. Le critère déterminant est donc celui de l’envergure des interventions. Aux frappes ponctuelles de courte durée, en cas d’urgence, le pouvoir exceptionnel revient au président au titre de commander in chief. Pour des interventions plus longues, le Congrès a son mot à dire et il procède alors par voie d’autorisation. La distinction entre des hostilités ponctuelles et une action offensive n’en demeure pas moins subtile69, tout comme l’est la définition de ce que constitue une attaque soudaine des États-Unis, de leur territoire ou de leurs forces armées, mentionnées par la résolution70.
En 1973, l’objet premier de la résolution était de s’assurer que le Congrès, à défaut de « déclarer » la guerre, soit tenu informé des initiatives prises en la matière par l’Exécutif, par voie de consultation et de notification au Congrès71. De ce point de vue, le pari est en partie gagné puisqu’en pratique, la plupart des présidents américains, s’ils ne demandent pas formellement une autorisation d’agir, informent le Congrès de l’emploi des forces armées. Toutefois, en octroyant ce pouvoir de déclencher des opérations de courte durée, la résolution de 1973 est aussi venue élargir un peu plus les prérogatives présidentielles, a fortiori dans un contexte de guerre permanente contre le terrorisme, qui légitime la multiplication d’interventions de courte durée, parfois qualifiées de « guerres irrégulières »72.
B) Une réappropriation congressionnelle contrastée face aux nouvelles formes de guerre
L’état de guerre permanent suscité par la lutte contre le terrorisme a fait de la compétence d’exception du président en tant que commandant en chef une compétence de droit commun que le Congrès a, dans une certaine mesure, validé par la voie des Authorization for Use of Military Force (AUFM).
Cet élargissement des pouvoirs de commandement par la voie législative fait suite au choc suscité par les attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché le territoire américain. Face à cette situation d’exception, le Congrès autorise, par l’adoption d’une résolution le 18 septembre 200173, l’utilisation de la force nécessaire et appropriée contre toute nation, organisation ou toute personne qui aurait permis ou favorisé lesdites attaques ainsi que pour prévenir tout nouvel acte terroriste. Conformément à la War Powers Resolution, ici explicitement rappelée74, ce texte législatif vaut autorisation du Congrès pour le déclenchement d’interventions qui seraient initiées par le président au nom de la guerre contre les terroristes. Elle sera utilisée comme fondement à l’intervention de George W. Bush en Afghanistan en 2001. Une résolution quasi identique sera adoptée le 10 octobre 2002 par le Congrès à propos de la situation en Irak75, autorisant la guerre préventive menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre cet État en 2003. Bien que son contenu encadre plus strictement les pouvoirs du président que l’AUMF de 2001, en renvoyant notamment à une action conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies76 et en exigeant un rapport régulier au Congrès77, son interprétation et son usage extensif ont conforté les pouvoirs du président des États-Unis en matière militaire.
De facto, en octroyant au président les pouvoirs nécessaires pour lutter contre l’État islamique, le seuil de soixante jours prévu par la War Powers Resolution de 197378 et la nécessité d’une autorisation formelle du Congrès ont été écartés. Sur ces bases textuelles, plusieurs présidents ont, dans la pratique récente, successivement déclenché des opérations en se réclamant de deux fondements juridiques : les pouvoirs inhérents du président comme commander in chief et les AUMF de 2001 et 2002. C’est ainsi qu’ont notamment été justifiées les frappes en Syrie79 et au Yémen80 sous les présidences de Barak Obama et de Donald Trump. Ce qui est qualifié de « frappes ciblées » ou d’« exécutions extrajudiciaires ciblées » menées par les États-Unis est ainsi couvert par un « double parapluie constitutionnel » que constitue le statut de commandant en chef de l’Armée du président et l’autorisation du Congrès. Par ailleurs, la difficulté à qualifier juridiquement les entités terroristes, notamment à considérer certains groupes comme « associés » ou non à de telles entités, garantit une marge de manœuvre supplémentaire au président81.
La permanence de cet état de guerre suscitée par la lutte contre le terrorisme conduit à une forme de permanence des pouvoirs exceptionnels du président en tant que commandant en chef. Les critiques à l’encontre de l’usage extensif de ces résolutions ont pu être vives et les présidents Obama82 et Biden ont eux-mêmes reconnu qu’une nouvelle AUMF devrait être adoptée notamment pour lutter contre l’État islamique. L’embarras présidentiel est d’ailleurs manifeste au regard des arguments avancés pour justifier ces frappes. Alors que Barak Obama s’appuyait à la fois sur son statut de commandant en chef et sur l’AUMF pour éviter un conflit ouvert avec le Congrès83, Joe Biden, lorsqu’il justifie en 2021 des frappes ciblées en Syrie contre les installations de milices iraniennes soutenues par l’Iran en réponse à des attaques contre les intérêts américains en Irak, ne fait référence qu’au fondement de commandement en chef de l’Armée et à celui de légitime défense prévu par la Charte des Nations Unies. Cet unique fondement sur le plan du droit interne américain est lié au fait que l’administration Biden entend réformer l’AUMF84. Sur un plan politique, mieux valait donc ne pas se fonder sur ces actes pour justifier les exécutions ciblées. Toutefois, en mars 2023, alors que la réforme des AUMF reste en suspens, le président Biden a réitéré l’autorisation de mener des frappes dans l’est de la Syrie face aux attaques permanentes et aux fins de prévention d’attaques futures, en s’appuyant cette fois sur son statut constitutionnel de commander in chief et sur l’AUMF85.
Ces quelques illustrations révèlent parfaitement les ambivalences liées à l’usage des pouvoirs de guerre dans la pratique institutionnelle américaine. Si l’on observe une prépondérance des pouvoirs du président, il existe une tendance commune des représentants du pouvoir exécutif à chercher un soutien bipartisan aux actions menées. Barak Obama en faisait explicitement état alors qu’il validait les frappes au Yémen en 2014 : « My administration has also secured bipartisan support for this approach here at home. I have the authority to address the threat from ISIL, but I believe we are strongest as a nation when the President and Congress work together. So I welcome congressional support for this effort in order to show the world that Americans are united in confronting this danger »86. Le président Biden s’inscrit dans la même optique, comme l’indique sa lettre au Congrès en mars 2023 : « I am providing this report as part of my efforts to keep the Congress fully informed, consistent with the War Powers Resolution (Public Law 93-148) »87. Les rapports réguliers envoyés au Congrès à titre informatif dénotent cette volonté de conciliation88 et la recherche d’un consensus entre les autorités exécutives et législatives. Par ailleurs, même si la balance penche en faveur du président, il reste au Congrès la possibilité de maintenir une surveillance au travers des pouvoirs budgétaires qui lui sont pleinement reconnus par le texte constitutionnel, y compris en matière militaire.
C) Le pouvoir budgétaire du Congrès, un relatif contrepoids aux actions de l’exécutif en matière militaire
Afin de manifester sa capacité de contrôle sur le pouvoir présidentiel, le Congrès a pu, dans l’histoire, user de ses prérogatives budgétaires. Disposant d’un pouvoir exclusif en la matière, il est en mesure de contrôler les affectations de crédits (appropriate funds)89, y compris en matière militaire. Il a en outre le pouvoir « de lever et d’entretenir des armées, sous réserve qu’aucune affectation de crédits à cette fin ne s’étende sur plus de deux ans » ; et « de créer et d’entretenir une marine de guerre »90.
C’est à ce titre que le Congrès entend se prononcer sur les conditions de déploiement de troupes à l’étranger, à l’image des soldats envoyés sur le continent européen dans le cadre des actions de l’OTAN. Cette question a suscité de nombreux débats aux États-Unis dans les années 1950. Tandis que pour le Congrès, ce déploiement et son financement relevaient de son autorité au titre du pouvoir de déclarer la guerre, le président estimait que l’action de déploiement était précisément menée pour ne pas faire la guerre et non pour planifier une intervention armée. À l’époque, le Congrès n’imposa finalement aucune limitation formelle au déploiement mais il adopta une résolution pour valider la répartition en Europe en la conditionnant à la consultation par le président du Comité des affaires étrangères du Sénat et en exigeant son accord à la politique d’affectation et d’envoi de nouvelles troupes à l’étranger91. Le débat est réapparu à la faveur de l’agression de l’Ukraine par la Russie en février 2022 au vu de l’annonce par le président Biden du déploiement de troupes notamment en Pologne, en République tchèque, en Grèce, en Bulgarie, en Lituanie et en Roumanie92.
Les parlementaires américains ont également usé de cette menace de blocage budgétaire lors de certaines actions extérieures menées par les États-Unis. Par exemple, alors que la résolution Tonkin avait donné carte blanche au pouvoir exécutif, l’extension du conflit au Cambodge et au Laos les a conduits à adopter un amendement93 exigeant qu’il soit mis fin aux hostilités. À défaut de toute action présidentielle en ce sens, le Congrès a usé de son pouvoir budgétaire pour limiter le déploiement de troupes dans ces deux États94. Il en a été de même lorsque les États-Unis ont soutenu les contras au Nicaragua95 ou quand ont été déployées des troupes en Somalie en 199396.
Cette arme budgétaire n’est toutefois pas sans limites et ce power of the purse s’avère quelque peu « erratique et imprévisible »97. Il peut notamment être surmonté par l’usage du veto présidentiel, ce qui fut le cas lors du soutien américain aux forces contras au Nicaragua. Bill Clinton menaça également d’en faire usage au moment de l’intervention au Kosovo dans les années 199098. Barak Obama a souhaité faire évoluer les choses à son arrivée, sans réel succès99. Le rôle budgétaire du Congrès est par ailleurs limité par le fait que les fonds sont versés au département de la Défense et que le président dispose d’une certaine liberté dans la réallocation des ressources. Enfin, le président peut demander le vote de crédits supplémentaires en cas d’urgence. C’est sur cette base que l’on a assisté à une augmentation exponentielle du budget de la défense en Irak et en Afghanistan, au point de parler d’une normalisation de l’urgence100. Le cas de l’aide financière à l’Ukraine est un autre exemple de ce pouvoir via l’adoption Supplemental Appropriation Act en 2022101. Le budget de la défense voté en 2023 augmente quant à lui de 10 %, incluant également une aide pour l’Ukraine102.
C’est finalement le compromis qui est le plus souvent recherché pour éviter le blocage complet qui ne permettrait pas la conduite des hostilités. On assiste ainsi à un jeu d’équilibre subtil entre soutien et contrôle du Congrès dans l’action conduite par le président. La prévalence des pouvoirs présidentiels trouve ses limites dans le contrepoids que peuvent exercer les parlementaires. Mais, sauf cas exceptionnel, la conduite des hostilités par le président se trouve assurée par un soutien, plus ou moins large du Congrès.
Néanmoins, la conduite de la guerre, même constitutionnellement garantie, n’exclut pas le respect par les autorités américaines d’obligations de nature constitutionnelle ou internationale dans l’exercice de leurs pouvoirs. Pour ce faire, un contrôle externe aux branches législatives et exécutives peut être exercé, même s’il reste parcellaire.
III. Des contrôles externes parcellaires de la conduite des hostilités par les autorités politiques américaines
Indépendamment du point de savoir qui exerce les pouvoirs de guerre, la conduite des hostilités implique la préservation d’un certain nombre de droits reconnus constitutionnellement et conventionnellement. En toute logique, une forme de contrôle devrait pouvoir s’opérer vis-à-vis de l’exercice des pouvoirs de guerre, tant du point de vue du droit interne américain que du droit international. À cet égard, force est de constater que le troisième pouvoir que représente le juge judiciaire, en particulier la Cour suprême, n’a qu’un rôle restreint dans ce contrôle (A). Quant au droit international, même si celui-ci est reconnu, d’un point de vue constitutionnel, « part of the law of the land » et pose un cadre strict d’utilisation licite de la force, sa capacité effective à encadrer l’exercice des pouvoirs de guerre est limitée (B).
A) Le droit de regard du pouvoir judiciaire sur les actes et sur les actions menées
Tandis que la Cour suprême n’a pas définitivement tranché la question de la répartition des pouvoirs de guerre entre autorités législatives et exécutives (1), elle s’est déclarée compétente pour contrôler les effets de l’exercice de ces pouvoirs sur le respect de droits constitutionnellement garantis (2).
1) Le silence judiciaire autour de l’interprétation des pouvoirs de guerre
Hormis quelques décisions précitées au cours du xixe siècle venant préciser les rôles respectifs du président et du Congrès en matière de politique étrangère, la Cour suprême n’a pas eu l’occasion de se prononcer plus avant sur les pouvoirs de guerre, ce qui explique en partie la persistance des questionnements précédemment examinés103.
Quelques affaires récentes devant les juridictions américaines pourraient néanmoins ouvrir la voie à un contrôle de la Cour suprême pour des affaires impliquant l’application des AUMF. Tel est notamment le cas de l’affaire Nathan Smith, un capitaine du corps des Marines déployé dans une opération contre l’État islamique en Syrie104. En mai 2016, ce dernier invoqua devant la U.S. District Court for the District of Columbia que ce déploiement était contraire au pouvoir du Congrès de déclarer ou d’autoriser la guerre, l’opération n’étant pas fondée sur l’AUMF de 2001105. Le 21 novembre 2016, la District Court usa néanmoins de deux motifs pour rejeter la demande106 : le premier tenait au défaut d’intérêt à agir de l’officier, le second à l’invocation de la célèbre doctrine de la Political Question pour déclarer la Cour incompétente. Sur ce second point, cette doctrine est la résultante de la séparation des pouvoirs et certains domaines sont confiés par la Constitution aux branches politiques du gouvernement. Ce faisant, la Cour suprême estime ne pouvoir y intervenir qu’avec prudence, ce qu’elle a indiqué dès 1962 dans l’arrêt Baker v. Carr107. Les affaires étrangères et les questions militaires font naturellement partie de ces domaines et cette doctrine est logiquement souvent invoquée lorsque sont en cause les war powers devant les juridictions américaines108. Dans le cas Nathan Smith, la District Court adopte d’ailleurs cette approche, rappelant que le domaine des affaires militaires est confié aux branches politiques du gouvernement.
L’application de cette doctrine doit toutefois être lue en lien avec le principe, lui aussi reconnu par la Cour suprême, selon lequel, une juridiction ne saurait se déclarer incompétente lorsqu’est en jeu l’interprétation d’un texte législatif. Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’affaire Zivotofsky v. Clinton en 2012109 alors qu’était en jeu, là aussi, une political question. En l’espèce, il s’agissait du refus du Département d’État d’inscrire sur le passeport d’un ressortissant américain son lieu de naissance qui était Israël, estimant que le Foreign Relations Authorization Act for 2003 invoqué à l’appui de la requête était inconstitutionnel. La Cour suprême a rappelé que les juridictions ont pour mission de dire le droit et qu’à ce titre elles sont chargées d’interpréter le texte législatif invoqué à l’appui de la requête contre une décision de l’exécutif110. Même si dans l’affaire Nathan Smith, la frilosité des juges de première instance n’a pas permis de se prononcer sur les war powers, les positions précitées de la Cour suprême et l’usage du prétoire pour contester les AUMF témoignent de ce qu’il n’y a pas d’obstacle de fond à ce qu’un jour une juridiction américaine puisse se prononcer sur la controverse liée à la répartition de ces pouvoirs, via une interprétation plus souple de la political question doctrine. Mais pour l’heure, ce sont plutôt les conséquences de la guerre qui ont donné lieu à un contrôle juridictionnel, au titre du writ of habeas corpus.
2) L’exercice d’un contrôle judiciaire des effets des pouvoirs de guerre sur le respect des droits fondamentaux
La guerre contre le terrorisme initiée par les États-Unis au début des années 2000 a conduit à la mise en place d’instances d’exception permettant notamment d’emprisonner les individus qualifiés de terroristes par le seul jugement d’une commission militaire et non par la voie d’un tribunal. La création de ces commissions est précisément fondée sur les pouvoirs de guerre du président qui, en tant que commandant en chef de l’Armée, a adopté en 2001 un décret présidentiel autorisant le jugement des détenus de Guantánamo par cette voie. Elle est justifiée par le refus d’octroyer aux détenus capturés en Afghanistan le statut de prisonnier de guerre. Ces derniers, qualifiés de combattants irréguliers, ne pourraient, selon l’exécutif, bénéficier des droits attachés à ce statut. L’usage de ces pouvoirs de guerre au détriment des droits fondamentaux a suscité de vives réactions111 et a conduit à des recours juridictionnels devant les juridictions américaines. La Cour suprême s’est prononcée sur cette question en 2004, dans l’affaire Rasul c. USA112, lui donnant l’occasion de préciser que l’état de guerre n’est pas un chèque en blanc pour le président des États-Unis. Dans cette affaire, les demandeurs étaient deux Britanniques et deux Australiens. La Cour suprême a décidé que les juridictions ordinaires étaient compétentes pour entendre les requêtes en habeas corpus113 faites par ces détenus de Guantánamo. En outre, elle a décidé que leur statut d’étranger n’empêchait pas ces dernières d’exercer leur compétence sur des requêtes relatives aux conditions de détention. Cela vaut également pour les citoyens américains, comme l’indique la Cour la même année dans l’affaire Hamdi v. Rumsfeld114. La majorité des juges à la Cour suprême115 a décidé que la détention indéfinie de Hamdi n’était pas autorisée et a rejeté l’argument des autorités américaines selon lequel un combattant ennemi n’avait pas droit de contester son statut. Selon les juges, un citoyen américain déclaré comme combattant ennemi doit avoir « a fair opportunity to rebut the government’s factual assertions before a neutral decisionmaker ». Par cette série de décisions, la Cour suprême entend exercer un contrôle de l’action présidentielle prise au nom de la guerre et permet aux prisonniers, qu’ils soient ou non ressortissants américains, à exercer un recours devant une instance juridictionnelle américaine. Les autorités politiques américaines ont toutefois essayé de contourner ces décisions. À peine un an après ces affaires, fut en effet adopté le Detainee Treatment Act116 interdisant les traitements inhumains et dégradants tout en excluant un possible recours en habeas corpus. Un nouveau recours permit toutefois à la Cour suprême de se prononcer sur ce texte législatif et d’invalider les tribunaux d’exceptions institués par celui-ci117. C’était sans compter sur un nouveau texte législatif, adopté en 2006, le Military Commissions Act qui remettait une nouvelle fois en cause la possibilité pour les combattants illégaux de faire un recours en habeas corpus118. Ce texte sera finalement révisé en 2010 sous la présidence de Barak Obama119, mettant fin au bras de fer initié entre les autorités politiques américaines et le pouvoir judiciaire sur cette question.
Cet épisode illustre toutefois bien quelles peuvent être les répercussions de l’exercice du pouvoir de guerre par le président sur la séparation des pouvoirs instaurée par la Constitution américaine. Elle met en lumière l’importance du contrôle exercé par la Cour suprême quant aux effets de ces pouvoirs en particulier sur la protection des droits individuels, eux aussi reconnus par le texte constitutionnel. Ces situations témoignent de l’équilibre délicat entre les trois pouvoirs face aux enjeux de la guerre sous toutes ses formes. Dans cet équilibre, se pose aussi la question du rôle joué par le droit international.
B) La mobilisation du droit international et ses limites
La pratique révèle que, dans l’exercice des pouvoirs de guerre constitutionnellement reconnus, le droit international constitue une opportunité de justifier les actions menées par l’Exécutif à l’étranger (1). Mais l’usage qui en est ainsi fait pose toutefois un certain nombre de questions quant à la licéité internationale des interventions américaines (2).
1) Le droit international, une base juridique pour agir, conformément à la Constitution
Le droit international est fréquemment invoqué par les autorités américaines comme fondement à des interventions armées à l’étranger, en complément de celui de commandement en chef du président ou d’une autorisation du Congrès. Selon les circonstances, ce sont tantôt des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre de la sécurité collective, tantôt l’argument de la légitime défense qui sont avancés120.
Ce recours au droit international est justifié par la Constitution américaine elle-même, dont l’article VI (2) dispose : « [t]his Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in pursuance thereof ; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land ; and the judges in every state shall be bound thereby, any thing in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding ». D’après cette clause dite de suprématie fédérale, les traités internationaux et les lois fédérales ont donc une valeur identique et sont tous deux supérieurs aux lois des États fédérés. Ainsi, pour qu’un traité revête une force obligatoire en droit interne, il n’est d’autre condition que celle d’avoir été conclu et ratifié selon les formes prescrites par la Constitution, notamment par l’article II section 2, alinéa 2. Aucun acte d’incorporation n’est nécessaire pour lui conférer son applicabilité comme l’exigeraient les systèmes dualistes. La Cour suprême, dans plusieurs affaires, a précisé ces aspects. Très vite, celle-ci a reconnu, par la doctrine de l’incorporation, que le droit international faisait partie du droit des États-Unis d’Amérique. La décision du Chief Justice Marshall dans l’affaire du Paquete Habana en est la meilleure illustration121. Dès lors que les États-Unis sont partis à la Charte des Nations Unies et membres de l’ONU, leurs engagements conventionnels s’imposent donc en droit interne.
Il s’agit aussi et surtout d’un moyen pour le président des États-Unis de justifier son action auprès du Congrès sans nécessairement demander son autorisation. À cet égard les frappes ciblées sont un très bon exemple de cette forme d’instrumentalisation du droit international pour justifier auprès des représentants du peuple américain le recours à la force armée de manière ponctuelle, en complément du fondement de commandant en chef de l’Armée122. On notera que la mobilisation du droit international coutumier (jus in bello et jus ad bellum) est peu usitée dans les justifications américaines, ce qui s’explique par la place limitée de celui-ci dans l’ordre juridique interne123.
On décèle ici une forme d’instrumentalisation du droit international dans le discours américain, qui ne peut se comprendre qu’au regard de la relation complexe entre droit international et droit constitutionnel qui peuvent conduire à une forme de « dilution » du droit international dans le droit interne. Le fréquent recours au « foreign relations law » pour qualifier les normes applicables aux relations extérieures l’illustre très bien. En tant que branche du système juridique américain, ce droit « is, as its roots, Constitutional law. How the United States conducts diplomacy ; makes international agreements, follows or fails to follow those agreements, and exerts its miltary and economic power are questions governed in the first instance by the U.S. constitution. […] The war against terrorism, […] make this timeless question all the more acute and immediate »124. Si les normes internationales peuvent être utilisées en soutien aux actions prises au nom de pouvoirs constitutionnels que sont les war powers, il est plus douteux qu’elles puissent constituer une limite effective à de telles actions.
2) Le droit international comme limite à l’exercice des war powers ?
Du point de vue du droit international, l’un des questionnements majeurs face aux actions américaines à l’étranger concerne l’usage qui est fait de l’argument de légitime défense, prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies. L’action du président des États-Unis en cas d’attaques ciblées est de manière presque systématique fondée sur cette disposition, comme en février 2021, à l’occasion d’une attaque contre un groupe iranien sur le territoire syrien125. Néanmoins cette justification est basée sur une interprétation large de la légitime défense avec l’idée que l’État territorial (en l’espèce la Syrie) n’avait « ni les moyens ni l’intention » de se défendre. Ce qui est devenu une doctrine dite de l’« uncapable or unwilling power », et présentée comme issue d’une observation neutre du droit international, ne reflète toutefois pas le droit positif. Apparue après l’intervention anglo-américaine en Irak126, elle est pourtant fréquemment utilisée par les autorités américaines pour justifier des frappes ciblées contre des acteurs non étatiques au nom de la légitime défense127. Des exécutions ciblées fondées sur cette doctrine et sur l’action en légitime défense ont notamment été défendues par Harold H. Koh lorsqu’il était conseiller juridique de B. Obama, notamment au nom de l’imminence de la menace que constitue le terrorisme128. Il n’en demeure pas moins que, sur le plan du droit positif, cela pose deux difficultés : celle d’une légitime défense qui pourrait être exercée contre un acteur non étatique et celle d’une légitime défense exercée à titre préventif. Sur le premier élément, rien dans la Charte des Nations Unies n’indique que l’action en légitime défense puisse être exercée lorsque l’agression armée provient d’une entité non étatique. Au contraire, l’interprétation de l’article 51 permet d’affirmer que cette disposition, lue à la lumière de la résolution de l’Assemblée générale de 1974 définissant l’agression129, est applicable en cas d’agression armée d’un État par un autre État. Afin de justifier une intervention sur la base de la légitime défense, il conviendrait donc de justifier que l’agression, bien que réalisée par une entité privée, est attribuable à l’État qui se serait engagé de manière substantielle dans une telle action, comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice à plusieurs reprises130. Mais une simple inaction d’un État à lutter contre le terrorisme sur son territoire ne permet pas à un autre État d’agir sur ledit territoire131. Quant au deuxième élément, l’argument de la légitime défense préventive132, qu’il soit fondé sur une menace diffuse d’agression ou sur une agression imminente, la pratique internationale ne permet pas d’affirmer que cette règle relève du droit international coutumier133. Cette appréhension de la légitime défense à titre préventif n’est pas nouvelle aux États-Unis et constitue un cadre intellectuel de la réflexion sur la sécurité collective au sein de la doctrine depuis de nombreuses années134. La logique de guerre contre le terrorisme a amplifié cette tendance135. En 2015, lors de la présentation de la National security strategy par Barak Obama celui-ci indiquait par exemple, pour justifier le recours aux exécutions extrajudiciaires : « when there is a continuing, imminent threat, and when capture or other actions to disrupt the threat, we will not hesitate to take decisive action »136. Mais rien, en droit international positif, ne permet d’attester l’existence d’un droit de légitime défense préventive. Les États membres de la communauté internationale ont d’ailleurs des points de vue divergents sur ces actions ciblées : certains appuyant les États-Unis, d’autres les critiquant137.
Les interventions américaines fondées sur le droit de légitime défense sont donc discutables quant à leur licéité au regard des engagements internationaux américains. Compte tenu du caractère décentralisé de l’ordre juridique international, et de l’absence de contrôle juridictionnel systématique, la portée pratique de cette limite que pourrait constituer le droit du recours à la force face aux actions américaines en matière de guerre est néanmoins limitée. Il faut donc de nouveau se tourner vers l’ordre juridique américain pour identifier une éventuelle limitation de ce pouvoir au nom du respect du droit international. On relèvera à cet égard que les autorités parlementaires et juridictionnelles américaines peuvent exercer un droit de regard dans la mesure où, comme indiqué précédemment, la Constitution prévoit que le droit international conventionnel est partie intégrante du droit des États-Unis. On observera d’ailleurs que la licéité de certaines interventions américaines, notamment l’assassinat du général iranien Kassem Soleimani sur le territoire Irakien, a suscité de vifs débats au Congrès, certains membres faisant part de leur volonté d’adopter une législation encadrant le pouvoir présidentiel en la matière138. Mais le fait que les autorités exécutives prennent soin de justifier de manière quasi systématique leurs actions sur la base non seulement du droit international mais aussi des pouvoirs de commandant en chef des armées, voire même sur une AUMF139, vient grandement limiter l’étendue d’une telle surveillance. Certes, certains auteurs expriment l’idée que les pouvoirs constitutionnels du président en tant que commandant en chef des armées seraient implicitement contraints par le droit international140. Mais la pratique a montré que ce n’était pas toujours le cas. De son côté, le Congrès n’a jamais imposé, par voie même de la War Powers Resolution, que soit respecté du droit international141. On rappellera que dans les autorisations fournies par le Congrès, il a pu préciser que les actions menées devaient l’être en conformité avec le droit de la Charte des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité142 sans que pour autant que cela puisse conduire un contrôle judiciaire du respect du droit international. Certains membres de la Chambre des représentants ont déposé en 2011 un recours contre la décision du président Obama de faire participer les forces américaines aux frappes contre le régime libyen. Mais la US District court for the district of Columbia a rejeté le recours faute d’intérêt à agir143. En pratique, s’il peut ponctuellement servir à contenir le pouvoir d’action des autorités américaines en temps de guerre, on ne peut que constater que le droit international est plus souvent mobilisé comme un fondement complémentaire à l’action des États-Unis à l’étranger sans nécessairement constituer un cadre strict aux interventions menées.
Aux États-Unis, les liens entre la guerre et la Constitution font débat depuis de longues décennies. Les imprécisions du texte constitutionnel quant aux pouvoirs de guerre respectifs du président et du Congrès en la matière ainsi que les spécificités de la séparation des pouvoirs outre-Atlantique expliquent en partie ce phénomène. À cela s’ajoutent les débats bipartisans qui peuvent venir abonder telle ou telle interprétation du texte fondamental à la faveur de l’une ou de l’autre de ces institutions. Mais au-delà du texte, la pratique institutionnelle révèle que les actions armées, quelle que soit leur forme – frappes ciblées, interventions des forces armées à l’étranger – sont systématiquement initiées par le président sous le regard critique des parlementaires. Force est néanmoins de constater qu’en matière de contrôle, la sécurité nationale et les intérêts essentiels de l’État qui sous-tendent les questions liées à la conduite de la guerre limitent significativement la capacité des parlementaires, du juge interne, comme des instances internationales à encadrer les initiatives du chef de l’exécutif.
1 Article I. section 10. 3. « Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre État ou une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu’il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai ». Art III. Section 3. « Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans l’acte de faire la guerre contre eux… »
2 L. Henkin, Foreign affairs and the US Constitution, 2nd edition, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 75-76.
3 L. Henkin, ibid., p. 75.
4 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, p. 595.
5 Bas v. Tingy, 4 U.S. 37 (1800).
6 Authorization for use of military force against Iraq resolution of 2002, Pub.L.No. 107-243, 116 Stat. 1498 (Oct. 16, 2002). « Congress authorizes war in the Gulf: 5 vote margin in Senate, 67 in House », New York Times, 13 janvier 1991.
7 J. C. Yoo, « War and the Constitution text », The University of Chicago Law Review, vol. 69, 2002, p. 1663 », nbp 61 à propos du cas de l’Irak, M. D. Young, « L’Amérique s’en va en guerre : chronologie des développements internes aux États-Unis durant la crise du Golfe, août 1990-janvier 1991 », Études internationales, vol. 23, 1992, n° 3, p. 549-579.
8 O. Corten, Le droit contre la guerre, 3e édition, Paris, Pedone, 2020, p. 10.
9 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 101.
10 Hurlburt « Inside Joe Biden’s brain », Foreign policy, 2021, vol. 50, n° 1, p. 35-40. M. Perry, « This is not a drill », Foreign policy, 2021, vol. 50, n° 2, p. 36-39.
11 L’on pense ici au cas de la France. L’unique référence à la guerre se trouve à l’article 35 et concerne l’autorisation de la déclaration de guerre par le Parlement, sans que ne soit abordée la question de la conduite des hostilités. Il semble que les débats aient été moins vifs sur ce thème que ceux existants aux États-Unis, même si des réflexions ont été menées au point de prévoir une révision constitutionnelle en 2008, prévoyant une obligation d’information du Parlement lorsque le pouvoir exécutif engageait les forces françaises à l’étranger dans un délai de trois jours après le début de l’intervention et, si l’intervention dépasse 4 mois, une autorisation du Parlement pour la prolongation de l’intervention. Le texte ainsi modifié s’apparente à la pratique américaine telle qu’elle ressort du texte constitutionnel et de la War Powers Resolution adoptée par le Congrès en 1973, v. supra. Sur le cas de la France, v. notamment C. Landais, P. Ferran, « La Constitution et la guerre. La guerre est-elle une affaire constitutionnelle ? », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Dossier : La Constitution et la défense nationale, avril 2016, n° 51, p. 29-35. V. également dans le présent dossier la contribution de M. Bonnet.
12 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 97. L. Klein, « Les War Powers en droit constitutionnel américain : état des lieux et perspectives », Jus politicum, décembre 2019, p. 259.
13 Par exemple, lorsque Donald Trump décide en 2017 d’intervenir en Syrie pour frapper une base de l’armée de l’air syrienne. B. Ackerman, « Trump must get congress’s. O.K. », The New York Times, april 7, 2017. T. Fleury Graff, « Guerres américaines et pouvoirs du Congrès fédéral : Trump et Obama, même(s) combat(s) », Jus Politicum, blog, 15 juin 2017. Sur les débats d’une manière générale, C. A. Bradley, International law in the U.S. legal system, 3rd edition, 2021, p. 298-299.
14 Parmi eux, l’on peut citer Louis Henkin, Harold h. Koh, Michael Glennon.
15 Rappelé par John C. Yoo, op. cit., note 7, p. 1640. V. également Michael D. Ramsey, « Textualism and war powers », Chicago law review, 2002, vol. 69, p. 1543.
16 J. C. Yoo, op. cit., note 7, p. 1643.
17 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 4 ; Propos du sénateur Brock Adams in « War powers and the responsibility of congress », ASIL proceedings, 1988, vol. 82, p. 1-21.
18 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 75.
19 J. C. Yoo, op. cit., note 7, p. 1661.
20 L. Klein, op. cit., note 12, p. 278. Également L. Henkin, op. cit., note 2, p. 46.
21 Cité par David Gray Adler, « The Constitution and Presidential war-making: The Enduring Debate », Political Science Quarterly, vol. 103, n° 1, printemps 1988, p. 24.
22 J. C. Yoo, op. cit., note 7, p. 1660.
23 J. C. Yoo, ibid., p. 1641.
24 V. Asil Proceedings, « War powers and the responsibility of congress », op. cit., note 17, p. 6. Les articles de la Confédération prévoyaient « Congress shall make war », également Cameron O. Kistler, « The anti-federalists and Presidential war powers », Yale law journal, 2011, vol. 121, n° 2, p. 460.
25 Article II, section 2 de la Constitution.
26 Article II, section 3 de la Constitution.
27 S. Benzina, « Les executive orders du président des États-Unis comme outil alternatif de législation », Jus politicum, n° 21.
28 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 88.
29 In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890).
30 Fleming v. Page, 50 U.S. 603 (1850).
31 The prize cases, 67 US (2 black) 635, 668 (1862).
32 L. Henkin, op. cit., note 12, p. 278.
33 Article I, section 8 de la Constitution.
34 « The power of the executive to establish rules and regulations for the government of the army is undoubt », United States v. Eliason, 41 US. (16. Pet.) 291, 301 (1842).
35 Lieber, General Orders n° 100, in The War of The Rebellion: A Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies, ser. III ( ed. 1901).
36 Conseil de sécurité des Nations Unies, Plainte pour l’agression de la république de Corée, résolution n° 83, 27 juin 1950, qui « Recommande aux Membres de l’Organisation des Nations Unies d’apporter à la république de Corée toute l’aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette région la paix et la sécurité internationale ». Sur le pouvoir délégué par le Conseil de sécurité et la question de savoir s’il se substitue à l’autorisation du Congrès, C. A. Bradley, op. cit., note p. 308-310.
37 Memorandum opinion for the Attorney General, Office for legal Counsel, April 1st, 2011.
38 Propos du Sénateur Adams, Proceedings of the American Society of international law, op. cit., note 17, p. 4.
39 Report on the development concerning the deployment of the United States forces to Panama, House Doc. 01-127, 101st Cong., 2nd session, (1990). J. F. Murphy, The United States and the rule of law in international affairs, Cambridge, Cambridge university press, 2004, p. 147.
40 La question posée à la Cour était alors de savoir si le Congrès pouvait laisser à la discrétion du président une plus grande liberté d’action sur l’exercice de l’autorité législative dans les affaires internationales. United States v. Curtiss-Wright Exports, 299 U.S. 304, 319-320 (1936). Selon le juge Sutherland : « Il est bien évident que si dans la maintenance de nos relations internationales un embarras, voire un embarras sérieux, doit être évité et le succès de nos entreprises et de nos desseins doit être atteint, une législation du Congrès – qui doit être rendue efficace à travers des négociations et des investigations dans le domaine international – doit accorder au président un degré de liberté qui ne serait pas admissible s’il s’agissait uniquement de questions de politique intérieure ».
41 Infra.
42 Lors du conflit du Vietnam, B. Adams signale que l’on parlait d’« action », d’« incident », mais pas de « conflit substantiel » ou de « guerre », in ASIL Proceedings, op. cit., note 17, p. 3.
43 Yalta et Postdam en sont un exemple.
44 Notamment dans le cas de la quarantaine de Cuba, de Grenade, ou de la République dominicaine, L. Henkin, op. cit., note 2, p. 98-99.
45 Ibid., p. 47.
46 À l’époque, le Congrès avait adopté la Tonkin Gulf Resolution afin de justifier l’intervention. Tonkin Gulf Resolution, Public Law 88-408, 88th Congress, August 7, 1964, General Records of the United States Government, Record Group 11, National Archives. Puis le président Nixon a envoyé des troupes au Cambodge sous couvert de ce que se poursuivait la guerre du Vietnam, ce qui a suscité de fortes tensions avec les parlementaires, L. Henkin, op. cit., note 2, p. 96-97, p. 103.
47 War Powers Resolution, texte reproduit in A.J.I.L. 1974, n° 2.
48 L. Henkin, op. cit., note 2, p. 85, p. 106-107.
49 US Code, § 1541 à 1549. Selon le § 1541, c. « Presidential executive power as Commander-in-Chief ; limitation. The constitutional powers of the President as Commander-in-Chief to introduce United States Armed Forces into hostilities, or into situations where imminent involvement in hostilities is clearly indicated by the circumstances, are exercised only pursuant to (1) a declaration of war, (2) specific statutory authorization, or (3) a national emergency created by attack upon the United States, its territories or possessions, or its armed forces ».
50 Pour le sénateur Adams, op. cit., note 17, p. 3.
51 « Nous prenons cette action non pas dans le but d’étendre la guerre au Cambodge, mais dans le but de mettre fin à la guerre au Vietnam et de gagner la paix juste que nous désirons tous. Nous avons fait et nous continuerons à faire tous les efforts possibles pour mettre fin à cette guerre par la négociation à la table de conférence plutôt que par davantage de combats sur le champ de bataille… » [https://fr.alphahistory.com/La-guerre-du-Vietnam/troupes-de-déploiement-nixon-cambodge-1970/].
52 L. Henkin, op. cit., note 2, p 107.
53 Renvoi de la doctrine américaine à l’affaire Immigration and naturalization service v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). V. les débats in ASIL proceedings, op. cit., note 17, p. 3 et s.
54 John C. Yoo, op. cit., note 7, p. 1664.
55 Annexe, « War powers : origins and purposes » , Hearing before the subcommittee on arms control, international security and science of the committee on foreign affairs, H.R., 100th Congress, 2nd session, 1988.
56 [https://www.justice.gov/olc/opinion/file/1067551/download], p. 3-9.
57 Selon le texte de la résolution, il est demandé au président de mettre fin à l’utilisation des forces armées américaines pour les hostilités menées contre la République islamique d’Iran tant qu’il ne disposait pas d’une déclaration de guerre du Congrès ou d’une autorisation explicite de la part de celui-ci. S.J.Res.68 – A joint resolution to direct the removal of United States Armed Forces from hostilities against the Islamic Republic of Iran that have not been authorized by Congress, 116th Congress (2019‑2020).
58 Sur cette affaire, voir infra, III.
59 AUFM, 2002, op. cit., note 6, 1498. Bruce Ackerman, Oona Hathaway, « Limited War and the Constitution: Iraq and the Crisis of Presidential Legality », Michigan law review, 2011 vol. 109, n° 4, p. 458.
60 Op. cit., note 49.
61 Congressional research service, « Ukraine: US deployments to Europe might raise War Powers Resolution questions », Insight, 15 mars 2022.
62 Tonkin Gulf Resolution précitée, op. cit., note 46.
63 C. A. Bradley, op. cit., note 13, p. 300.
64 Op. cit. note 39.
65 Bill Clinton est intervenu au Kosovo sans consentement du Congrès sur base. Rappelé par B. Ackerman, O. Hathaway, op. cit., note 59, p. 458.
66 L’opération « Renard du désert » en Irak en 1998 a été déclenchée sans l’autorisation du Congrès, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies L’opération a été menée en décembre 1998 avec des frappes très intensives de courte durée (70 heures). Les autorités américaines se sont fondées sur les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation entre l’Irak et le Koweït, S/RES/1154 (1998) du 2 mars 1998 et S/RES/1205 (1998) du 5 novembre 1998. J. F. Murphy, op. cit., note 39, p. 152.
67 C. A. Bradley, op. cit., note 13, p. 300.
68 Memorandum for the Justice Department’s office of legal counsel, par Caroline KRASS, 1er avril 2011. Envoi au Congrès d’un report par l’administration Obama qui reprend le même argumentaire, et justifie l’action sur le fondement du commandement en chef.
69 Sénateur Adams, op. cit., note 17, p. 4.
70 Op. cit., note 49.
71 Notification sous 48 heures, tel que prévu à la section 4 de la Résolution.
72 À ce sujet, E. Tenenbaum, « Les États-Unis au défi des guerres irrégulières », Politique américaine, 2019/2 (n° 33), p. 89-112.
73 Authorization for use of military force, Public Law 107–40, Sept. 18, 2001, 107th Congress, section 2,a.
74 Section 2 b : « Consistent with section 8(a)(1) of the War Powers Resolution, the Congress declares that this section is intended to constitute specific statutory authorization within the meaning of section 5(b) of the War Powers Resolution ».
75 Authorization for use of military force against Iraq resolution of 2002, Public Law 107-243, oc. 16, 2002.
76 EC. 3. Authorization for use of United states armed forces. (a) authorization.—The President is authorized to use the Armed Forces of the United States as he determines to be necessary and appropriate in order to— (1) defend the national security of the United States against the continuing threat posed by Iraq ; and (2) enforce all relevant United Nations Security Council resolutions regarding Iraq.
77 Section 4. A.
78 C. A. Bradley, op. cit., note 13, p. 308.
79 Précité, L. Klein, op. cit., note 12, p. 262.
80 The White house, Statement by the President, sept. 2014.
81 À ce propos, remarques de Stephen Preston, membre du Département de la défense, « Policy address “ legal framework for the U.S. use of military force since 9/11” », A.S.I.L Proceedings, 2015, p. 334.
82 The White House, Letter From The President – War Powers Resolution, text of a letter from the President to the speaker of the house of representatives and the president pro tempore of the senate, June 13, 2016.
83 L. Klein, op. cit., note 12, p. 261.
84 K. E. Eichensehr (ed.), « Contemporary practice of the United States relating to international law », A.J.I.L, vol. 115, 2021/3, p. 567.
85 Letter to the Speaker of the House and President pro tempore of the Senate consistent with the War Powers Resolution (Public Law 93-148), 25 mars 2023.
86 The White house, Statement by the President, sept. 2014, op. cit., note 79.
87 Lettre du 25 mars 2023, op. cit., note 84.
88 S. Preston, op. cit., note 80, p. 334.
89 Constitution, Article I, section 9, clause 7 selon lequel « Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n’est en vertu d’affectations de crédits stipulées par la loi ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses de deniers publics seront publiés périodiquement. »
90 Constitution, Article I, section 8.
91 S.RES. 99 82d cong., 1st session 97 cong Rec ; 3282_3 ( 1951).
92 Congressional research service, op. cit., note 60.
93 Act of Jan. 12,1971, Pub. L. No. 91-672, 12, 84 Stat. 2053, 2055 (terminating the Gulf of Tonkin Resolution).
94 B. Ackerman, O. Hathaway, op. cit., note 59, p. 485-486.
95 Amendement Boland adopté par le Congrès. M. J. Glennon, Constitutional diplomacy, Princeton, Princeton University Press, 1991, p. 286.
96 B. Ackerman, O. Hathaway, op. cit., note 59, p. 490.
97 Ibid., p. 485.
98 Ibid., p. 488 et s.
99 M. B. Sheridan, S. Wilson, « More Funds Sought for Iraq and Afghanistan », Wash. Post, Apr. 10, 2009, A04. N. D. Kristof, « 1 Soldier or 20 Schools? », N.Y. Times, July 28, 2010. B. Ackerman, O. Hathaway, op. cit., note 59, p. 494.
100 B. Ackerman, O. Hathaway, op. cit., note 59, p. 491 et p. 493.
101 Cette loi autorise une aide globale de 40,1 Mds$, dont 19,1 Mds$ en assistance militaire et 5,1 Mds$ pour les activités des forces américaines et de renseignement. H.R.7691 – Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2022 117th Congress (2021-2022).
102 Congressional research service, U.S. security assistance to Ukraine, February 27, 2023.
103 Infra.
104 Opération décidée par Barak Obama qui violerait le serment que le capitaine aurait prêté à la Constitution. Le capitaine déposa un recours en 2016 devant la U.S. District Court for the District of Columbia
105 L. Klein, op. cit., note 12, p. 264.
106 Michael Smith v. Obama, 217 F. sup. 3d 283, 288 (D.D.C. 2016). L’affaire se terminera en appel pour caducité du fait du retour à la vie civile du requérant en cours d’instance. L. Klein, ibid.
107 Baker v. Carr 369 U.S. 186 (1962). Pour une traduction française des termes de l’arrêt, v. E. Zoller, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, p. 326. La Cour suprême y fixe des facteurs qui donnent au juge une certaine marge d’appréciation pour évaluer la justiciabilité de l’affaire. L’approche se fait au cas par cas. L. Klein, op. cit., note 12, p. 272-273.
108 L. Klein, ibid.
109 Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. 189 (2012).
110 La Cour rappelle que depuis l’arrêt Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803) l’interprétation des textes législatifs est une compétence judiciaire. Rappelant l’affaire INS v. Chadha, 462 U.S. 919, 943 (1983), elle souligne aussi que les juridictions ne peuvent se soustraire à leur responsabilité simplement « parce que les questions ont des implications politiques ». Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. 189, 196 (2012).
111 À propos des débats autour de ces commissions, v. l’agora « Military commissions », in A.J.I.L., vol. 96, 2002, p. 320-358.
112 Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004)
113 Dont la Constitution américaine prévoit, article I, section 9, 2. 2. Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité publique l’exige.
114 En l’espèce, le requérant, Yaser Esam Hamdi, citoyen américain, avait été capturé en Afghanistan et transféré à Guantánamo puis dans une base militaire en Virginie. En juin 2002, il engagea une action devant la District Court for the Eastern district of Virginia sur la base de la procédure d’habeas corpus pour violation du droit au procès équitable prévu dans le cinquième amendement de la Constitution américaine. Ses avocats invoquèrent également le respect du droit humanitaire et du statut de prisonnier de guerre. En première instance, la cour a rejeté sa demande. En appel, le 8 janvier 2003, la Court of Appeals for the fourth circuit a confirmé le jugement de première instance en se fondant sur l’affaire Ex Parte Quirin de la Cour suprême. Affaire Ex Parte Quirin v. Cox, Provost Marshal, 317 U.S. 1 (1942). Décision reproduite in I.L.M., vol. 42, 2003, p. 197-215.
115 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004).
116 Adopté en 2005, reproduit in 42 USC Ch. 21 D : Detainee treatment.
117 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006)
118 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008).
119 Sur cette révision, v. « Military commissions Act revised, pending military commissions proceedings », A.J.I.L., vol. 1054, 2010, p. 117 et s. Plus généralement sur ce bras de fer entre représentants du pouvoir législatif et représentants du pouvoir judiciaire, L. Delabie, Approches américaines du droit international, entre unité et diversité, Paris, Pedone, 2010, p. 393-395 et p. 411-413.
120 Supra, I. 2. i.
121 « International law is part of our law, and must be ascertained and administered by the courts of justice of appropriate jurisdiction, as often as question of right depending upon it are duly presented for their determination. For this purpose, where there is no treaty, and no controlling executive or legislative act or judicial decision, ressort must be had to the customs and usages of civilized nations ; and, as evidence of these, to the works of jurists and commentators, who by years of labor, research and experience, have made themselves peculiarly well acquainted with the subjects of which they treat. Such works are resorted to by the judicial tribunals, not for the speculations of their authors concerning what the law ought to be, but for the trustworthy evidence of what the las really is », The Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900).
122 Supra, II, 2.
123 C. A. Bradley, op. cit., note 13, p. 323 et s.
124 M. D. Ramsey, The constitution’s text in foreign affairs, Cambridge, Harvard University Press, 2007, p. 1.
125 À ce sujet, A.J.I.L. 2021-3. Contemporary practice of the US.
126 O. Corten, « À la paix comme à la guerre », Le droit international face aux exécutions extrajudiciaires ciblées, IHEI, Cours et travaux, Paris, Pedone, 2021, p. 73 et s.
127 D. Bethelehem, « Principles relevant to the scope of a State’s right to self defense against an imminent or actual armed attack by nonstate actors », A.J.I.L., 2012, p. 1-8.
128 H. H. Koh, « The Obama administration and international law, Keynote address at the Annual meeting of the American Society of international law, March 2010. O. Corten, « À la paix comme à la guerre », op. cit., note 124, p. 16-17.
129 Article 1 de la définition annexée à la Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1974 et généralement considérée comme le reflet du droit coutumier. L’Assemblée y définit l’agression armée comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ».
130 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (Nicaragua c. États-Unis), CIJ, Recueil 1986, P. 104, § 195. CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), CIJ, Recueil 2005, p. 222-223, § 146.
131 O. Corten, « À la paix comme à la guerre », op. cit., note 124, p. 76.
132 À ce sujet, voir par exemple la lettre des États-Unis au Conseil de sécurité au sujet de leur engagement en Syrie en 2014, S/2014/695, 23 septembre 2015 ; également lettre envoyée auprès du Conseil de sécurité en 2020 pour justifier l’action contre Qassem Soleimani, S/2020/20, 9 janvier 2020. Sur cette justification de légitime défense préventive, v. O. Corten, « À la paix comme à la guerre », op. cit., note 124, p. 81 et s.
133 CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), CIJ, Recueil 2005, p. 222-223, § 148.
134 Déjà envisagée lors de l’intervention à Grenade, OYNER (C. C.), « The United States action in Grenada. Reflections on the lawfulness of invasion », A.J.I.L., vol. 78, 1984, p. 131-132. Sur l’approche extensive de la légitime défense défendue par certains observateurs, v. O. Corten, « À la paix comme à la guerre », op. cit., note 8, p. 49 et s.
135 Argument de la légitime défense préventive débattue au sein de la doctrine internationaliste américaine lors de l’intervention des États-Unis en Iraq en 2003. V. par exemple, en soutien à cet argument, R. Wedgwood, « The fall of Saddam Hussein: Security council mandates and preemptive self- defense », AJ.I.L., vol. 97, 2003, p. 578. (Notre traduction). M. G. Glennon, « Self defence in an age of terrorism », A.S.I.L., Proceedings of the 97th annual meeting (April 2-5, 2003), p. 150 et s.
136 National security strategy, 2015, p. 9. Pratique étendue à la Somalie, v. « Contemporary practice of US », A.J.I.L., 2016, p. 588-592. V. également sur les pratiques précédentes, John R. Crook, « President Obama outlines shifts in U.S. counterterrorism policy », Contemporary practice of the United States relating to international law , A.J.I.L., 2013, n° 3, vol. 107, p. 674 et s. ; ou encore « United States’ Legal Justification for Drone Strike on Anwar al-Awlaki Released », A.J.I.L., 2014, vol. 108, p. 552-556.
137 O. Corten, « À la paix comme à la guerre », op. cit., note 124, p. 24 et s.
138 V. aussi le projet de résolution proposé par le Congrès après cette affaire. Op. cit. note 57.
139 Cette législation, adoptée par le Congrès en 2001, autorise le recours à la force armée contre tout responsable des attaques perpétrées à l’encontre des États-Unis le 11 septembre 2001.
140 D. Golove, « The supreme Court, the war on terror, and the American just war constitutional tradition », p. 561, in D. L. Sloss, M. D. Ramsey, W. S. Dodge (eds.), International law in the Supreme court: continuity and change, Cambridge, Cambridge university press, 2011. Sur ce point, C. A. Bradley, op. cit., note 13, p. 304.
141 C. A. Bradley, ibid.
142 AUMF concernant l’Irak précité.
143 Kucinich v. Obama, 821 F. sup. éd 110 (D.D.C. 2011).
Lucie Delabie, « La guerre dans la Constitution des États-Unis», Le retour de la guerre [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 12 | 2023, mis en ligne le 17 décembre 2023. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2456.
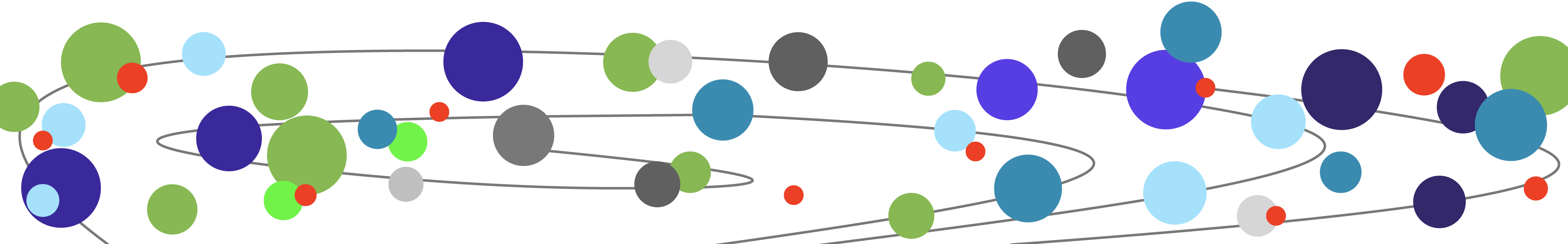




One thought on “Lucie Delabie – La guerre dans la Constitution des États-Unis”
Comments are closed.