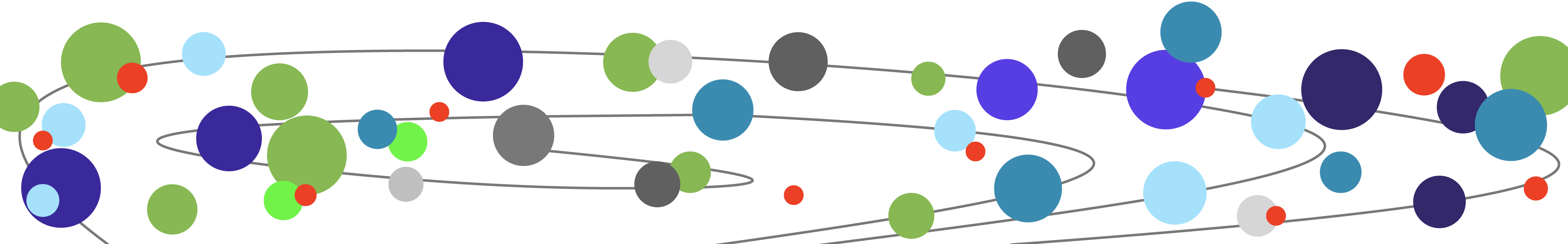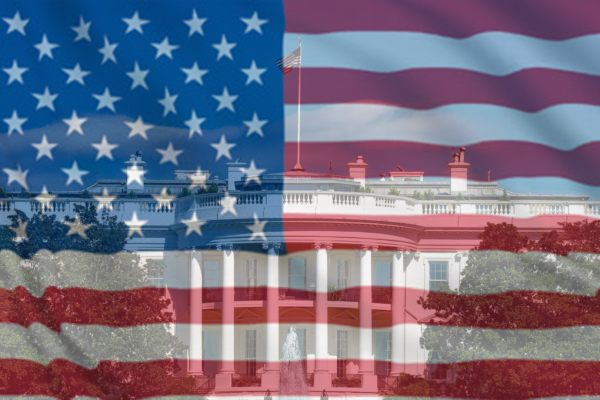Loïc Azoulai, Professeur à l’École de Droit de Sciences Po Paris


Ce fut longtemps une grave question que se savoir comment qualifier une organisation telle que la Communauté européenne. Comprendre l’Union européenne qui lui a succédé ne semble pas plus simple. À cette question, il semble que la Cour de justice de l’Union européenne a fini par apporter une réponse dans son avis 2/13 rendu le 18 décembre 2014. Rassemblant des formules connues en une synthèse inattendue, elle énonça que l’Union européenne est une structure constitutionnelle (compétences, pouvoirs et droits fondamentaux), un cadre institutionnel (cadre d’action collective, règne du droit, coopération loyale) et un droit autonome formant « un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux ». Le malheur est qu’au moment où cette synthèse nous était donnée, elle avait déjà perdu de son actualité. Si cette synthèse rend parfaitement compte des idées et des intentions présidant à la construction européenne, elle ne correspond plus à la situation à laquelle l’Union européenne est à présent confrontée. À présent, le réseau des interdépendances structurées par le droit de l’Union se heurte à la multiplication des manifestations de défiance mutuelle entre États membres. Les institutions de l’Union ont cessé de se mouvoir au-dessus des clivages politiques, des conflits sociaux et des antagonismes culturels. N’étant plus, et depuis longtemps, l’objet d’un « consensus permissif », le fonctionnement de la machine institutionnelle s’abîme chaque jour un peu plus dans l’extrême polarisation caractérisant l’état des sociétés européennes[1]. Voilà donc ce qu’il nous faut admettre : l’Europe et son droit, ayant réussi à surmonter les passions historiques du continent et de ses peuples – le nationalisme et la guerre –, sont plus que jamais en proie aux passions sociales – le dégoût des populations pour les institutions lointaines et le désir de séparation, séparation du local par rapport au global, de la société par rapport à l’État, de la nation par rapport à l’Europe et au monde mondialisé[2].
Les sociétés européennes connaissent un phénomène auquel la science politique a maintenant donné un nom : elles sont en proie à une « polarisation affective »[3]. Les clivages ne sont plus seulement d’ordre politique et idéologique ; ils touchent aux affects et aux représentations culturelles. Les individus et les groupes sociaux s’opposent non plus seulement en fonction d’idéologies politiques, blocs de pensées et d’idéaux collectifs formulés par les élites en direction de la masse des gouvernés, mais en fonction de la manière dont les groupes sociaux se rapportent à leurs conditions concrètes d’existence, en fonction de la manière dont chacun se représente son mode de vie, son « idéal de vie » [4]. L’enjeu des luttes sociales, il faut désormais le chercher dans des désaccords touchant tout aussi bien à la nature des attachements personnels qu’aux représentations de la vie sociale ou les préférences politiques. Ce pour quoi les individus et les groupes luttent relève de motifs mêlant habitudes, valeurs, croyances, identités, visions de la société et liens d’appartenance. À tel point qu’il en devient pratiquement impossible de distinguer, dans ces luttes, l’aspect idéel lié aux représentations et aux croyances de l’aspect matériel lié aux pratiques sociales et culturelles. Sur ce terrain mêlé se joue une grande part du débat public en Europe aujourd’hui. Sur ce terrain prolifèrent et conversent les réseaux sociaux. Quant aux mouvements sociaux, ils tendent à se cristalliser autour d’enjeux autant sociaux que culturels et existentiels : la défense de traditions et de modes de vie ancrés dans une communauté ou sur un territoire, la défense de pratiques sociales ou religieuses, la préservation de la planète et de ses formes de vie. À cette transformation de la conflictualité sociale correspond la montée en puissance d’un discours véhiculant l’idée qu’il existe des modes de vie « non négociables ».
Un mode de vie non négociable
Il est une formule qu’il nous est donné d’entendre presque chaque jour, dans la presse, sur les réseaux sociaux ou dans la rue : « notre mode de vie est notre bien le plus précieux ; il n’est pas négociable ». De tels mots avaient été prononcés par George W. Bush en 1992 au Sommet de Rio. Pressé d’agir en réponse aux premières alertes sur le changement climatique, il avait osé proclamer : « The American way of life is not up for negotiation. Period ». C’est le même langage que parle Viktor Orbán à Budapest le 15 mars 2018. La menace, il ne la voit pas dans le climat mais dans l’immigration : « Bruxelles veut diluer et remplacer le peuple de l’Europe ! Il se débarrasse de notre mode de vie, de notre culture et de tout ce qui se nous distingue en tant qu’Européens des autres nations du monde (…). L’Europe et la Hongrie sont au cœur d’une guerre des civilisations. Nous faisons face à une immigration qui déstabilise notre ordre et met en danger notre mode de vie. Si nous ne préservons pas notre mode de vie, tout perdra sens ». Pareil langage n’appartient plus uniquement aux idéologues de l’identité nationale. Il touche les conservateurs. Ainsi Theresa May en janvier 2017 à Lancaster House, en cheffe du Brexit : « Nos traditions politiques sont différentes… il en résulte que des institutions supranationales aussi fortes que celles créées par l’Union européenne cadrent mal avec notre histoire politique et notre mode de vie ». Ce langage résonne dans tous les combats actuels. Lors de son « discours d’indépendance » au Parlement catalan le 10 octobre 2017, Carles Puigdemont déclare : « Ces dernières années, nous avons observé un mépris blessant pour notre langage, notre culture et le mode de vie de notre pays ».
Cette manière de formuler n’est pas l’apanage du monde politique. Des intellectuels européens ayant une large audience disent ou écrivent : « les majorités aussi (pas simplement les minorités) ont une ethnicité, un mode de vie à préserver et que beaucoup craignent de perdre ». Ces mots de David Goodhart dans le magazine britannique Prospect en mars 2018 font écho à ceux d’Alain Finkielkraut dans un entretien donné au Monde en septembre 2016 : « Être Français, ce n’est pas une formalité mais une forme de vie et (…) celle-ci n’est pas négociable ». Ces mots en rencontrent d’autres, les mêmes, mis cependant au service d’autres causes, parfois opposées. Commentant la décision Achbita rendue par la Cour de justice, Iman Amrani écrit dans The Guardian le 14 mars 2017 : « Pour celles qui le portent, le hijab est une partie intégrante de leur mode de vie, lié à la manière dont elles choisissent de pratiquer leur foi. Ceci ne saurait être sujet à débat ». Ces mots entrent facilement dans les discours et dans des stratégies de communication. Mais ne nous y trompons pas : ils forment aussi bien l’univers de significations dans lequel nous vivons. Tout cela est réel. Ce sont les mots de l’Europe polarisée.
Or, par la voix de ses dirigeants politiques, l’Union européenne parle désormais le même langage. Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé le 14 septembre 2016, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, plaçait les années à venir sous le signe d’une « Europe meilleure », « une Europe qui préserve notre mode de vie ». « Je suis convaincu, disait-il, que le mode de vie européen est une chose qui vaut la peine d’être préservée ». Pourquoi abandonner ainsi l’habituelle rhétorique des réformes politiques et institutionnelles pour embrasser la rhétorique du projet culturel ? C’est que « notre Union traverse une crise existentielle… Jamais encore, je n’avais vu un terrain d’entente si réduit entre nos États membres… Jamais encore, je n’avais vu une telle fragmentation, et aussi peu de convergence dans notre Union… J’ai l’impression que beaucoup ont oublié ce que cela signifie d’être Européen ». Si elle veut survivre, l’Union doit se concevoir comme une expérience vécue et partagée. Il semble que Jean-Claude Juncker ait précisément reconnu dans l’état d’extrême polarisation dans lequel se trouvent les sociétés européennes, où l’idée même de l’Union risque de se perdre, l’impulsion d’où l’on devait repartir.
Il a fallu peu de temps pour que Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, adopte le même langage. Elle fit même de cette idée un emblème politique. Aussi annonça-t-elle, à peine nommée, la création d’un poste de vice-président chargé de « la protection de notre mode de vie européen ». Celui-ci serait notamment responsable de l’immigration et de l’intégration. Une telle association ne pouvait que soulever une vague d’indignation. Ursula von der Leyen a fini par l’admettre : l’idée de protéger le mode de vie européen de l’immigration était malencontreuse. On parle désormais, à la Commission, de « promotion du mode de vie européen ». Von der Leyen s’en est expliquée : « nous ne pouvons et nous ne devons pas laisser d’autres que nous s’approprier notre langage. Cela fait partie de qui nous sommes. Nous ne permettrons pas à ces forces [populistes] de détourner la définition du mode de vie européen (…). Nous devrions être fiers de notre mode de vie européen sous toutes ses formes ». La promotion du mode de vie européen ne se résume donc pas à une défense de l’Union et de ses réalisations, son cadre institutionnel unique, son marché unique. Elle correspond à un engagement pour des valeurs plus fondamentales que l’Union elle-même : une société ouverte et pluraliste, un monde multipolaire, la liberté, la démocratie et l’État de droit. Jean-Claude Juncker à nouveau en 2016 : « Une partie intégrante de notre mode de vie européen est constituée de nos valeurs ». Ou, selon la même inspiration, le discours de la Sorbonne d’Emmanuel Macron de septembre 2017 : nos valeurs libérales, héritées des Lumières et protégées par les organisations européennes édifiées au XXème siècle, « ne sont pas négociables ».
Entre valeurs communes et sentiments collectifs
De telles affirmations ne sont pas pure rhétorique. Elles ont conduit à des prises d’initiative et à l’adoption de nouvelles législations. Tel le règlement général sur la protection des données personnelles, fierté des institutions européennes[5]. Tel l’engagement des institutions en faveur de la défense de l’État de droit en Hongrie et en Pologne[6]. La Cour de justice de l’Union européenne a manifesté son engagement dans sa jurisprudence : celle protégeant les internautes et les données personnelles, étendant l’empire de cette protection en Europe et, dans certaines conditions, hors du territoire européen[7] ; celle exigeant des États membres qu’ils instaurent et conservent un système de justice impartial et indépendant[8] ; ou encore celle exprimant son refus de céder à l’argument selon lequel il serait loisible à un État membre de défendre la nécessité de préserver « une société ethniquement homogène » en Europe[9]. Tout cela compte, assurément. Reconnaissons-en la valeur, la portée. Nous ne savons que trop, sur ce continent, le mal que des institutions non-libérales sont susceptibles de faire aux individus. Nous savons combien les mots lancés pour enflammer les passions sociales dissimulent d’avilissements collectifs désastreux. Tout cela compte, mais cela ne suffit pas. Car une défense abstraite des valeurs européennes manque quelque chose de décisif : le fait que les passions sociales qui agitent les Européens ne sont pas uniquement des formes rhétoriques créées par les leaders populistes pour tromper leurs électeurs ; elles traduisent des réalités sociales, des besoins exprimés par des individus et des groupes sociaux ancrés localement. C’est là le point essentiel. Les passions sociales expriment sous une forme véhémente, parfois violente, des besoins élémentaires, besoins matériels aussi bien que besoins existentiels d’expression, de participation et de reconnaissance[10].
En ce sens, l’accent porté sur les valeurs manque complètement la crise du quotidien des sociétés européennes. Il n’est pas surprenant qu’il provoque des réactions hostiles de la part de nombreux groupes d’individus. Sommés de faire partie de cette communauté européenne des valeurs, de nombreux individus se sentent exclus ou menacés dans leurs besoins et dans leurs modes de vie. Pour eux, l’Europe des valeurs est à la fois trop distante, éloignée de la vie quotidienne des populations et de leurs besoins, et trop intrusive, affairée à prescrire et à normaliser la conduite des individus, ignorant les pratiques et les modes de vie. Comment tenir compte de l’expérience de vie des Européens ? Comment resocialiser, comment revitaliser l’Union ? Comment la reconnecter à ce besoin qu’éprouve toute société « d’entretenir et de raffermir, à intervalles réguliers, les sentiments collectifs et les idées collectives qui font son unité et sa personnalité »[11] ?
Il arrive que l’Europe cesse d’être une pure assertion de valeurs et qu’elle s’attache à recueillir les sentiments collectifs des Européens. Il est remarquable que cette réaction ait pour siège la question sensible de l’accueil des étrangers. Cela concerne d’abord la mobilité et l’intégration des citoyens européens les plus pauvres au sein de l’Union. Accusés de pratiquer le « tourisme social », ceux-ci sont rejetés, perçus comme des saboteurs de l’État-providence. La réaction est plus sensible encore lorsqu’il s’agit de l’arrivée de migrants provenant de l’extérieur de l’Union. Soupçonnés de déstabiliser la cohésion des sociétés européennes, ceux-là aussi sont rejetés, perçus comme des abuseurs du droit d’asile. Dans ces deux cas, les institutions de l’Union ont fait, semble-t-il, le choix de reconnaître le bien-fondé des perceptions sociales hostiles à l’accueil et à la protection de ces individus[12].
L’Union européenne est-elle pour autant assurée d’acquérir la consistance sociale qui lui manque ? Rien n’est moins sûr. De ce fait, elle prend le risque d’épouser les solutions de gouvernements animés d’intérêts partisans et d’une conception tronquée de la réalité. N’oublions pas que c’est principalement à travers les voix des représentants des États membres que les institutions européennes se font une idée des perceptions sociales dominantes. Or, ces perceptions sont souvent fort éloignées de la réalité et de la complexité des situations individuelles concernées. Dans le domaine de l’immigration, l’Union européenne semble entièrement préoccupée par la mission de réguler, structurer et coordonner l’action de ses États membres. Tâche assurément impérieuse, mais qui ne devrait pas occulter le fait que c’est la vie d’individus qu’elle contribue ainsi à structurer, ou à déstructurer. Situation que l’on peut résumer ainsi : c’est en essayant de saisir le réel que, par construction institutionnelle, l’Union s’éloigne le plus de lui, de la fragilité des expériences vécues et de la précarité des modes d’appartenance et d’interaction sociale. La question demeure donc de savoir si l’Union européenne et son droit sont en mesure de répondre aux préoccupations existentielles des individus vivant sur le sol européen sans s’abîmer dans des considérations abstraites ou partisanes.
Négocier le non-négociable
Dans quelle mesure l’Union peut-elle faire droit aux pratiques et aux représentations considérées par leurs protagonistes comme étant indissociables de leurs modes de vie et de leurs valeurs ? Comment traite-t-elle de pratiques et de représentations élevées au rang de normes non-négociables ? Il est certain que, en Europe, les tribunaux sont devenus un lieu privilégié pour ceux qui souhaitent voir reconnaître des pratiques ou des représentations intimement liées à leurs différences sociales et culturelles ou à leurs besoins existentiels. Dans le droit, devant les prétoires, s’expriment désormais tout ensemble la frustration, l’insatisfaction, la résistance et la revendication de formes d’individuation et de modes de vie. Or, le droit de l’Union n’a pas été préparé à cette transformation. Son idéal se situe presque à l’opposé de ce mouvement. Il réside dans l’idée d’édifier un ordre institutionnel s’élevant et se mouvant au-dessus des batailles politiques et idéologiques, des conflits sociaux et des différences culturelles – expulsant de son ordre la vie quotidienne, ses conventions, ses conflits, ses passions[13]. Les juristes européens ont toujours eu pour principale ambition de construire un monde d’objectifs, de principes et de règles, sorte d’abri conceptuel capable de prémunir la fragile construction institutionnelle qu’est l’Europe du monde chaotique et dangereux des antagonismes politiques, idéologiques et sociaux. Le droit de l’Union a fonctionné comme une machine à enfermer des rapports politiques et sociaux à haute teneur conflictuelle dans un réseau stable de principes, de doctrines et de formules favorables à la poursuite du processus d’intégration. Maintenant qu’il se trouve sous la pression des passions sociales, comment peut-il s’adapter ?
Pour les juges, pour les juges européens en particulier, il est tentant de réagir en lisant dans l’expression des revendications la manifestation d’intérêts et de droits. Cela leur permet de jouer le jeu classique de la justice, celui de la mise en rapport et la mise en balance des droits et des intérêts. Le droit met en scène le conflit entre des droits subjectifs, ou entre des droits subjectifs et des intérêts collectifs, et le but du juge est alors de chercher des solutions intermédiaires ou de compromis : des solutions proportionnées. Technique classique, éprouvée, déclinée à l’infini. Technique qui, tout en décevant ponctuellement telle revendication ou telle prétention, a pour avantage de maintenir les positions en l’état. Car, quel que soit le résultat de la dispute dans un cas donné, chaque partie reçoit en quelque sorte sa part sur le plan formel : à chacun son droit et, donc, sa capacité de poursuivre la lutte. Sous cette forme, le droit est porteur d’espoir[14]. Seulement, sur les sujets les plus saillants, l’espoir ne suffit pas. Le juge est pressé de se prononcer en vérité, de poser des limites ; il est appelé à décevoir l’espoir.
L’étude de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union suggère que les sujets les plus saillants sont ceux qui, d’une manière ou d’une autre, mettent en jeu le rapport complexe des individus à la loi[15]. C’est lorsque sont en cause des pratiques sociales ou individuelles arrimées à des modes de vie ayant la prétention de faire loi et qui, cependant, trouvent dans les lois et les règles de droit une limite à leur développement ; ou bien, suivant un autre schéma, des activités techniques ou des comportements sociaux se développant à l’abri du droit qui en viennent à heurter des représentations collectives et à des modes de vie faisant loi pour certains individus. La jurisprudence désigne le vivant, les délinquants, les croyants et les migrants comme les principaux sujets de ces conflits. Chose remarquable, ces conflits sont portés désormais sur la scène européenne. Se dessine ainsi une quadrature conflictuelle dans lequel se meuvent tant bien que mal le droit européen et tous ses interprètes.
Le domaine du vivant met aux prises des individus avec des opérations scientifiques, économiques ou techniques qui se développent suivant des règles propres à leurs domaines respectifs mais qui mettent en cause quelque chose que ces individus appellent « loi de la nature » ou « loi de la vie », garante pour eux de formes de vie humaine ou non-humaine. Il nourrit chez certains groupes des affects de protection et de conservation. Sous l’angle du droit européen, la délinquance désigne des comportements d’étrangers qui s’exonèrent de la loi commune, transgressent la loi de l’État qui les accueille, tout en réclamant pour eux une place au sein de l’ordre social. Elle nourrit dans la société d’accueil des sentiments hostiles d’expulsion et de rejet. Les croyants sont les sujets de pratiques sociales que leur dicte la loi de leur foi et qui trouvent dans la loi de l’Etat ou dans les normes sociales environnantes des limites extérieures, incompatibles avec elles. Ils portent naturellement des demandes de respect et de reconnaissance. À ces demandes le corps social oppose bien bien souvent défiance et rejet. Enfin, les migrants abordant les rivages de l’Europe sont des individus en quête d’hospitalité et d’intégration. La seule perspective de leur arrivée sur le territoire européen nourrit des sentiments de peur, d’angoisse et d’insécurité chez les Européens. Ils sont perçus comme un risque ou comme une menace pour les habitudes, les biens et les lois gouvernant la vie des habitants du territoire.
Il faut ici nous borner à quelques illustrations sur chacun de ces sujets.
Le vivant
Pour aborder juridiquement le problème du vivant, considérons l’arrêt Brüstle rendu par la Cour de justice en 2011[16]. Affaire sensible dans laquelle était en cause un brevet déposé par un chercheur allemand portant sur la production de cellules cérébrales produites à partir du prélèvement de cellules souches embryonnaires et sur l’utilisation desdites cellules pour la thérapie d’anomalies neuronales. Cette affaire posait la question de savoir si l’activité scientifique à laquelle se livrait M. Brüstle était brevetable ou si, touchant à une limite d’ordre moral, l’interdiction d’utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, elle devait être exclue du régime de la brevetabilité, régime de droit orienté vers le marché. Dans le cas de cellules prélevées sur l’ovule humain à un stade très précoce de son développement, doit-on considérer que celles-ci forment un élément de l’embryon humain, être humain potentiel, soustrait à toute utilisation commerciale ? Il est un fait que les conceptions de l’embryon humain divergent en Europe. Dans son préambule, la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques reconnaît ces divergences. Celles-ci touchent à des différences éthiques et culturelles qui ont des implications bien au-delà du domaine de la recherche scientifique et de son exploitation commerciale : il en va d’une conception de la famille, d’une idée de l’ordre social et du sens général de la vie.
Dans cette affaire, la Cour de justice refuse prudemment de prendre part au débat éthique et politique. Elle préfère « se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive ». Ce qui ne la conduit pas à opérer un renvoi aux législations nationales. Le but de la directive étant de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et à la circulation des inventions biotechnologiques, la notion d’embryon humain ne saurait diverger d’un droit à l’autre au sein de l’Union ; il convient de lui donner une définition uniforme, européenne. Cela permet à la Cour de se reconnaître une compétence d’interprétation. Mais cela ne veut pas dire qu’elle en reste là. Dès lors qu’il est question d’attribuer un sens « européen » à la notion, elle estime qu’il faut changer de registre. Son analyse n’est plus régie par l’objectif de créer un marché unique, l’important n’est plus dès lors « d’encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie » ; l’essentiel est d’assurer « le respect des droits fondamentaux et, en particulier, de la dignité humaine ». L’interprétation de la notion d’embryon doit tenir compte du respect dû à « la dignité et l’intégrité de l’Homme ». Il s’ensuit cette définition extensive : « tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un ‘’embryon humain’’ (…) dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». La Cour de justice crée un champ consacré à l’interdiction de la brevetabilité sur le marché européen.
Cela revient-il à glorifier la vie humaine ? Ce qui ressort de l’ensemble de cette décision, prise en son contexte, c’est autre chose : non pas une volonté d’immuniser la vie humaine réputée intangible, mais plutôt une volonté de poser une limite sociale à l’exploitation scientifique et commerciale de la matière humaine. Il semble que la Cour de justice soit ici guidée par la volonté de protéger un modèle de société qui incorpore dans son fonctionnement des limites à la puissance technique et commerciale. Elle admet que la société européenne est une société riche et inventive ; elle accepte que l’invention repose sur la possibilité d’utiliser la matière humaine. Cependant, elle entend aussi signifier que la richesse scientifique, technique et économique ne se conçoit pas sans limite. Le respect de la vie humaine est le nom et le lieu de cette limite. Il désigne la part de non-négociable qui se loge dans le fonctionnement même du marché européen. Toute forme d’utilisation n’est pas permise. La Cour de justice se tient entre une « position métaphysique » sacralisant la vie et une « position permissive » autorisant toute forme d’exploitation de la matière humaine[17].
On peut se demander si cette conception est susceptible de s’étendre au vivant non-humain. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a toujours considéré que « la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité »[18]. La vie humaine et le modèle de santé publique lui sont les plus chers. Certes, la préoccupation d’une protection élevée de l’environnement ne lui est plus étrangère. Mais elle a pris l’habitude, en ce domaine, de mettre en balance l’intérêt de protéger l’environnement avec des intérêts économiques qu’elle considère comme légitimes au plan européen. En droit européen, la protection de l’environnement est l’un des termes d’une conciliation ; elle est constamment objet de négociation[19].
Mais il semble qu’elle le soit jusqu’à un certain point. C’est ce que vient illustrer la récente affaire de la forêt Białowieska en Pologne[20]. En 2016, le ministre polonais de l’environnement a décidé d’autoriser de nombreuses autorisations d’exploitation de peuplements forestiers de plus de 100 ans au sein de cette forêt primaire, bien que celle-ci soit une zone protégée au titre du dispositif « Natura 2000 » mis en place par l’Union européenne en accord avec les États membres, par ailleurs classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de la diversité des espèces qu’elle abrite. Cette décision était justifiée par la nécessité de stopper la propagation d’une espèce d’insecte ravageur, le bostryche typographe, et aux fins de garantir la sécurité des personnes présentes dans la forêt. Après s’être rendus sur place, les services de la Commission européenne ont émis des doutes sur la légitimité de ces mesures et sur leurs justifications. Selon la Commission, ces mesures porteraient atteinte à « l’intégrité du site », à savoir des processus naturels qui doivent être exempts de toute intervention humaine. Pour la Pologne, au contraire, l’intégrité du site ne peut être que le résultat de l’intervention humaine et ce site appelle, dans les circonstances présentes, une « gestion forestière active ».
Saisie par la Commission, la Cour de justice n’exclut pas par principe toute opération de gestion forestière ni toute activité humaine à l’intérieur d’un tel site. Mais elle relève que, « par leur nature même », les opérations en cause compromettent durablement « les caractéristiques écologiques de ce site ». Une opération de mise en balance s’insère dans le raisonnement, mais celle-ci est d’une nature particulière : il s’agit de trouver un équilibre entre mesures de gestion forestière active et mesures de gestion forestière passive ; le but demeure celui de réaliser les objectifs de conservation visés par les directives « habitats » et « oiseaux ». Le souci des « exigences économiques, sociales, culturelles et régionales » est entièrement subordonné à l’objectif de maintien de l’intégrité du site, maintien de la biodiversité et maintien de l’habitat et du mode de vie des oiseaux protégés. Cette forêt, « écosystème spécifique et unique », doit être protégée au titre de « patrimoine commun de l’Union ». Qu’elle soit terre polonaise, cela n’est pas contestable. Cela signifie que la Pologne s’en voit confier la gestion et la protection. Mais cette gestion est assurée pour le compte de l’Union. C’est que les Européens doivent une part de leur subsistance à cette forêt et à cet espace.
Si la forêt de Białowieska n’est pas un terrain totalement soustrait à l’exploitation, si des raisons économiques et sociales tenant au mode de vie des communautés humaines vivant à proximité de ce territoire peuvent justifier une exploitation commerciale, celle-ci ne saurait se faire au détriment de l’intégrité du site. La Cour de justice donne forme à une exigence de respect de la nature se logeant au cœur du territoire exploitable de l’Union européenne, sur le modèle du respect dû à l’intégrité de la personne humaine lequel se loge au cœur du marché européen.
Les délinquants
Tel qu’il est posé à l’échelle de l’Union, le problème de la délinquance et de la criminalité se présente sous un aspect particulier. D’une part, il convient de gérer la crainte que l’espace de libre circulation se transforme en espace d’impunité pour les sujets délinquants ou poursuivis pénalement. Le sujet délinquant est un agent rationnel tout comme l’est l’opérateur économique ; il peut être tenté de tirer des facilités de circuler dans l’Union l’opportunité de se soustraire au cadre répressif national ou d’opter pour un régime de droit ou de sanction d’un autre État membre qui soit moins rigoureux. Cette crainte justifie l’instauration de mécanismes efficaces de coopération entre les autorités policières et judiciaires des États membres. D’autre part, l’Union et ses États membres sont tenus de respecter l’exigence de traiter les citoyens de l’Union sur un même plan que les ressortissants nationaux dans les sociétés d’accueil. Telle est l’essence même du projet de citoyenneté européenne. Projet qui consiste à admettre que les Européens doivent pouvoir se représenter comme faisant partie intégrante d’une société qui n’est pas la société de leur État d’origine. Tout citoyen européen est présumé être intégrable dans toute société européenne. Jusqu’à quel point s’étend cette exigence d’intégration sociale ? Va-t-elle jusqu’à inclure la nécessité d’intégrer les ressortissants des autres États membres soupçonnés ou convaincus de crime ? Faut-il appliquer à ces individus les mêmes dispositifs de réhabilitation des criminels et délinquants en vigueur dans l’État d’accueil ? À quel moment l’expulsion est-elle permise, en plus de la sanction pénale ? Quel seuil de tolérance l’Union est-elle prête à imposer aux États membres et à leurs sociétés ?
À ces questions, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une réponse nuancée. Elle ne conçoit pas que les sociétés nationales soient uniquement des espaces de circulation ; ce sont des communautés sociales qui reposent sur des valeurs[21]. Le comportement d’un citoyen européen provenant d’un autre État membre, s’il constitue « une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » et met ainsi en cause l’ordre public ou la sécurité publique, peut être considéré comme une atteinte aux valeurs de la société d’accueil[22]. En ce cas, il sera légitime de soumettre son auteur à une mesure d’expulsion. Reste qu’une telle mesure ne saurait être automatique. L’objectif d’intégration sociale s’oppose à l’automaticité. La mesure d’expulsion doit être soigneusement soupesée : avant toute expulsion, il faut tenir compte des circonstances individuelles du cas d’espèce, de la réalité et de l’actualité de la menace, des liens réels d’intégration contractés par la personne concernée dans la société d’accueil, des liens familiaux ou professionnels existants. C’est ainsi par exemple qu’un ressortissant colombien installé en Espagne, vivant avec ses enfants, dont l’un est de nationalité polonaise et l’autre de nationalité espagnole, enfants dont il s’est vu confier la garde exclusive, ne saurait être expulsé sur le seul fondement d’antécédents pénaux, s’il peut être établi que ses deux enfants ont besoin de lui et qu’ils reçoivent, de la part de leur père, « des soins et une éducation scolaire adéquats ». En ce cas, en effet, l’objectif d’intégration des citoyens européens et de leur famille ainsi que « l’intérêt supérieur de l’enfant » l’emportent sur la référence abstraite à la sauvegarde de l’ordre public[23].
Cependant, cette exigence de tolérance rencontre une limite. La question est de savoir en quel point se trouve cette limite. La Cour de justice a jugé qu’un ressortissant italien ayant commis un crime d’agression sexuelle sur mineurs dans le cercle familial est sujet à expulsion, en dépit du fait qu’il a passé la plus grande partie de son existence en Allemagne et qu’il y a contracté l’essentiel de ses liens et de ses attaches[24]. Selon la Cour, ce crime revêt la nature d’une véritable attaque contre la sécurité publique. Certes, par son crime, cet individu n’a pas mis en cause les institutions de l’Etat et de la société, critère auquel on juge habituellement les menaces contre la sécurité publique. Cependant, la Cour considère que son comportement est une mise en cause des fondements institutionnels et axiologiques de la société : la famille comme structure morale et comme forme de socialisation et, au sein de la famille, l’enfant, cet être « particulièrement vulnérable ». Sur des bases semblables, la Cour de justice a jugé qu’un ressortissant croate ayant participé à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité commis par les unités spéciales de l’armée bosniaque durant la guerre de Bosnie peut être considéré comme une menace actuelle et persistante pour la société néerlandaise, en dépit du fait qu’il réside paisiblement dans ce pays depuis de longues années[25]. Il est vrai sans doute que de tels crimes ne se reproduiront pas en dehors de leur « contexte historique et social spécifique ». Cependant, pour la Cour, ils témoignent à eux seuls de la persistance, chez cet individu, « d’une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales visées aux articles 2 et 3 TUE ». Dans un cas comme dans l’autre, par la violence dont ils témoignent ou dont ils ont témoigné, il faut considérer que ces comportements violent le socle de valeurs constitutif de la socialité européenne.
Nous touchons là à ce que la Cour de justice désigne comme la limite du tolérable. Cette limite ne se trouve pas dans la qualification du crime, abus sexuel sur mineur ou crime de guerre. Elle se trouve dans ce que ce crime révèle : à savoir ce que le philosophe Frédéric Worms appelle « la violation », soit une rupture dans l’ordre social allant bien au-delà du trouble à l’ordre social, une rupture qui touche à l’ordre même des relations humaines, à leur intégrité et à leur intimité[26]. Passé ce seuil, le souci du maintien de la structure sociale de base prend le pas sur la possibilité de réintégrer des existences déviantes.
Les croyants
La croyance religieuse constitue, pour les croyants, un monde en soi[27]. Ce monde dicte aux croyants des principes, des normes, des pratiques et des modes de vie. Les juridictions européennes sont enclines à traiter cet ensemble de normes et de pratiques à l’aide du langage des droits subjectifs : droit à la liberté de religion, droit à la liberté de manifester sa religion en public ou en privé. Pareil langage des droits permet de traiter les revendications liées à des pratiques religieuses sous le prisme de la négociation : la liberté religieuse est mise en balance, selon les cas, avec la liberté d’expression, avec la liberté d’information, avec la liberté d’entreprendre ou encore avec la protection du bien-être des animaux. Cette forme de régulation des pratiques religieuses ne nie pas la singularité de ces pratiques mais elle contribue à affaiblir leur charge normative ; elle fait d’elles des marqueurs culturels ou identitaires privés de tout effet prescriptif[28]. C’est ainsi par exemple que sont requalifiés les signes religieux chrétiens dans les sociétés européennes séculières : pour la Cour européenne des droits de l’homme, le crucifix présent dans les salles de classe en Italie n’est pas le reflet d’une pratique religieuse, c’est un symbole de la nation et de son identité[29]. Cependant, il est des pratiques religieuses qui résistent à cette requalification. Ce sont les pratiques dont leurs auteurs considèrent qu’elles sont la manifestation de principes non-négociables, liés à leur foi. Cette défense est aussi pour eux une manière de demander une reconnaissance en tant que groupe social légitime. Tel est notamment le cas des musulmans nés et vivant leur foi en Europe.
En matière religieuse, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie, jusqu’à présent, de deux sortes de cas : d’un côté, des cas de discriminations au travail fondées sur la manifestation religieuse ; de l’autre, des cas relatifs à des pratiques d’abattage rituel des animaux, selon des rites casher ou halal. Au titre des discriminations au travail, il y a par exemple le cas de Mme Achbita, de confession musulmane, travaillant comme réceptionniste dans une entreprise de sécurité[30]. Après trois ans passés dans cette entreprise, elle décide de porter le foulard islamique durant les heures de travail. La direction s’oppose à cette pratique. Elle l’informe que l’entreprise a fait le choix d’une politique de neutralité vis-à-vis des signes religieux. Samira Achbita cesse alors de travailler, elle est en arrêt maladie. À son retour, elle fait savoir qu’elle est déterminée à se conformer à ce que lui dicte sa foi : porter le foulard islamique. Elle est licenciée. L’affaire est portée devant la Cour de justice par la Cour de cassation belge. Selon la Cour de justice, Samira Achbita n’est pas victime d’une discrimination directe en tant que femme musulmane. En revanche, ce licenciement est constitutif d’une discrimination indirecte. Il n’est pas douteux que l’obligation apparemment neutre découlant de cette règle interne de l’entreprise ait pour effet de créer un désavantage particulier pour les travailleurs adhérant à une religion. Une telle discrimination est susceptible d’être justifiée. Selon la Cour, en l’espèce, la justification existe : elle réside dans la volonté de l’entreprise « d’afficher, dans ses relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité ». Politique qui se concrétise par le souhait légitime « d’afficher une image de neutralité ». Pour justifier cette entrave à la liberté de religion, la Cour convoque la liberté d’entreprendre protégée en tant que droit fondamental par le droit de l’Union. Mais elle apporte aussi deux tempéraments à cette solution. D’une part, l’interdiction du port du voile doit être limitée aux postes de travail qui sont au contact avec les clients. D’autre part, Mme Achbita doit se voir proposer, dans la mesure du possible, un poste n’impliquant pas de contact visuel avec les clients de l’entreprise.
Cette solution n’a de sens qu’à la condition de considérer l’entreprise comme l’agent d’une normativité sociale imposant la neutralisation des signes religieux dans l’espace public. La Cour de justice ne conçoit la religion que sous la forme du respect pour ce qui, dans la religion, ne relève pas de la pure normativité interne à la pratique religieuse. Sa manière de respecter la religion ici est d’aménager pour elle un lieu d’expression à l’écart de la société. La même neutralisation s’observe dans les cas relatifs à l’abattage rituel. Dans certains pays européens, ces pratiques sont contestées au nom de la nécessité d’éviter la souffrance animale. Elles sont tolérées par le droit de l’Union au titre d’une exception fondée sur le respect des rites religieux dans les États membres. Cette exception est une faculté : les États membres sont libres d’en faire usage ; et elle est encadrée par la nécessité de respecter certaines normes techniques d’abattage. Or, en 2015, le ministre régional flamand de la santé a décidé de ne plus autoriser de sites d’abattage des animaux sans étourdissement de façon temporaire, hors du circuit de l’abattage agréé, durant la fête du sacrifice célébrée par les musulmans. Pareille décision a pour conséquence de créer un défaut de capacité d’abattage durant la fête du sacrifice, les abattoirs agréés étant dans l’incapacité de répondre à la hausse de demande observée. Portée devant la Cour de justice de l’Union, cette affaire conduisait celle-ci à se prononcer sur la validité des règles européennes qui, tout en prévoyant une exception tenant aux rites religieux, imposait de procéder à l’abattage dans des abattoirs répondant à certaines exigences techniques[31]. Ces exigences n’étaient à l’évidence pas satisfaites par les sites provisoires créés en Belgique au moment de la fête du sacrifice.
La Cour de justice est visiblement gênée par cette question. Elle estime que les règles européennes prévoyant l’abattage rituel dans des abattoirs agréés visent « uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses ». Elles ne portent donc pas atteinte à l’essence de « la liberté de religion des musulmans pratiquants ». Les conditions techniques imposées par le législateur européen sont interprétées comme le résultat d’une conciliation justement opérée entre les méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux et les exigences européennes en matière de protection du bien-être des animaux. De ce point de vue, la difficulté rencontrée par la communauté musulmane en Flandres est un problème de circonstance, lié à des motifs conjoncturels et purement internes. Cela ne saurait remettre en cause l’équilibre trouvé en droit européen, reflet d’un équilibre établi à l’échelle européenne au sein de l’ordre social. Que ce problème « temporaire » et « conjoncturel » coïncide précisément avec le moment de célébration d’une fête religieuse importante pour cette communauté, cela ne semble pas entrer en ligne de compte. Pour la Cour, il s’agit de juger une mesure tenant à une technique d’abattage et non une pratique religieuse essentielle à un groupe social.
Dans le cas de la discrimination au travail comme dans le cas de l’abattage rituel, l’importance de la pratique religieuse n’est pas complètement ignorée. La pratique elle-même n’est pas niée. Mais celle-ci est en quelque sorte désactivée dans ses composantes prescriptives, d’attachement personnel et d’appartenance communautaire. Le résultat de l’analyse juridique est d’isoler la pratique et de l’enserrer dans des dispositifs techniques, de type managérial dans le cas du port du voile, de type logistique dans le cas de l’abattage rituel. Ce résultat témoigne d’un refoulement de la normativité religieuse. La Cour de justice prend soin sinon d’en neutraliser les effets du moins de les confiner à des lieux ou à des tâches bornés, de telle sorte qu’ils soient insusceptibles de perturber l’ordre social et la normativité qui le gouverne.
Les migrants
Le droit européen des étrangers a pour particularité de soumettre les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne à des régimes catégoriels totalisants et qui communiquent peu entre eux[32]. À la différence des citoyens européens, ces étrangers sont privés de mobilité géographique, de mobilité sociale et de mobilité juridique. Ils ne disposent de la faculté de circuler entre différents points du territoire de l’Union et, au sein de l’espace social, entre différents statuts en fonction de leur situation et de la place qu’ils occupent dans la société. Aux termes des textes de droit européen, l’étranger est soit un résident régulier sur le territoire européen, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers en situation régulière, ressortissant de pays tiers résident de longue durée ou encore le titulaire d’un droit de résidence au titre de l’un des statuts relatifs à l’immigration économique, soit un ressortissant en situation irrégulière soumis à une obligation de retour, soit un demandeur d’asile ou le bénéficiaire d’un statut de protection internationale[33]. Il est, de fait, pratiquement impossible de passer d’un statut à l’autre. En outre, le statut ainsi attribué a vocation à déterminer l’ensemble des données de l’existence individuelle : lieu de vie, accès à l’emploi, bénéfice d’une protection sociale, jouissance de la vie familiale.
Cette situation témoigne d’une volonté de soumettre le sort des étrangers à l’État et à son contrôle. Le droit européen conçoit les relations entre l’État et les étrangers sur le mode de la domination et de la dépendance, selon un schéma fort éloigné de l’idéal de réciprocité gouvernant les relations sociales au sein d’un État libéral. Dépendance qui n’exclut pas toute protection, qui favorise même parfois une intégration dans la sphère sociale par la prise en charge et par l’intégration dans un cercle possible de celui de la communauté nationale. Mais ceci n’a lieu qu’au prix d’un effort de justification, fondé sur des motifs d’humanité (en matière d’asile), de proximité (en matière de regroupement familial) ou simplement d’intérêt (en matière d’immigration économique). Au reste, cette inclusion n’est jamais tout à fait acquise ; le statut obtenu est toujours sujet à révision ou à confirmation[34]. Mais que cet effort n’opère pas, et les étrangers sont alors rendus à leur statut de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, perçus au mieux comme des victimes, au pire comme des menaces pour le corps social en Europe. C’est sur cette catégorie d’étrangers irréguliers que se concentre la puissante mécanique des représentations collectives hostiles aux étrangers. Ces représentations ont assurément un effet de déformation de la réalité des faits, notamment sur l’importance des flux de migrants en Europe. Elles modifient les perceptions sociales. Mais comment agissent-elles sur les règles et leur interprétation ?
Pour répondre à cette question, il faudrait mener une enquête portant sur les pratiques juridiques devant les autorités administratives et devant les tribunaux, en différents pays européens et à différents niveaux de responsabilité et de juridiction. Contentons-nous ici d’une illustration. Celle-ci est tirée d’une jurisprudence à présent abondante dans ce domaine de la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt Jawo du 19 mars 2019[35]. Cet arrêt décrit la situation tant de fois répétée ces dernières années d’un jeune homme originaire d’Afrique de l’Ouest ayant parcouru une partie de l’Afrique avant de traverser la Méditerranée jusqu’à l’Italie pour enfin gagner l’Allemagne. D’après les données enregistrées dans le système d’information recueillant les empreintes digitales des demandeurs d’asile dans l’Union (Eurodac), une première demande d’asile avait été formulée en Italie où il avait obtenu un titre national de séjour pour raisons humanitaires. Une seconde demande est déposée en Allemagne. Dans ce cas, les règles européennes en matière de responsabilité d’examen de la demande d’asile prévoient que les autorités allemandes rejettent cette demande et ordonnent le transfert de M. Jawo vers l’Italie. C’est le sens du règlement Dublin III. Cependant, les choses se compliquent lorsque, le jour choisi par les autorités pour le transfert, M. Jawo est déclaré absent de la structure d’hébergement collectif où il logeait. Il déclarera avoir rendu visite ce jour-là à l’un de ses amis vivant dans une autre commune d’Allemagne. Mais les autorités allemandes décidèrent de voir dans cette absence le fait constitutif d’une « fuite », motif qui justifie une extension du délai autorisé de remise aux autorités italiennes. Lors d’une seconde tentative de transfert, M. Jawo refusera d’être transféré, au motif que les conditions dans lesquelles sa demande d’asile serait traitée en Italie ne respectent pas les droits fondamentaux des personnes.
Cette affaire posait deux questions : l’une portant sur la définition de la fuite au sens du règlement Dublin III, l’autre sur les motifs justifiant un refus de transfert. Sur la première question, la Cour de justice reconnaît qu’au sens ordinaire du terme la fuite suppose « l’existence d’un élément intentionnel ». Cependant, elle ajoute aussitôt qu’il convient de tenir compte du contexte institutionnel, lequel consiste en l’institution d’une « méthode claire et opérationnelle pour déterminer rapidement l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ». Cette structure de coopération institutionnelle entre États membres est une pièce essentielle de la politique européenne : elle autorise les autorités nationales à présumer qu’une absence vaut intention de se soustraire aux autorités pour faire échec au transfert. Cette solution est tempérée, toutefois, par deux conditions : la personne concernée doit être informée de ses obligations d’information en cas d’absence et elle doit avoir la possibilité de contester cette présomption. Sous ces conditions, la Cour de justice affirme clairement que l’exigence de coopération institutionnelle l’emporte sur la réalité de l’action intentionnelle. Ce jugement est révélateur. Il illustre le fait que les étrangers qui se trouvent en Europe, demandeurs d’asile et personnes en situation irrégulière, sont l’objet d’une intense forme d’institutionnalisation : leur sort est entièrement entre les mains des institutions et de leur coopération, ils sont pratiquement privés de toute possibilité d’exprimer des préférences ou des choix, ils sont privés de toute liberté de circuler et de toute agentivité sur le territoire européen.
La seconde question posée par la juridiction de renvoi mettait justement en cause les modalités de cette coopération entre États membres. La règle est que le transfert d’un demandeur d’asile vers in État membre est exclu dans toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, soit par l’effet même du transfert soit à la suite de celui-ci. Il reste que la Cour de justice incite à la prudence dans l’appréciation d’un tel risque : avant de stopper le transfert, elle demande aux autorités nationales de s’assurer que les défaillances dans l’État de transfert atteignent « un seuil particulièrement élevé de gravité ». Ce seuil est atteint lorsque la personne concernée « se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême ». Mais il ne l’est pas si la personne concernée risque de se trouver dans une situation de « grande précarité » ou dans « une forte dégradation des conditions de vie ». N’est-ce pas, à nouveau, faire prévaloir les exigences institutionnelles sur le souci des existences individuelles ? Dans le droit des migrants, ce n’est que lorsque le seuil vital est affecté que l’ordre des priorités est susceptible de se renverser.
La quadrature du droit
Cette brève et parcellaire enquête au sein de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union indique que la pression des passions sociales pousse la Cour à s’écarter, dans les domaines saillants, du mode classique de la mise en balance des droits et des intérêts. De nouvelles formes de raisonnement et de nouveaux motifs surgissent. Dans deux des domaines identifiés, celui du vivant et celui des croyants, la Cour de justice répond aux demandes de protection en s’efforçant d’aménager des espaces hors marché ou hors société : elle extrait des activités, des sites ou des pratiques du fonctionnement ordinaire de l’ordre social et marchand et des normes qui le régissent. C’est une question de champ de protection. Dans les deux autres domaines, celui des délinquants et celui des migrants, la question se pose en termes de degré de protection : la protection est plus ou moins élevée selon que la Cour fait plus ou moins prévaloir la raison d’État et les impératifs de l’ordre public sur les exigences d’intégration des individus dans la société d’accueil.
Suivant ces modes d’analyse, le niveau de protection varie. Le degré d’extension du champ soustrait à l’empire du marché est élevé dès lors que l’on touche à l’intégrité du vivant : de vastes domaines de la recherche sur le vivant sont exclus de la brevetabilité, de vastes sites naturels sont soustraits à l’exploitation forestière. En revanche, les formes d’expression du religieux sont confinées à des espaces bornés, encadrés par des règles managériales ou par des normes techniques. La même variabilité affecte le niveau de protection dans les deux autres domaines concernés. À l’égard des délinquants, citoyens européens, le seuil auquel les individus peuvent être sujets à une mesure d’expulsion est élevé : il faut démontrer qu’il en va d’une mise en cause de quelque chose comme l’ordre fondamental des relations humaines. À l’inverse, à l’égard des migrants, le seuil auquel un transfert dans un autre État membre ou un retour dans le pays d’origine est justifié est bas : ce n’est que si un risque vital est avéré que celui-ci doit être empêché. Si l’on essaie de se figurer schématiquement les résultats de l’analyse, on obtient ceci :
| Protection hors société/marché | Protection dans la société |
| (+) VIVANT | (+) DELINQUANTS |
| (-) CROYANTS | (-) MIGRANTS |
Sur la première colonne se trouvent les espaces plus ou moins étendus de protection du vivant et des croyances à l’égard des normes en vigueur sur le marché et dans la société. Sur l’autre colonne se trouvent les seuils plus ou moins élevés au-delà desquels les individus délinquants ou migrants sont susceptibles de faire l’objet d’un rejet hors de la société d’accueil et, par conséquent, le niveau corrélatif de leur protection dans cette société. Que nous dit ce schéma sur la manière dont le droit de l’Union européenne réagit aux passions sociales qui colonisent la scène européenne aujourd’hui ? Mis sous pression, le droit de l’Union se révèle réceptif aux représentations favorables à la protection du vivant, et il est sensible aux représentations collectives hostiles aux migrants. En revanche, il s’avère beaucoup moins sensible aux réactions hostiles aux Européens délinquants ; il est également moins réceptif à la demande de protection des croyances et des pratiques des musulmans. À partir de ces constats, de nouvelles questions se posent. Il faudrait s’interroger sur la justification de ces choix, sur le contexte dans lequel ces choix sont opérés et sur la manière dont ils sont effectivement mis en œuvre. Ces questions relèvent d’une philosophie, d’une sociologie et d’une anthropologie du droit de l’Union. C’est vers de telles études que les juristes européens doivent s’engager.
Pour citer cet article : Loïc Azoulai, « Droit de l’Union européenne et passions sociales », Confluence des droits_La revue [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 14 février 2020. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=107


[1] L’expression de « consensus permissif » a été forgée par L. N. Lindberg & S. A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change in the European Community, Englewood Cliffs, 1970. Voir également H. Liesbet & M. Gary, « A Postfunctionalist Theory of European Integration : From Permissive Consensus to Constraining Dissensus », British Journal of Political Science, vol. 39, n° 1, 2008, p. 1.
[2] Sur la notion de passions sociales, voir G. Origgi (dir.), Passions sociales, PUF, 2019. Sur le droit de l’Union et les passions historiques, voir L. Azoulai & D. Ritleng (dir.), Nationalisme, populisme et droit de l’Union européenne, Revue trimestrielle de droit européen, 2018, p. 715.
[3] Le concept a été forgé par S. Iyengar, G. Sood & Y. Lelkes, « Affect, Not Ideology. À Social Identity Perspective on Polarization », Public Opinion Quarterly, 76(3), 2012, p. 405. Voir également N. Gidron, J. Adams & W. Horne, « Toward a Comparative Research Agenda on Affective Polarization in Mass Publics », APSA Comparative Politics Newsletter, 29(1), 2019, p. 30.
[4] P. Genestier, « Les « gilets jaunes » : une question d’autonomie autant que d’automobile », Le Débat, 2019/2, p. 16.
[5] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
[6] E. Dubout, « Integration Through the Rule of Law ? La judiciarisation de l’État de droit dans l’Union européenne », Revue des Affaires Européennes, 2019, p. 51 ; H. Labayle, « Winter is coming : l’État de droit devant les institutions de l’Union, remarques sur les crises polonaises et hongroises », Revue des Affaires Européennes, 2018, p. 485 ;
[7] CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, aff. C-131/12, EU :C :2014 :317 ; CJUE, 6 octobre 2015, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissione, aff. C-362/14, ECLI :EU :C :2015 :650 ; CJUE, 3 octobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek c/ Facebook Ireland Limited, C-18/18, ECLI :EU :C :2019 :821 ; CJUE 24 septembre 2019, Google LLC c/ CNIL, n° C 507/17, ECLI :EU :C :2019 :772 ; CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a. c/ CNIL, C-136/17, ECLI :EU :C :2019 :773.
[8] CJUE, 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16,EU :C :2018 :117 ; CJUE, 24 juin 2019, Commission c/ Pologne, C-619/18, EU :C :2019 :531 ; CJUE, 19 nov. 2019, A. K e.a., C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU :C :2019 :928.
[9] CJUE, 6 septembre 2017, République slovaque et Hongrie (soutenues par République de Pologne) c. Conseil, C-643/15 et C-647/15, ECLI :EU :C :2017 :631, pt 302.
[10] L’idée des deux ordres de besoins, besoins matériels et besoins communicationnels, vient de Dionys Mascolo, Le Communisme. Révolution et communication ou la dialectique des valeurs et des besoins (1953), Éditions Lignes, 2018.
[11] E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), PUF, 2008, p. 610.
[12] La réaction au « tourisme social » se lit notamment dans CJUE, 11 novembre 2014, Dano, aff. C-333/13, EU :C :2014 :2358. La réaction aux « abus » en matière de demande d’asile se lit dans Commission européenne, Proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), COM(2018) 634 final, 12 septembre 2018.
[13] L. Azoulai, « Solitude, désœuvrement et conscience critique. Les ressorts d’une recomposition des études juridiques européennes », Politique européenne,n° 50,2015, p. 83.
[14] Voir, sous un autre angle, A. Riles, « Le droit est-il porteur d’espoir ? », Clio Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 15, 2019.
[15] Sur cette question, voir E. Balibar, Saeculum. Culture, religion, idéologie, Galilée, 2012.
[16] CJUE, 18 octobre 2011, Brüstle, ECLI :EU :C :2011 :669.
[17] Voir, sur le plan philosophique, E. Bimbenet, « Non pas une mais deux vies. Les ressources normatives d’une philosophie du corps humain », in Y.C. Zarka & A. Zafrani (dir.), La phénoménologie de la vie, Cerf, 2019, p. 149.
[18] CJUE, 16 décembre 2010, Commission c/ France, C-89/09, ECLI :EU :C :2010 :772, pt 42.
[19] M. Torre-Schaub, « Marché unique et environnement : quelle intégration ? », Revue Internationale de Droit Economique, 2006/3, p. 317.
[20] CJUE, 17 avril 2018, C-441/17, Commission c/ Pologne, EU :C :2018 :255.
[21] L. Azoulai & S. Coutts, « Restricting Union citizens’ residence on grounds of public security. Where Union citizenship and the Area of Freedom, Security and Justice meet », Common Market Law Review, 50, 2013, p. 553.
[22] Le critère de la menace réelle et suffisamment grave remonte à CJCE, 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU :C :1977 :172, pt 35.
[23] CJUE, 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU :C :2016 :675.
[24] CJUE, 22 mai 2012, P. I., C-348/09, ECLI :EU :C :2012 :300.
[25] CJUE, 2 mai 2018, K., C-331/16 et C-366/16, ECLI :EU :C :2018 :296.
[26] F. Worms, « Penser la violation. Relations morales et protection publique », Esprit, février 2000, p. 69 ; du même auteur, Les maladies chroniques de la démocratie, Desclée de Brouwer, 2017.
[27] C. Geertz, « Religion as a cultural system », in C. Geertz, The interpretation of cultures : selected essays, Fontana Press, 1993, p. 87.
[28] O. Roy, L’Europe est-elle chrétienne ?, Seuil, 2019.
[29] CEDH, 18 mars 2011, Lautsi c/ Italie, req. n° 30814/06.
[30] CJUE, 14 mars 2017, Samira Achbita, C-157/15, ECLI :EU :C :2017 :203.
[31] CJUE, 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a. c/ Vlaams Gewest, C-426/16, ECLI :EU :C :2018 :335.
[32] Sur ce point, voir L. Azoulai, « Le droit européen de l’immigration, une analyse existentielle », Revue trimestrielle de droit européen, 2018, p. 519.
[33] Pour une synthèse, voir J.-Y. Carlier, La condition des personnes dans l’Union européenne, Larcier, 2007. Le tableau est à compléter avecK. Hailbronner & D. Thym, EU Immigration and Asylum Law. A Commentary, Beck, Hart, Nomos, 2nd ed., 2016.
[34] Dans de nombreux États membres, cela prend la forme d’obligations de se soumettre à des tests d’intégration civique : voir, sur ces pratiques et leur encadrement, CJUE, 4 juin 2015, P,S, C-579/13, ECLI :EU :C :2015 :369 ; CJUE, 9 juillet 2015, K et A, C-153/14, ECLI :EU :C :2015 :453 ; CJUE, 7 novembre 2018, C, A, C-257/17, ECLI :EU :C :2018 :876.
[35] CJUE, 19 mars 2019, Abubacarr Jawo, C-163/17, ECLI :EU :C :2019 :218.