Dominique Rousseau, Professeur émérite, UMR 8103 ISJPS, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Le citoyen est le grand absent des formes politiques contemporaines. Il est abondamment cité mais aussi absolument oublié. Car la forme capitaliste de l’économie n’a pas besoin de citoyen mais de travailleur-consommateur. Dans le contexte et à l’époque où elle s’invente, l’économie de marché produit des effets « démocratiques » en ce qu’elle libère les individus des ordres hiérarchiques, pose l’égalité des individus comme principe général d’action sociale et favorise la diversité des initiatives individuelles. En faisant de l’individu la valeur de référence, elle bouscule, elle casse les structures dans lesquelles il était enfermé et qui l’aliénaient mais elle renverse également l’idée d’individu. Il n’est plus, comme dans les grandes religions ou métaphysiques, une donnée ou une idée qui aurait droit à la reconnaissance de sa singularité précisément parce qu’elle serait inhérente à son être, soit comme être de Dieu soit comme être de Raison. L’individu se construit comme tel par sa liberté d’action sur le monde et le monde actuel s’est construit par cette liberté : en mettant fin à la société par ordres, aux privilèges de classes, à l’hérédité économique, familiale et politique, à la domination des hommes sur les femmes. Le libéralisme économique, en mettant l’individu-en-train-de-se-faire au centre de sa dynamique, a contribué à révolutionner les sociétés ; mais il s’est développé en réduisant progressivement l’individu à sa seule dimension économique, le « laisser-faire », oubliant ou négligeant ses dimensions sociale, politique, culturelle. Et ce développement unidimensionnel a produit de terribles inégalités dans l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement qui mettent en cause, aujourd’hui, non seulement la cohésion politique des sociétés mais l’idée même d’individu que le libéralisme portait à l’origine[1]. Le capitalisme écrase l’individu et les marchés imposent leurs lois aux politiques et aux citoyens. Jusqu’à la caricature. Ils ont obtenu en 2011, lors de la crise de l’euro, ce que ni les sit-in, ni les manifestations, ni les grèves, ni les défilés n’avaient arraché : la démission de premiers ministres, l’Irlandais Cowen en février, le Portugais Socrates en mars, l’Espagnol Zapatero en juillet, le Slovaque Radicova en octobre, l’Italien Berlusconi et le Grec Papandréou en novembre ! Les gouvernants sont moins responsables devant leur Parlement et leur peuple que devant les marchés et les systèmes politiques sont devenus des plouto-démocraties gérées par une nouvelle « Noblesse d’État » pour reprendre la formule de Bourdieu.
Mais la forme représentative de la démocratie n’a pas davantage besoin de citoyen ; elle a besoin d’électeur. Sieyès le dit clairement dans son discours du 7 septembre 1789, où il oppose de manière radicale gouvernement représentatif et démocratie : « Les citoyens, déclare-t-il, qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volontés particulières à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants »[2]. Le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, le développement des partis politiques, l’essor du Parlement et, plus récemment en France, l’élection populaire du Chef de l’État ne changent pas fondamentalement la réalité des choses s’ils en modifient l’apparence. Toutes les institutions, tous les instruments ou mécanismes présentés comme les vecteurs d’une participation directe des citoyens à la prise des décisions politiques sont aussi des institutions, des instruments, des mécanismes qui renforcent et perfectionnent la délégation de pouvoirs. Le suffrage universel légitime la représentation autant ou plus qu’il ne donne au peuple la maîtrise des décisions ; les partis politiques organisent et reproduisent la représentation autant ou plus qu’ils ne donnent à leurs adhérents ou aux citoyens les moyens d’intervenir dans les choix politiques… Le ressort même du régime représentatif n’est jamais atteint par ces technologies politiques modernes. Le peuple est peut-être davantage nommé, davantage sollicité mais il reste toujours aux portes de l’espace de délibération. Les constitutions valorisent sans doute la figure du citoyen et énoncent toutes le principe du « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple », mais elles consacrent l’essentiel de leurs dispositions à déposséder le peuple de son pouvoir en organisant et légitimant l’existence et la parole des représentants et par conséquent l’absence et le silence des représentés. « Au nom de… » reste la règle grammaticale fondamentale de la forme représentative du gouvernement des sociétés politiques.
En régime représentatif, la démocratie est donc toujours en état de manque. Car il advient toujours un moment où ceux au nom desquels « on » parle, « on » pense et « on » décide entrent en rébellion ouverte contre les porte-parole institués. « On » ne gouverne pas impunément « au nom de ». Le peuple est à la fois le référent du système représentatif et sa ligne de faille dans la mesure où il peut à tout moment faire irruption, soulever l’écorce représentative en affirmant que ses attentes, ses préoccupations, ses volontés ne sont pas celles que les représentants lui attribuent. Quand une telle situation se produit, quand le système représentatif est nu, l’expression qui, comme par hasard, s’impose sous la plume est celle de « tremblement de terre » ou de « séisme politique ».
Il en est ainsi aujourd’hui où se multiplient les marques d’une fracture entre gouvernants et gouvernés. Le système représentatif dysfonctionne ; le lien représentatif a disjoncté : les représentés ne se « voient » plus dans le corps de leurs représentants, ne « s’entendent » plus dans leurs voix, ne se « reconnaissent » plus dans leurs décisions et les représentants ne regardent plus, n’écoutent plus, ne connaissent plus celles et ceux qu’ils sont censés représenter. Rompre avec la forme représentative de la démocratie impose de reconnaître la légitimité des citoyens à intervenir en continu dans la fabrication des politiques publiques locales, nationales et supranationales et d’établir les institutions lui permettant cette action politique continue.
La crise actuelle n’est pas celle de la démocratie mais de sa forme représentative. Au demeurant, l’expression « démocratie représentative » ne doit son succès qu’à l’oubli des paroles de Siéyès opposant de manière radicale gouvernement représentatif et démocratie. Cette période constitutionnelle-là prend fin. Car, au cœur des mouvements sociaux depuis une vingtaine d’années, un autre cycle s’ouvre qui porte l’exigence plus forte de ce que j’ai appelé en 1992 la démocratie continue. Distincte de la démocratie directe qui abolit toute distinction entre représentants et représentés, distincte de la démocratie représentative qui monopolise la fabrication des lois au profit des seuls représentants, elle définit un au-delà de la représentation, non parce qu’elle la supprimerait, mais parce qu’elle transforme et élargit l’espace d’intervention des citoyens en inventant les formes et procédures leur permettant d’exercer un travail politique.
S’il en est ainsi, il convient de rechercher les fondements constitutionnels de la démocratie continue (I) et les institutions qui la font vivre (II).
I. Les fondements constitutionnels
de la démocratie continue
A) Le peuple-concret
Le peuple, en effet, n’est ni une donnée immédiate de la conscience, ni une donnée naturelle ; il n’est pas une réalité objective, présent à lui-même, capable de se comprendre comme tel. Le peuple est une création artificielle, très précisément il est créé par le droit et plus précisément encore par la constitution. Il faut relire Cicéron qui, dans La République, distingue et oppose la foule (multitudo), réunion sans forme d’individus, et le peuple (populus) qui, écrit-il, « ne se constitue que si sa cohésion est maintenue par un accord sur le droit »[3]. Le peuple n’est pas seulement une association d’individus, il est une association politique et c’est le génie d’une constitution de transformer une association primaire d’individus en association politique de citoyens.
L’histoire de la formation des peuples est, en effet, celle d’un processus continu et souvent conflictuel d’intégration d’individus, de groupes, de communautés au départ étrangers les uns aux autres et qui, par l’action du droit et des institutions que la constitution établit, vont se trouver liés par des questions communes à débattre et à résoudre, par des règles communes, par des services communs qui, à leur tour, vont développer un sentiment de solidarité qui constitue le peuple politique. Quand, par exemple, Mirabeau veut décrire l’état de la France à la veille de la Révolution, il parle d’une « myriade de peuples » ; et, après 1789, cette « myriade » devient, toujours sous la plume de Mirabeau, « le peuple français ». Ce qui a transformé une multitude en peuple, pour reprendre l’interrogation de Rousseau, c’est la Déclaration de 1789 qui, en constituant les députés « représentants du peuple français », crée d’un même mouvement la représentation et le peuple, liant ainsi l’une à l’autre : les députés ne peuvent se proclamer « représentants du peuple » s’ils ne construisent pas le corps politique qu’ils veulent représenter ; et donc, réciproquement, le peuple ne peut exister que si les représentants le construisent pour exister eux-mêmes. Pouvoir magique de la constitution qui, d’un même mouvement, crée le corps politique du peuple et donne à cette création juridique la sensation étrange d’être le reflet d’une chose – le peuple – qu’elle a produite « en réalité » ! Et cette énonciation constitutionnelle, pour magique qu’elle soit peut-être, n’en est pas moins efficace en ce qu’elle produit des comportements, des règles, des institutions qui lui sont conformes. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 mai 1991[4], qualifie le peuple français de « concept juridique » qui, figurant « depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels, a valeur constitutionnelle » et interdit en conséquence que le législateur puisse faire du peuple corse une composante du peuple français.
Mais la constitution ne produit pas seulement le peuple comme « concept juridique » ; elle produit aussi le peuple comme ensemble d’êtres physiques concrets. Ce qui ressort clairement de cette même décision du 9 mai 1991 où le Conseil précise que « le peuple français est composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ». « Composé » implique, en effet, de comprendre que le peuple n’est pas seulement une entité abstraite mais un ensemble d’individus « réels » disposant de droits qui les font citoyens. Au demeurant, le Conseil s’inscrit parfaitement dans la logique politique de la Déclaration de 1789 qui ne s’adresse pas à une abstraction ou au corps social mais « aux membres du corps social ». Les droits déclarés le sont pour « chaque homme », « tous les citoyens », « les membres de la société » : « l’exercice des droits naturels de chaque homme, pose l’article 4, n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits » ; « tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants » à la formation de la loi, affirme l’article 6 qui poursuit en affirmant que « tous les citoyens » sont égaux aux yeux de la loi ; « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi » – article 7 – et « nul ne doit être inquiété pour ses opinions » – article 10 ; « tout citoyen », dit encore l’article 11, peut donc « parler, écrire et imprimer librement ». En termes clairs, le peuple que la Déclaration met sur la scène politique est « tout un chacun » ; c’est à « tout un chacun » que la Déclaration donne des droits – concourir à la formation de la loi, parler et écrire librement… – et c’est par ces droits que « tout un chacun » devient citoyen. Pour paraphraser Simone de Beauvoir, « on ne naît pas citoyen, on le devient par l’agir constitutionnel ».
Et les déclarations de droits ultérieures renforcent cette logique politique « individuelle » en connectant « tout un chacun » avec sa réalité vécue, avec son environnement social, avec sa singularité. Le préambule de 1946 donne à la femme des droits égaux à ceux de l’homme – alinéa 3 –, au travailleur le droit de participer à la gestion de son entreprise – alinéa 8 –, à l’enfant, la mère et les vieux travailleurs le droit à la protection de la santé – alinéa 11 –, à l’enfant et à l’adulte le droit à l’instruction et à la culture – alinéa 13. Ici, ce n’est pas l’individu abstrait que construit la constitution mais l’individu concret, pris dans sa situation sexuelle, professionnelle, générationnelle… Continuant cette logique, la Charte de l’environnement de 2004 prend l’individu dans son milieu naturel : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » – article 1er –, « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » – article 2 –, « toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » – article 7
Ainsi, la constitution ne fabrique pas seulement le peuple-corps politique ; elle fabrique aussi le peuple des individus démocratiques en donnant à « tout un chacun » les droits qui le transforment et fondent sa légitimité à intervenir et agir dans toutes les sphères de la Cité : l’entreprise, la famille, l’école, l’environnement, la consommation, la santé, la loi,… Le peuple de la démocratie continue se construit et se définit donc par les droits que la constitution énonce au profit des êtres physiques concrets. Et ce mode de construction fait que le peuple de la démocratie continue n’est jamais clos sur lui-même, fondé une fois pour toutes et définitivement ; il reste toujours ouvert, il est un peuple continu en ce que la « liste » des droits qui le constituent s’allonge et se modifie sans cesse. Par cette création continue de droits et libertés, la position du peuple-tout-un-chacun est renforcée dans la mesure où d’une part ces droits bénéficient aux personnes physiques concrètes et où d’autre part la qualité constitutionnelle, c’est-à-dire supérieure à la loi, reconnue à ces droits offre aux individus démocratiques les bases sur lesquelles ils peuvent réclamer contre les lois du peuple-corps-politique.
B) L’espace d’exercice des droits constitutionnels
Quand des hommes s’assemblent, cette réunion produit toujours la nécessité de règles qui fondent leur vie commune et organisent leurs rapports ; qui, pour reprendre l’article 2 de la Déclaration de 1789, les constituent en « association politique ». Il n’est pas de société sans règles. Et, pour reprendre la problématique de Marcel Gauchet, quand ces sociétés sortent de la religion et, plus généralement, de toute forme de transcendance où enraciner les règles d’intégration politique, le seul médium laïc qui reste pour « faire société », pour assurer le maintien, la maîtrise et le destin du collectif – c’est-à-dire, du politique et de l’histoire –, c’est le droit. Dans les sociétés post-métaphysiques, sans droit pas de politique et pas d’histoire. Seulement le vide et l’anomie. Les droits de l’homme n’étouffent ni la politique ni l’histoire. Ils ouvrent, au contraire sur du politique car ils mettent les hommes en relation les uns avec les autres – liberté d’aller et venir, liberté d’expression… – pour construire les règles et ils ouvrent sur l’histoire car ils sont toujours devant nous, à découvrir et à réaliser : l’égalité proclamée en 1789, le logement proclamé en 1946, l’environnement sain proclamé en 2004 restent toujours des droits à venir et non des droits finis sous prétexte qu’ils auraient été proclamés en 1789, 1946 et 2004.
Les droits de l’homme ne sont pas des libertés « fermées » mais des « libertés de rapport », selon l’expression de Claude Lefort[5]. Lorsque l’article 6 de la Déclaration de 1789 reconnaît aux citoyens le droit de concourir à la formation de la loi, il invite les citoyens à entrer en relation les uns avec les autres pour définir la volonté générale ; lorsque l’article 4 définit la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, il invite les individus à prendre en considération l’existence et les droits de l’autre ; lorsque l’article 11 proclame la liberté de communication des pensées et des opinions, il invite moins l’individu à se replier sur lui-même qu’à s’ouvrir aux autres, à se mettre en rapport avec les autres hommes. En d’autres termes, la Déclaration de 1789 fait éclater le système fermé des ordres de l’Ancien Régime et lui substitue un système ouvert. Ce qu’inaugurent les droits de l’homme n’est pas la constitution d’un espace privé dans lequel serait enfermé et s’enfermerait chaque individu mais la création d’un espace public dans lequel le corps et les idées de chaque homme pouvant circuler librement se confrontent nécessairement aux corps et aux idées des autres.
Selon une représentation classique héritée, pour se limiter à la période récente, de la tradition hégélienne, la société serait divisée en un espace civil et un espace politique. Le premier serait celui des intérêts privés, des individus pris dans leurs déterminations sociales, leurs activités professionnelles et leurs conflits ; le second serait celui des institutions publiques, de la représentation, de l’État. Imbriquées pendant toute une période historique, ces deux sociétés se seraient progressivement séparées, l’espace politique « sortant » de l’espace civil pour le gérer, et cette séparation serait la marque de la « modernité ». Dans la forme représentative de la démocratie, le seul lieu légitime de production des règles est la sphère politique-institutionnelle.
À cette représentation efficace mais un peu rustique, il est possible, dans la logique des travaux d’Habermas, de proposer un autre schéma où s’intercale, entre l’espace civil et l’espace politique, l’espace public. Ce dernier peut être compris comme le lieu qui reçoit, par le canal des associations, des mouvements sociaux, des journaux, les idées produites dans l’espace civil et où, par la confrontation et la délibération publique, se construit une opinion publique sur des propositions normatives qui sont ensuite portées dans l’espace politique. Parce que le modèle de la démocratie continue prend sens par l’affirmation de la capacité de l’espace public à produire, par la délibération, les exigences normatives des citoyens et à les imposer, par la mobilisation de ses acteurs, au pouvoir politique, il opère une réduction de l’État et en particulier de sa prétention à se poser comme le « tuteur » de la société. D’où une conséquence juridique importante : la constitution n’est plus constitution de l’État, mais constitution de la société, puisque toutes les activités des individus saisies par le droit peuvent être rapportées à la constitution.
II. Les institutions de la démocratie continue
A) Les assemblées de citoyens
D’abord, les assemblées primaires de citoyens. Ces assemblées regrouperaient tous les citoyens d’une circonscription électorale et la constitution ferait obligation aux parlementaires de soumettre tous les projets et propositions de lois à la délibération de ces assemblées avant qu’ils ne soient soumis à l’Assemblée nationale et au Sénat. Inscrites dans la constitution, ces assemblées primaires de citoyens seraient donc permanentes – à la différence du RIC qui est intermittent – et garantiraient une action continuelle du citoyen sur les affaires de la Cité. Mieux donc que le RIC qui est un faux ami. Puisque tout le monde se réfère à Athènes, il faut rappeler que le lieu de la démocratie, c’est l’agora, que le mode de fabrication des règles de la Cité, c’est la délibération publique, c’est l’exercice public de la raison, de l’argumentation. C’est la mobilisation de l’espace public qui est producteur de lois comme le montre, par exemple, l’adoption de la loi sur l’avortement : les femmes avortent en secret dans l’espace privé ; puis certaines d’entre elles le disent dans l’espace public et cela conduit les juges d’abord (procès de Bobigny en 1971) et les élus ensuite (loi Veil en 1974) à reconnaître le droit pour les femmes de disposer de leur corps. Le référendum favorise les idées reçues, les idées que le système libéral a mis dans la tête des gens et plus souvent encore les émotions. À part quelques exceptions, le registre argumentaire des campagnes référendaires est celui des affects, des instincts, de la peur. C’est vrai en Suisse, au Royaume-Uni, en Colombie ou en Italie où, en 2016, lors de la campagne référendaire sur la réforme de la Constitution italienne, Beppe Grillo, le leader du Mouvement 5 étoiles, a ainsi déclaré : « Faites confiance à vos tripes et ne faites plus confiance à votre cerveau car il vous fait commettre des erreurs »… La délibération favorise l’élévation de la conscience, le référendum conduit à son abaissement.
Ensuite, l’institutionnalisation des conventions de citoyens. La société civile n’est pas animée seulement par ceux qui militent dans un parti politique, collent des affiches, distribuent des tracts, participent aux universités d’été de leur parti ou dépouillent les suffrages le soir d’élections ; ni seulement par ceux qui siègent dans les conseils de parents d’élèves, sont responsables d’une section syndicale, dirigent une société, créent une association de défense des consommateurs ou relancent un club sportif. La société civile est aussi faite avec ceux qui sont sans affiliation partisane, syndicale ou associative, sans appartenance particulière, avec ceux que les autres appellent les « citoyens ordinaires » pour ne pas dire « passifs ». Ces citoyens-là existent mais, puisqu’ils ne sont pas organisés formellement dans des clubs, associations ou syndicats, ils sont insaisissables par les moyens habituels. Pour faire exister institutionnellement les citoyens « actifs », il suffit de s’appuyer sur leurs organisations. Pas simple mais possible. Pour faire exister les citoyens-qui-ne-sont-nulle-part, il faut que la constitution de la démocratie continue consacre un nouvel instrument, le tirage au sort, et une nouvelle institution, les conventions de citoyens.
Ces conventions réunissent une quinzaine de citoyens pour délibérer et produire une proposition normative sur un sujet d’intérêt général. Tirés au sort, ces citoyens reçoivent pendant plusieurs jours une formation contradictoire, neutre et impartiale sur le sujet retenu ; ils auditionnent ensuite les acteurs concernés par la question ; enfin, ils délibèrent à huis clos pour produire leurs propositions qui sont portées devant les assemblées parlementaires pour qu’elles en discutent et décident[6]. Ces conventions s’inscrivent ainsi dans le régime d’énonciation concurrentielle de la généralité caractéristique de la démocratie continue, qui met en œuvre pour la déterminer un échange entre les institutions de l’État – assemblée nationale, sénat, gouvernement –, de la société civile organisée – assemblée sociale – et de la société civile « inorganisée » – les conventions de citoyens. Elles seraient réunies à l’initiative de citoyens au moyen d’une pétition ayant recueilli cinq cent mille signatures, d’un groupe parlementaire ou du Premier ministre.
Des procédures apparemment proches se sont développées ces dernières années sous les appellations « jury populaire » ou « conférence de citoyens » dans la suite des « conférences de consensus médicales », créées en 1977 par l’Institut national de la santé des États-Unis, qui réunissaient des professionnels chargés d’évaluer les incertitudes de certaines pratiques médicales, et reprises en Europe du Nord et notamment au Danemark à l’initiative de l’Office parlementaire d’évaluation de la technologie[7]. Mais ces initiatives ne se déroulent pas toujours selon des règles claires et transparentes, sont parfois prises dans la logique des professionnels de la communication et restent en marge du système de décision. Dès lors que, dans le cadre de la démocratie continue, ces conventions doivent devenir un des éléments du régime d’expression de la volonté générale, il convient de les inscrire formellement dans la nouvelle constitution. Concrètement, elles pourraient être accueillies au sein de la nouvelle Assemblée sociale qui élaborerait un règlement de leur procédure délibérative conforme aux exigences de leur participation à la définition de l’intérêt général.
Toutes les études confirment ce que Sidney Lumet montre dans « Douze hommes en colère » : la transformation progressive, par la délibération, de gens ordinaires en citoyens conscients de devoir sortir de leurs préoccupations personnelles pour chercher la décision juste. À l’encontre du système représentatif qui est l’expression en droit d’une philosophie malheureuse et désespérée de l’homme, la démocratie continue est sous-tendue par l’idée que l’homme se transforme par l’échange et le partage des expériences de vie. L’homme de la démocratie continue est un homme heureux. Parce qu’elle donne son plein effet à la première partie de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ». Le système représentatif ne retient que la deuxième partie : les citoyens concourent à l’expression de la volonté générale « par leurs représentants ». La démocratie continue invite à (re)découvrir la première partie en faisant entrer directement les citoyens par les conventions dans le régime de production de la volonté générale.
Enfin, le statut constitutionnel de lanceur d’alerte civique. En France comme partout dans le monde, la plupart des « affaires » – l’affaire du Mediator, de la banque HSBC, des prothèses mammaires, de la viande de cheval dans les hamburgers, etc. – ont été rendues publiques non par les députés, non par les journalistes mais par des citoyens qui, dans leur institution, dans leur entreprise, se rendent compte de dysfonctionnements, de conflits d’intérêts, de manœuvres obscures et le disent publiquement. Et le disant dans l’espace public, ils obligent les politiques à s’en saisir et à légiférer. Ces lanceurs d’alerte doivent être reconnus comme citoyens et protégés dans l’exercice de leur « métier de citoyen ».
Évidemment, contrairement à une représentation qui en est souvent donnée, ces assemblés et conventions ne seront pas des lieux angéliques où la discussion sur la transformation des exigences sociales en propositions normatives se ferait calmement, à l’abri de la mauvaise foi ou de pratiques manipulatrices. Elles seront un espace social, c’est-à-dire, un espace de luttes, de controverses pour la formation, sur un sujet donné, d’une volonté normative ; un espace où, pour construire une opinion normative, interviennent aussi bien des collectifs de citoyens bénévoles que des grands groupes financiers soucieux de contrer la formation d’une règle contraire à leurs intérêts ; un espace où les médias peuvent aussi bien chercher à imposer la vision des hommes politiques que se saisir, pour gagner ou ne pas se couper de son lectorat, des questions qui agitent l’espace public et participer à l’organisation du débat public. Si la démocratie n’existe que par les luttes dont elle est l’objet, la démocratie continue, elle, ne peut exister que par un espace public vivant, critique, démultiplié, mobilisant sans cesse ses ressources sociales, associatives, intellectuelles pour imposer à l’espace politique des transactions qui fassent droit à ses exigences politiques.
Car ces assemblées et conventions ne seront pas seulement le lieu où se forme la volonté normative ; elles seront aussi le lieu qui, par la mobilisation de ses acteurs, construit une force capable d’imposer à l’espace politique – à l’État, pour aller vite – au minimum la prise en charge des questions sur lesquelles elles se seront mobilisées, au maximum la prise en charge des propositions normatives qui y ont été élaborées. En d’autres termes, l’espace public doit être en mesure de peser, y compris en dehors des moments électoraux, sur l’espace politique pour lui imposer son « agenda », pour le contraindre à répondre aux questions sur lesquelles il s’est mobilisé et si possible dans le sens des propositions qu’il a formulées.
Là aussi, le modèle de la démocratie continue renverse radicalement le schéma de la démocratie représentative : alors que dans celui-ci l’espace politique élabore de manière relativement autonome, par la magie du mandat représentatif, les règles qu’il « déverse » ensuite dans les espaces public et civil, dans celui-là l’espace public, parce qu’il est reconnu comme le lieu où la volonté générale se forme, « déverse » dans l’espace politique ses propositions normatives et le contraint à y répondre. Sans doute l’État ne répond-il pas toujours et nécessairement dans le sens voulu par l’espace public ; sans doute résiste-t-il et oppose-t-il ses propres exigences à celles produites par l’espace public ; mais il est, au minimum, contraint à des transactions.
B) La création d’une Assemblée sociale délibérative
La création d’une Assemblée sociale succédera au et remplacera le Conseil économique, social et environnemental pour devenir une assemblée législative de plein exercice. Cette proposition institutionnelle est la conséquence logique de la place et du rôle de la société civile et du peuple-tout-un-chacun que la démocratie continue leur reconnaît dans l’élaboration de la volonté générale. Contrairement au système représentatif qui fait de la société civile le simple réceptacle de la volonté fabriquée et définie dans l’espace politique, la démocratie continue fait de cette société le lieu où se forme, par la confrontation des expériences de vie, le commun, l’intérêt général. Il convient donc de donner à cette société-là une assemblée qui lui permettra de participer à l’élaboration de la loi.
Dans la culture politique française, l’idée d’une « troisième chambre sociale » a mauvaise réputation. Spontanément, elle est associée à Vichy, aux projets constitutionnels de Pétain, au corporatisme et au fascisme. Ce qui fait beaucoup ! Et ce qui est injuste car elle est présente et depuis longtemps dans la pensée progressiste. Celle, par exemple, d’un Léon Duguit, professeur de droit et collègue d’Emile Durkheim, affirmant en 1895 que « si l’on veut que le Parlement soit une exacte représentation du pays, il faut qu’il soit composé de deux chambres, dont l’une représentera plus particulièrement les individus (la Chambre des députés) et dont l’autre (le Sénat) représentera plus particulièrement les groupes sociaux ; un pays où la double représentation des individus et des groupes n’est pas assurée n’a point de constitution »[8]. La formule est forte et sonne comme le commandement constitutionnel du futur modèle politique. Celle, dans le monde politique, d’un Pierre Mendès-France considérant en 1962 « qu’à côté de l’Assemblée qui exprime les diversités idéologiques et politiques, la présence des groupes socio-professionnels est devenue nécessaire dans une seconde assemblée »[9].
L’identité politique troublée de l’Assemblée sociale renvoie, plus fondamentalement, à la difficulté de penser politiquement la question dite des « corps intermédiaires » et de la société civile[10]. 1789, c’est d’abord l’anéantissement des « corporations », celles qui regroupaient les personnes d’une même profession comme celles qui pouvaient regrouper des citoyens partageant les mêmes idées politiques. Désormais, il n’y a plus d’intérêt intermédiaire entre l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général ; le lien se fait directement entre chaque citoyen pris isolément et l’État ; toute forme qui pourrait séparer les citoyens de l’État est condamnée. Des individus libérés des contraintes des corporations, un État limité à garantir l’ordre « naturel » de la propriété privée et de la liberté du commerce en empêchant le retour des corporations, telle est la synthèse républicaine-libérale qui, avec de multiples nuances, gouverne la France depuis deux siècles. Et qui s’achève aujourd’hui.
La démocratie continue porte une autre synthèse politique dont les premiers éléments s’affirment avec force en 1848 avec la création des ateliers nationaux et de la « commission du gouvernement pour les travailleurs », dite commission du Luxembourg, composée de délégués des travailleurs des différentes corporations et de délégués du patronat, présidée par Louis Blanc et qui a pour fonction d’« étudier toutes les questions relatives au travail et en préparer la solution dans des projets de loi qui seront soumis à l’Assemblée nationale ».
Si la démocratie continue hérite de cette histoire, elle se sépare radicalement des entreprises politiques pour la maintenir dans le cadre de l’État jacobin et affirme la capacité normative de la société civile et donc la nécessité de lui donner une institution pour l’exprimer. Le Tiers-État était tout dans la société mais rien dans l’ordre politique et il n’est devenu quelque chose qu’en imposant la création d’une institution qui l’exprime : l’Assemblée nationale. De même, les collectivités territoriales ont leur assemblée avec le Sénat. Mais pas « les forces vives », selon une expression vieillotte mais qui identifie bien ce qu’elle veut désigner. Les forces qui font vivre un pays, aujourd’hui au XXIème siècle, sont les travailleurs, les cadres, les entrepreneurs ; les forces qui font le succès d’un pays se trouvent dans les entreprises, les banques, les services publics ; les enjeux vitaux pour un pays sont la production et la répartition de la richesse ; les questions vitales sont d’ordre économique, écologique et social. Or, toutes ces forces n’ont pas de Parlement. Et ce manque pèse sur la détermination de l’intérêt général en ce que toutes ces questions sont traitées par l’assemblée politique qui, constatait déjà Mendès-France, les aborde nécessairement sous un angle électoral, concrètement, en fonction des intérêts électoraux des élus locaux. Pour que ces forces vives deviennent visibles, il faut une assemblée qui les présente, qui les fasse monter sur la scène publique et qui leur donne une voix délibérative dans le débat politique concourant à l’expression de l’intérêt général.
Au regard des principes constitutifs de la démocratie continue, cette assemblée sociale aurait deux mérites. Elle ferait droit à la double identité du peuple, le peuple-corps-politique, celui des citoyens abstraits, visible par et dans l’Assemblée nationale et le peuple-corps-social, celui des citoyens concrets se réalisant dans leurs activités professionnelles et sociales, visible par et dans l’Assemblée sociale. Elle favoriserait également l’affirmation d’instruments juridiques de régulation autres que la loi. L’État s’exprime par la loi. Elle est, selon la définition juridique, générale et impersonnelle, et, par ces qualités, elle protège la société de l’emprise des intérêts privés. La formule célèbre « c’est la loi qui libère et la liberté qui opprime » traduit parfaitement cette conviction toujours fortement ancrée dans les consciences que, livrée aux intérêts de ses membres, la société serait violente et qu’elle n’est sauvée que par l’État qui, avec la loi, la libère de l’oppression des intérêts privés. Sans doute pertinente autrefois, cette formule ne l’est plus aujourd’hui quand la société est devenue « fluide », complexe, plurielle, quand cohabitent en son sein des conceptions de vie personnelle et des temporalités sociales différentes. Au point même qu’elle peut s’inverser : l’oppression peut venir de la loi qui, par sa généralité, ne peut saisir la multiplicité des situations particulières, voire peut les contraindre, les soumettre, les asservir en n’imposant qu’une seule conception de vie sociale. Ce que peut vouloir signifier une autre formule, celle de François Mitterrand stigmatisant « la force injuste de la loi », injuste parce qu’elle est impersonnelle et écrase les situations singulières, parce qu’elle est générale et opprime les particularités.
À côté de l’assemblée des territoires – le Sénat – et de l’assemblée de la Nation – l’Assemblée nationale – cette nouvelle assemblée constitutionnelle aurait trois compétences principales : organiser la consultation du public pour éclairer les pouvoirs publics sur les conséquences sociales et environnementales à long terme de leurs décisions ; accueillir les pétitions des citoyens, les analyser avec les pétitionnaires et des citoyens tirés au sort et les transmettre à l’Assemblée nationale et au Sénat pour que ces assemblées répondent à ces initiatives citoyennes ; délibérer avec le Sénat et l’Assemblée nationale sur les projets et propositions de loi.
*****
Dans la typologie classique des systèmes politiques, il est admis, depuis Maurice Duverger, de distinguer trois catégories de démocratie : la démocratie présidentielle, la démocratie parlementaire et la démocratie semi-présidentielle. La première donne à un président de la République élu au suffrage universel le pouvoir de déterminer la politique du pays ; la deuxième donne ce pouvoir à un Premier ministre appuyé sur la confiance des députés et responsable devant eux ; la troisième partage le pouvoir entre un président élu par le peuple et un Premier ministre responsable devant l’Assemblée nationale, l’équilibre entre les deux têtes de l’Exécutif dépendant de la concordance ou non des majorités présidentielle et parlementaire. Jusqu’à aujourd’hui, de révisions en révisions, de commissions en commission, les remèdes à la crise démocratique ont été cherchés dans une de ces trois catégories : durée du mandat présidentiel, nombre d’assemblées parlementaires, mode d’élection des députés, …Toutes propositions sympathiques mais qui relèvent du bricolage inspiré d’une pensée XIXème siècle ! Car elles ont pour unique objet de distribuer autrement les rôles entre les acteurs de la représentation politique alors que l’exigence contemporaine est d’ouvrir aux citoyens les chemins de la fabrique de la loi.
Depuis 2002, l’enroulement des élections présidentielle et législative produit une pratique institutionnelle qui fonctionne sur deux lois simples et non écrites : le pouvoir de déterminer la politique du pays et donc de faire les lois est donné à celui qui gagne les élections ; le pouvoir de sanctionner l’équipe gouvernante ne relève plus du Parlement mais du peuple lors des élections générales qui se déroulent tous les cinq ans.
La question constitutionnelle moderne est donc d’imaginer les institutions qui peuvent faire vivre la démocratie « entre les deux moments électoraux ». Les formes institutionnelles de la démocratie représentative – présidentielle, parlementaire, semi-présidentielle – garantissent aux représentants le monopole de la fabrication de la volonté générale. La forme constitutionnelle de la démocratie continue casse ce monopole et garantit aux citoyens le pouvoir d’intervenir en continu dans cette fabrication. L’enjeu politique de la prochaine révision devrait être ce passage d’une forme institutionnelle et intermittente de la démocratie à une forme constitutionnelle et continue de la démocratie. De passer d’une figure unidimensionnelle du citoyen – celle de l’électeur – à une figure plurielle où le citoyen est tout à la fois électeur, pétitionnaire, lanceur d’alerte, requérant, associatif, … Faut-il rappeler ici ce qu’écrivait Pierre Mendès-France : « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l’État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l’association, de la profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernants (quels que soient les principes dont ils se recommandent), les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de toutes sortes de groupes, sont abandonnés à leurs propres faiblesses et cèdent bientôt soit aux tentations de l’arbitraire, soit aux routines et aux droits dits acquis. Le mouvement, le progrès ne sont possibles que si une démocratie généralisée dans tout le corps social imprime à la vie collective une jeunesse constamment renouvelée. La démocratie n’est efficace que si elle existe partout et en tout temps ». C’était en 1962… ![11].
Pour citer cet article : Dominique Rousseau, « La démocratie continue : fondements constitutionnels et institutions d’une action continuelle des citoyens », Confluence des droits_La revue [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 11 février 2020. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=726

[1] Voir par ex. John Dewey, Après le libéralisme, Climats, 2014.
[2] Siéyès, « Sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale », in Les orateurs de la Révolution française, La Pléiade, 1989, pp. 1026-1027.
[3] Cicéron, La République, Gallimard, p. 45.
[4] CC 91-290 DC, 9 mai 1991, Recueil. p. 50.
[5] Claude Lefort, « Droits de l’homme et Politique », in Libre 7, Payot, 1980.
[6] Sur ces conventions, voir l’étude réalisée par Jacques Testart, Marie-Angèle Hermitte, Michel Calon et Dominique Rousseau et en annexe téléchargeable à cet article, la proposition de loi qui a été portée par la Fondation Sciences Citoyennes (FSC), 2007.
[7] Voir Jacques Testart, Marie-Angèle Hermitte, Michel Calon et Dominique Rousseau, op. cit.
[8] Léon Duguit, Manuel de droit constitutionnel, 1907. Voir également L’élection des sénateurs, RDP, 1895.
[9] Pierre Mendès-France, La République moderne, coll. Idées, 1962.
[10] Voir par exemple Alain Chatriot, « Les apories de la représentation de la société civile », RFDC, 2007, n° 71, p. 535.
[11] Pierre Mendès France,La République moderne, Gallimard, 1962
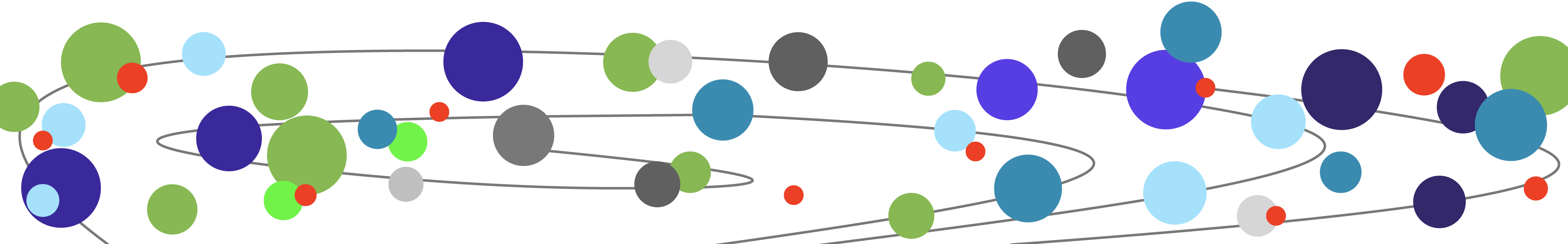




One thought on “D. Rousseau – La démocratie continue : fondements constitutionnels et institutions d’une action continuelle des citoyens”
Comments are closed.