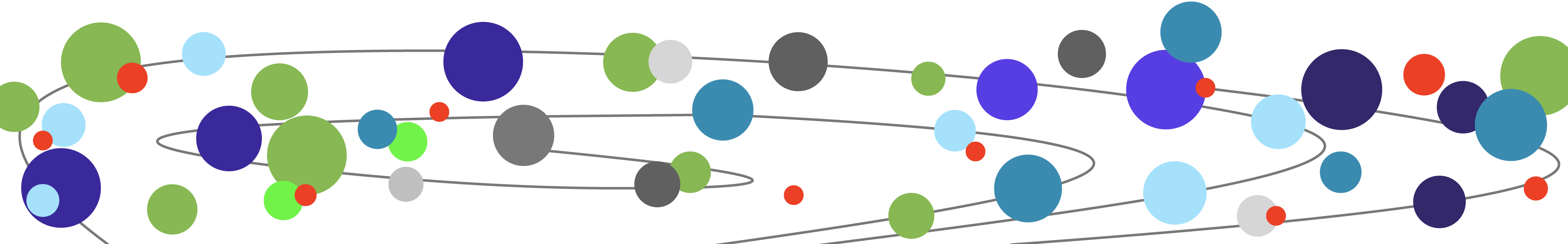Jean-Marie Paugam, Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce
Le présent entretien est adapté du discours prononcé par M. Jean-Marie Paugam à l’occasion de la rentrée solennelle du CERIC le 23 septembre 2023.

Comment faire coopérer des systèmes de valeur et des organisations juridiques différents, des puissances hétérogènes, à partir de règles communes ? Comment s’assurer que tous respecteront ces règles ?
L’Organisation mondiale du commerce a apporté, dans son domaine, des réponses originales à ces questions. Je voudrais vous les commenter en tâchant d’observer le système à travers les yeux d’un personnage qui y joue un rôle important et auquel vous vous identifierez je n’en doute pas : la ou le juriste.
La fin de la guerre froide marquait symboliquement le début d’une nouvelle ère de mondialisation dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd’hui.
La mondialisation est un phénomène géopolitique, traduit par l’intégration progressive des différents marchés mondiaux, celui de la Chine, dont le voyage avait commencé en 1979 avec les réformes de Deng Xiao Ping, celui de l’ex-URSS avec la Prestroïka puis le démantèlement du COMECON, celui des premiers pays émergents, qu’on appelait à l’époque les « tigres d’Asie ».
La mondialisation est aussi un phénomène technologique : la baisse du coût des communications et des transports, qui a permis le découplage des lieux de production et de consommation.
Enfin la mondialisation repose sur une organisation juridique, celle qui permet aux différents marchés de s’interconnecter et aux capitaux de circuler. L’OMC a été créée à ce moment-là, en 1994, en reprenant l’armature antérieure du GATT, qui régissait jusque-là principalement les échanges au sein du bloc occidental. L’OMC a fondé ce que l’on pourrait appeler le droit public de la mondialisation.

Pourquoi faut-il un droit public pour autoriser l’intégration progressive des marchés mondiaux ?
Parce que le marché, ce que les économistes, depuis Adam Smith, nomment « la main invisible », est un phénomène naturel qui ne fonctionne que s’il peut s’ancrer sur une construction culturelle, celle de règles visibles et partagées. Ces règles produisent un bien public indispensable aux acteurs économiques : la prévisibilité et la sécurité juridique des transactions. Une entreprise n’expédiera pas ses biens dans un pays lointain si elle n’est pas certaine qu’elle pourra les y écouler. Pour acquérir cette certitude, elle doit savoir que l’État où elle veut exporter se comportera d’une manière qui lui permette de les vendre, ou en fixant des conditions qui soient claires.
Le droit public du commerce international apporte cette garantie de bon comportement des États souverains, vis-à-vis des opérations du commerce international. Produire ce bien public, la sécurité des transactions, est le premier rôle du droit de l’OMC et, partant, du juriste qui contribue à son élaboration, son interprétation et sa mise en œuvre.
Il ne s’agit pas du tout d’une considération théorique, mais au contraire d’un enjeu quotidien de l’économie mondiale. À chaque crise internationale, quand le rapport de force prend le pas sur celui de droit, comme par exemple lors de la guerre commerciale engagée par le président Trump contre la Chine, ou, pis encore, la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les économistes observent le même phénomène : ce qui provoque les effets récessifs, ce sont moins les conséquences directes des mesures qui sont prises par les États, que celles de l’incertitude qu’elles créent pour les acteurs. Dans l’incertitude, les entreprises suspendent aussitôt leurs actes d’investir et de vendre et se mettent à chercher des solutions, souvent coûteuses, pour assurer leurs transactions contre la défaillance des règles. Lorsque la Russie a interrompu en juillet dernier l’accord sur l’exportation des céréales de la mer Noire, les prix du blé se sont immédiatement envolés, pénalisant des millions de personnes dépendantes des grains ukrainiens et russes pour leur approvisionnement.

De quoi est constitué ce droit public ? Comment parvient-il à rendre interopérables des systèmes de valeur, des systèmes de droit et des systèmes de pouvoir aussi divers que le sont les États souverains qui composent la planète ?
Il le fait à partir de trois principes très simples, une sorte d’équivalent de nos principes généraux du droit dans l’ordre juridique national, qui ont vocation à discipliner le comportement des puissances souveraines dans leur relation aux marchés internationaux : la transparence ; la non-discrimination ; la bonne foi.
Les États acceptent de se conformer à ces trois principes, qui reviennent à dire : dites ce que vous faites, publiez vos actes, informez les autres de vos interventions économiques, par exemple vos taxes et vos subventions. Traitez tout le monde sur un pied d’égalité, ne discriminez pas entre États tiers – c’est le principe de la clause de la nation la plus favorisée – ni entre entreprises étrangères et nationales – c’est le principe du traitement national. Respectez vos engagements, sans les remettre en cause ni en détourner l’application pour créer un avantage indu à vos entreprises.
Par exemple si un État décide de frapper ses importations de sel d’un droit de douane de 100 %, il peut le faire, mais à condition qu’il en informe tous ses partenaires, qu’il ne discrimine pas entre eux et qu’il n’applique pas en douce un tarif de 150 % ; ou, plus subtil, qu’il n’invente pas des catégories discriminantes, en distinguant par exemple le sel de mer et le sel d’océan, pour favoriser ses producteurs nationaux ou ses voisins.
Ici, normalement, notre juriste doit être fier ! Ces principes sont très puissants et, le moins que l’on puisse dire, est que leur architecture juridique est extraordinairement efficace ! Quotidiennement, elle parvient à faire s’entendre des États, petits et grands, ouverts ou moins ouverts au commerce, dotés de systèmes de valeur et d’inspirations culturelles, philosophiques ou religieuses différents, organisés constitutionnellement par des principes démocratiques ou moins démocratiques, reconnaissant des répartitions des rôles extrêmement diverses entre la puissance publique et le marché, pour la production de ce bien commun qu’est la sécurité juridique des transactions entre acteurs commerciaux. Cette architecture a accompagné une expansion historique sans précédent des échanges internationaux.
Bien entendu, la mise en œuvre de ces principes, le contrôle de leur application, font l’objet d’une infinité de développements complexes, qui s’adaptent à la nature particulière de chaque opération du commerce et qui font l’objet des négociations commerciales, via les discussions que nous avons chaque jour au sein de l’organisation. L’OMC a mis au point des traités particuliers pour le commerce des biens, des services, de l’agriculture, de la propriété intellectuelle, des subventions industrielles et j’en passe.
Ici, naturellement, intervient notre juriste. À chaque fois qu’un pays estimera qu’un autre ne respecte pas les règles commencera la discussion visant à établir la violation d’un engagement ou la discrimination.
Et cette discussion pourra in fine être soumise à un mécanisme de résolution des différends. L’originalité de l’OMC était d’avoir créé un mécanisme qui, tout en étant respectueux des souverainetés, possédait une capacité significative de contrainte des États. Les plaintes d’un pays contre un autre étaient d’abord soumises à un panel d’arbitres, sans que le défendeur puisse s’y opposer. En cas de désaccord sur les conclusions des arbitres, la plainte était renvoyée à l’examen d’un Organe d’appel, composé de juristes professionnels. Une fois que l’Organe d’appel s’était prononcé sur les torts et les mérites des parties, le perdant devait s’exécuter en retirant les mesures condamnées ou en acceptant d’offrir des compensations commerciales à la partie gagnante. Voici les grands traits de ce droit public de la mondialisation dont l’OMC fournit le socle de base.

Quels sont les défis qu’il pose au juriste ?
Le juriste se trouve rapidement pris dans une situation compliquée. Son statut est a priori très enviable, car il est le maître du langage et chacun se tourne vers lui pour savoir quelle est la vérité du droit pour régir les comportements. Mais il est maître d’un langage technique, au-dessus, ou à côté duquel, se situe le verbe politique.
Notre juriste n’a pas un rôle prééminent au moment de la négociation des règles. Les négociations sont d’abord une affaire politique, ou des diplomates cherchent à résoudre par la créativité de langage des situations qui, sinon, se révéleraient de pures et simples impasses de négociation.
Un traité, à l’OMC, ça se conclut souvent la nuit, après des heures de tension et de crise, par un texte de compromis qui, très souvent, contient ce que l’on désigne pudiquement par des « ambiguïtés constructives », c’est-à-dire en fait un langage qui permette à tout le monde de clamer la victoire. Le juriste est consulté, bien sûr, sa voix est instrumentale, mais pas décisive. Il n’y a pas dans la société internationale l’équivalent de l’avis du Conseil d’État, ou le filtrage du Secrétariat général du Gouvernement, comme c’est le cas avant transmission d’un projet de loi au conseil des ministres dans notre République.
Et quand la ou le juriste revient en fin de course, au moment où il faut régler les différends qui seront justement nés des ambiguïtés voulues dans les textes, chacun va lui demander au contraire d’interpréter pour clarifier et de trancher le point de droit. C’était le rôle qu’exerçait notre Organe d’appel. Il l’a souvent fait et plutôt bien. Tant et si bien finalement que l’un des grands membres de l’OMC a décidé d’y mettre un terme. Les États-Unis, qui ont abondamment utilisé le mécanisme de règlement des différends de l’OMC – pensez par exemple au cas des subventions à Boeing et Airbus qui a duré plus de 15 ans – ont eu le sentiment que l’Organe d’appel faisait œuvre jurisprudentielle, qu’il tendait à s’ériger en source autonome de droit, dépassant et altérant le contenu des traités souverainement conclus. En un mot, l’Organe d’appel s’érigeait lui-même en souverain.
Dans l’ordre juridique interne, s’il y a conflit entre une décision de justice et une volonté parlementaire, ce conflit est résolu par une modification de la loi. Dans l’ordre juridique international, en tout cas celui de l’OMC, ce conflit ne peut se résoudre car, pour modifier le traité, il faut un consensus de toutes les parties. Autant dire qu’en pratique a pu se créer un déséquilibre mécanique entre la fonction de résolution des différends et celle de négociation des traités. Les États-Unis ont considéré que ce déséquilibre attentait à leur souveraineté et, pour le moment, mis un terme au fonctionnement de l’Organe d’appel.
Vous voyez que notre juriste de la mondialisation est un colosse aux pieds d’argile : il n’a qu’une voix limitée quand il s’agit d’élaborer la règle et il encourt les foudres des États s’il va trop loin dans son interprétation ! L’Organe d’appel de l’OMC a été détruit parce qu’un pays, un seul pays, a trouvé qu’il était allé trop loin dans la judiciarisation des relations entre États.
Et pourtant « elle tourne » ! L’OMC, comme la terre pour Galilée, continue de jouer son rôle de soubassement juridique du commerce mondial, dont l’essentiel des transactions se noue quotidiennement en suivant ses règles, en apportant sécurité et prévisibilité aux entreprises, sans que personne n’y fasse même attention en temps normal.

Pourra-t-elle dans l’avenir continuer à le jouer ? Quels seront les défis qu’affrontera le juriste ?
Nous affrontons différentes remises en cause des bases du droit de la mondialisation, qui entraînent une forme de blocage de l’OMC : certains veulent s’abstraire des règles existantes, d’autres les changer parce qu’elles leur semblent injustes, d’autres enfin leur cherchent des alternatives.
La règle internationale peut devenir insupportable à une société lorsqu’elle affecte son contrat social, ou met en relation deux sociétés aux contrats sociaux trop différents. C’est alors que certains veulent s’en abstraire. L’abolition de la règle internationale devient aisément un étendard pour les partis que l’on appelle populistes : le mal vient d’au-delà des frontières, de l’international. Les populistes sont souvent manipulateurs mais ont-ils complètement tort ? Pas toujours : le commerce, on le sait depuis David Ricardo, crée de l’emploi, de la richesse, de l’efficacité économique, ça en détruit aussi ! C’est le principe des avantages comparatifs, c’est-à-dire de la spécialisation : comme on se spécialise sur ce que l’on fait de mieux relativement, des activités seront sacrifiées par la machine économique. Des activités cela veut dire des emplois et des vies. L’échange est globalement bénéfique, mais il a un coût social.
Il peut y avoir d’autres formes de coûts. Les choix des pays en matière environnementale peuvent être très différents : certains veulent payer plus pour l’environnement, d’autres moins.
L’échange international met donc aux prises des contrats sociaux hétérogènes : quel est le prix que ma communauté nationale accepte de payer en termes de casse sociale ou environnementale pour permettre d’enrichir plus globalement mon économie ? Quels groupes sociaux vont perdre et lesquels vont bénéficier ? Comment vais-je compenser les perdants par mes dispositifs de redistribution et de sécurité sociale ? Chaque pays qui s’engage dans l’échange va formuler les réponses qui lui conviennent, car à la fin chacun sait que sur le long terme il sera gagnant. Mais la confrontation entre les contrats sociaux peut devenir insupportable, surtout à court terme, en particulier si l’on a affaire à des régimes économiques trop différents pour que la concurrence internationale soit considérée comme suffisamment loyale. C’est évidemment le cas aujourd’hui entre les États-Unis, l’Europe et la Chine. Économies de marché d’un côté, économie planifiée de l’autre. État essentiellement neutre vis-à-vis des choix des entreprises, ou État-partie dirigeant leur stratégie : l’affrontement des modèles a commencé.
Car si ces asymétries causent trop de sacrifices économiques au bout d’un moment ça casse ! Les opinions publiques n’acceptent plus le rapport coût-bénéfice de l’échange international et les populistes blâment la règle de droit qui l’organise. Président des États-Unis, le pays qui a inventé le système commercial multilatéral, Donald Trump, dénonce tout ce que l’économie de son pays a perdu au jeu de l’OMC, ignore les traités et engage une guerre économique contre la Chine. Il y a une certaine parenté de mécanique dans le Brexit, même si en l’occurrence ce n’était pas tant le commerce des biens que la circulation des personnes qui était devenue insupportable à l’opinion britannique. Mais la conséquence n’était pas si différente : c’est la règle européenne qui fut rejetée. À des intensités variables, cette question se pose pour chaque accord commercial : sous l’angle social ou sous l’angle environnemental on la retrouve par exemple sous-jacente dans les réactions politiques que suscite l’accord conclu entre l’Europe et l’ensemble du Mercosur, que certains pays veulent faire entrer en vigueur et d’autres, comme la France, refusent. Notre couple de juristes se trouve face à un problème fondamental de légitimité de la règle de droit international auquel il ne peut pas répondre grand-chose, car la réponse est extra-juridique.
Après les frottements entre contrats sociaux vient le deuxième grand défi : celui que je nommerai un peu pompeusement le retour de l’Histoire. La règle de droit à l’OMC a été historiquement conclue entre des pays économiquement avancés et de niveau relativement homogène. C’étaient, pour simplifier un peu, les pays de l’OCDE avec les grandes puissances industrielles du G7 jouant un rôle moteur en leur sein. On en était à peu près là au sortir de la guerre froide, à la création de l’OMC, au moment où l’américain Francis Fukuyama énonçait « la fin de l’histoire », concept qu’il empruntait d’ailleurs sans trop le dire, au philosophe français Alexandre Kojève, qui l’avait lui-même formulé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le monde allait donc s’homogénéiser sur les standards de la démocratie de marché à l’occidentale. Les économistes du « consensus de Washington » ajoutaient : « libéralisez les échanges et les niveaux de vie convergeront ».
Et dans une assez large mesure cela s’est produit et continue de se produire sous nos yeux. Au xvie siècle, Le Caire, Mombassa, Istanbul, Ispahan, New Delhi, Pékin, Mexico – ou Tenotchitlan ! – se situaient au même niveau de développement qu’Amsterdam, Paris, Berlin, Madrid ou Londres, jusqu’à ce que ces puissances européennes ne décrochent des autres avec la révolution industrielle. La mondialisation ferme progressivement cette grosse parenthèse historique et l’on vit aujourd’hui le retour à cet équilibre antérieur, ou de très grandes puissances régionales, de poids équivalent, rivalisent ou coopèrent pour structurer la société internationale. Le retour de puissance de ces nouveaux grands, qu’on appelle aussi les émergents, qui sont symbolisés par les « BRICS », débouche sur une critique frontale de certaines règles de l’OMC, qui sont jugées déséquilibrées à leur détriment.
Dans certains cas seulement, parce que la plupart du temps des grandes puissances émergentes ne rejettent pas les principes généraux de transparence, non-discrimination, bonne foi. Mais ce qu’ils veulent est un rééquilibrage des situations acquises, qui favorisent les pays anciennement industrialisés. L’Inde est l’avocat le plus vocal de ce camp-là, mais elle n’est pas seule.
Vous avez peut-être suivi, par exemple, un conflit qui s’est développé à cet égard sur l’accès aux vaccins et aux médicaments durant la crise du COVID : de très nombreux pays en développement y ont rejeté la protection des droits de propriété intellectuelle à l’OMC, au nom de l’urgence de la lutte contre la crise sanitaire. La recherche et les brevets étaient au nord, mais l’immense cohorte de populations malades et sans accès au vaccin était au sud. On avait connu un conflit analogue vingt ans plus tôt pour les traitements contre le SIDA. L’OMC a mis des années à trouver un compromis sur ce conflit des brevets.
Ce n’était pas simplement un différend de juristes : les juristes du nord et du sud savaient parfaitement ce que disait la règle de droit. C’était un autre conflit, sur la légitimité de la règle elle-même, son rapport à une conception de la justice. Or des conflits de ce type, l’OMC comme toute la société internationale en connaît beaucoup. Le commerce agricole en est l’un des terrains privilégiés : pour garantir la sécurité alimentaire de chacun faut-il davantage de liberté des approvisionnements, ou davantage de soutien à la production ? Comment concilier les deux à la satisfaction de chacun ?
Tout ce qui a trait à la répartition des droits et des responsabilités des nations face à la gestion des biens publics globaux, la santé, le climat, la biodiversité soulève des conflits fondamentaux qui se superposent souvent, mais pas toujours, à la ligne de fracture du développement et des intérêts des nouveaux géants émergents.
Enfin, le retour de l’histoire c’est aussi celui de la sécurité, au sens le plus classique. Montesquieu avait-il vu juste ? Le « doux commerce » produira-t-il assurément la paix ? Rien n’est moins certain aujourd’hui, vous le savez, en particulier depuis la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, deux membres qui avaient accédé en même temps à l’OMC. Sans aller jusqu’à la guerre, les tensions géopolitiques interfèrent de manière croissante dans le commerce international, sous forme de régimes de sanctions, de mesures destinées à contrôler les composants stratégiques des armes et des industries du futur.
Que constatent alors nos juristes ? Que ces lignes de fractures qui traversent les rapports entre sociétés aboutissent à un blocage de la coopération multilatérale : on remet en cause la règle de droit existante, on arrive très difficilement à en négocier de nouvelles. Il y a deux conséquences à cet affaiblissement.
La première est que le fait prend le pas sur le droit, la règle devient progressivement obsolète par rapport à l’évolution de l’économie. Celle-ci connaît aujourd’hui deux transformations fondamentales : la digitalisation et la décarbonisation. Or, à l’OMC nous n’avons pas encore de règles globales régissant le commerce électronique, encore moins les outils de la lutte contre le changement climatique. Les nations vont réguler mais sans coopérer : le risque est celui de la discrimination qui viendra fragmenter le système et accroître l’insécurité juridique pour les entreprises. À terme, des pertes de bien-être pour tous.
Prenons l’exemple de la lutte contre le changement climatique : États-Unis et Europe ont, sans se concerter, adopté deux approches radicalement opposées. L’Europe a décidé d’augmenter le prix du carbone, c’est-à-dire fondamentalement de taxer ; les États-Unis ont choisi de baisser le prix des alternatives au carbone, c’est-à-dire de subventionner. Dans les deux cas, il y a des risques de discrimination pour les entreprises, qui pourront pénaliser justement leurs investissements dans la transition vers une économie décarbonée.
L’autre conséquence est que des règles se réinventent sous des formes diverses. On les trouvera par exemple dans les accords de libre-échange que conclut l’Union européenne avec des pays tiers : on y parle commerce électronique et climat, même parfois normes sociales. Vous trouverez aussi toute une génération spontanée de règles privées, parfois articulées par un secteur professionnel, pour édicter comment les entreprises doivent se comporter à l’international : quels standards doivent-elles suivre, quelles responsabilités doivent-elles assumer ? Parfois, ces normes d’origine privée sont sanctionnées par un label commercial : par exemple « commerce équitable », ou « produit d’une exploitation durable »… On trouve aussi toute une gamme de régulations publiques, plus ou moins contraignantes, que les juristes appellent parfois le « droit mou » ou la « soft law ».
Évidemment notre couple de juristes se sent un peu perdu face à ces dynamiques : pour lui le droit public du commerce c’était des traités « durs », du droit à la romaine, universel, qui s’imposent via un mécanisme de règlement des différends. Que faire de ces sources alternatives de droit, qui sont proliférantes ? Peuvent-elles régénérer la coopération internationale ? C’est une question que la prochaine génération aura à résoudre : face au blocage du système multilatéral et si celui ne parvient plus à faire émerger de régulations pures et classiques, faudra-t-il privilégier des alternatives, des normes hybrides, pour traiter les enjeux du futur ?
Personnellement je réponds oui. L’accord de Paris contient par exemple un modèle qui pourrait trouver des applications intéressantes dans certains domaines à l’OMC : il est fondé sur l’adoption d’un objectif commun, limiter le réchauffement à deux degrés, et la responsabilité individuelle pour sa mise en œuvre, ce que l’on appelle les contributions déterminées nationalement. Beaucoup sont sceptiques sur l’efficacité. Mais à l’heure de l’extrême urgence pour affronter les défis globaux, qui hésitera longtemps entre une telle norme et l’inaction ?
Donc la voici, le voici, notre juriste, nos publicistes de la mondialisation. Ils avaient rêvé d’un droit produit et objet de la coopération entre nations. Ils rencontrent des forces tectoniques qui s’opposent : le réveil des ressentiments historiques, la résurgence des conflits géopolitiques, les divergences entre systèmes de valeurs et systèmes économiques, la prolifération des régulations, l’irruption d’acteurs et de normes privées dans la gouvernance.

Que vont-ils faire ? Baisser les bras ? Cultiver candidement leur jardin de droit interne ?
La tentation est forte, d’autant qu’elle est nourrie par les postures populistes que j’évoquais, suggérant que si l’on abandonnait la coopération internationale on se porterait mieux. Et de flirter aussitôt avec le concept de démondialisation, parfois pour s’en réjouir, parfois pour le devancer, en imaginant une économie mondiale qui se cloisonnerait à nouveau sur les marchés nationaux ou de grands ensembles régionaux. Les rapports de force entre blocs y reprendraient le pas sur les règles.
Je réfute cette vision mais lui reconnais un point : je crois, pour paraphraser Malraux, que « la mondialisation sera juridique ou ne sera pas ». Je ne crois pas que la désintégration radicale des marchés mondiaux se produira. Il y aura des retours en arrière dans certains domaines. Il y aura des détours, en particulier là où les batailles industrielles seront les plus vives pour maîtriser les technologies du futur. Aussi là où les enjeux de ces technologies seront les plus fulgurants pour les emplois d’aujourd’hui, pour l’équilibre des contrats sociaux, pour l’équilibre géopolitique des puissances.
Mais au fond, une démondialisation aurait trop de conséquences récessives insupportables pour le monde. Conséquences immédiates, car le recloisonnement des marchés priverait sans délai l’économie internationale d’un moteur indispensable pour espérer tirer de la pauvreté les centaines de millions de personnes que la croissance démographique de la planète engendre. Conséquences différées, parce que la coopération internationale est seule capable de permettre à l’humanité d’affronter efficacement les défis globaux qui la menacent et pourraient détruire son économie ! Changement climatique, épuisement de la biodiversité et des océans, sont par nature transfrontières et ne peuvent être résolus dans un cadre souverain.
Donc nos juristes vont avoir du pain sur la planche. Ils auront à développer des réponses et des techniques juridiques nouvelles, tout en puisant dans le savoir ancien, entre autres celui de l’OMC. Il appartiendra aux juristes, et notamment aux plus jeunes, d’y réfléchir. Leur génération aura à trouver les voies de la coopération internationale pour préserver les biens communs de la planète : la vie elle-même, face au changement climatique ; la justice, face aux inégalités économiques globales ; la liberté, face aux nouveaux visages et moyens technologiques de l’oppression.
Propos recueillis par Romain Le Bœuf le 15 septembre 2023, Professeur de droit public, Aix Marseille Université, Université de Toulon, CNRS, DICE, CERIC, Aix‑en-Provence, France.
Jean-Marie Paugam, « Entretien — Un droit public de la mondialisation ? L’organisation mondiale du commerce et ses défis », Confluence des droits_La revue [En ligne], 12 | 2023, mis en ligne le 12 décembre 2023, URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2535.