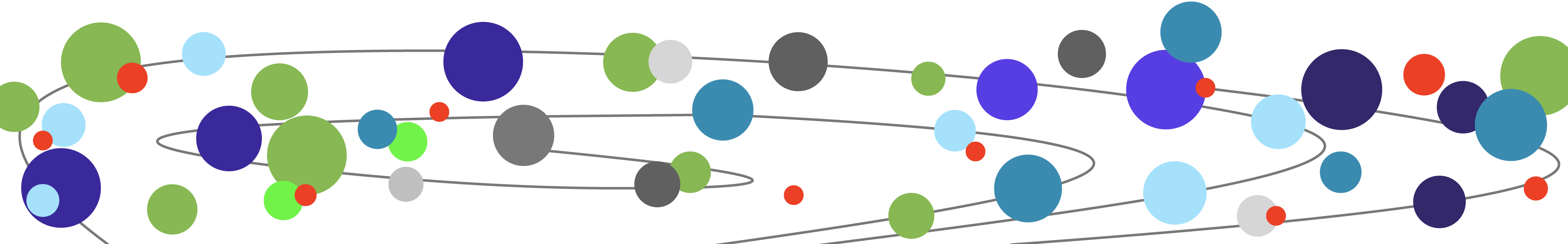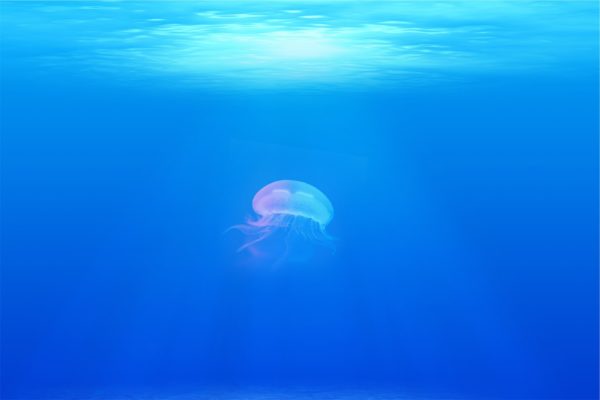Laurence Burgorgue-Larsen
Professeure de droit public à l’École de droit de la Sorbonne (IREDIES)
À partir d’un moment historique avéré, le colloque de Besançon de novembre 1970 qui avait pour objet de convaincre les autorités françaises de ratifier la Convention européenne, le récit bifurque pour présenter une uchronie qui entend montrer les conséquences néfastes d’une France qui n’adhère pas aux valeurs conventionnelles. La France tombe de son piédestal ; elle est isolée et tombe dans les affres de la prédation territoriale. La conséquence ne se fait pas attendre, elle est mise au ban de la société des nations européennes.
Branching off from the proven historical moment of the Besançon conference of November 1970, which aimed to convince the French authorities to ratify the European Convention, the narrative presents an alternative history that illustrates the harmful consequences of France not adhering to the Convention’s values. France falls from its pedestal ; it is isolated and falls prey to territorial predation. The consequence is swift : it is sidelined by the community of European nations.
Besançon, novembre 1970. Le colloque bat son plein. Tous les défenseurs d’une « France européenne » se sont retrouvés dans cette ville du Doubs au charme suranné. Si la salle qui les accueille est un amphithéâtre à l’allure sobre, sans l’apparat des nombreux « palais » de la République – du Palais de l’Élysée en passant par le Palais Royal – sa configuration permet néanmoins que les débats se déroulent de façon efficace. L’atmosphère y est chaleureuse, les participants sont conscients de l’importance des enjeux. Sous la houlette de l’Institut international des droits de l’homme – dont la création a été rendue possible grâce aux ressources provenant de l’attribution du Prix Nobel de la paix au Bayonnais René Cassin en 1968 – il s’agit en effet de démontrer que les obstacles avancés par la sphère gaullienne à une ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales peuvent aisément être surmontés. Tout semble prêt pour faire bouger les lignes, enfin.
Au milieu des universitaires, entourés d’un parterre d’étudiants chevronnés, mais également de quelques vieux briscards de la politique, deux quadragénaires membres du Conseil d’État se détachent. Fidèles aux idées que le Maître bayonnais n’a eu de cesse de défendre tout au long de sa vie – et plus particulièrement depuis qu’il a été propulsé juge à la Cour européenne en 1959 – Roger Errera et Nicole Questiaux sont « chargés de déminer le terrain » à Besançon1. Âgés respectivement de 37 et 40 ans, leur parcours au sein de la juridiction administrative suprême est marqué du sceau de l’excellence. Sortis tous les deux « dans la botte » du concours de l’École Nationale d’Administration – le bijou institutionnel voulu par le Général – ils intègrent naturellement l’antre du droit administratif. Nicole Questiaux s’y distingue, notamment, pour avoir été la première femme, en 1963, à devenir « Commissaire du Gouvernement »2, tandis que Roger Errera ne cesse de jongler avec plusieurs fonctions au sein du Conseil d’État comme à l’extérieur de celui-ci. Leurs carrières ne se résument point toutefois à la fulgurance de la perfection et l’éminence de leurs fonctions, l’engagement en faveur de la garantie des droits y est tout aussi important. Roger Errera, né à Paris en 1933, est le fils d’un émigré issu de la communauté juive de Salonique qui doit fuir la Grèce, persécuté du fait de son activité de journaliste critique. En France, sous l’occupation, le sort continue de s’acharner sur sa famille. Au désarroi de l’exil, s’ajoute l’injustice de la spoliation. Exode et persécution antisémite, tels sont les affres de la famille Errera3. Quant à Nicole Questiaux, ses convictions socialistes l’animent sa vie durant et imprègnent sa vision du droit qui doit combattre l’arbitraire et embrasser l’idéal de justice sociale.
Ces deux brillants juristes, engagés, sont donc venus à Besançon en service commandé. La Convention européenne – dont l’élaboration fut portée à bout de bras par le démocrate-chrétien et ancien résistant Pierre-Henri Teitgen ; dont la signature fut acquise en France dès le 4 novembre 1950, jour de son adoption à Rome – ne parvient pas toutefois à passer le cap de la ratification. La France dénote par rapport à ses alter ego européens que sont le Royaume-Uni et l’Allemagne qui la ratifiaient respectivement en 1951 et 1952. Il faut donc remédier à cette ineptie, continuer à ouvrir les esprits, marteler les avantages d’un ancrage de la France dans l’Europe des droits de l’homme et écarter les critiques nationalistes. La guerre d’Algérie et la querelle scolaire avaient eu raison de cette ratification pendant les années 1960 ; le début des années 1970 semble ouvrir une nouvelle ère. La défiance à l’égard du contrôle international s’est dissipée, le contexte des guerres coloniales s’est éloigné. Il convient, une fois encore, d’expliquer et convaincre. Roger Errera se charge de déminer le rapport à la religion, expliquant que la laïcité n’est pas malmenée, tandis que Nicole Questiaux rassure sur la compatibilité de l’article 16 de la Constitution avec la Convention.
Contre toute attente, leurs discours raisonnés et argumentés ne sont pas parvenus à tempérer, ni faire faire disparaître les oppositions. Les personnalités politiques présentes – des communistes et des gaullistes – s’emportent, jouent les trublions, impressionnent et influencent les jeunes étudiants sensibles à leurs arguments. Pis, ils réussissent à convaincre les membres de la Ligue des droits de l’homme que l’article 9 de la Convention sur la liberté de religion est l’emblème d’une « Europe vaticane ». Un jeune stagiaire en poste au Quai d’Orsay, venu incognito afin d’écouter les échanges, retourne à Paris et transmet illico à l’Élysée une note diplomatique secrète relatant l’ambiance électrique du colloque de Besançon. Sa conclusion ne prête guère à discussions : la classe politique française n’est pas encore prête pour le grand saut juridique. Il fit passer sa note par l’intermédiaire d’une de ses amies d’enfance, qui était la maîtresse d’un membre influent du gouvernement. Guy de Lacharrière, directeur juridique du Quai d’Orsay, découvre le pot aux roses. Il s’en offusque et le fait savoir à qui de droit. Il n’imagine pas un seul instant toutefois que le ver est dans le fruit ; que les travaux parlementaires sur la ratification qui, jusque-là, avançaient à un rythme satisfaisant, vont dérailler. Le stagiaire, la maîtresse et le ministre, forts de leurs nombreux relais au sein de la machine parlementaire, réorientent magistralement le cours de l’Histoire. Quatre ans de manœuvres machiavéliques, de coups bas, de trahisons et de chantages eurent raison de la ratification. Le vote fut bloqué au niveau du Sénat.
1974 est un séisme politique inégalé. René Cassin, qui n’avait eu de cesse au milieu des années 1960 de menacer de démissionner de son poste de juge à la Cour européenne si la France ne ratifiait pas le texte4, n’hésite pas cette fois-ci et met sa menace à exécution. Figure internationale de la défense des droits, blessé de la Première Guerre mondiale, conseiller juridique du Général de Gaulle pendant la seconde, promoteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, récipiendaire du Prix Nobel de la paix en 1968, sa démission fait la « Une » des journaux du monde entier. La France n’est plus la France : le pays de Voltaire tombe de son piédestal. Les gros titres des quotidiens ne laissent pas de place au doute : El País titre gravement « El emblemático Cassin se rebela cuando Francia rechaza los derechos humanos » ; le Corriere de la Serra est alarmiste « I diritti umani sono a rischio in Francia », tandis que le New York Times pense déjà à la suite, « French Senate blocks ECHR ratification. What next? ».Le pays qui a inspiré moult révolutions à travers le monde depuis 1789 ; s’est engagé dans la construction des « États-Unis d’Europe » après 1945, montre à la face du monde qu’il refuse la garantie internationale des droits mise en place après l’indicible horreur de la Shoah.
Cette indignation des pays occidentaux n’est pas celle des pays du Tiers-Monde, trop habitués – pour certains d’entre eux – aux turpitudes de l’ancien colonisateur. Jeune Afrique ne s’indigne ni s’étonne de la volte-face sénatoriale. La France sent le soufre de Dakar à Abidjan en passant par Ouagadougou ou encore Bangui. Les capitales d’Afrique de l’Ouest et du Centre n’ont-elles pas vu régulièrement débarquer le « Monsieur Afrique » du Général de Gaulle, Jacques Foccart, le « Prince des Ténèbres » – The man who ran Africa – pour continuer, sous des allures pseudo-diplomatiques, à orienter et téléguider la politique des gouvernements africains ; à adouber des régimes autoritaires, dès lors que les intérêts économiques de l’Hexagone étaient préservés ? Le pays des Lumières ne brille plus depuis longtemps sur le continent du « Rhinocéros d’or »5. Les turpitudes de la Françafrique sont connues de tous. Que le Palais qui se dresse sur les flancs du Jardin du Luxembourg ait bloqué le processus de ratification de la Convention européenne est la suite logique d’une politique juridique extérieure marquée par le culte de la préservation des intérêts vitaux. La protection des droits de l’homme n’en fait pas partie. Au moins, l’hypocrisie n’est plus de mise. La presse africaine, dans un concert unanime, considère que la France ne pourra plus délivrer des leçons démocratiques à tour de bras.
Du côté du bloc communiste, l’éditorialiste vedette de la Pravda, Vladimirovich Poutinievskaïa, est aux anges. L’Ouest est touché en plein cœur. Le Conseil de l’Europe, mécano intergouvernemental créé en pleine guerre froide, avec l’ambition de s’ériger en parangon de vertu démocratique, prompt à brandir les valeurs libérales à la face de l’URSS de Staline, puis de Khrouchtchev et enfin de Brejnev, essuie sa première grande défaite. La non-ratification de la Convention européenne par la France marque la fissure du bloc occidental sur le continent européen et, au-delà, à travers le monde. La France est rapidement bannie du cercle des États vertueux. Son ostracisme politique a des effets délétères sur le terrain diplomatique. Le processus d’intégration européenne en est profondément affecté. Le couple franco-allemand implose ; l’Allemagne du Chancelier Willy Brandt décide promptement de forger une nouvelle alliance stratégique avec le meilleur ennemi de l’Hexagone, le Royaume-Uni. L’axe diplomatique entre Londres et Bonn efface à la vitesse de l’éclair celui qui s’était noué entre Paris et la capitale ouest-allemande. La France n’est plus en odeur de sainteté, à telle enseigne qu’elle perd toute son influence au sein des institutions des Communautés économiques européennes. Déjà fragilisée par la « politique de la chaise vide » – marquée par le culte gaullien de l’intérêt vital – elle n’arrive pas à réparer son image et imposer son influence. Quant à sa puissance, elle n’est plus qu’un lointain souvenir. Le droit communautaire s’élabore sans qu’elle puisse l’orienter ; ses intérêts nationaux, pourtant si précieux à ses yeux ne sont plus défendus. Elle est prise à son propre piège. Ostracisée en Europe, elle l’est également à l’échelle du globe. Les diplomates du Quai d’Orsay ont perdu de leur superbe ; ils n’inspirent plus le respect dans l’univers policé des rencontres et autres sommets internationaux ; ils ne sont plus sollicités pour jouer les bons offices lors de la survenance de crises internationales.
La France est hors du monde ; sa voix ne porte plus. Elle se vide de ses plus grands esprits qui, après les désastres du xxe siècle, avaient cru pouvoir y trouver un havre de paix, un refuge éclairé. Ceux qui ont fait sa grandeur, ses Français d’origine étrangère, repartent sur les chemins de l’exil. Vidée de ses plus grands écrivains, poètes, musiciens et chanteurs, l’aura culturelle du pays s’évanouit. Vidée de ses plus grands philosophes, juristes, scientifiques, elle ne réussit plus à innover et créer. La paupérisation du pays est en marche. Anéanti par la perte de ses repères moraux, le pays accouche d’une piètre classe politique, plus intéressée à maintenir ses privilèges qu’à défendre des idéaux. Courtisée par le bloc communiste – de Moscou en passant par La Havane et Luanda – la France succombe à la culture du parti unique ; étouffe la moindre dissidence et fait du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures son maître mot diplomatique. L’éditorialiste vedette de la Pravda considère alors que le moment est opportun pour s’y installer. Il prend ses quartiers dans le 8e arrondissement de Paris, non loin du siège de la Cathédrale Saint‑Alexandre-Nevsky, l’antre de la culture orthodoxe à Paris. De journaliste inféodé à la ligne du parti à Moscou, il s’autoproclame homme politique à Paris après une procédure expresse de naturalisation. Bénéficiant de la corruption généralisée de la classe politique, de l’étouffement des contre-pouvoirs et de la disparition forcée des opposants politiques, Vladimirovich Poutinievskaïa brigue la magistrature suprême. Le soir du 10 mai 1990, il devient président de la Nouvelle République communiste de France. Premier président français d’origine russe, il marque irrémédiablement l’Histoire du pays. Isolé dans son Palais, arrogant et belliqueux, il est prompt à s’en prendre à ses voisins. Ses discours sont clairs, ses menaces à peine voilées, mais personne ne semble s’en soucier : quiconque osera empiéter sur ce qu’il considère être son espace, subira les foudres de l’invasion suivie de l’annexion. Alors que l’Espagne, libérée de la férule du Général Franco, fière de son ancrage démocratique européen, décide de rappeler son ambassadeur suite à une énième provocation à la frontière des Pyrénées, l’impensable se produit. Ordre est donné de lancer les chars français sur le Pays basque espagnol. Saint-Sébastien est rasée, Guernica bombardée. L’Histoire est de retour en Europe. Le tragique aussi. La désolation retrouve ses droits ; les humains perdent les leurs. Le Conseil de l’Europe, qui avait trop longtemps fermé les yeux sur les multiples égarements de la présidence de « Poutiniev » – comme on se plaisait à le surnommer dans les milieux autorisés – finit par déclencher la procédure de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe. La France est exclue de l’organisation paneuropéenne, mise aux bans du concert des sociétés démocratiques. Un véritable cauchemar, une catastrophe.
1 E. Decaux, « La France et la Convention européenne des droits de l’homme : un peu, beaucoup, passionnément », RQDI, Hors-série, 2020, p. 258.
2 [https://www.conseil-etat.fr/actualites/portraits-de-femmes-du-conseil-d-etat-journee-du-8-mars].
3 [http://www.rogererrera.fr/biographie/].
4 Il s’agissait en effet d’une époque où il était possible pour un juge de siéger au sein de la Cour européenne alors que son État n’avait pas ratifié la Convention.
5 F.-X. Fauvelle, Le Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain, Paris, Tallandier, 2022, 398 p.
Laurence Burgorgue-Larsen, « Quand la France refuse de ratifier la Convention européenne des droits de l’homme », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4605.