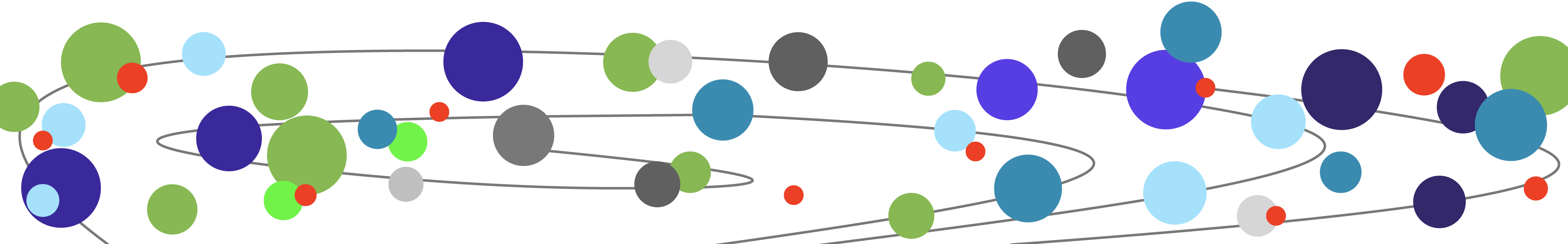Julien Bonnet
Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP, Président de l’Association française de droit constitutionnel
Et si le Conseil d’État avait accepté de contrôler la constitutionnalité des lois promulguées dans l’arrêt Arrighi rendu en 1936 ? Envisager une telle uchronie implique une immersion dans le contexte de l’époque, à travers les hésitations de Latournerie, les débats doctrinaux de la IIIe République et les influences historiques déterminantes. Sur le fondement d’une méthodologie de l’uchronie, l’étude envisage les points de bascule qui permettent d’envisager l’hypothèse. Enfin, les conséquences potentielles qu’aurait pu provoquer une telle décision du Conseil d’État sont analysées, à travers trois scénarios : une frénésie constitutionnelle, une révolution silencieuse, ou une réaction politique hostile.
What if the Council of State had agreed to review the constitutionality of laws in the ‘Arrighi’ ruling handed down in 1936? To consider such a counterfactual scenario, we must immerse ourselves in the context of the time, through Latournerie’s hesitations, the doctrinal debates of the Third Republic, and the decisive historical influences. Based on a methodology of alternate history, the study considers the tipping points that make it possible to envisage this hypothesis. Finally, the potential consequences of such a decision by the Council of State are analysed through three scenarios: constitutional frenzy, silent revolution, or hostile political reaction.
Marty Mc Fly, Retour vers le futur, 1985.
Je vois que vous n’êtes pas encore prêts pour ce genre de chose mais par contre vos gosses vont adorer.
Conception française de la séparation des pouvoirs et légicentrisme : ces quelques mots suffisent pour décrire la charpente du droit français. Ils expriment les modalités particulières du constitutionnalisme français, mais également, en cascade, la conception dominante de la représentation des sources du droit et de la hiérarchie de légitimité des organes, dès lors que le juge, soumis aux mots de la loi, devrait seulement leur rendre grâce sans pouvoir s’en écarter. L’effet structurant de cette représentation du droit, en dépit de ses limites, a pour origine l’absence de contrôle de constitutionnalité des lois par les juridictions judiciaires et administratives. Bien que le refus des juges se soit clairement exprimé clairement depuis les origines, l’étendard jurisprudentiel est sans nul doute l’un de ces arrêts que tout étudiant a entendu prononcer sur les bancs des facultés de droit : Arrighi. Du nom de l’affaire tranchée par le Conseil d’État le 6 novembre 19361, dont l’un des passages répond au « moyen tiré de ce que l’article 36 de la loi du 28 février 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles » de la IIIe République. Par une formule sibylline dont le Conseil d’État a le secret, le juge répond « qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».
Encore en vigueur et solidement installée malgré la multiplication des dérogations et des nuances (interprétation conforme de la loi, contrôle de conventionnalité, abrogation implicite, écran législatif transparent, QPC…), la jurisprudence Arrighi est un pilier inébranlable de notre droit2.
Dès lors, comment faire « sans Arrighi », sans que l’édifice s’effondre, comment penser un futur alternatif alors que l’origine et les conséquences de cet arrêt semblent irrémédiables ? C’est tout l’intérêt de la démarche uchronique qui permet d’interroger les nœuds de l’histoire en déconstruisant l’évidence du fait accompli. En effet, la patine du temps transforme le hasard en irrémédiable, l’hésitation de l’instant en routine. Refaire le chemin en envisageant un autre avenir recèle donc une force explicative incontestable, grâce à la remise en cause du fait accompli, défini par Charles Renouvier, pionnier de l’uchronie, comme l’illusion de « la nécessité préalable qu’il y aurait eu à ce que le fait maintenant accompli fût, entre tous les autres imaginables, le seul qui pût réellement s’accomplir »3. Érigée au rang de pierre angulaire du droit français, et pas seulement du droit public, la jurisprudence Arrighi, dont l’équivalent judiciaire en termes de renommée renvoie aux conclusions Matter4, semble une fatalité à laquelle nous n’aurions pu échapper. Justement, en tant qu’« antidote à l’illusion de la fatalité »5, l’uchronie introduit « dans le cours de l’histoire des déterminations différentes et en insérant la causalité libre des volontés humaines au sein de la causalité naturelle des “tendances invincibles”, nous rendons au devenir historique ce qu’il contient d’ouvert et de possible »6.
S’aventurer dans une uchronie de la jurisprudence Arrighi mérite quelques justifications et préalables, car la prise de décision d’un juge n’est pas un évènement inattendu, factuel et soudain. Pour autant, l’uchronie est un « instrument de mesure de la place de l’action humaine dans l’histoire »7. Ainsi, l’arrêt Arrighi demeure une « décision » qui peut se prêter à l’uchronie en raison des hésitations palpables au moment du choix opéré par les membres du Conseil d’État (I). Une fois le cadre de réflexion précisé, il sera temps d’envisager les scénarios d’un avenir qui n’a pas eu lieu (II), ce qui permettra, chemin faisant, de revenir sur l’origine et les fondements de la jurisprudence Arrighi, d’en dévoiler les forces, les faiblesses, la part de hasard et peut-être aussi de faire émerger une nouvelle manière de raconter l’enchaînement des évènements qui a conduit à l’état actuel de notre droit public.
I. Les spécificités d’un carrefour de l’histoire du constitutionnalisme français
Monument jurisprudentiel. Écoutons Bruno Genevois : « Lorsque l’Assemblée générale du Conseil d’État examina au cours de l’été 1958 le projet de Constitution, Roger Latournerie défendit, en se référant à la jurisprudence Arrighi, l’idée selon laquelle le Conseil d’État statuant au contentieux ne devait pas être juge de la constitutionnalité des lois. Je n’oublie pas non plus que les rapporteurs respectifs des arrêts du 6 novembre 1936, Raymond Odent et Emmanuel Rain, siégeaient au sein de la Section du contentieux lorsque fut rendu l’arrêt du 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules et que l’un d’eux évoque ce jour-là le souvenir qu’il avait gardé du délibéré de 1936 »8. Ces mots de l’ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État illustrent la transmission d’une idée commune par des membres du Conseil d’État, tel un secret de fabrique traversant les générations. Le poids des années et l’incarnation des arrêts emblématiques dans des personnalités transforment une continuité jurisprudentielle en monument juridique. Les idées s’incarnent dans les personnes, les personnes s’incarnent dans les idées, le tout donnant une impression d’harmonie où l’on ne se sait plus à qui le respect est finalement dû.
Faits de l’espèce. Cependant, Arrighi n’est pas seulement une jurisprudence, c’est aussi une affaire avec ses faits d’espèce qui éclairent sur les enjeux en présence et les conditions de l’uchronie. Aux termes de l’article 2 du décret du 10 mai 1934, « pourront être mis à la retraite d’office, avec droit à pension d’ancienneté, les fonctionnaires justifiant d’un nombre d’années de service au moins égal au minimum exigé et qui seront, du fait de leur admission à la retraite d’office, dispensés de la condition d’âge ». Le Sieur Arrighi, agent militaire, mis à la retraite d’office à partir du 30 juin 1934, contestait la mesure en estimant que les services militaires ne devaient pas entrer en compte. Pour alimenter sa demande, il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures d’économie qu’exigera l’équilibre du budget. Investi par l’article premier de la loi constitutionnelle du 25 février 18759 du pouvoir législatif, le Parlement ne pouvait en effet, selon le requérant, s’en dessaisir valablement au profit de l’autorité exécutive. Il s’agissait donc d’une question de délégation de compétence entre le pouvoir législatif et exécutif, que le Conseil d’État refuse de trancher en raison de son incompétence pour contrôler la constitutionnalité des lois. La référence mystérieuse à « l’état actuel du droit public » ainsi que les conclusions Latournerie ont conféré une autre dimension à cette affaire aux apparences anecdotiques.
Les doutes et la résignation de Latournerie. Si l’arrêt Arrighi est un véritable carrefour de l’histoire, un turning point, c’est principalement en raison des hésitations clairement exprimées par les conclusions du commissaire du gouvernement Roger Latournerie, dont la trace se retrouve dans la motivation adoptée avec une formule de regret – « en l’état actuel du droit public » – qui préserve l’avenir. Dès 1936, dans sa note sur l’arrêt et les conclusions, Charles Eisenmann relevait ceci : « les deux plateaux sont, par leur charge juridique, si près de l’équilibre parfait, que c’est un supplément de poids d’une autre nature qui décide de la victoire du contre »10. La jurisprudence Arrighi n’est donc pas à proprement parler une motivation juridique, elle est une « pétition de principe »11 dévoilant explicitement le choix de politique jurisprudentielle opéré par le Conseil d’État. Nul besoin, en effet, de surinterpréter les conclusions pour y déceler les doutes. Ils sont nettement exprimés et la conclusion du commissaire du gouvernement est révélatrice : « il faut se résigner en effet, tout au moins provisoirement, même aux dépens de l’harmonie des plus belles constructions juridiques, même aux dépens parfois de l’apparente équité, à ce que certaines parties du Droit restent à l’état de Droit imparfait, à l’état de Droit sans sanction »12. La résignation est le maître mot. Car les arguments en faveur de l’admission du contrôle sont passés en revue avec force de détails et même de conviction. La conception de la séparation des pouvoirs fondée sur l’action réciproque permet ce contrôle, d’autant que le juge de l’action est le juge de l’exception ; dans un régime de hiérarchie des normes, le juge « ne fait rien que de conforme à sa mission – pourvu que sa décision n’ait d’effet que sur le procès auquel elle s’applique – en faisant céder, le cas échéant, à la loi supérieure celle du degré inférieur » ; « la conception que l’on se fait tant de la loi que des pouvoirs du juge, s’est considérablement modifiée » ; s’il « fut un temps où le pouvoir judiciaire fut suspect de vouloir entreprendre sur l’autorité du législateur, il ne paraît guère contestable que ces temps sont bien révolus » ; « et si la loi continue à rester la règle juridique fondamentale, – sinon, aux yeux de tous, suprême, – le temps n’a pas laissé d’atténuer sérieusement, depuis un siècle, la conception quasi oraculaire qu’on s’en était faite un instant. » Invoquant Kelsen, les précédents de 1851 de la Cour de cassation exerçant un tel contrôle, le commissaire du gouvernement avance la plupart des arguments favorables au contrôle de constitutionnalité des lois. Cependant, par résignation, Latournerie passe plus brièvement au second temps de son propos en annonçant que « si persuasive, à certains égards, que puisse paraître cette thèse, elle ne nous paraît pas devoir être retenue. » En effet, le Parlement « reste l’expression de la volonté générale et ne relève, à ce titre, que de lui-même et de cette même volonté » et en pratique l’avantage d’un tel contrôle n’est pas évident, car il « faudrait, pour qu’il y en eût un, que la loi supérieure eût un contenu substantiel à l’égard des droits individuels », ce qui n’est pas le cas des lois constitutionnelles de la IIIe République. Refuser le contrôle, « c’est le seul rôle […] que, en l’état du Droit, puisse avoir [la] jurisprudence »13 du Conseil d’État. Revenir sur les conclusions Latournerie permet de comprendre que l’argument politique et culturel l’a emporté sur la logique juridique. Raisonner par uchronie autour de cette jurisprudence ne consiste donc pas à envisager un futur fantaisiste et totalement illusoire.
Pression doctrinale. Les hésitations du commissaire du gouvernement et le regret attentiste de la formule « en l’état actuel du droit public » ont été alimentés par un mouvement doctrinal de la IIIe République favorable à l’admission d’un contrôle de constitutionnalité des lois14. Inaugurée en 1895 par Gaston Jèze15, la controverse doctrinale fut nourrie de plusieurs écrits au début du xxe siècle, notamment de Maurice Hauriou16. Le militantisme des juristes de la IIIe se décupla à l’occasion de l’affaire des Tramways de Bucarest dans laquelle Henry Berthelemy et Gaston Jèze présentèrent un mémoire, auquel adhèreront de nombreux auteurs17, visant à soulever devant le tribunal d’Iflov l’inconstitutionnalité d’une loi roumaine. L’engagement des éminents auteurs ne fut pas vain puisque le jugement du 2 février 1912 accepta la requête. Ce succès, rapporté par les revues juridiques de l’époque, eut un certain retentissement18. Un autre cas d’espèce donna du souffle au mouvement doctrinal, l’affaire Ratier, du nom de l’ancien garde des Sceaux mis en cause devant un tribunal correctionnel selon une loi que la doctrine jugeait contraire à la Constitution19. Érigée en symbole de la lutte contre la souveraineté parlementaire20, l’affaire Ratier provoqua une vague d’indignation de la part de nombreux juristes dont les points de vue furent publiés par le journal Le Temps21. Les articles consacrés à l’exception d’inconstitutionnalité se succédèrent22, et Paul Duez put ainsi affirmer en 1929 qu’« un vigoureux effort en faveur du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois a été effectué ces dernières années par la doctrine française »23.
Méthodologie d’une uchronie jurisprudentielle. Comme toute uchronie, celle concernant Arrighi doit se mener avec humilité et précaution. Le fameux article du Doyen Vedel sur les rétrofictions24 préconisait de modifier « la réalité au plus ras de ce qui est nécessaire pour les besoins de l’exercice », d’imaginer le comportement des acteurs « d’après ce ils furent réellement dans des circonstances comparables » et de raisonner dans le respect des règles juridiques du contexte donné. Il s’agit en somme d’une forme de perspectivisme qui ambitionne de se placer au plus près de la position de l’acteur et des circonstances. Ce « travail d’imagination et de rigueur » doit ainsi « éviter deux écueils, le conformisme et l’utopie, le premier s’appuyant sur l’extrapolation et la seconde proposant des aventures invraisemblables. »25 Ces exigences méthodologiques ne sont pas simplement un passage obligé, elles ont une influence directe sur le contenu des scénarios uchroniques et des discours imaginés qui les accompagnent. Il serait par exemple anachronique de justifier un autre Arrighi en invoquant la légitimation du contrôle de constitutionnalité en vertu des errances des pouvoirs politiques durant la Seconde Guerre mondiale. En 1936, Hitler était déjà aux commandes de l’Allemagne, un référendum sur la remilitarisation de la Rhénanie et l’approbation des députés du parti unique recueille 99 %, mais les atrocités ensuite commises ne se sont pas encore produites.
Cependant, au-delà de ces considérations méthodologiques générales, l’uchronie d’une jurisprudence présente quelques spécificités. Au moins deux, qu’il faut avancer avec prudence, car l’exercice semble inédit, du moins à notre connaissance.
Première spécificité, l’uchronie d’une prise de décision juridictionnelle suppose de prendre en compte l’ensemble des acteurs ayant participé à la prise de décision. Autant le dire d’emblée, l’objectif demeurera inachevé, car comment accéder à ce que chaque membre du Conseil d’État avait à l’esprit une fois les conclusions de Latournerie prononcées ? Pour autant, il est possible d’approcher au mieux de la réalité en supposant que les éléments en débat au moment de la prise de décision et exprimés en doctrine ou par le commissaire du gouvernement, sont ceux susceptibles d’être partagés ou rejetés par les acteurs habilités à décider. Bien qu’on ne soit pas à l’abri de l’influence d’une autre considération totalement conjoncturelle ou personnelle, il est vraisemblable que les éléments connus du débat sur le contrôle de constitutionnalité des lois en 1936 soient majoritairement ceux qui ont pesé dans la balance du choix des membres du Conseil d’État. L’approximation est inévitable, mais elle semble légère et acceptable pour conduire un raisonnement uchronique crédible.
Deuxième spécificité, le juge, ou plus exactement les membres de la formation de jugement appelés à trancher l’affaire, ne disposent pas d’une information exhaustive sur les possibilités d’action et les conséquences de leur action, ils ne peuvent pas anticiper l’intégralité des variations de leur environnement et du comportement des autres acteurs juridiques, le tout afin de classer leurs choix possibles en fonction du maximum d’utilité qui pourrait en résulter. Dès lors, en transposant au système juridique les thèses de Herbert Simon sur la rationalité limitée26, le juge ne peut que poursuivre un seuil minimal de satisfaction d’un intérêt, sans être en capacité d’optimiser le meilleur choix possible dans une logique utilitariste de rationalité absolue27. À titre de comparaison, les délibérations des membres du Conseil constitutionnel précédant la fameuse décision IVG du 15 janvier 1975 demeurent silencieuses sur le risque de concurrence du contrôle de conventionnalité des lois exercé par les juridictions judiciaires et administratives28. L’ignorance s’explique aisément dès lors qu’à cette époque le droit européen et international n’a pas encore connu l’essor qui sera le sien. Le système juridique n’est donc pas un lieu de certitude absolu où les juges seraient à même de disposer des capacités cognitives suffisantes pour prétendre calculer l’ensemble des fins et des buts, les hiérarchiser et choisir la voie optimale pour leur intérêt. Leur rationalité est par définition limitée, dès lors les perspectives uchroniques tracées autour d’Arrighi doivent tenir compte de ce paramètre.
II. Les scénarios d’un avenir qui n’a pas eu lieu29
En prenant la « DeLorean » du droit, deux types de moments peuvent s’avérer utiles pour changer le futur. Évidemment, en retournant en 1936 afin d’envisager les conditions de possibilité ainsi que les modalités et les conséquences de l’acceptation d’un contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil d’État (B). Mais la perspective uchronique invite à élargir le champ d’analyse en modifiant l’un des paramètres présents en 1936 et ainsi remonter plus loin dans le temps (A).
A) Remonter à un carrefour plus ancien
L’Histoire avance « par des lignes courbes et on peut jouer de l’uchronie jusqu’à une distance séculaire »30. Si l’attentat du Petit-Clamart avait par malheur touché sa cible ou si l’idée d’une dissolution n’avait pas été soufflée au président Chirac en 1997, le destin de la Ve République aurait probablement changé. Il est donc tentant de remonter le fil de l’histoire afin de transformer le moment Arrighi en consécration attendue du contrôle de constitutionnalité des lois. L’objectif ne consiste pas à démontrer que le refus du Conseil d’État en 1936 est seulement le fruit du hasard, mais simplement qu’un changement parfois infime de circonstances aurait permis de poser la question dans des termes distincts. Tel un ruban de Möbius, l’histoire du légicentrisme aurait pu subir des torsions plus ou moins importantes… Deux instantanés peuvent ainsi être analysés.
La faute à Rousseau. Et si Jean-Jacques Rousseau n’avait pas écrit Du Contrat social ou si la diffusion de ce classique de la philosophie politique n’avait pas connu un tel destin ? Porté par un style littéraire qui en a favorisé la renommée, le Contrat social de Rousseau a en effet nettement influencé les révolutionnaires chez qui « l’expression de la volonté générale fait consensus »31, comme le montrent par exemple la plupart des avant-projets de déclaration rédigés pendant l’été 178932 ou l’analyse des journaux de l’époque33. Dès lors, si par exemple la censure de l’ouvrage avait été davantage suivie d’effets ou si le manuscrit avait été volé ou détruit, de toute évidence, les rédacteurs de la Déclaration de 1789 n’auraient pas emprunté la mystique de la volonté générale pour rédiger l’article 6. Il ne s’agit évidemment pas d’un regret, autant le préciser, mais simplement d’évoquer une alternative uchronique fondée sur un évènement factuel dont l’effet en cascade se retrouve au cœur du débat tranché en 1936 dans l’arrêt Arrighi. Dépourvue de la qualité d’exprimer la « volonté générale », la loi aurait en effet probablement fait l’objet d’une moindre sacralisation, sans pour autant être banalisée, car l’équilibre de la séparation des pouvoirs porté établi depuis 1789 ne découle pas seulement du choix des mots de l’article 6 de la Déclaration.
À une publication près. Le détour par l’uchronie invite à remonter le fil des évènements qui permettent de rehausser le niveau de compréhension des composantes d’une prise de décision. Or, dans la longue histoire du refus du juge ordinaire de contrôler la constitutionnalité des lois, une rupture sans lendemain s’est produite dans deux arrêts de la Cour de cassation de 1851. Appelée à statuer sur le régime de l’état de siège, la Cour, dans un arrêt du 15 mars 1851, accepte d’examiner « le moyen pris de la violation de l’art. 4 de la constitution du 4 novembre 1848, et de l’inconstitutionnalité des articles 7 et 8 de la loi du 9 août 1849 »34. Tout en rejetant le moyen, la Cour de cassation venait d’exercer pour la première fois de son histoire un authentique contrôle de la constitutionnalité d’une loi promulguée postérieurement à la Constitution35. Ce précédent en provoqua un second, à propos du même texte, dans un arrêt du 17 novembre 1851 où la Cour considère que « l’article 8 de cette loi n’a pas violé l’art. 4 de la constitution et n’a fait qu’une légitime application du principe consacré par l’art. 106 »36. Si ces deux arrêts avaient fait jurisprudence et que le Conseil d’État ait suivi la Cour de cassation, l’arrêt Arrighi aurait été une simple application d’un contrôle de constitutionnalité dont le principe aurait été acté bien des années auparavant. C’était sans compter sur le Second Empire qui emporta avec lui les velléités de la Cour de cassation. Justement, l’analyse à la loupe de l’enchaînement des évènements à l’origine du coup d’État du 2 décembre 1851 dévoile une légère part d’aléa. En vertu de l’article 32 de la Constitution de la République de 1848, l’Assemblée nationale « fixe l’importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose ». Mais pouvait-elle disposer directement de ces forces militaires ou devait-elle passer par l’intermédiaire du Gouvernement ? Un décret du 11 mai 1848 avait consacré explicitement ce droit et les dispositions pertinentes des article 6 et 7 avaient été « imprimé[e]s et rendu[e]s publics par tous les chefs de corps »37. Sauf qu’une telle diffusion ne valait pas publication en bonne et due forme. Dans un contexte agité de crainte réciproque de coups d’État, les députés rejettent le 17 novembre 1851, par 408 voix contre 300, une proposition visant à clarifier la situation et à permettre au président de la Chambre de requérir directement la force armée38. Si la publication du décret de 1848 avait été réalisée dans les formes, le coup d’État du 2 décembre aurait-il eu lieu ? Ou aurait-il eu lieu plus tardivement, de manière irrémédiable à la faveur d’un autre contexte ? Dans les deux hypothèses uchroniques, la Cour de cassation aurait ainsi pu continuer à développer le contrôle de constitutionnalité des lois réalisé dans ses arrêts du 15 mars et du 17 novembre 1851 – le jour même du vote de rejet à l’Assemblée au sujet des forces armées ! –, et contribuer ainsi à présenter sous un autre forme la question du maintien de ce contrôle par-delà le changement de République. Le cadre de jugement de l’arrêt Arrighi aurait été en tous les cas différent.
B) Les révolutions de 1936
Le contrôle de constitutionnalité des lois fait partie de ces questions juridiques qui dépassent largement les enjeux de technique contentieuse. En touchant à l’équilibre des pouvoirs, à la place de la loi, aux garanties des justiciables contre le pouvoir, ce contrôle est aussi, inévitablement, une question institutionnelle, d’équilibre et de rapports de force entre les pouvoirs. Conséquence pour notre exploration uchronique sur le moment Arrighi, envisager que le Conseil d’État ait adopté en 1936 une autre solution suppose d’anticiper les réactions des autres acteurs juridiques du système dans lequel le Conseil d’État évolue. Ces acteurs sont pour l’essentiel le pouvoir politique, la Cour de cassation et le peuple ou les justiciables. Se dessine alors une cartographie infinie des possibles, parmi lesquels trois scénarios peuvent être envisagés, présentés dans l’ordre décroissant de réussite de l’arrêt Arrighi dans sa version uchronique d’acceptation du contrôle de constitutionnalité des lois.
La frénésie constitutionnelle. S’il avait accepté de contrôler la conformité de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 au regard de l’article premier de la loi constitutionnelle du 25 février 187539, tout en rejetant en l’espèce le moyen, le Conseil d’État aurait rompu avec son refus de principe de contrôler la constitutionnalité des lois. Mais, c’est notre première hypothèse uchronique, ce revirement aurait été une réussite contentieuse et politique. Comment penser une telle révolution radicale dans le cadre d’une République du légicentrisme ? Au niveau du raisonnement juridique tenu par le Conseil d’État, il aurait suffi de puiser dans les ressources argumentatives des conclusions Latournerie, la difficulté n’est pas ici, elle est davantage dans l’anticipation des conséquences de la décision. Il faudrait en effet que le pouvoir politique n’adopte aucune mesure de rétorsion et ne retire au Conseil d’État la compétence qu’il se serait accordée. Or, le contexte politique de 1936 permet d’envisager une telle uchronie40. Agitée par la crise économique mondiale, tourmentée par la montée du fascisme, alertée par les régimes autoritaires qui s’installent en Europe, la France de 1936 est une République agitée. La crise du 6 mai 1934, avec ses émeutes meurtrières, a confirmé le rejet grandissant du système institutionnel. Les citoyens, comme les politiques et donc les juristes, sont en quête de repères et de moyens de vivifier la vie institutionnelle du pays. Dans ce contexte, la victoire du Front populaire aux législatives des 26 avril et 3 mai constitue un espoir pour la gauche que le Conseil d’État aurait pu relayer quelques mois plus tard. Mais la droite et l’extrême droite auraient également pu voir sous un œil favorable l’arrêt Arrighi dans sa version uchronique, dès lors que ce contrôle de constitutionalité des lois leur aurait permis de contester par exemple la loi 10 janvier 1936 permettant la dissolution des ligues factieuses ou de prolonger dans les prétoires l’opposition au Front populaire en contestant la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés et les caisses de congés payés ou les réformes de 1937 au sujet de la nationalisation des industries d’armement ou la réforme de la Banque de France. Pour ce faire, le Conseil d’État aurait pu étendre le champ des normes de référence en censurant largement les délégations de compétence au pouvoir règlementaire. Il n’est pas non plus interdit d’envisager que, soutenu par la classe politique et le grand public, le juge administratif ait suivi les préconisations de la doctrine de la IIIe République en puisant dans la Déclaration de 1789 des ressources contentieuses ou en mettant en œuvre plus tôt que prévu la théorie des principes généraux du droit. Mettant à son profit les agitations de la IIIe République, le Conseil d’État aurait ainsi pu se frayer un chemin sur le terrain du contrôle de constitutionnalité des lois que chaque parti politique ou frange de la société entendait tirer à son profit. En sacrifiant les principes du légicentrisme sur l’autel des intérêts de l’instant, le Conseil d’État aurait donc pu bénéficier de cet opportunisme contentieux et développer le contrôle de constitutionnalité des lois, emmener avec lui la Cour de cassation et radicalement transformer l’équilibre de la IIIe République et, plus largement, le constitutionnalisme français.
La révolution silencieuse. Le premier scénario de la frénésie constitutionnelle pourrait être taxé d’excès d’optimisme à l’égard d’un mécanisme contentieux qui aurait renversé les fondements culturels et institutionnels de l’époque. En empruntant une voie médiane et davantage prudente, il est possible d’envisager une uchronie d’Arrighi sous la forme d’une acceptation atténuée du contrôle de constitutionnalité des lois. Dans ce scénario, le Conseil d’État aurait pu juger que le principe même d’un tel contrôle était admis, mais qu’en l’état actuel du droit public ce contrôle ne pourrait s’exercer qu’à l’égard des lois constitutionnelles de 1875 et donc porter essentiellement sur des questions de répartitions de compétence. Par ce repli stratégique, le Conseil d’État aurait probablement suscité des réactions mêlant déception et ravissement. Les uns célébrant l’avènement d’un nouveau moyen d’action contentieux, les autres se réjouissant qu’en pratique l’œuvre du législateur soit la plupart du temps préservée. Par cette forme de compromis dilatoire, la version uchronique de l’arrêt Arrighi aurait pour point commun avec la version historique d’être une pierre d’attente teintée de regrets. Mais avec un principe inversé dès lors que le Conseil d’État admettrait désormais le principe du contrôle de constitutionnalité des lois. Une fois ce premier stade passé, l’avenir de cette décision en demi-teinte aurait pu s’écrire de deux manières : l’extinction progressive par désuétude si les juges avaient interprété strictement les questions de répartition de compétence ; la révolution silencieuse et couronnée de succès si la Cour de cassation avait suivi le mouvement, que les juges auraient progressivement étendu le champ des normes de références et que le pouvoir politique désormais accoutumé au contrôle juridictionnel des lois ait souhaité réviser les lois constitutionnelles de 1875, par exemple afin de donner une valeur constitutionnelle à la Déclaration de 1789.
La révolte du politique et la mise au pas des juges. Le dernier scénario uchronique qui sera envisagé, et bien que l’exhaustivité en la matière soit inatteignable, est celui de la réaction rapide et hostile du pouvoir politique. Que le Conseil d’État ait admis sans retenue (scénario de la frénésie constitutionnelle) ou en demi-teinte (scénario de la révolution silencieuse) le contrôle de constitutionnalité des lois, les parlementaires de la IIIe République ne l’auraient pas accepté, du moins dans l’hypothèse envisagée. Soucieux que les réformes de son gouvernement ne soient pas entravées par ses collègues du Conseil d’État, Léon Blum aurait pu impulser le vote d’une révision des lois constitutionnelles de 1875 visant à prohiber expressément toute compétence des juridictions judiciaires et administratives en matière de contrôle des lois. Il faut dire que l’article 10 de la loi de 179041 n’ayant pas empêché le Conseil d’État, dans le cadre d’un raisonnement uchronique, le passage à la forme constitutionnelle de l’interdiction semblerait inévitable. Par un « effet boomerang », le Conseil d’État aurait subi les conséquences institutionnelles de son coup de force prétorien, entraînant avec lui la juridiction judiciaire. Marqués au fer rouge, les juges auraient subi un mouvement d’hostilité institutionnelle, voire populaire si l’opinion publique avait suivi, qui aurait profondément marqué le constitutionnalisme français dans le sens inverse que précédemment, à savoir une exacerbation du légicentrisme. Car, dans ce scénario, comment envisager que la création du Comité constitutionnel de la quatrième République soit proposée au sortir de la guerre ? Et l’uchronie peut dans ce cas emmener la réflexion aux portes de la Ve République, car le Conseil constitutionnel de 1958 doit beaucoup à la déception et aux limites de son prédécesseur de la IVe République. La France serait – peut-être – l’un des derniers États ne connaissant pas le contrôle de constitutionnalité et se rapprocherait sur ce point du régime anglais.
Conclusion uchronique. Surgit alors un enseignement original que l’uchronie a permis de faire émerger : et si Arrighi, le véritable arrêt refusant le contrôle de constitutionnalité des lois, était l’acte lointain de naissance du Conseil constitutionnel ? Car l’avènement du contrôle de constitutionnalité sous la Ve République doit finalement beaucoup à la prudence dont le Conseil d’État a fait preuve en 1936. Ce point de basculement de l’histoire a été un repli au profit des générations futures qui étaient « prêtes pour ce genre de choses »… L’uchronie n’est donc pas seulement un exercice imaginatif et récréatif, elle est utile pour mieux comprendre le cheminement de l’action humaine et les trajectoires du droit.
1 CE sect., 6 nov. 1936, Arrighi, Rec. 966 ; RDP, 1936, p. 675, concl. R. Latournerie ; S,1937, p. 33, note A. Mestre ; P. Laroque, « Les juges français et la loi », RDP, 1926, p. 730.
2 Malgré les critiques émises à son égard, cf. not. J. Bonnet, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des lois. Analyse critique d’un refus, Paris, Dalloz, 2009. Contra, cf. not. B. Genevois, B. Genevois, « Le Conseil d’État n’est pas le censeur de la loi au regard de la Constitution », RFDA, 2000, p. 719 ; A. Vidal-Naquet, « Abandonner la jurisprudence du Conseil d’État Arrighi ? », in G. Drago (dir.), L’application de la Constitution par les Cours suprêmes, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2007, p. 150 et s.
3 Ch. Renouvier, Uchronie (l’utopie dans l’histoire) : esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être…, 1857, Ref., p. 468.
4 P. Matter, « Conclusions sur Cass., Req., 23 février 1932 », Dalloz, 1932, p. 141.
5 J. Synowoecki, Charles Renouvier, pionnier de l’uchronie, in Écrire l’histoire avec des « si », Éditions Rue d’Ulm, 2015.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 B. Genevois, « Le Conseil d’État n’est pas le censeur de la loi au regard de la Constitution », RFDA, 2000, p. 715. L’auteur exprime d’ailleurs son attachement aux « témoignages des protagonistes de telle ou telle décision marquante ».
9 « Article 1. – Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. – La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. – La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale. »
10 C. Eisenmann, « Note sous CE, 6 novembre 1936, Arrighi et Coudert », Dalloz, 1938, III, p. 6.
11 M. Guyomar, P. Collin, « Détermination du juge devant lequel doivent être portées les contestations relatives aux actes administratifs organisant le référendum », AJDA, 2000, p. 803.
12 R. Latournerie, « Conclusions sur CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi et Coudert », op. cit., p. 8.
13 R. Latournerie, « Conclusions sur CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi et Coudert », op. cit., p. 8.
14 Pour une présentation complète des débats doctrinaux sous la IIIe République, voir notamment J.-P. Machelon, La République contre les libertés ? Les restrictions aux libertés publiques de 1874 à 1914, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1976 ; M.-J. Redor, De l’État légal à l’État de droit, Economica-PUAM, droit public positif, 1992 ; S. Pinon, Les réformistes constitutionnels des années trente. Aux origines de la Ve République, LGDJ, 2003 ; G. Sicart, La doctrine publiciste française à l’épreuve des années 1930, Thèse dact., Paris II, 2000.
15 G. Jeze, « Notions sur le contrôle des délibérations des assemblées délibérantes », Revue générale d’administration, 1895, II, p. 401.
16 M. Hauriou, « Note sous CE, sect., 7 août 1909, Winkell », Pandectres françaises, 1909, III, p. 145.
17 La Revue du droit public, 1912, p. 222 informe de l’assentiment de P. Beauregard, A. Esmein, F. Larnaude, A. Pillet, A. Colin, A. Wahl, N. Politis.
18 H. Berthelemy, G. Jèze, « Pouvoir et devoir des tribunaux en général et des tribunaux en particulier de vérifier la constitutionnalité des lois à l’occasion des procès portés devant eux », RDP, 1912, p. 138 ; Sirey, 1912, IV, p. 9, note H. Berthelemy.
19 Sur les conclusions de P. Reynaud, défenseur de A. Ratier, voir A. Blondel, Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France, Aix, 1927, p. 358.
20 Sur l’affaire Ratier, cf. en particulier C. Courvoisier, « 1925, une année folle pour l’exception d’inconstitutionnalité ; à propos d’un jugement du Tribunal correctionnel de Seine », in J. Lorgnier (dir.), Justice et République(s), Hellemes, Ester, 1993, p. 259 ; M. Milet, « La controverse de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité. Genèse d’un débat : l’affaire Ratier », Revue française de science politique, vol. 49, n° 6, décembre 1999, p. 783.
21 Voir S. Pinon, op. cit., p. 172s. ; G. Sicart, op. cit., p. 237.
22 H. Berthelemy, « Les limites du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire, 1925, p. 355 ; H. Berthelemy, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1926 ; F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », Revue politique et parlementaire, 1926, p. 181 ; P. Laroque, « Les juges français et le contrôle de la loi », RDP, 1926, p. 722 ; F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », Revue politique et parlementaire, 1926, p. 181 ; A. Blondel, Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France, Aix, 1927 ; H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, 1928, p. 14 ; M. Waline, « Éléments d’une théorie de la juridiction constitutionnelle en droit positif français », RDP, 1928, p. 30 ; A. Mestre, « Recherches sur l’exception d’illégalité », in Mélanges Hauriou, 1929, p. 567.
23 P. Duez, « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France », in Mélanges Hauriou, Sirey, 1929, p. 213.
24 G. Vedel, « Rétrofictions : Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969… », Revue française de science politique, 1984, n° 4-5, p. 719-751.
25 J. Lesourne, Ces avenirs qui n’ont pas eu lieu, Odile Jacob, « Hors collection », 2001, p. 417.
26 H. Simon, Administration et processus de décision, 1945, rééd. Economica, 1983. Voir également L. Sfez, Critique de la décision, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 4e éd., 1992, p. 231 s.
27 Sur l’utilitarisme, v. par ex. C. Audard (dir.), Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, T. 1, Bentham et ses précurseurs 1711-1832, PUF, 1999 ; L.-M. Nodier, « Définition de l’utilitarisme », Revue du MAUSS, n° 6, 1995, p. 15 ; G. Tusseau, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel, L’Harmattan, 2001.
28 B. Mathieu, J.-P. Machelon, F. Mélin-Soucramanien, D. Rousseau, X. Philippe (dir.) Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2e éd., 2014, p. 266.
29 J. Lesourne, Ces avenirs qui n’ont pas eu lieu, op. cit.
30 J.-N. Jeanneney, « Ve République : de quelques bifurcations du hasard », in L’État, le droit, le politique. Mélanges J.-C. Colliard, Dalloz, 2014, p. 291.
31 M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, Gallimard, 1989, p. 162.
32 C. Fauré (textes réunis et présentés par), Les déclarations des droits de l’homme de 1789, Bibliothèque historique Payot, 1988 : cf. par ex. les projets d’article 6 de Sinety p. 179 (dans le même sens : sixième bureau, p. 232), Thouret p. 151, Sieyès p. 102 (dans le même sens : Gouges-Cartou, p. 209), Traget p. 124, Servan p. 48, Rabaut de Saint-Étienne, p. 261.
33 J.-J. Tatin-Gourier, Le Contrat social en question, Université de Lille, 1986, p. 151 s.
34 Cass., crim., 15 mars 1851, Dalloz, 1851, I, p. 142.
35 Sur cette jurisprudence ponctuelle, voir J.-L. Mestre, « Données historiques, la Cour de cassation et le contrôle de constitutionnalité »,in La Cour de cassation et la constitution de la République, PUAM, 1995, p. 35 ; J.-J. Bienvenu, « Aux origines de la cassation et au lendemain des Constitutions : les premières décisions de cassation », in G. Drago (dir.), L’application de la Constitution par les Cours suprêmes, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2007, p. 14.
36 Cass., crim., 17 novembre 1851, Sirey, 1851, I, p. 707.
37 Recueil de jurisprudence, de législation et de doctrine, Dalloz, 1849, p. 102.
38 M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France, Montchrestien, 9e édition, 2006, p. 243.
39 « Article 1. – Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. – La Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. – La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale. »
40 G. Candar Gilles. Histoire politique de la IIIe République. La Découverte, 1999.
41 « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. »
Julien Bonnet, « Sans Arrighi », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4606.