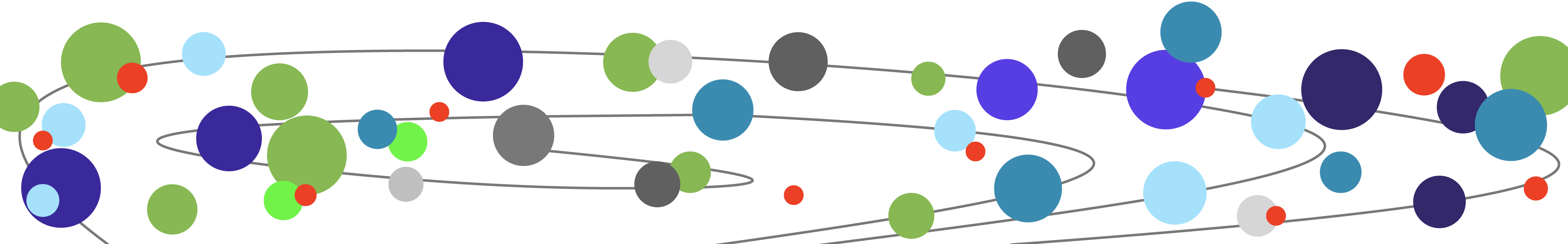Romain Le Bœuf
Professeur de droit public, Aix Marseille université, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France

Nathalie Rubio
Professeur de droit public, Aix Marseille université, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
L’Union européenne actuelle est le résultat de la déclaration prononcée par Robert Schuman le 9 mai 1950. Or, un siècle plus tôt, en 1849, Victor Hugo appelait dans un autre discours à la création des États-Unis d’Europe. Que serait-il advenu si ce discours avait été pris au sérieux et s’il avait, avec cent ans d’avance, donné naissance à l’Union européenne ? Sous la forme de fragments historiques, la présente uchronie esquisse une ligne d’évolution possible de cette Europe précocement unie.
The European Union as we know it today stems from Robert Schuman’s seminal speech of May 9, 1950. Yet, a century earlier, in 1849, Victor Hugo had advocated in another speech for the creation of a “United States of Europe.” What might have happened if Hugo’s vision had been taken seriously and had given rise to a European Union ? This alternate history explores a possible trajectory of a Europe united far earlier than in reality.
1849 – Le Discours
Le discours s’acheva sous un tonnerre d’applaudissements. Le Congrès des amis de la paix universelle dépassait dès l’instant de son ouverture les meilleurs espoirs de ses organisateurs1. Bien que l’évènement ne dût commencer qu’à midi, il y avait eu dès onze heures une affluence considérable dans la salle, à tel point que le tapissier n’avait pas eu le temps de disposer convenablement tous les sièges2. La foule se composait d’hommes considérables : publicistes, philosophes, ministres des cultes et autres écrivains éminents. Pourtant l’orateur, qui descendait maintenant de la tribune, avait marqué ces esprits graves :
« Nous disons à la France, à l’Angleterre, à la Prusse, à l’Autriche, à l’Espagne, à l’Italie, à la Russie, nous leur disons : un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi ! […] Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent […] vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France.
« Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d’événements et d’idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples, et, à l’époque où nous sommes, une année fait parfois l’ouvrage d’un siècle3. »
Au vrai, l’orateur lui-même ne se berçait guère d’illusions : il connaissait trop les hommes et la politique pour croire que quelques mots lancés du haut d’une tribune pouvaient suffire à infléchir le cours inexorable de l’histoire. Les nations européennes étaient encore trop divisées pour que son projet de voir advenir les États-Unis d’Europe puisse naître de son vivant. Il faudrait un siècle, dans le meilleur des cas. Or, comme il arrive parfois, l’auditoire se révéla infiniment plus convaincu que l’orateur et tout Paris bruissait de la proposition audacieuse que venait de formuler Victor Hugo.
Louis de Saint-Julle de Colmont, qui venait de quitter ses fonctions de secrétaire général du ministère des Finances, avait été vivement impressionné par le discours4. L’idée d’une réunion des pays européens faisait écho à sa vision pragmatique d’un monde organisé autour des intérêts industriels et financiers5. Sans doute, Colmont faisait partie de ces hommes politiques vieillis dans le maniement des affaires et peu enclins à la songerie. Pourtant, il répugnait à ne voir dans le projet esquissé par Victor Hugo qu’un rêve creux. Il en devinait la redoutable utilité, à la fois pour accompagner l’essor industriel de l’Europe et pour endiguer les tensions que les nationalismes naissants faisaient courir au continent. Le soir même, il en parlait à l’un de ses amis, que le sort et le mérite avaient récemment propulsé à la tête du ministère des Affaires étrangères.
Alexis de Tocqueville connaissait le monde6. Il était suffisamment philosophe pour en saisir les buts, et suffisamment politique pour en percevoir les ressorts. L’Europe connaissait ce qui était peut-être la plus longue période de paix de son histoire. Pourtant, le jeune ministre doutait que cette tranquillité puisse durer encore longtemps. Les tensions devenaient perceptibles. La compétition que se livraient les pays européens pour trouver des débouchés commerciaux à leur production industrielle croissante délitait peu à peu ce qui avait été la Sainte-Alliance. Les rivalités s’accentuaient pour l’accès aux ressources et les enjeux économiques étaient de moins en moins dissociables de l’extension coloniale. Le nationalisme allait renforcer les tensions aux frontières au sein du continent européen. En France même, Alexis de Tocqueville savait à quel point la jeune République était fragile et quels risques faisait courir à la France et à l’Europe la récente élection de Louis Napoléon Bonaparte. Était-il possible d’éviter à l’Europe ce destin tragique autant qu’évident ? Il savait que lui-même ne resterait que peu de mois au ministère. Comment dévier le cours inévitable des choses en si peu de temps7 ? Décidément, il y avait dans cette brève discussion qu’il avait eue avec Louis de Colmont une idée qui ne le lâchait pas. Sans doute, l’union des États européens comme moyen de garantir la paix était une vieille chimère. Alexis l’approuvait en tant que philosophe, mais Tocqueville ne voyait pas comment la faire advenir en tant que ministre. Colmont, un esprit pratique, lui avait toutefois suggéré une manière de faire qui pourrait rallier les oppositions : dans son Nouveau Cynée, Éméric Cruce avait tracé le projet d’une paix fondée sur l’interdépendance économique des pays européens8. Si l’Assemblée rejetait l’idée politique d’une fédération des nations européennes, Tocqueville saurait bien la convaincre de soutenir la création d’un espace au sein duquel les produits de l’industrie pourraient circuler librement. Le soir même, le ministre fit passer une note à tous les journaux de Paris. Ceux-ci feraient en sorte que le discours prononcé par Victor Hugo en début d’après-midi trouve un écho suffisant dans l’ensemble des capitales européennes. Dès le lendemain, toutes les chancelleries avaient pris connaissance de ce curieux projet venu de France9.
1870 – La dépêche d’Ems
Les couloirs de la Commission européenne bruissaient de leur frénésie habituelle. Vêtus à la mode victorienne et arborant de généreuses moustaches, divers fonctionnaires – Français, Italiens, Belges, Néerlandais, Luxembourgeois, Prussiens et autres Bavarois – s’affairaient depuis bientôt vingt ans à régler depuis Bruxelles les affaires d’une Europe en plein essor industriel. Cela avait débuté en 1851 par la création d’une Communauté du Charbon et de l’Acier. Les diplomates, d’abord surpris, avaient fini par emprunter au modèle – baroque mais fonctionnel – qu’avait été depuis 1815 la Commission centrale pour la navigation du Rhin10. Le succès de cette première communauté avait incité, dès 1857, à lui adjoindre deux autres : une Communauté européenne de l’énergie à vapeur et, surtout, une Communauté économique favorisant la libre circulation des biens manufacturés et des produits agricoles.
Ce matin pourtant, les discussions avaient un objet et un ton inhabituels. Le jeune Giuseppe Tornielli11 était inquiet :
« Tout de même, voilà une situation bien grave.
— Il y a assurément là de quoi froisser l’Empereur, répondit sombrement Joseph de Cadoine de Gabriac12, et tout Français un peu patriote se sentira piqué. »
Depuis plusieurs décennies, le nationalisme agitait l’Europe. Après avoir conduit à l’indépendance de la Grèce et de la Belgique, il avait achevé d’unifier l’Italie quelques années auparavant. Désormais, c’était le Chancelier allemand Otto von Bismarck qui rêvait d’unifier l’Allemagne. La France marquait sa réticence face à ce projet qui risquait d’affaiblir sa position. Dans chacun des pays, des factions poussaient à un affrontement armé. Le matin même, le Chancelier allemand avait fait envoyer à Paris un télégramme par lequel il annonçait à la France rompre les discussions à propos de la question de la succession d’Espagne13. Le ton de cette dépêche avait marqué tous les esprits14.
« Cette dépêche m’a tout l’air d’avoir été écrite pour provoquer Napoléon, continua Tornielli.
— Assurément, intervint le prussien Clemens August Busch15 en renouant sa courte cravate. Bismarck s’est d’ailleurs vanté d’un texte qui ferait sur le taureau gaulois l’effet d’un chiffon rouge16.
— Ne vous alarmez pas jeunes gens, trancha Eugène de Kerckhove17, plus rompu qu’eux aux fluctuations des relations diplomatiques. Bismarck est un vieil homme, qui pense une vieille politique. Il y a trente ans, je ne dis pas : un tel texte eut certainement déterminé un roi à la guerre. Chacun de notre côté de la frontière, nous pouvions nous défier les uns des autres ; mais nous sommes aujourd’hui trop proches pour nous regarder comme des ennemis18. Songez-y : vous qui vous connaissez si bien et qui avez tant fait ensemble, accepterez-vous de vous couper la gorge parce qu’un texte trop vif a irrité une susceptibilité trop grande ? Nos intérêts communs ne sont-ils pas trop nombreux pour les sacrifier tout entiers à la fierté nationale19 ? Nous avons parlé, il y a peu de temps, d’unir nos armées dans une Communauté européenne de défense : pensez-vous probable que vos ministres, qui siègent ensemble au Conseil, consentent désormais à les jeter l’une contre l’autre ? Non Messieurs ! Nos Communautés, par leur seule existence, ont tissé tant de liens entre nos nations que la paix entre elles n’est plus suspendue au fil ténu de la volonté de leurs chefs20. Notre Communauté est un système de paix qui fonctionne21. D’ailleurs, sachez-le, le commissaire français et le commissaire prussien ont abordé la question de cette dépêche ce matin en ma présence : ils étaient bons amis et en riaient franchement. Je crois que déjà vos ministres s’affairent à calmer vos empereurs. Ce qui eut pu être jadis un drame ne sera aujourd’hui qu’une comédie, et l’affaire sera achevée avant même d’avoir commencé. »
1885 – La Conférence de Berlin
Le ton du député était cinglant :
« Quoique vous en pensiez, il faut à l’Europe des débouchés pour ses produits commerciaux. Les considérations qui justifient la politique d’expansion coloniale au point de vue de ce besoin sont de plus en plus impérieusement senties par les populations industrielles de l’Europe et particulièrement de notre riche et laborieux pays de France. Oui, ce qui manque à notre grande industrie, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Ce droit qui sert notre commerce est la juste contrepartie de notre devoir de civilisation à l’égard de l’Afrique22.
— Pourtant, Monsieur le député, répondit Alphonse de Courcel23, vous ne pouvez pas revendiquer pour la France seule ces débouchés commerciaux, sans parler de ces ressources abondantes qui doivent bénéficier à tous les États de l’Europe. Elles doivent être offertes à l’ensemble du monde, sans distinction, ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix24.
— Monsieur l’Ambassadeur, répondit Jules Ferry, vous devriez mieux sentir que quiconque qu’il s’agit là d’une question de politique nationale, dont votre Communauté n’a pas à se mêler.
— C’est une affaire qui touche au commerce, Monsieur le Député, et rien de ce qui touche au commerce n’est étranger à notre Communauté. Vous conviendrez que la compétence en matière coloniale, si elle ne figure pas telle quelle dans le traité, est au moins implicite : elle est inhérente à notre Union douanière et à notre politique commerciale commune. La Communauté a du reste une compétence expresse pour conclure des accords d’association avec des puissances tierces. C’est d’ailleurs ce qu’a vivement rappelé ce jeune juge italien à la Cour de Justice, comment s’appelle-t-il déjà ? Ah, oui : Donisio Anzilotti.
— C’est un fédéraliste enragé celui-là, guère respectueux de la volonté des États, trancha le député.
— Si vous voulez, mais il n’en reste pas moins que poursuivre le développement du continent africain est l’une des tâches essentielles de l’Europe, objecta l’ambassadeur25. »
Il avait été décidé quelques mois plus tôt que la colonisation de l’Afrique devait être coordonnée au niveau européen. Après de longues discussions, il fut convenu à Berlin que les États membres désireux d’étendre leur emprise en Afrique le feraient sur la base de licences d’exploration et d’exploitation délivrée par la Commission, après étude du projet par la Direction générale « Affaires coloniales »26. La Direction des affaires humanitaires s’assurerait quant à elle que la mission civilisatrice était menée dans des conditions conformes à l’héritage chrétien des communautés.
« Votre naïveté va faire passer la France à côté d’une chance historique d’étendre son empire. Les Africains l’ont bien compris d’ailleurs : leurs chefs se réunissent déjà. À Lomé, il n’y a pas si longtemps ; à Cotonou bientôt.
— Entre nous, Monsieur le Député, pensez-vous sincèrement que le modèle colonial réponde à la mission civilisatrice que vous appelez de vos vœux27 ? Il faut envisager avec l’Afrique un nouveau modèle de relations28. Bientôt, la domination coloniale sera supplantée par des accords de partenariat, comme nous en avons avec les autres nations, dans un esprit de solidarité et d’intérêt mutuel29. Les conférences de Lomé et de Cotonou, que vous semblez craindre si fortement, ne sont au fond que le prolongement naturel d’une méthode qui a fait ses preuves sur notre continent et dont nous devons espérer qu’elle puisse servir de modèle pour la paix du monde. »
1914 – L’assassinat
Attablés à la terrasse d’un café, deux étudiants discutaient :
« Arrête un peu, dit le premier. Si l’Europe connaît la plus longue période de paix de son histoire, ce n’est certainement pas grâce à une poignée de ronds-de-cuir bruxellois obnubilés par le commerce. Qu’imagines-tu ? Que si l’Europe n’avait pas été faite, nous aurions eu la guerre ? »
Et il explosa de rire.
« Je ne sais, pas répliqua son amie. Quelles auraient été selon toi les suites de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, il y a quelques mois, si l’Union n’était pas intervenue pour modérer les exigences de l’Autriche ? Ces ronds-de-cuir dont tu te moques ont aplani la crise en promettant un accord de partenariat avec la Serbie en échange d’une enquête indépendante sur l’attentat30.
— L’Union n’est pour rien dans l’affaire et cet assassinat n’est qu’une triste anecdote. Quelles raisons auraient bien pu pousser les puissances à s’affronter pour cette vétille ? Non, décidément, tu ne me convaincras pas que l’Europe soit utile à la paix. C’est une menace qui a d’elle-même déserté notre continent. »
1920 – La pandémie
Au ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et Prévoyance sociales, l’optimisme n’était plus de mise. Pendant plusieurs mois, les risques liés à cette « grippe américaine » avaient été minimisés31. Désormais, la panique grandissait. Le ministre Jules-Louis Breton était démuni. Les symptômes paraissaient encore trop bénins pour convaincre ses collègues de la nécessité de mesures énergiques. Le gouvernement se refusait à toute mesure d’ampleur nationale et se bornait à renvoyer les décisions au niveau local32. Autant dire qu’aucune coopération à l’échelle internationale ou européenne n’est envisagée.
À Bruxelles, les institutions européennes avaient une connaissance précise du danger et des enjeux, mais l’Union disposait de compétences très limitées en matière sanitaire. Au cours de quelques réunions, le Conseil avait vainement appelé à une réponse coordonnée. Les gouvernements des États membres se bornaient quant à eux à réagir dans la panique, sans guère se soucier des quelques lignes directrices publiées par la Commission33.
« Pourtant, rien n’est plus complexe, plus décevant, que le traitement de la grippe, soulignait le Commissaire européen en charge de la Santé. C’est un véritable chaos thérapeutique. Il n’y a pas de vaccin. Les autorités n’ont à leur disposition aucun traitement efficace.
— Pire, enchérit son interlocuteur : il faut affronter le charlatanisme apothicaire qui loue dans la presse toutes sortes de baumes qui au mieux provoquent quelque soulagement symptomatique. L’alcool est même paré de toutes les vertus thérapeutiques, notamment le rhum dont les autorités doivent prendre le contrôle pour éviter pénuries et contrebande. La plupart des médecins sont conscients de l’inanité de tout traitement, mais ces incertitudes entraînent des rumeurs34.
— Et dans ce désordre, chaque État y va de ses propres mesures prophylactiques : certains ferment leurs frontières quand d’autres les laissent grandes ouvertes. En France, le Conseil supérieur d’hygiène a rendu hier un avis dans lequel il déclare “qu’en raison de la diffusion du virus déjà accomplie, il était vain de fermer les frontières comme d’y prendre les mesures de quarantaines et de désinfection prévues pour les grandes maladies pestilentielles, vain aussi d’exiger le passeport sanitaire et la surveillance médicale des immigrants après leur arrivée à destination”35. »
La maladie prospéra ainsi pendant de longues années, par des vagues successives qui frappaient à tour de rôle chacun des États membres. Les efforts des uns étaient anéantis par l’incurie des autres, la maladie circulant sans cesse d’un territoire à l’autre sans être jamais freinée par des mesures concertées. Cette pandémie affecta de façon terrible l’image de l’Union, à laquelle les États membres imputaient leurs défaillances sanitaires et leurs excès économiques. Face aux promesses manquées des États, l’Autrichien Stefan Zweig publia son ouvrage Le monde de demain : espoir d’un Européen, qui esquissait le risque d’une fragmentation de l’Union et d’un effondrement de ses valeurs.
Pourtant, ce fut seulement une fois qu’ils eurent définitivement perdu le contrôle de la situation que les États s’avisèrent d’abandonner la gestion de la crise sanitaire à l’Union. Enfin la synchronisation des mesures prophylactiques, le rétablissement coordonné de contrôles aux frontières et la construction d’un vaste plan destiné à promouvoir la recherche médicale permirent de diminuer définitivement à la fois le nombre de malades et la gravité de leurs symptômes. En 1927, le Commissaire européen à la Santé déclara que l’épidémie était terminée. Son ampleur n’en avait pas moins durablement affecté l’économie mondiale.
1929 – Une crise économique
La crise sanitaire avait peu à peu conduit les États à succomber sous le poids de la dette qu’ils avaient accumulée pour lutter contre la maladie et de la rancœur de populations épuisées par les mesures sanitaires. Dès 1921, la Russie tsariste, très affaiblie, s’effondra au profit d’un pouvoir soviétique36. Les États d’Europe et des États-Unis tinrent quelques années supplémentaires, au prix d’investissements publics considérables. Les dirigeants européens adoptèrent dans l’urgence – et dans une assez grande improvisation37 – de vastes plans de relance destinés à maintenir à flot l’économie. Cependant, l’injection massive de liquidités, sans améliorer de façon sensible le sort des populations, favorisa toutes sortes de spéculations boursières et renforça l’inflation. Au début de l’automne 1929, les marchés s’effondrèrent avec une violence sans précédent. Dans toute l’Europe, le chômage croissait à une vitesse affolante. Instruits des conséquences de la crise sanitaire, les États européens comprirent immédiatement que leur salut résidait dans la confiance qu’ils mettraient dans l’Union.
La Banque centrale européenne était à cette époque présidée par un ancien haut fonctionnaire du Trésor britannique. Universitaire opiniâtre, cet homme avait soutenu publiquement le gouvernement du Premier ministre David Lloyd George lorsque celui-ci avait entrepris de résister aux demandes pressantes d’un retrait de son pays de l’Union européenne38. Ce que l’on désignait alors par le barbarisme de « Brexit » n’avait pas eu lieu. Plus encore, le Premier ministre britannique fit le choix inouï, non seulement de maintenir le Royaume-Uni dans l’Union, mais de resserrer les liens avec ses partenaires européens en faisant de l’Euro la monnaie de la Couronne britannique. La seule condition que posa l’illustre Premier ministre fut d’avoir toujours un Britannique à la tête de la Banque centrale européenne. Cet homme répondait en 1929 au nom de John Maynard Keynes.
Keynes avait acquis une popularité croissante au sein de la population européenne par les mises en garde répétées qu’il avait adressées aux gouvernements et aux marchés boursiers depuis sa prise de fonctions en 1926. Keynes, il est vrai, avait mauvaise presse auprès de la Commission européenne, qui demeurait attachée à une vision beaucoup plus classique de l’économie de marché. Cependant, la crise avait favorisé en 1927 l’élection de nombreux députés socialistes au Parlement européen. Surtout, la crainte de voir certains États membres rejoindre les rangs soviétiques favorisa d’importants compromis, y compris de la part des plus orthodoxes. Ce New Deal européen fonctionna si bien qu’il endigua la montée constante des populismes dans les États européens.
1939 – Populismes
Devant la Faculté de droit, deux collègues partagent un thé.
« Je te l’avais dit, s’exclame la première. Si nescis, me quaeris, ajoute-t-elle en souriant.
— Je suis trop pessimiste, répond le second. Je n’avais pas été surpris de l’échec de Mussolini, mais je ne pensais pas que les nazis se résoudraient à une telle humiliation. »
Quelques années auparavant, la crise sanitaire et ses conséquences économiques avaient entraîné une montée en puissance de mouvements populistes dans plusieurs pays. Dans chaque cas, l’Union avait été pointée du doigt comme étant responsable du marasme dans lequel était plongée l’Europe.
En Italie, le parti fasciste de Benito Mussolini avait accédé au pouvoir dès la fin du mois d’octobre 1922. Pendant de longs mois, l’Italie et l’Union se jaugèrent mutuellement. Les députés européens s’émurent seulement de quelques épisodes répressifs à l’égard des syndicats et autres mouvements d’opposition. La Banque centrale réagit quant à elle de façon prudente face aux velléités du gouvernement italien en matière d’indépendance monétaire. Cependant, les élections de 1924 donnèrent lieu à de vives alarmes. De nombreux membres du Parlement européen s’émurent des conditions dans lesquelles s’étaient tenues les élections italiennes. Le député Giacomo Matteotti dénonça vivement la modification de la loi électorale ainsi que les actes d’intimidation menés par les fascistes à l’occasion du scrutin39 : il fut assassiné quelques jours plus tard40. Cet assassinat détermina la Commission à proposer au Conseil européen d’actionner l’article 7 du Traité à l’encontre de l’Italie. Les chefs d’État et de gouvernement temporisèrent tant qu’ils le purent, mais l’adoption en 1925 des lois fascistissimes les détermina finalement à sanctionner l’Italie. Le Conseil suspendit alors de nombreux droits qu’elle tenait du traité, donnant aux termes vagues de l’article 7 une interprétation que Mussolini n’avait pas anticipée. Ces mesures écornèrent durablement l’image du Duce, dont le projet autoritaire s’épuisa peu à peu dans une série de provocations qui amusèrent l’Europe autant qu’elles irritèrent la population italienne41. Les sanctions européennes pesèrent également sur la situation économique du pays, qui n’était plus admis à bénéficier des mesures d’aides instaurées par l’Union42. Le fascisme se délita progressivement et ses derniers partisans n’hésitèrent pas à soutenir, en remplacement de leur Duce, une figure libérale de cette Union européenne qu’ils avaient abhorrée43.
En Allemagne, le nazi Adolphe Hitler avait été nommé chancelier en 1933. Très vite, sa politique tourna le dos à tous les engagements européens de l’Allemagne. Cependant, le Chancelier Hitler était instruit du précédent italien : dès le lendemain de l’incendie du Reichstag, et avant que l’Union ait eu le temps de réagir, il notifia au Conseil européen le retrait de l’Allemagne44. Après deux années de tractations aussi irritantes qu’infructueuses, et conformément aux termes de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne, l’Allemagne cessa le 1er mars 1935 d’être membre de l’Union européenne.
La déconvenue fut sévère. Privée de ses principaux débouchés, l’industrie allemande s’effondra pour de bon. Le chômage de masse et l’inflation reparurent, au moment même où les politiques initiées par John Maynard Keynes permettaient dans les autres États membres un redressement spectaculaire sur le plan économique aussi bien que social. Hitler, incapable de rencontrer le succès sur le plan intérieur, engagea l’Allemagne sur la voie d’une diplomatie agressive. Cette escalade aboutit le 23 août 1939 à la conclusion d’un pacte avec l’URSS, par lequel les deux États se partageaient la jeune Pologne. L’annonce de cette nouvelle entraîna des émeutes dans tout le pays. Les manifestants se massèrent sur la Pariser Platz, au pied de la Porte de Brandebourg. Hitler fut contraint par le Parti d’abandonner le pouvoir. L’Empereur désigna Karl Dönitz en tant que nouveau chancelier45. Ce dernier espérait sauver ce qui restait de l’idéologie nazie. Néanmoins, et durant les quelques jours que dura son pouvoir, son seul acte politique consista, le 1er septembre 1939, à déposer une nouvelle demande d’adhésion à l’Union. Les négociations furent menées par Konrad Adenauer. Bientôt, le Reich céda la place en Allemagne à la République fédérale.
« C’était écrit, s’exclama la femme.
— Restons prudents tout de même, répliqua l’homme : Staline ne pardonnera pas à l’Union de l’avoir privé de la Pologne. »
1950 – Centenaire
En ces premiers jours de mai, les discussions tournaient presque exclusivement autour du centenaire de l’Union européenne. Au-delà du symbole, ce centenaire serait marqué par la première élection d’un président de l’Union européenne au suffrage universel direct. Cette réforme – qui avait été âprement contestée – avait été actée lorsque l’Ukraine et la Russie avaient rejoint le troisième cercle de l’Union l’année précédente.
« Tu as lu cet article du New York Times qui veut prouver que le projet politique européen est voué à l’échec ? Cela fait cent ans que cela fonctionne et certains en sont encore à douter comme au premier jour ! s’amusa la femme.
— Ne leur en veux pas trop : les Européens eux-mêmes ont douté longtemps de la viabilité des États-Unis d’Amérique. Washington est un peu fâché que nous n’ayons pas suivi leur modèle fédéral.
— Ce modèle n’aurait pas marché. Le simple fait de penser l’Europe en termes de hiérarchie a provoqué de trop nombreuses crispations. Il fallait en sortir d’une manière ou d’une autre.
— Tu te rappelles des premières réactions lorsque ce collègue autrichien a proposé pour la première fois son modèle concentrique du droit ? Il a dû en subir des critiques, le pauvre : j’étais présent lors de sa première conférence : “Imaginez une série de cercles concentriques qui représenterait les obligations juridiques des membres d’une communauté sociale organisée. Vous voyez apparaître un centre, encerclé par divers degrés de normativité”.
— Cette évolution de l’Union vers un modèle concentrique était en germe depuis longtemps : je crois que c’était son évolution naturelle. La doctrine n’a fait que proposer le cadre théorique qui a servi de base à la dernière révision des traités46.
À ce moment, une jeune militante s’approcha.
— Pour les élections européennes : votez Schuman ! »
Et elle leur tendit un tract. L’homme l’attrapa par politesse. La militante partie, il reprit sa conversation :
« Schuman président ! Tu vois comme va la politique de nous jours. Nos aïeux avaient Victor Hugo : nous aurons Robert Schuman. L’époque des Pères fondateurs est bien loin.
— Je ne sais pas : si nous n’avions pas fait l’Europe il y a cent ans, je pense que Robert Schuman aurait pu en porter l’idée.
— Tu imagines que nous n’ayons pas fait l’Europe ? Je me demande bien ce qui aurait été différent, demanda l’homme.
— Nous pourrions essayer d’écrire cette histoire, suggéra la femme. Imagine que ce ne soit pas le discours de Victor Hugo, mais celui de Robert Schuman qui ait servi de point de départ ? Les faits seraient les mêmes, mais le cadre juridique et institutionnel européen aurait cent ans de retard. Quelle aurait été notre histoire ? »
1 Les faits servant de trame à la présente contribution sont pour l’essentiel authentiques. Les altérations inhérentes à l’exercice uchronique sont signalées comme telles en notes de bas de page chaque fois que leur caractère imaginaire n’est pas évident. Le droit de l’Union est réputé être exactement ce qu’il a été, mutatis mutandis, du point de vue de son contenu : chacun des actes de droit primaire et de droit dérivé a seulement été publié avec exactement cent ans d’avance. Les notes de bas de page se rapportent à la chronologie réelle et ne comportent aucun élément fictif.
2 Le présent texte emprunte très librement au procès-verbal des séances du Congrès des amis de la paix universelle, qui s’est tenu à Paris du 22 au 24 août 1849 : J. Garnier, Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849 : compte rendu des séances, précédé d’une Note historique sur le mouvement en faveur de la paix, Librairie Guillaumin, Paris, 1850.
3 Le texte intégral de cette allocution est reproduit aux pages 3 à 5 du compte rendu des séances, cité supra.
4 La présence de Louis de Saint-Julle de Colmont est attestée par le compte rendu des séances du Congrès, précit, et son rôle au sein du ministère est confirmée par le Dictionnaire historique des inspecteurs des Finances, 1801-2009, p. 89 et p. 1013 et s. Ce personnage a paru aux auteurs pouvoir tenir de façon crédible le rôle d’impulsion qui avait été celui de Jean Monnet dans la chronologie réelle.
5 Ces opinions sont prêtées à Colmont par les auteurs. Aucun élément de bibliographie n’a permis d’identifier avec précision la pensée politique du personnage.
6 Alexis de Tocqueville a occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères du second gouvernement d’Odilon Barrot, du 2 juin au 31 octobre 1949, soit au moment du discours prononcé par Victor Hugo à l’occasion du Congrès de la paix de Paris. Le lien d’amitié unissant Louis de Colmont et Alexis de Tocqueville est lui aussi de l’invention des auteurs.
7 Les auteurs ne peuvent s’empêcher d’inviter le lecteur à rapprocher cette réflexion d’Alexis de Toqueville du projet initié par le personnage de Hari Seldon, dans l’ouvrage d’Isaac Asimov, Fondation, 7 vols, 1941-1987. La structure de cet ouvrage a par ailleurs inspiré celle de la présente contribution.
8 E. Cruce, Le Nouveau Cynée, ou Discours des occasions et moyens d’établir une paix générale et la liberté du commerce par tout le monde, Paris, Jacques Villery, 1623, 226 p.
9 Cette appropriation politique et diplomatique du discours prononcé par Victor Hugo n’est pas historique et constitue le point de basculement sur lequel est bâtie cette uchronie.
10 La Commission centrale pour la navigation du Rhin est considérée comme la plus ancienne organisation internationale. Elle a été instituée en 1815, lors du Congrès de Vienne, elle repose à l’époque sur une administration internationale ad hoc. Elle est toujours en fonctionnement aujourd’hui. Concernant cette organisation, voy. M. Libera et S. Schirmann (dir.), La commission centrale pour la navigation du Rhin, histoire d’une organisation internationale, Paris, L’harmattan, 2018, 366 p.
11 Né en 1836 et mort en 1908, Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano devient diplomate pour le Royaume d’Italie en 1867. Les diplomates dont les noms sont mentionnés le sont pour les besoins du texte, sans que les auteurs entendent préjuger de leurs positions politiques ou de leur engagement en faveur du mouvement pro-européen.
12 Né en 1830 et mort en 1903, Joseph de Cadoine de Gabriac est un diplomate français. Dans la chronologie réelle, Gabriac fut envoyé en tant que chargé d’affaires à Berlin afin de rétablir les relations diplomatiques entre la France et l’Allemagne à la fin de la guerre de 1870, ce qui a paru aux auteurs en faire un acteur tout désigné pour le rôle qu’il tient dans la présente uchronie.
13 Le trône d’Espagne, antérieurement dévolu aux Bourbons, était vacant depuis la Glorieuse révolution de 1868. Le prussien Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen se porta candidat à la succession, avec l’aval du roi de Prusse. La France repoussa vivement cette candidature, et le candidat allemand renonça à faire valoir sa prétention. Cependant, Napoléon III demanda au roi de Prusse de confirmer l’abandon définitif par la Prusse de ses prétentions à la couronne d’Espagne. S’ensuivirent d’exagérations diplomatiques, savamment orchestrées, qui devaient conduire les deux pays à la guerre.
14 La dépêche d’Ems est considérée comme le casus belli de la guerre de 1870 : informé du refus poli de son roi de donner suite à l’insistance des Français, Bismarck publia la nouvelle sous la forme d’une dépêche à laquelle il donna le ton le plus insultant, ton qui fut encore amplifié par les journaux français. Sur ce texte, voy. R. de Castries, « La dépêche d’Ems », La Revue des deux mondes, septembre 1983, p. 567-575.
15 Né en 1834 et mort en 1895, Clemens August Busch est un diplomate prussien.
16 La formule est authentique, voy. R. de Castries, « La dépêche d’Ems », précit., p. 570.
17 Né en 1817 et mort en 1889, Eugène de Kerckhove débuta sa carrière de diplomate en 1841. Il quitte ses fonctions au sein de la diplomatie belge en 1849 et exercera par la suite les fonctions de ministre plénipotentiaire de l’Empire ottoman à Bruxelles.
18 Cette phrase traduit la distinction que proposera en 1963 le norvégien Johan Galtung entre les paix dissociatives, qui consistent à séparer les adversaires, et les paix associatives, qui consistent à les rapprocher (J. Galtung, Theories of Peace – A Synthetic Approach to Peace Thinking, non publié, Oslo, 1967).
19 Cette phrase traduit l’un des six critères qui caractérisent, selon Johan Galtung, une « structure de paix » dans laquelle la question de la paix ou de la guerre dépend d’un nombre étendu de facteurs qui permet de garantir que la détérioration des rapports dans un domaine donné est compensée par le maintien de relations positives dans les autres domaines (J. Galtung, Theories of Peace, précit.).
20 Cette phrase traduit un autre des critères de la « structure de paix », à savoir l’existence de relations entre une pluralité d’acteurs, de sorte que la dégradation des relations entre quelques-uns d’entre eux soit toujours contrebalancée par le maintien de bons rapports entre tous les autres (J. Galtung, Theories of Peace, précit.).
21 L’expression fait référence à l’ouvrage de David Mitrany, A Working Peace System, publié en 1943, et dans lequel l’auteur promeut les interdépendances de fait comme moyen d’assurer la paix (sur cet ouvrage, voy. not. G. Devin, « Que reste-t-il du fonctionnalisme international ? Relire David Mitrany (1888-1975) », Critique internationale, 2008/1, n° 38, p. 137-152).
22 Propos librement extrait du discours de Jules Ferry à l’Assemblée nationale le 28 juillet 1885.
23 Représentant de la France à la Conférence de Berlin sur l’Afrique de l’Ouest.
24 Cette dernière phrase est empruntée au célèbre discours de Robert Schuman du 9 mai 1950.
25 Cette phrase est également empruntée au discours du 9 mai 1950.
26 Le mécanisme suggéré, entièrement fictif, se situe à la croisée de plusieurs méthodes d’utilisation déléguée d’espaces territoriaux en droit international : il se situe au croisement des mandats, tels qu’ils ont été instaurés par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, et des licences d’exploration et d’exploitation délivrées par l’Autorité internationale des Fonds marins instituée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce mécanisme paraît selon les auteurs constituer une hypothèse crédible de la manière dont la question coloniale aurait été envisagée par les institutions européennes si elles y avaient été confrontées.
27 Cette mission civilisatrice avait été expressément mentionnée par Jules Ferry dans son discours du 28 juillet 1885, comme formant la contrepartie des avantages commerciaux que la France devait retirer de la colonisation. Les termes particulièrement polémiques de ce discours appelèrent une réponse ferme de Georges Clémenceau dans un autre discours daté du 31 du même mois.
28 L’expression figure dans la Convention signée entre la Communauté économique européenne et les États ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) signée à Lomé le 28 février 1975, JOUE L 25 du 30 janvier 1976, p. 2-40.
29 Cette dernière expression figure dans le texte de la Troisième Convention signée à Lomé le 8 décembre 1984, art.1, JOUE L 86 du 31 mars 1986, p. 3-208.
30 Suite à l’attentat, la Serbie avait refusé la participation de la police autrichienne à l’enquête, ce qui avait été l’un des éléments déclencheurs de l’ultimatum autrichien et de la Première Guerre mondiale.
31 Voy. F. Vinet, « La gestion de l’épidémie de grippe espagnole (1918-1919) : préfets et municipalités en première ligne », Revue française d’administration publique, vol. 176, n° 4, 2020, p. 861. Dans la chronologie réelle, la grippe en question reçut le qualificatif d’« espagnole » car l’Espagne, n’étant pas impliquée dans la Première Guerre mondiale, était l’un des rares pays dans lequel la presse avait conservé une relative liberté : les journaux espagnols relataient donc sans restriction l’épidémie, que la censure passait sous silence ailleurs. En l’absence de guerre, ce qualificatif ne se serait certainement pas imposé. Les débats demeurent vifs aujourd’hui quant au lieu d’apparition de cette pandémie, mais l’hypothèse d’une apparition aux États-Unis demeure la plus commune (L. Spinney, La grande tueuse. Comment la grippe espagnole a changé le monde, Paris, Albin Michel, 2018, 432 p.).
32 F. Vinet, « La gestion de l’épidémie de grippe espagnole (1918-1919) : préfets et municipalités en première ligne », précit., p. 861.
33 Ces appels à la coordination ont effectivement été formulés, en 2020, au début de l’épidémie de Covid-19, par les institutions de l’Union : voy. notamment, les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels, JOUE C 86 I du 16 mars 2020, p. 1-4 ainsi que la déclaration commune des membres du Conseil européen sur le Covid-19 du 26 mars 2020, non publiée au JOUE.
34 Cet échange incorpore diverses citations d’époque figurant dans F. Vinet, « La gestion de l’épidémie de grippe espagnole (1918-1919) : préfets et municipalités en première ligne », précit., p. 861.
35 Cette décision du Conseil supérieur d’hygiène est citée dans F. Vinet, « La gestion de l’épidémie de grippe espagnole (1918-1919) : préfet et municipalités en première ligne », précit., p. 861.
36 En l’absence de la Première Guerre mondiale, il est à supposer que la révolution soviétique n’a pas trouvé en 1917 les conditions favorables à son déroulement. Il lui faut alors attendre les désordres induits par la pandémie de grippe pour se déclencher.
37 L. Van Middelaar, Quand l’Europe improvise – Dix ans de crises politiques, Paris, Gallimard, Le Débat, 2018, 412 p.
38 Le Premier ministre David Lloyd George a été l’un des principaux protagonistes des négociations de paix de Versailles en 1919. Les qualités qu’il montra à cette occasion font supposer aux auteurs qu’il eût été mieux à même d’emporter la conviction de sa population que ne le furent ses successeurs.
39 Sur la modification de la loi électorale en 1923 et le déroulement du scrutin de 1924, voy. F. Le Moal, Histoire du fascisme, Paris, Perrin, 2018, spéc. p. 116 et s. et M. Ostenc, Mussolini : une histoire du fascisme italien, Paris, Ellipses, 2013, p. 75.
40 Voy. F. Le Moal, Histoire du fascisme, Paris, Perrin, 2018, spéc. p. 122 et s. et M. Ostenc, Mussolini : une histoire du fascisme italien, Paris, Ellipses, 2013, p. 77 et s.
41 Sur la critique réelle adressée au fascisme de l’époque d’avoir suscité des ricanements en Europe en raison du caractère bouffon de son chef, voy. F. Le Moal, Histoire du fascisme, Paris, Perrin, 2018, spéc. p. 10 : « On remarquera aussi que, malgré sa dureté, le fascisme suscitait de nombreux ricanements, y compris à l’époque de sa gloire. Mussolini n’était-il pas présenté comme un “César de carnaval” ? Les marches au pas de l’oie, les photographies du Duce torse nu dans les champs ou sur les plages, la théâtralité de ses discours pendant lesquels il savait jouer de sa voix et de son corps avec le talent d’un acteur, la grosseur de sa tête chauve donnaient un caractère bouffon au régime ».
42 Le 16 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, qui permettait de conditionner les versements de fonds européens aux États membres au respect des règles de l’État de droit : règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, JOUE L 433I du 22 décembre 2020, p. 1-10.
43 L’hypothèse n’est pas invraisemblable et évoque le remplacement en 2021 de Giuseppe Conte, membre du mouvement 5 étoiles, par Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019.
44 La manœuvre est probable : dès 1933, Adolf Hitler annonçait le retrait de l’Allemagne de la Société des Nations.
45 Karl Dönitz fut le successeur désigné par Hitler juste avant son suicide en 1945. Dönitz régna une seule journée, avant de mettre fin à ses jours.
46 Cette représentation d’une Union organisée sous la forme de « cercles concentriques » est notamment attribuée à Jacques Delors. L’ancien président de la Commission européenne appelle d’ailleurs à une clarification des concepts de « Fédération d’États-Nations » et de « différenciation » lors de son audition par la Délégation pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale, Compte rendu n° 149, Réunion du mardi 19 juin 2001.
Romain Le Bœuf et Nathalie Rubio, « Si Victor Hugo avait été entendu… Fragments d’une histoire européenne », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4604.