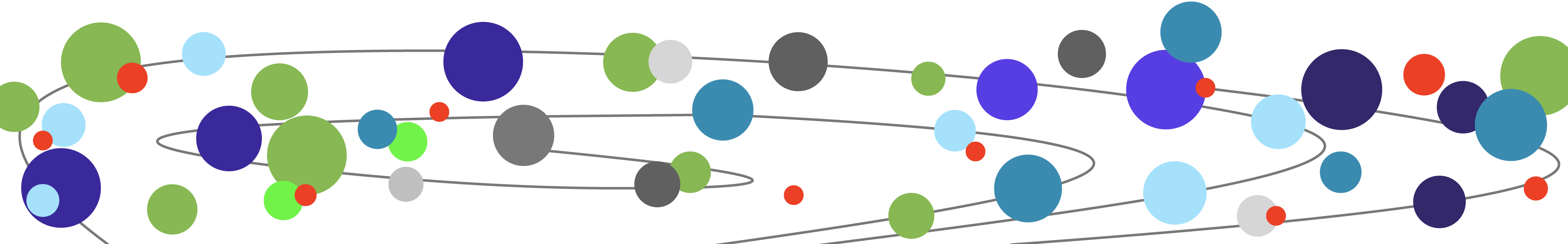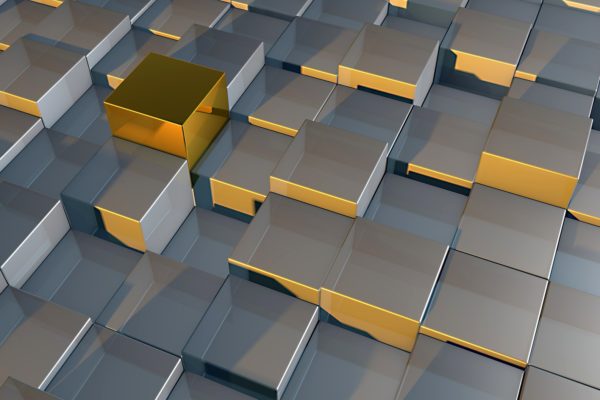Laetitia Janicot
Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ISJPS)
Sans le Code général de la propriété des personnes publiques, le droit des biens publics ressemblerait étrangement à ce qu’il est aujourd’hui… En effet, les principales évolutions du droit des biens sont liées au poids du droit de la Convention européenne des droits de l’homme et de celui de l’Union européenne ainsi qu’à des considérations de nature plus pragmatiques, notamment financières et commerciales. Si l’adoption du Code général de la propriété des personnes publiques a révolutionné les sources du droit domanial, le droit des biens publics aurait pu évoluer jurisprudentiellement dans la même direction.
Without the General Code of Public Property, public property law would look strangely like it does today… Indeed, the main developments in the law of public property are linked to the weight of the law of the European Convention on Human Rights and that of the European Union as well as to considerations of a more pragmatic nature, notably financial and commercial. If the adoption of the General Code of Public Property has revolutionized the sources of public property law, the law of public property could have evolved jurisprudentially in the same direction.
Si le Code général de la propriété des personnes publiques n’avait pas été adopté, à quoi ressemblerait aujourd’hui le droit des biens publics ?
Ce code1, institué par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), est le résultat d’un long processus2. L’ordonnance n’a, en effet, été ratifiée que par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de ratification et la partie réglementaire du code est, pour sa part, issue du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011. Le CG3P a depuis fait l’objet de nombreuses révisions. Parmi celles-ci peuvent être mentionnées l’ordonnance relative au droit des biens publics ultramarins3 ou encore celle intégrant, à la suite de l’arrêt Promoimpresa, le droit européen de la mise en concurrence4. Le Code général de la propriété des personnes publiques est, en effet, ici appréhendé non pas comme un moment précis, figé en 2006, mais plutôt comme l’insertion d’un ensemble de règles dans un code.
Le travail, auquel nous invite Ariane Vidal-Naquet et qui consiste à réécrire « l’histoire des possibles non advenus », présente un intérêt particulier lorsqu’on s’interroge sur place du CG3P, ou plus généralement de la loi, en droit administratif des biens.
D’une part, le CG3P a été adopté dans un domaine où la jurisprudence a été pendant longtemps la principale source du droit. Ainsi, la reconstruction fictive de l’histoire du droit administratif des biens, telle qu’elle aurait pu se produire, sans l’adoption de ce code, donne l’occasion de réfléchir à la place et à l’autorité de la loi, à l’utilité de la codification, ainsi qu’à la manière dont le juge exerce son pouvoir normatif.
D’autre part, et surtout, le Code général de la propriété des personnes publiques n’opère pas, à la différence de la plupart des autres codes, une codification à droit constant. Le code a pour ambition de réaliser « une refonte normative ciblée sur la modernisation de la gestion domaniale »5. Le code innove, à ce titre,par sa structure fondée sur le droit de propriété, par la définition qu’il retient du domaine public, ou encore en ce qu’il promeut la valorisation économique du domaine en sécurisant le régime juridique de ses occupants. « Réformiste », le Code n’est pas pour autant « révolutionnaire »6. Il entérine, en effet, la distinction entre domaine public et domaine privé ; il consacre les principes d’inaliénabilité ou d’imprescriptibilité du domaine public ou encore des jurisprudences passées7, dont certaines étaient pourtant décriées (comme, par exemple, la théorie des mutations domaniales ou le principe d’insaisissabilité).
Ces spécificités du CG3P confèrent ainsi tout son intérêt à une démarche uchronique, qui consiste à se demander ce qu’il se serait passé si cette codification n’avait pas eu lieu. Le juge s’en serait-il tenu à sa jurisprudence passée ou, au contraire, l’aurait-il de lui-même modifiée, atténuée, voire renversée, ou même aurait-il pu adopter de nouvelles règles semblables à celles dégagées par le CG3P ?
Ce travail d’identification de ce qu’aurait fait le juge administratif sans le code ne peut pas être le produit de la seule imagination et n’entend pas non plus constituer une œuvre de science-fiction. Loin d’inventer une nouvelle histoire du droit des biens publics qui n’a pas été, comme le propose l’initiatrice de ce projet, ces brèves réflexions générales tentent, tant bien que mal, de trouver appui sur des indices. Parmi ceux-ci, la prise en compte de la jurisprudence administrative ultérieure et des règles de droit existant aujourd’hui peut aider à « refaire », à reconstruire une histoire du droit administratif des biens dans un sens le plus vraisemblablement possible.
Or l’étude de ces indices aboutit à un résultat plutôt inattendu au regard de l’ambition réformatrice affichée du code. Il nous semble, en effet, possible de dire que l’histoire du droit des biens publics n’aurait pas été si différente que cela, « le champ des possibles » n’étant pas aussi large qu’on le pensait. Le droit, appréhendé de manière générale, aurait probablement été assez proche sans le code. Comment expliquer un tel résultat ? Deux facteurs principaux nous semblent expliquer cette reconstruction fictive du droit des biens publics. Les premiers, qui se retrouvent aussi en droit administratif général, renvoient aux contraintes qu’impose le respect du droit de l’Union européenne et du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (I). Les seconds traduisent la nécessité pour le juge comme le législateur de rechercher un équilibre permanent entre protection et valorisation économique, équilibre qui sous-tend l’ensemble du droit des biens publics (II).
I. Un droit sous contraintes
Les principales contraintes, qui pèsent sur le droit des biens publics, sont issues du droit de l’Union européenne et du droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Deux exemples, bien connus, montrent que ces droits auraient probablement eu des effets assez proches en droit des biens, que le Code général de la propriété des personnes publiques ait été ou non adopté. Ils portent sur l’attribution des autorisations d’occupation du domaine public (A) et sur le principe d’insaisissabilité des biens publics (B).
A) L’attribution des autorisations d’occupation du domaine public
Dans son arrêt Promoimpresa, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, tout d’abord, précisé que les titres domaniaux sont des « autorisations » au sens de la directive Services 2006/123/CE du 12 décembre 20068 lorsqu’un opérateur économique a l’obligation de les solliciter pour accéder à une activité de service ou pour l’exercer. La délivrance et le renouvellement de telles autorisations, dont le nombre est limité compte tenu des ressources naturelles ou des capacités techniques, doivent être « soumis à une procédure de sélection entre les candidats potentiels, laquelle doit répondre à toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate »9.
Pour répondre à ces exigences posées par la CJUE, l’ordonnance du 19 avril 2017 a introduit, aux articles L. 2122-1-1 et suivants du CG3P, l’obligation pour l’autorité compétente, « lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, « d’organiser librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Qu’aurait fait le juge administratif en l’absence de ces nouvelles dispositions ?
Certes, on le sait, le Conseil d’État a refusé en 2010 d’imposer lui-même de telles règles de mise en concurrence et de publicité au motif qu’une telle solution nécessiterait « à la fois […] une décision politique et […] une organisation textuelle précise »10.
Mais, après l’adoption de l’arrêt Promoimpresa11, le Conseil d’État aurait pu difficilement maintenir une telle position. Contraint par le juge de l’Union européenne12, et en tant que juge européen de droit commun, il n’aurait pas pu laisser, comme en 2010, « la question de la transparence de l’attribution des conventions d’occupation du domaine public » entre les mains du seul législateur.
La mise en place de procédures respectueuses du principe de transparence n’aurait pas, en outre, été une affaire si difficile pour le juge. Il n’aurait pas, en effet, été nécessaire, contrairement à ce qu’indiquait le rapporteur public en 2010, de prévoir des règles trop précises de publicité et de mise en concurrence. D’ailleurs, le CG3P, lui-même, ne spécifie pas les conditions et les critères au regard desquels les gestionnaires doivent fonder leur choix. Il se contente de prévoir un principe de liberté, certes, assorti d’exceptions, selon lequel l’autorité compétente « organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Ainsi, le juge administratif aurait pu, tout autant que le législateur, décider qu’il appartenait à l’autorité gestionnaire de fixer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans le respect du principe de transparence, les conditions auxquelles elle entend subordonner la délivrance des titres d’occupation. Son contrôle aurait été alors assez comparable à celui qu’il exerce sur les conditions de passation des marchés à procédure adaptée.
D’ailleurs, sans fondement légal, le Conseil d’État a consacré l’opposabilité du principe de non-discrimination issu de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des dispositions de la directive du 12 décembre 2006 aux autorisations d’occupation du domaine public accordées avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 avril 201713.
Tous ces éléments laissent penser que, même en l’absence de CG3P, le Conseil d’État aurait probablement accepté, sous la contrainte du droit de l’Union européenne, de poser le principe du respect de règles de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution des autorisations d’occupation du domaine public.
B) Le principe d’insaisissabilité des biens publics
Le principe d’insaisissabilité des biens publics est un autre exemple de l’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Consacré par l’article L. 2311-1 du CG3P, après avoir été reconnu comme un principe général du droit14, le principe d’insaisissabilité a été et reste, encore aujourd’hui, malgré sa codification, contesté au regard du droit de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne assimile, en effet, ce mécanisme à une aide d’État, qui prend la forme d’une garantie implicite et illimitée de l’État, incompatible avec le droit de la concurrence15. Les personnes publiques, opérateurs économiques, échappent, en effet, à tout risque de faillite et peuvent, ainsi, accéder plus facilement au crédit.
Le législateur ne l’a, jusqu’à présent, pas remis en cause, mais il a introduit, en dehors du code, quelques exceptions et il a transformé un nombre important d’établissements publics nationaux en sociétés privées16.
Qu’aurait fait, de son côté, le juge administratif en l’absence de codification de ce principe ? Ayant déjà admis l’opposabilité et l’applicabilité du droit de la concurrence en matière de gestion du domaine public17, il ne serait probablement pas resté, lui non plus, indifférent à la jurisprudence de la CJUE sur les aides d’État.
Certes, il n’aurait pas pu prévoir, comme l’a fait le législateur, des exceptions au principe, mais il aurait pu, si ce n’est le remettre en cause, limiter à tout le moins, son application aux seuls biens indispensables au fonctionnement du service public18. D’ailleurs, à propos d’ex-établissements publics industriels et commerciaux, devenus sociétés, le législateur a prévu un régime de quasi-domanialité qui ne semble pas poser de difficultés vis-à-vis du droit de l’Union européenne.
Le droit de l’Union européenne admet, en effet, des tempéraments aux règles de la concurrence lorsqu’ils contribuent au bon accomplissement d’une mission de service d’intérêt économique général19.
Conscient des difficultés que ce principe pouvait aussi engendrer au regard du droit de la Convention européenne des droits de l’homme20, le Conseil d’État n’a d’ailleurs pas procédé autrement, lorsqu’il a autorisé le préfet, sous certaines conditions21, à procéder à la vente forcée de biens d’une collectivité territoriale pour assurer le respect d’une décision de justice ayant force de chose jugée, la condamnant à payer une somme d’argent. Il a, en effet, assorti ce pouvoir de saisie à la condition que ces biens ne soient pas nécessaires à la continuité du service public22.
Cette jurisprudence, qui s’applique aux voies d’exécution administratives, aurait pu tout autant s’appliquer aux procédures civiles d’exécution. Au nom du respect du droit de la concurrence de l’Union européenne, le juge administratif aurait pu ainsi juger que seuls les biens publics non nécessaires à la continuité du service public puissent faire l’objet de voies d’exécution23.
D’ailleurs, le refus du Conseil d’État de qualifier les immeubles acquis par des personnes publiques au sein du périmètre d’une association syndicale de propriétaires ou d’une association foncière urbaine libre, comme des biens appartenant au domaine public, a conduit à ce que de tels biens publics, en tant qu’ils appartiennent au domaine privé, puissent faire l’objet d’hypothèques légales24. Cette solution a été ensuite confirmée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Celle-ci a, en effet, précisé que « lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public », c’est-à-dire aux immeubles affectés à une mission de service public (art. 220).
Indépendamment de ces contraintes, le législateur comme le juge administratif cherchent tous deux à concilier la protection des biens publics et leur valorisation économique, deux exigences structurantes du droit administratif des biens.
II. Un droit à la recherche d’un équilibre
Le juge administratif comme le législateur cherchent tous deux à développer la valorisation économique des biens publics. Présenté comme un « Code de la valorisation »25, le CG3P a, par exemple, consacré le principe jurisprudentiel selon lequel toute occupation privative doit donner lieu au paiement d’une redevance26, ainsi que les modalités de calcul de celle-ci27. Le juge administratif poursuit la même « logique gestionnaire »28, lorsqu’il consacre le principe d’incessibilité des biens publics à vil prix29 ou, plus récemment, le principe selon lequel « une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes »30.
Au contraire, dans le sens de la protection du domaine public, le CG3P a consacré les principes jurisprudentiels d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité auxquels le Conseil d’État reste lui aussi attaché31.
Au-delà de ces cas de convergence, le CG3P est revenu sur certaines jurisprudences passées au nom de la valorisation économique du domaine public. La démarche uchronique consiste alors à réfléchir à la destinée de ces nouvelles règles en l’absence de code. Ce travail peut être mené sur les deux principaux « éléments de rupture », qui ont été identifiés par la doctrine32. Le premier a consisté pour le législateur à réduire le périmètre du domaine public, qui avait été trop largement étendu par la jurisprudence administrative (A) et le second a emporté un assouplissement du principe d’inaliénabilité (B).
A) La réduction du périmètre du domaine public
Le législateur s’est appliqué, tout d’abord, à limiter l’hypertrophie du domaine public à laquelle le juge administratif avait largement contribué33.
Indépendamment des déclassements opérés par le législateur34 et de la qualification de certains biens comme entrant dans le domaine privé ou public35, le code a notamment remplacé l’exigence d’un aménagement spécial par celle d’un aménagement indispensable36, même si celle-ci est désormais limitée à l’hypothèse où le bien est affecté à une mission de service public. De même, s’il a consacré la théorie de l’accessoire37, il l’a fortement restreinte en exigeant systématiquement un lien physique et fonctionnel, contrairement au juge administratif qui pouvait admettre que ces liens ne soient qu’alternatifs. Enfin, le code ne reprend ni la théorie du domaine public par anticipation ni la théorie du domaine public global. Ce silence, associé à l’exigence d’un aménagement indispensable, ont pu être interprétés comme la volonté du législateur d’abandonner ces deux théories.
En l’absence d’intervention du législateur, et donc sans CG3P, le juge aurait-il continué à étendre le champ du domaine public ou, au contraire, l’aurait-il, de lui-même, réduit ?
La définition du domaine public, et par voie de conséquence son périmètre, n’auraient probablement pas été si différents, comme en témoigne la jurisprudence administrative postérieure au code.
D’une part, le Conseil d’État a neutralisé, dans le temps, le nouveau critère de l’aménagement indispensable. Il a, en effet, jugé que l’entrée en vigueur du code n’avait pas pour effet de faire sortir du domaine public des biens qui en faisaient partie en application des anciens critères38. Le critère de l’aménagement indispensable ne s’applique donc qu’aux biens entrés dans le domaine public après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2006. Il n’est pas ensuite certain que l’adoption de ce nouveau critère emporte d’importantes modifications du droit39. Les cas dans lesquels il peut avoir une utilité, en tant que critère réducteur du domaine public, devraient, en effet, rester rares, puisque, la plupart du temps, le bien en lui-même, et non l’aménagement, est nécessaire au service public et l’aménagement ne suscite pas dans ce cas de doutes. Dans la majorité des cas, l’aménagement « indispensable » aurait été tout aussi « spécial » auparavant40.
D’autre part, le Conseil d’État a réaffirmé, malgré le silence du code, l’application de la théorie du domaine public par anticipation41 ainsi que celle du domaine public global42, théories « expansionnistes du domaine public »43. Un tel maintien laisse ainsi penser que le Conseil d’État ne les aurait sans doute pas abandonnées en l’absence de code.
Enfin, s’agissant de la théorie de l’accessoire, le Conseil d’État a décidé d’appliquer les deux critères physiques et fonctionnels aux biens construits antérieurement à l’entrée en vigueur du code44. Cette application rétroactive des deux critères s’explique sans nul doute par la modification opérée par le CG3P. Mais, il faut toutefois relever que le juge pouvait se montrer quelquefois exigeant, avant 2006, en exigeant tout à la fois un lien physique et un lien fonctionnel45.
Tous ces éléments laissent penser que, si le CG3P n’avait pas été adopté, la qualification d’un bien public n’aurait finalement pas été si différente de celle qui est retenue aujourd’hui. Ainsi, la redéfinition, par le CG3P, des critères de qualification du domaine public, emporte moins d’effets qu’on ne pouvait l’imaginer. Qu’en est-il du second « élément de rupture », identifié par la doctrine, et qui a consisté à assouplir le principe d’inaliénabilité ?
B) Les assouplissements au principe d’inaliénabilité
Le CG3P a assoupli certaines règles impliquées par le principe d’inaliénabilité au nom de la valorisation économique du domaine public.
Poursuivant une logique de « valorisation cession »46, l’article L. 3112-1 permet ainsi les cessions amiables, sans déclassement, entre personnes publiques, lorsque les biens « sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». L’article L. 3112-2 permet, dans les mêmes conditions, à deux personnes publiques d’échanger des biens relevant de leur domaine public respectif. Pour cela, l’opération doit avoir pour objet « l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public » et l’acte d’échange doit comporter des clauses garantissant la continuité du service public. L’article L. 3112‑3 impose, en revanche, le déclassement, lorsque le bien est échangé avec une dépendance relevant du domaine privé (ou un bien privé). Le CG3P admet aussi la possibilité de déclassement anticipé du domaine public (art. L. 21421‑2) ainsi que les promesses de vente sous conditions suspensives (art. L. 3112–4).
Poursuivant une logique de « valorisation cession »46, l’article L. 3112-1 permet ainsi les cessions amiables, sans déclassement, entre personnes publiques, lorsque les biens « sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». L’article L. 3112-2 permet, dans les mêmes conditions, à deux personnes publiques d’échanger des biens relevant de leur domaine public respectif. Pour cela, l’opération doit avoir pour objet « l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public » et l’acte d’échange doit comporter des clauses garantissant la continuité du service public. L’article L. 3112‑3 impose, en revanche, le déclassement, lorsque le bien est échangé avec une dépendance relevant du domaine privé (ou un bien privé). Le CG3P admet aussi la possibilité de déclassement anticipé du domaine public (art. L. 21421‑2) ainsi que les promesses de vente sous conditions suspensives (art. L. 3112–4).
Témoigne également de l’assouplissement du principe d’inaliénabilité en vue d’une « valorisation gestion »47, cette fois, la faculté de constituer, sur le domaine public, des servitudes conventionnelles « dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent » (art. L. 2122-4)48 ou encore l’institution de fonds de commerce sous certaines conditions (art. L. 2124-32-1, introduit par la loi du 18 juin 2014)49. De même, il a été inséré dans le CG3P ainsi que dans d’autres codes (le Code général des collectivités territoriales, notamment), les nombreuses lois autorisant la constitution de droits réels sur le domaine public50.
S’agissant de la constitution de droits réels sur le domaine public, il est certain que le droit n’aurait pas été le même en l’absence de loi51. La jurisprudence administrative exige, en effet, malgré l’adoption du CG3P, l’intervention législative pour créer de nouveaux droits réels sur le domaine public ou étendre le champ de ceux qui existent52. Le Conseil d’État a, en effet, jugé « qu’aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’État et ses établissements publics puissent autoriser l’occupation d’une dépendance du domaine public en vertu d’une convention autre qu’une convention dite “d’occupation du domaine public”, à condition, toutefois, dès lors qu’elle confère un droit réel immobilier, que les clauses de la convention ainsi conclue respectent les dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public de l’État constitutives de droits réels, qui s’imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public »53.
Ainsi, si le législateur n’avait pas adopté les différentes lois, reprises par le CG3P et les autres codes, le juge administratif aurait sans aucun doute continué à juger illégale la constitution de droits réels sur le domaine public, même entourée de conditions équivalentes à celles qui sont posées dans les lois54. Pour que soient respectées les exigences constitutionnelles qui résultent de l’existence et de la continuité du service public55 et celles relatives aux propriétés publiques56, le Conseil constitutionnel exige, en effet, le respect d’un régime légal de protection du domaine public.
Ainsi, à défaut de pouvoir consentir des droits réels sur le domaine public, faute de loi, l’autorité domaniale aurait seulement pu attribuer des autorisations d’occupation du domaine public ordinaires. Les droits conférés à l’occupant du domaine, titulaire d’une autorisation ordinaire, auraient été beaucoup moins étendus et beaucoup moins bien protégés que ceux accordés dans le cadre du Code.
Mais, sur certains points, et sous l’effet de la jurisprudence, le statut de l’occupant n’aurait pas été si différent de celui de l’occupant titulaire d’une autorisation constitutive de droits réels. Ainsi, dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public ordinaire, l’occupant dispose d’un droit sur les constructions, les ouvrages et les installations qu’il a construits si le titre le prévoit ou ne s’y oppose pas57. De même, cet occupant dispose désormais du pouvoir de céder son droit d’occupation dès lors qu’il obtient l’accord écrit de l’autorité gestionnaire58. Enfin, si l’administration met fin au contrat d’occupation avant son terme, pour un motif d’intérêt général, l’occupant a droit à une indemnisation de l’ensemble de son préjudice, lorsqu’aucune clause du contrat ne s’y oppose pas59.
Plus généralement, et alors que le CG3P est silencieux sur cette question, le Conseil d’État a renforcé, dans le but de valoriser le domaine public, en limitant le caractère précaire de l’occupation privative, certains droits des occupants, notamment en matière de renouvellement des autorisations d’occupation du domaine public60.
Avec le CG3P, l’évolution du droit domanial se caractérise par le déplacement « du centre de gravité d’une logique de protection (centrée sur l’affectation publique) vers une démarche de valorisation (fondée sur le droit de propriété) »61. Il est vrai que, sans le CG3P, et plus généralement sans la loi, le droit domanial n’aurait pas suivi complètement cette voie, le juge administratif restant particulièrement attaché au principe d’inaliénabilité et à la protection de l’affectation des biens publics. Mais il ne l’aurait pas non plus complètement ignorée en raison du poids du droit de la Convention européenne des droits de l’homme et de celui de l’Union européenne. Le juge administratif ne serait, sans doute, pas non plus resté indifférent aux contraintes financières qui pèsent sur les personnes publiques ainsi qu’à la nécessité de « l’ouverture [des biens publics] à la commercialité »62. Si l’adoption par le législateur d’un code a opéré une « véritable mutation des sources du droit domanial »63, elle n’explique pas, à elle seule, et ces quelques réflexions uchroniques ont tenté de le montrer, les évolutions récentes qui affectent le droit des biens publics.
1 Sur le Code, J.-F. Giacuzzo, Code général de la propriété des personnes publiques, Fascicule 6, Jurisclasseur Propriétés publiques, 2019 ; S. Guérard (dir.), Réflexions générales sur le Code général de la propriété des personnes publiques, LexisNexis, Colloques et débats, 2007 ; Ch. Maugüe et G. Bachelier, « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA, 2006, p. 1086 ; H.-G. Hubrecht et F. Melleray, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », Droit adm., Aout-sept 2006 ; Ph. Yolka, « Naissance d’un nouveau code : la réforme du droit des propriétés publiques », JCP A. 2006, n° 22, act. 452. Dossier AJDA 2016, p. 1073 et s. et RFDA, 2006, p. 899.
2 L’adoption par ordonnance a été permise par une habilitation législative (art. 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003) pour une période de 18 mois prorogée à deux reprises (de 6 mois par l’article 89 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, puis de 9 mois par l’article 48 de la loi n° 2005‑842 du 26 juillet 2005). L’élaboration du CG3P a été également précédée de plusieurs rapports : le rapport du Conseil d’État, Réflexions sur l’orientation du droit des propriétés publiques, EDCE 1987 et le rapport d’un groupe interministériel présidé par M. Querrien, 1999.
3 Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016.
4 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
5 Ch. Maugüe et G. Bachelier, « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA, 2006, p. 1086 ; Rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, Texte n° 20.
6 Pour reprendre les expressions de Ph. Yolka, « Naissance d’un nouveau code : la réforme du droit des propriétés publiques », JCP A., 2006, n° 22, act. 452.
7 Par exemple, la définition du domaine public maritime.
8 Article 12 point 1 : Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
9 CJUE, 14 juill. 2016, aff. C–458/ 14 et C-67/15, Promoimpresa Srl, et Mario M. Melis.
10 Conclusions N. Escaut sur CE, 3 décembre 2010, Ville de Paris c./ Association Paris Jean Bouin, n° 338272.
11 Faisant aussi application du principe de transparence : CJCE 7 décembre 2000, Telaustria C 324/98 dans lequel la Cour a jugé que l’autorité concédante était, en toute hypothèse, dès lors que ce contrat présentait un intérêt transfrontalier certain, tenue « de respecter les règles fondamentales du Traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier », ce principe impliquant « notamment une obligation de transparence » qui consiste « à garantir en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication ».
12 Ce principe a déjà été appliqué à une habilitation unilatérale (CJUE 3 juin 2010, The Sporting Exchange Ltd, aff. C–203/ 08 – agrément pour l’exploitation de jeux de hasard).
13 CE, 10 juillet 2020, Sté Paris Tennis, n° 434582 : « aux termes des dispositions de l’article 12 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dont le délai de transposition expirait le 28 décembre 2009 : “Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture”. Ces dispositions, relatives à la liberté d’établissement des prestataires, sont susceptibles de s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, aff. C–458/ 14 et C-67/15, y compris lorsqu’est en cause une situation dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, comme l’a jugé la Cour par son arrêt du 30 janvier 2018, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort contre X BV et Visser Vastgoed Beleggingen BV contre Raad van de gemeente Appingedam, aff. C– 360/15 et C-31/16 ».
14 Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, Bureau de recherches géologiques et minières, Bull. civ. I, n° 348.
15 CJUE, 3 avril 2014, France c. Commission, aff. C–559/ 12.
16 Par exemple, la loi n° 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, art. 85 autorisant les offices publics de l’habitat à octroyer des sûretés réelles mobilières – CCH, art. L. 421-4-1.
17 CE, Sect., 26 mars 1999, Sté EDA, p. 107.
18 V. en ce sens, Ch. Roux, L’insaisissabilité des biens des personnes publiques : vers la mise en place d’un critère fonctionnel ?, Presses Lyon III, 2008 ; Ch. Roux, « L’insaisissabilité des biens publics emportée par la loi ELAN », AJDA, 2019, p. 601 ; Ch. Roux, Droit administratif des biens, préc., p. 22 ; P. Levallois, L’Etablissement public marchand. Recherches sur l’avenir de l’entreprise en forme d’établissement public, Dalloz, 2021, NBT ; Ph. Yolka, « Sûretés, filles de prudence ? », AJDA, 2020, p. 1025.
19 Notamment, l’art. 106 §2 du TFUE et, par exemple, CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00.
20 Plus précisément au regard du droit au respect des biens, qui implique le droit pour un créancier de recouvrer sa créance (CEDH, 26 septembre 2006, Sté fermière de Campoloro et al. c. France, n° 57516/00 ou CEDH 24 septembre 2013, De Luca et Pennino c./ Italie, n° 001-126435) et au regard du droit à l’exécution des décisions de justice composante du droit à un procès équitable énoncé à l’article 6 § 1 de la CEDH (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, n° 18357/91).
21 Lorsque les crédits sont insuffisants, et en cas de mise en demeure de créer ces ressources, restée infructueuse.
22 CE, Sect., 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro, n° 271898.
23 Ch. Roux, Propriété publique et droit de l’Union européenne, LGDJ, 2015, p. 709 et s. et P. Levallois, L’Établissement public marchand. Recherches sur l’avenir de l’entreprise en forme d’établissement public, Dalloz, 2021, NBT, p. 640 et s.
24 CE, 23 janvier 2020, Sté JV Immobilier et al. c./ Cne de Bussy-Saint Georges, n° 430192 et n° 430359 et CE, 10 mars 2020, n° 432555, Association syndicale des propriétaires de la cité Boigues.
25 Y. Gaudemet, « À propos de la valorisation économique des propriétés publiques », RDP, 2012, p. 1123.
26 CG3P, art. L. 2125–1.
27 CG3P, art. L. 2125–3.
28 H.-G. Hubrecht et F. Melleray, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », Droit adm. août-sept. 2006, étude 15.
29 CE, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473.
30 CE, 28 septembre 2021, CCAS de Pauillac, n° 431625. S’agissant de l’articulation entre ces deux principes, C. Chamard parle de « principe de prohibition des opérations patrimoniales défavorables aux personnes publiques », C. Chamard, JCP A., 2021, p. 2349.
31 CG3P, Art. L. 3111–1 et par ex., CE 20 juillet 2021, Soc. Ecnimont SpA et TCM FR SA, n° 443342, consacrant le principe d’inaliénabilité comme une règle d’ordre public.
32 Ch. Roux, Droit administratif des biens, préc., p. 26.
33 Parmi les arrêts et les conclusions le plus souvent cités pour illustrer cette jurisprudence, CE, Ass., 11 mai 1959, Dauphin, p. 294 ; CE, Sect., 30 mai 1975, Dame Gozzoli ; D. Labetoulle concl. sur CE Ass., 3 mars 1978, Lecocq, AJDA, 1978, p. 584 ou encore CE, 28 janvier 1970, Et. Philip-Bingisser, n° 76593.
34 Par exemple, à propos des biens de la Poste, article 22 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ou des biens du domaine public d’Aéroports de Paris, article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports.
35 CG3P, art. L. 2211-1 et L. 2212-1.
36 CG3P, art. L. 2111–1.
37 L. 211-2.
38 CE, 3 octobre 2012, Cne de Port Vendres, Rec. Tables, p. 742.
39 V. en ce sens, Ch. Roux, Droit administratif des biens, préc., p. 72 ou encore N. Foulquier, Droit administratif des biens, LexisNexis, 2018, 4e édition, § 111, p. 51.
40 CE, 5 mars 2004, n° 372422, à propos d’une parcelle comprenant une trappe d’accès à des canalisations ainsi qu’une grille fermée obstruant son accès.
41 Pour les biens antérieurs à 2006, CE, 8 avril 2013, ATLALR, n° 363738 : « le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » et pour les biens postérieurs à 2006, CE, 10 avr. 2016, n° 391431, Cne Baillargues : « Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ». V. sur cette théorie, F. Melleray « La domanialité publique virtuelle », RFDA, 2020, p. 921.
42 CE, Ass., Avis, 19 juillet 2012, n° 386715, Domaine de Chambord.
43 Ch. Roux, Droit administratif des biens, préc., p. 79.
44 Par exemple, CE, 26 janvier 2018, Société Var Auto, n° 409618.
45 Par exemple, CE, Section 8 mai 1970, Sté Nobel-Bozel, n° 69324, à propos d’un mur édifié en bordure de voie publique dont la qualification d’accessoire avait été refusée.
46 Ph. Yolka, « Où va le droit domanial ? », JCP A., 2012, n° 43 – n° hors-série.
47 Ph. Yolka, « Où va le droit domanial ? », JCP A., 2012, n° 43 – n° hors-série, préc.
48 Revenant ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’État, notamment, CE, 10 décembre 1954, Cne de Champigny-sur-Marne, p. 658, interdisant la constitution de servitudes sur le domaine public. Mais le Conseil d’État admettait toutefois que les servitudes conventionnelles constituées avant l’incorporation du fonds dans le domaine public subsistent à condition d’être compatibles avec l’affectation : CE, 11 mai 1959, Dauphin, p. 294.
49 Revenant ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’État. V. par exemple, CE, 28 avril 1965, Association T., n° 53714.
50 Principalement, les lois du 5 janvier 1988 et du 25 juillet 1994, mais pas seulement. L’ordonnance de 2006 a, par exemple, créé les AOT constitutives de droits réels sur le domaine public local. V. les art. L. 2122-6 et s. du CG3P.
51 Ph. Yolka, « Les droits réels sur le domaine public (survol d’une décennie) », AJDA, 2016, p. 1797 et E. Fatôme et J.-F. Lafaix, « Attribution et consolidation des titres d’occupation du domaine public », AJDA, 2017, p. 611.
52 CE, 1er octobre 2013, Sté Espace Habitat construction, n° 349099. Il a, par exemple, refusé d’appliquer rétroactivement l’article L. 2124-32-1 du CG3P relatif aux fonds de commerce aux autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (CE, 24 novembre 2014, Sté des remontées mécaniques les Houches Saint-Germain, n° 352402). Même s’il ressort des conclusions rendues sur cet arrêt que cette solution est fondée sur le principe de non-rétroactivité d’une loi nouvelle à un contrat en cours et sur le souci de préserver l’équilibre des contrats en vigueur, elle montre combien le Conseil d’État s’oppose à la constitution de fonds de commerce sur le domaine public (Concl. Bohnert, BJCP, 2015, n° 99).
53 À propos d’un bail à construction sur le domaine public national, CE, 11 mai 2016, n° 390118, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, cons. 14, note E. Fatôme et J.-F. Lafaix, « Attribution et consolidation des titres d’occupation du domaine public », AJDA, 2017, p. 611.
54 V. en ce sens, E. Fatôme et J.-F. Lafaix, « Attribution et consolidation des titres d’occupation du domaine public », préc. 611 qui mentionnent la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002, § 14 et 15.
55 Cons. const. n° 2005-513 DC du 14 avril 2005, § 4.
56 Cons. const. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, § 18.
57 CE, 4 mars 1991, Palanque, n° 79528, par exemple, alors que le titulaire d’un titre attributif de droits réels est nécessairement propriétaire des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, qu’il réalise sur le domaine public.
58 CE, 18 septembre 2015, Société Prest’air, n° 387315, alors que la cession d’un titre constitutif de droits réels est possible avec l’agrément du cessionnaire par l’autorité compétente.
59 CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n° 316534. Cette solution n’a toutefois pas été encore étendue aux autorisations unilatérales d’occupation du domaine public. Dans le cadre du titre attributif de droits réels, la loi prévoit un droit à indemnisation intégrale du préjudice, direct, matériel et certain résultant de l’éviction anticipée en cas de retrait de l’autorisation avant terme pour un motif autre que l’inexécution des clauses et conditions de l’autorisation (art. L. 2122–9, al. 3 du CG3P et L. 1311-7 du CGCT).
60 CE, 25 janvier 2017, Cne de Port-Vendres, n° 395314.
61 Ph. Yolka, « Où va le droit domanial ? », JCP A., 2012, n° 43 – n° hors-série.
62 Pour reprendre les termes de Ph. Yolka dans l’article précité.
63 Ph. Yolka, art. précité.
Laetitia Janicot, « Le code général de la propriété des personnes publiques », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4603.