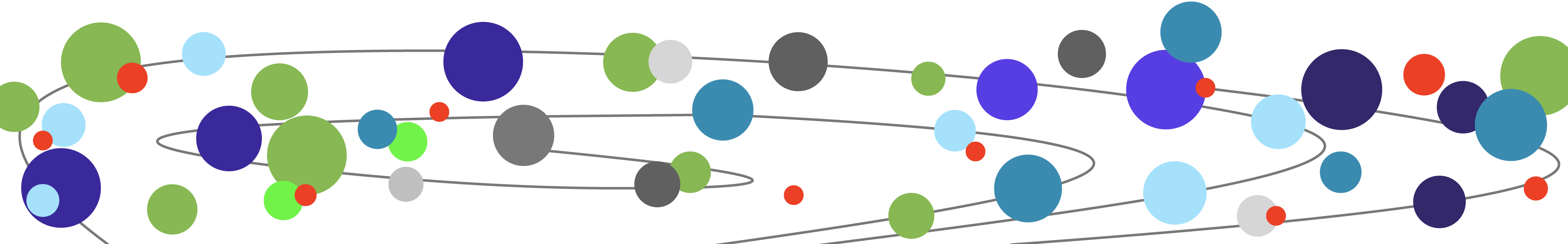Mathieu Touzeil-Divina
Professeur de droit public, Université Toulouse Capitole,
Co-directeur du Master droit de la Santé (Ut1),
Président du Collectif L’Unité du Droit
En embarquant pour Alger sur La Marsa en 1904, Louis Rolland, jeune docteur en droit public de l’Université de Paris, venant d’échouer à l’agrégation et se retrouvant sans poste, ne se doutait certainement pas que le remplacement qu’il ferait dans la Faculté de droit du département algérien (en remplacement du titulaire nommé député) aller le conduire non seulement en Méditerranée mais aussi à redécouvrir et même à sauver les rives du service public alors sénescent.
When he embarked for Algiers on the Marsa in 1904, Louis Rolland was a young doctor of public law from the University of Paris, having just failed the competitive examination and finding himself without a position. He certainly did not suspect that the replacement he would make in the Faculty of Law of the Algerian department (replacing the incumbent appointed deputy) would lead him not only to the Mediterranean but also to rediscover and even save the shores of the then aging public service.
La Marsa est un paquebot (de la Compagnie mixte) qui a essentiellement, en 1904 au moins, relié les villes de Marseille et/ou de Port-Vendres à Alger. C’est vraisemblablement sur ce navire ou un similaire comme le Général Chanzy (de la Compagnie transatlantique) qu’embarqua Louis Rolland (1877-1956) pour rejoindre, à l’automne 1904, le département algérien où il recevait sa première affectation universitaire. Au moment où il arrivait au Maghreb, cela dit, une grève générale du service public maritime s’achevait ce dont la presse témoigna1. Ainsi, c’est dès son entrée en fonctions académiques que la confrontation au service public se matérialisait. Pourtant, Louis Rolland ne savait certainement pas encore qu’en embarquant pour Alger il allait aussi s’engager pour le service public et la défense de sa notion.
De Louis Rolland, on connaît bien sur les « Lois » éponymes. On en mentionne du reste souvent « trois » (la mutabilité, l’Égalité et la continuité du service public) mais il en existait en fait quatre2 à ses yeux3 en commençant par une « Loi de rattachement » et de direction organiques de toute activité de service public par la personne et la puissance publiques. On sait parfois aussi (parce qu’il a beaucoup publié) qu’il a laissé une œuvre doctrinale importante et essentiellement composée, outre de nombreux articles, de deux grands manuels ou précis : l’un en droit administratif4 et l’autre, souvent minoré sinon méprisé, en matière de législation coloniale5. Tous deux, pourtant, ont une architecture identique et un moteur commun : la notion de service public.
L’importance de cette dernière dans son œuvre a même longtemps associé son nom à celui d’une « École » (si tant est qu’elle ait réellement existé) ou au moins à un courant : celui, après Léon Duguit (1859-1928) notamment, du service public légitimant le droit administratif. Géographiquement, cependant, Louis Rolland n’a jamais enseigné à Bordeaux (siège de ladite École) ce qui le distingue de Roger Bonnard (1878-1944) dans les pas au moins géographiques et girondins de Léon Duguit précisément. Les hommes se connaissaient et s’estimaient manifestement mais n’étaient ni des proches ni placés dans une relation de disciple (Louis) à maître (Léon). Comme Gaston Jèze (1869-1953), en revanche, Louis Rolland est connu pour avoir été l’un des professeurs de la Faculté de droit de Paris, place du Panthéon. Il y enseigna effectivement de 1918 à 1947 et y délivra, à nos yeux, l’une de ses œuvres ultimes : le Cours de droit administratif enseigné aux doctorants.
Cela dit, avant d’être auréolé de cette respectabilité et de cette aura parisiennes, le professeur Rolland enseigna également près les Facultés de droit de Nancy (de 1906 à 1918) et d’Alger (de 1904 à 1906). Or, nous croyons pouvoir affirmer ici que le passage de Louis, fut-il bref en bord de Méditerranée, a radicalement modifié sinon révolutionné son parcours de vie et d’enseignement mais aussi, et surtout, sa conception du droit administratif et des services publics en son sein.
Louis Rolland6 est né en Sarthe, à Bessé-sur-Braye, le 24 août 1877 et il est décédé le 2 mars 1956, à Paris. Il est le fils de Georges et de Georgette et il est le fruit de deux grandes familles du Maine : les Rolland et les Quetin. Les premiers sont essentiellement des juristes à l’instar du grand-père de Louis (Pierre Rolland (1810-1870)) qui fut notaire ou encore de son oncle (Jules, également notaire). Son père ne fut en revanche pas juriste, mais manufacturier, à Bessé-sur-Braye comme la plupart des membres de la dynastie des Quetin : papetiers sur plusieurs générations. Georges & Georgette eurent trois fils, dont Louis qui épousa, le 21 avril 1908 à Nancy, Joséphine Schmitt (1886-1951), fille d’un universitaire en médecine : le professeur (nancéen), (Marie Xavier) Joseph Schmitt (1855-1912).
Cela rappelé, une véritable thèse sur l’homme et sa doctrine manquent encore et les pistes que nous suivons, avec d’autres, mériteraient sincèrement d’être encore approfondies et vivifiées par exemple s’agissant de son engagement politique comme député du Sillon ou encore de ses réflexions en matière de droit colonial. On ignore en effet encore trop sur l’homme et ses doctrines même si plusieurs travaux leur ont été consacrés, travaux auxquels on a d’ailleurs été associés ou que nous avons initiés. Preuve de cette ignorance, sinon de cet oubli, la sépulture parisienne de Louis Rolland (inhumé le 6 mars 1856) a fait l’objet d’une « reprise » de concession et n’est désormais plus visible. Essayons donc, au moins, de raviver ses écrits et son formidable esprit en posant trois questions successives au regard de l’exercice uchronique proposé : en quoi la venue de Louis « le Sarthois » en Algérie a-t-elle révolutionné sa vision du droit public (I) ? Quelles sont les conséquences sur la doctrine et le droit administratifs des positions de Louis « l’Algéro-parisien » (II) ? Quelle aurait été la face du droit administratif si Louis « l’Algéro-Lorrain » n’avait pas profité de la coloniale Méditerranée (III) ?
I. En quoi la venue de Louis « le Sarthois » en Algérie
a-t-elle révolutionné sa vision du droit public ?
Pour comprendre l’uchronie ici proposée de la non-participation de Louis Rolland à la fortune du droit administratif, encore faut-il d’abord réaliser ce qu’il a apporté. Or, ce que nous croyons et affirmons, c’est que Louis Rolland7 a véritablement sauvé non seulement la notion de service public mais encore, ce faisant, le droit administratif dans son autonomie face au droit privé. Or, c’est en Algérie qu’il fut confronté à ladite notion puisqu’il y fut chargé du cours de droit administratif d’un titulaire qu’il fallait remplacer. Comment Louis le métropolitain arriva-t-il alors dans le département algérien ?
A) La chance saisie d’un nouveau départ
Après des études de Droit à Paris, Louis Rolland, qui avait ainsi quitté sa Sarthe natale, soutint ses deux thèses de doctorat8 (en sciences juridiques et politiques – comme cela s’est pratiqué quelques années) et ce, en vue de se présenter aux concours professoraux. Toutefois, en 19019 comme en 190310, il échoua aux épreuves de l’agrégation. En 1904, il se retrouvait donc sans emploi ni perspectives académiques et fit savoir à ses enseignants, dont le doyen Henry Berthélémy (1859-1943), qu’il était à leur disposition et ouvert à leurs conseils. Précisément, le doyen parisien apprit qu’à l’École supérieure de Droit d’Alger le titulaire du cours de droit administratif depuis une quinzaine d’années, Maurice Colin11 (1859-1920), venait d’y être élu (en 1902) député face au polémiste antisémite Édouard Drumont (1844‑1917). Ce dernier avait été député de 1898 à 1902 mais ne fut ainsi pas réélu. Colin était arrivé à Alger en 1887 à la suite de son succès à l’agrégation et y avait surtout prospéré comme avocat. En 1903, après plusieurs allers et retours d’Alger à Paris, il voulut se consacrer en métropole à sa carrière politique et demanda à être remplacé par un docteur en droit recommandable « de » et recommandé « par » l’École du Panthéon.
Il faut alors rappeler qu’à l’époque, on ne se bousculait pas pour une telle mission qui était assortie de quatre contraintes majeures et cumulées : il fallait un docteur en droit ayant la vocation universitaire et recommandé de ses pairs, que l’intéressé accepte d’enseigner le droit administratif (qui était loin d’être la matière la plus prisée des juristes12), qu’il consente à occuper un poste précaire et non pérenne de façon non déterminée et en fonction des volontés du député titulaire de rester ou non longuement en métropole et, enfin, qu’il soit déterminé à accepter une forme d’exil en quittant la métropole.
C’est le pari qu’acceptera et la chance que saisira Rolland qui, à l’époque, n’avait pas encore d’attache familiale et à qui l’on fit comprendre qu’il s’agirait pour lui de la meilleure des préparations au concours d’agrégation. C’est donc muni des recommandations décanales de Berthelemy que Louis Rolland fut ainsi nommé13, par arrêté en date du 31 octobre 1904, comme chargé du cours de droit administratif en l’École supérieure de droit d’Alger avant qu’elle ne devienne (en 190914) une Faculté15 à part entière. Quelques mois avant lui, le grand Édouard Lafferrière (1841‑1901) avait également fréquenté Alger peu avant sa mort puisqu’avant sa nomination comme Procureur général près la Cour de cassation, il avait été (de 1898 à 1900) le gouverneur général16, représentant l’État, dans le département. Rolland inscrivait donc ses pas dans ceux d’illustres prédécesseurs publicistes.
B) Louis Rolland à Alger (1904-1906)
On ignore encore où séjourna précisément le jeune enseignant même si, selon toute vraisemblance de notabilités et de proximités à l’École de droit, il devait habiter non loin de l’ancien Boulevard Lafferrière, en plein centre-ville colonial près de la « grande poste » et de l’imposante statue du Duc d’Orléans, colonisateur de l’Algérie. Si, dès 1857, ce territoire avait obtenu par un décret du 3 août une École de médecine et de pharmacie, c’est en 1879 que fut créée – avec la Loi du 20 décembre 1879 – une17 « École préparatoire à l’enseignement du Droit ». Rapidement, le nombre d’inscrits y augmenta et, en 1887 au moment où le professeur Colin arriva, le directeur de l’établissement (Robert Estoublon (1844-1905) à qui l’on doit un exceptionnel Code annoté18) y déclara la présence de 179 étudiants19. On sait en outre que le bâtiment principal de cette Université ne date pas de 1909, mais a été entrepris – dès 1879 – (et comme à Toulouse) sur le site d’un ancien arsenal qui fut inauguré le 3 novembre 1887. On connaît donc – encore aujourd’hui – les lieux où enseigna Louis Rolland à Alger20 (et on a même eu le privilège d’y déambuler).
On sait également qu’à Alger, dans un premier temps, on demanda au publiciste qui remplacerait Colin de gérer comme lui une chaire généraliste et non spécialisée puisqu’intitulée « droit administratif et constitutionnel » à l’instar des premiers cours publicistes de la Faculté de droit de Paris, un siècle plus tôt en 1819. Il n’y avait donc qu’un seul spécialiste publiciste dans les murs de l’École qui deviendra Faculté de Droit lorsque Rolland y fut envoyé en mission.
C) Louis Rolland & le droit public en Algérie
Matériellement, on sait que Rolland accomplit trois rentrées universitaires de 1904 à 1907 ce dont témoignent, dans son dossier préc. aux archives, deux arrêtés confirmatifs ministériels des 31 juillet 1905 et 28 mai 1906. En 1906, toutefois, sa réussite au concours national d’agrégation (dont il sera cette fois le major) le conduira à la Faculté de Droit de Nancy qu’il intégrera (pour dix ans selon les statuts) à compter du 19 novembre 1906. En Lorraine, il continuera de délivrer des cours de droit administratif (et devint titulaire de chaire en 1911) mais pratiqua aussi, du fait de son passage par Alger, une autre spécialisation : la législation coloniale. C’est ce dernier cours qui lui permettra même, en 1918, de rejoindre la Faculté de Paris. À la capitale, il enseigna dans la prestigieuse École coloniale (qui sera ensuite le siège de l’ENA et de l’actuel INSP) et, en tant que député du Maine-et-Loire21, Rolland eut encore l’occasion d’étudier les questions ultramarines, puisqu’il siégea durant quatre ans (1928-1932) au sein de la Commission de l’Algérie, des colonies et des protectorats22.
À Alger, si Rolland s’intéressa aux questions coloniales, il ne les enseigna donc pas encore, mais s’y confronta nécessairement comme en témoigne sa participation fructueuse, par de nombreuses notes d’arrêts, à la Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence23. Surtout, ce qui nous frappe c’est la manière dont l’auteur va faire de la notion de service public le cœur de ses enseignements et de ses écrits : de sa doctrine. En effet, même s’il le remplaça, ce n’est pourtant pas à partir du manuel précité de Colin que Louis Rolland trouvera l’inspiration pour ses propres premières leçons et ses premiers écrits en droit public.
II. Quelles sont les conséquences sur la doctrine et le droit administratifs
des positions de Louis « l’Algéro-parisien » ?
C’est comme parisien (puisqu’il a été titulaire de l’École du Panthéon et de l’École coloniale notamment à Paris de 1918 à son départ en retraite en 1947) que Rolland fut célèbre et encore célébré. C’est à Paris qu’il entama sa carrière politique, entre sa région natale et la capitale, et qu’il fit publier la plupart de ses écrits. Concrètement, quelles sont les positions doctrinales que prit Rolland dès sa période algérienne et qu’il ne quittera plus par suite et dont on peut affirmer qu’elles ont marqué le droit administratif français ? La lecture des tables des matières des deux précis nous en donne directement la réponse : la place motrice du service public.
A) Le service public d’origine duguiste, au cœur du droit administratif de Rolland
Certes, l’auteur ne fut pas le seul à envisager ladite notion comme centre dynamique du droit public mais il fut, croyons-nous, le seul à réussir par suite à la « sauver » alors qu’entre les années 1920 et 1940 on annonçait sa mort à la suite de la reconnaissance de la notion de service public à caractère industriel et commercial (SPIC).
« Le droit administratif est essentiellement le droit des services publics. On doit donc essayer d’abord de s’entendre sur cette notion24 ». Voilà qui posait clairement les bases de sa doctrine.
Certainement par ses premiers écrits, Rolland fut un disciple admiratif de Léon Duguit son contemporain plus âgé de dix-huit années et déjà considéré, comme un « maître ». Lorsque l’on parcourt les premières éditions des précis et les articles notamment publiés à la RDP, cet état d’admiration et d’acquisition doctrinales à la pensée duguiste est manifeste. À cet égard, le Précis de droit colonial y compris, faisait une place primordiale au service public et à l’intérêt général. En ce sens Rolland y définissait-il l’Algérie25 comme une : « partie intégrante de l’État », « personne morale de droit public interne », « l’Algérie constitue un ensemble de services publics placés sous l’autorité d’un gouverneur général ». Il s’attachait alors à distinguer (par exemple dans un beau commentaire sous Tribunal de Tunis, 15 juillet 1907 à la Revue algérienne…26) les services publics français (sic) de ceux, locaux et parfois propres, d’un État protégé comme le Maroc ou la Tunisie. Ces phrases qui assimilent la personne morale étatique ou coloniale à un faisceau ou à un « ensemble » de services publics et qui, conséquemment, la réduisent à cet aspect témoignent manifestement de cette fascination duguiste comme l’est l’utilisation fréquente par Rolland du terme27 de « gouvernants ». Pour le doyen de Bordeaux28, en effet, rappelons que l’État formait un « faisceau de services publics » : « l’État n’est pas, comme on a voulu le faire et comme on a cru quelque temps qu’il était, une puissance qui commande, une souveraineté ; il est une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants ».
Moins réducteur – mais peut-être plus subtil que Duguit – Louis Rolland déclarera quant à lui – ainsi qu’on le citait en exergue de ce développement – : « le droit administratif est essentiellement le droit des services publics ». Le droit administratif, selon Rolland, était donc « essentiellement » et non exclusivement celui des services publics. On retrouve ici le sens de la nuance propre à l’auteur qui refusait de réduire l’État notamment aux seuls services publics. Ainsi écrivit-il même29 : « si importants que soient les services publics […], ce serait une erreur de croire qu’ils constituent tout l’État ». Partant, c’est plutôt à Gaston Jèze que Rolland va emprunter, notamment en osant définir la notion de service public que Duguit refusait – précisément – d’enfermer dans des critères juridiques, car elle matérialisait – selon le Bordelais – une réponse à l’interdépendance sociale. Redisons ici en effet solennellement que Duguit n’a jamais accepté de définir30 le service public (contrairement à ce que l’on écrit encore trop souvent) ; service public à propos duquel il estimait qu’on pouvait – seulement – l’identifier. Par ailleurs, le doyen de Bordeaux entendait écrire une théorie de l’État lorsque Rolland, quant à lui, ne s’intéressait « qu’à » celle du droit administratif.
Par ailleurs, à l’instar de Jèze à nouveau, Rolland accepta de recourir à la notion (jugée trop métaphysique et conséquemment détestable par Duguit) d’intérêt général pour non seulement définir le service public, mais encore pour le considérer, ainsi que l’avait fait bien avant lui le doyen Foucart, comme une réponse subjective des gouvernants (et donc de la puissance publique) à ce même intérêt général31. La définition du service public selon Louis Rolland était alors la suivante32 : « le service public est une entreprise ou une institution d’intérêt général placée sous la haute direction des gouvernants, destinée à donner satisfaction à des besoins collectifs du public auxquels, d’après les gouvernants, à un moment donné, les initiatives privées ne sauraient satisfaire d’une manière suffisante et soumis, pour une part tout au moins, à un régime juridique spécial ». Comme on le constate aisément, Rolland y faisait état de trois critères (qui deviendront des indices selon la célèbre jurisprudence Narcy33) : organique (l’institution et ses « gouvernants »), matériel (à travers l’existence d’un « régime juridique spécial ») et fonctionnel (à travers l’intérêt général).
Quoi qu’il en soit, l’auteur n’a donc pas suivi aveuglément toutes les théories du doyen Duguit ou même de Jèze présentés comme les maîtres de l’École du service public34. On doute d’ailleurs très fortement de l’existence même de cette École35. Relevons ainsi que Rolland ne partageait pas, notamment, la vision duguiste d’un droit (et d’un intérêt général) uniquement objectif(s) et s’imposant aux gouvernants. Duguit avait en effet à cet égard une exceptionnelle formule36 : « le droit public est le droit objectif des services publics ». Rolland, en outre, avait accepté d’intégrer la catégorie des services publics industriels opposés puis intégrés par suite à ce qu’il nommait les « services publics proprement dits ». À cet égard, Rolland, reprochait même à Duguit une vision trop extensive qui inclurait, à terme, toute activité publique comme étant de service public. À l’inverse, il faisait cette fois grief à Jèze de refuser de prendre en compte la nouvelle catégorie des services publics industriels et commerciaux.
B) Le service public même industriel & commercial, au cœur du droit administratif de Rolland
Nous croyons qu’à travers la reconnaissance (et la célébrité) des « Lois » dites de Rolland, on oublie souvent ce qui – à nos yeux – est le plus important apport du maître publiciste au droit administratif. Pour s’en rendre compte, il faut se poser la question suivante : pourquoi Rolland a-t-il entrepris de rechercher les fameux principes communs à tout service public ? Nous pensons que la réponse à cette question se trouve dans la « crise » que le service public rencontrait au tournant économique des années 1930. Rolland constate ainsi en 194537 : la « notion de service public est entourée d’un certain halo. Elle subit en quelques manières une crise ». En effet, suite notamment à l’arrivée – déstabilisante – de la notion de SPIC38, face à l’absence de régime juridique unique appliqué à tout service public et constatant qu’il devenait (ce qu’avait bien prédit Duguit) quasi impossible de définir le mouvant service public, plusieurs auteurs (encouragés par Hauriou) déclarèrent, autour de la Seconde Guerre mondiale, la « crise » du service public39. Au cœur de cette « crise » s’imposait donc le Spic que d’aucuns refusaient de considérer comme un service public à part entière sinon « noble » et qu’ils dénigraient en conséquence. Toute autre sera la perception de Rolland.
Telle est en effet – affirmons-nous – la plus forte des intuitions de Rolland : constatant que le droit administratif ne pouvait se réduire à la notion de service public et confronté à celle de SPIC, il a considéré qu’il fallait démontrer que ce dernier était un véritable service public à part entière. Pour ce faire, il a entrepris de rechercher des principes communs à tous les services publics, y compris industriels et commerciaux. Ce faisant, il a identifié non un régime juridique, mais plusieurs principes communs : les célèbres « Lois de Rolland ». Ainsi, alors que les premiers écrits de l’auteur font état de l’existence de « services publics proprement dits » opposés aux services commerciaux (qu’il nomme les « autres40 services publics »), sa doctrine va évoluer.
Rolland, le premier selon nous, va donc (préfigurant un De Laubadère (1910‑1981) par exemple) envisager l’existence d’un droit administratif (ou public) économique au cœur duquel l’entreprise et le droit privé au lieu d’être des notions ennemies deviendront des référents. En ce sens écrit-il en 194441 : « le service public est une entreprise ou une institution d’intérêt général placée sous la haute direction des gouvernants, destinée à donner satisfaction à des besoins collectifs du public auxquels, d’après les gouvernants, à un moment donné, les initiatives privées ne sauraient satisfaire d’une manière suffisante et soumis, pour une part tout au moins, à un régime juridique spécial ». Les références à l’entreprise et à l’initiative privée dénotent alors par rapport à la doctrine de ses contemporains. Et pourtant, ainsi que l’a également relevé le professeur Regourd42 : « parce qu’il est extensible, le service public a proliféré dans le domaine des activités privées ». En outre, on le sait, cette explosion de l’interventionnisme public économique a notamment été rendue possible après les phénomènes dits de43 « socialisme municipal » et les conséquences exceptionnelles des deux Guerres mondiales. À ce dernier égard, Rolland écrira plusieurs articles (précités) à la RDP sur « l’administration locale et la guerre ». Il déclare notamment au début de ceux-ci : « Instinctivement, les autorités locales […] étendent leur activité dans des directions nouvelles, font tout ce qui est ou leur paraît être nécessaire ». Rolland en conclura même qu’en période de crise, les autorités ne sont plus obligées d’admettre que « les choses économiques iront d’autant mieux que les pouvoirs publics s’en occuperont moins ».
Nous affirmons en conséquence que c’est cette acceptation – rare à l’époque et pionnière – par Rolland du SPIC comme « véritable » service public entraînant avec lui l’existence d’un régime exorbitant fut-il minimal, mais réel qui va lui permettre non seulement de rechercher et d’identifier les principes communs ou « Lois » du service public, mais encore de « sauver » la notion même de service public en lui conférant une unité juridique que l’on peinait à voir tellement l’hétérogénéité des services s’imposait.
Plus encore qu’un découvreur de « Lois », Louis Rolland est donc à nos yeux le « sauveur » du service public.
C) Le service public subjectif et ses « Lois » selon Rolland
En effet, en recherchant ces fameux principes ou « Lois » du service public, il a réussi non seulement à démontrer que l’absence de régime juridique unique n’empêchait pas l’existence de règles et de dénominateurs communs, mais encore que ces règles s’appliquaient bien au SPIC ce qui faisait de ce dernier un « véritable service public » à part entière et non un vilain petit canard du droit administratif. Revalorisant le SPIC, c’est l’ensemble du droit public « essentiellement » construit autour de lui que Rolland magnifiait. Et, alors que d’aucuns criaient à la crise du service public en indiquant que le Spic avait conduit la notion à sa mort, Louis Rolland réussit à démontrer que c’était au contraire le Spic qui avait sauvé la ou plutôt les théories du service public.
Partant, Rolland va traduire (à la différence du maître Bordelais Duguit) une vision non objective, mais subjective44 du service public puisqu’il acceptera comme Jèze avant lui de considérer comme déterminante la volonté des gouvernants de reconnaître potentiellement toute activité comme étant qualifiable de service public. L’auteur traduit alors la vision de ce que nous avons nommé par ailleurs une « théorie du post-it » paraphrasant pour ce faire nos prédécesseurs les professeurs Jèze, Waline et Truchet45. On sait cependant que cette subjectivité si pratique est aussi le poison même de la notion de service public, ce qu’a parfaitement identifié le professeur Delvolvé par ces mots46 : « la subjectivité de la conception du service public est cœur de la notion. Elle est la raison de [son] imprécision ».
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il est temps de réhabiliter et surtout de réétudier l’œuvre de Rolland sans la réduire aux trois « Lois » déjà célébrées. Comme son confrère Roger Bonnard, Rolland a donc bien voulu intégrer à la théorie générale du service public le service public industriel et commercial. Pour ce faire, il a sciemment donné une nouvelle définition très « large » de cette notion. N’incluant plus le critère du régime administratif, il s’est basé sur l’intérêt général et la direction du service par les gouvernants. Puis il a dressé le constat suivant47 : « les services publics ont tous des caractères communs les différenciant des entreprises privées. Pour le surplus, ils ne sont pas tous soumis au même régime. Normalement, habituellement, ils sont soumis à un régime juridique spécial ; mais il en est qui sont soumis aux règles du droit privé ». Il en a conclu que le service public était dualiste (tel un Janus administratif, il aurait deux manières d’être représenté) : il existerait un service public « au sens large » qui désigne toutes les entreprises publiques relevant des personnes publiques et un « service public étroit ou proprement dit » qui regrouperait les seules entreprises du service public au sens large soumises au régime spécial de droit administratif. Constatant alors qu’il ne pourrait jamais y avoir de véritable régime du service public (étant donné sa diversité et le fait qu’il puisse être soumis à une part fluctuante de droit privé), le professeur Louis Rolland va pourtant dégager quatre caractères communs à tous les services publics « au sens large ». Il s’agit, du minimum minimorum de droit spécial auquel tous les services publics – même industriels et commerciaux – sont soumis. Et c’est ce que l’on a aujourd’hui, coutume de désigner comme les « Lois de Rolland » : la direction des gouvernants (ou Loi dite de rattachement organique), l’obligation de continuité, la loi de changement et le principe d’Égalité.
III. Quelle aurait été la face du droit administratif si Louis « l’Algéro-Lorrain »
n’avait pas profité de la coloniale Méditerranée ?
On voudrait ici prendre trois hypothèses pour répondre à la commande uchronique : la première est purement juridique, les deux autres concernent la personne même de Louis Rolland.
A) Le service public uchronique d’un droit commun triomphant
Si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger, il ne se serait peut-être pas autant intéressé à la notion de service public puisqu’il n’aurait pas été nécessairement contraint d’organiser un cours de droit administratif. C’est le remplacement du député Colin qui l’y engagea. Partant, peut-être aurait-il, comme ses contemporains majoritaires, été convaincu que le Spic non seulement n’était pas un « véritable » service public mais encore qu’il aurait entraîné le droit administratif à sa perte.
En effet, si l’on suit la logique même de la décision dite Bac d’Eloka48 que d’aucuns présentent encore comme la naissance dudit SPIC, mais un SPIC inférieur ou moins « noble » que le véritable service public d’essence administrative, toute activité assimilable en tout ou partie à l’exercice d’un « industriel ordinaire » serait arrivée dans le giron libéral du juge judiciaire au nom du droit commun. Concrètement, en effet, alors qu’aujourd’hui, à la suite de Rolland, on estime que toutes les plus importantes questions concernant un SPIC (sa direction, son mode de gestion, sa création ou sa suppression, ses tarifs…) relèvent, quel que soit son mode de gestion, même contractuel ou privé, quelle que soit la personne qui le matérialise et l’exécute au quotidien, des seuls droit et juge administratifs, l’histoire et la jurisprudence auraient très bien pu prendre une autre voie : celle du droit commun.
En ce sens, au lieu de faire du droit administratif, une branche juridique autonome (et aussi respectable que le vénérable droit privé), il eut été facile, sans l’esprit et le génie de Rolland de ne faire de ce droit public qu’un droit exceptionnel et de très stricte application extraordinaire : uniquement aux cas d’exercices de la puissance publique souveraine et exorbitante du droit privé/commun.
Ce n’est pourtant pas le chemin qu’a choisi le droit public français et nous pensons qu’il revient en très grande partie à Rolland d’y avoir incité et convaincu ceux qui en ont décidé au Conseil d’État en particulier, mais aussi par l’adoption de certaines normes mettant en avant le service public lorsque l’enseignant fut également (de 1928 à 1936 a-t-on rappelé) député à l’Assemblée nationale.
B) Louis Rolland, uchronique espion anarchiste ?
Si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger, il ne se serait peut-être pas autant intéressé à la notion de service public puisqu’il n’aurait pas été nécessairement contraint d’organiser un cours de droit administratif. D’ailleurs, si l’on examine ces premiers écrits, on est même porté à croire qu’à l’intérieur du droit public, c’est peut-être vers les relations et le droit internationaux publics que l’auteur se serait tourné. Dès 1901, ainsi, rappelons-le, l’une de ses deux thèses de doctorat portait sur la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales49. Au cours de sa carrière universitaire, certes, il n’enseigna pas a priori le droit international public, mais il publia plusieurs articles dans la Revue générale de Droit international public et fut l’auteur de nombreux ouvrages relatifs au droit des gens. Il convient par ailleurs de noter que, durant toute sa vie, Louis Rolland fut animé par le souci du respect du droit international. Ainsi, dans les années qui précédèrent la Grande Guerre, il fut membre de la Ligue des catholiques français pour la paix50. Quelques années plus tard, en qualité de député du Maine-et-Loire (1928-1936), il défendit aussi et par exemple51 « avec éloquence les mécanismes de sécurité collective et l’action de la Société des Nations ». On aurait pu s’arrêter là dans l’évocation internationaliste, mais un fait historique est venu troubler nos recherches. Imaginons que Louis Rolland ait véritablement embarqué (comme on le suggérait en introduction) sur La Marsa entre Marseille et Alger. Imaginons même précisément que ce voyage eut lieu le 10 octobre 1904. Rolland fut nommé par arrêté en date du 31 octobre 1904 et l’on peut imaginer qu’avant l’ampliation du document il ait pu se rendre quelques jours plus tôt à Alger. Et, on l’a dit, les premiers jours d’octobre, une importante grève bloqua le port et le tout premier navire à quitter Marseille pour Alger avec 400 personnes fut La Marsa, navire habituellement affrété sur la ligne Port-Vendres/Alger. Or, on sait avec précision que sur La Marsa52 navigua Louise Michel (1830-1905) qui se rendait en Algérie pour un cycle de conférences53. La Dépêche algérienne atteste ainsi, dans son édition du 10 octobre 1904, non seulement de la fin du mouvement social, mais encore du départ dudit paquebot.
Imaginons alors la plus improbable des rencontres sur la Méditerranée : Louis approche Louise et ils commencent à parler non du beau temps, mais de la fin de la grève et de l’importance du service public (évidemment). Louis va devenir professeur de droit mais est encore un prolétaire académique, il peut donc charmer l’anarchiste vieillissante Louise, qui voit en lui tout le potentiel d’un jeune intellectuel prêt à défendre la paix et à se battre pour l’intérêt général. Et pourquoi pas l’enrôler ? Après tout, Louis Rolland porte l’un des prénoms et patronymes les plus courants. Il existe des milliers de Louis Rolland54 et il pourra donc se fondre dans la masse populaire et la nasse méditerranéenne. Et si Louis avait accepté et à partir de ce moment joué un double jeu : celui respectable du professeur de droit, démocrate-chrétien, et celui, inavoué et inavouable, d’un espion anarchiste qui aurait mis en action sa passion des relations internationales au profit du drapeau rouge ?
Et si Louis avait ainsi rencontré Louise ?
C) Louis Rolland, uchronique mentaliste lorrain ?
Si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger et avait attendu 1906 pour triompher de l’agrégation et aller à Nancy, il n’y aurait vraisemblablement pas enseigné le droit colonial puisqu’il ne serait pas passé par Alger. Il n’aurait conséquemment pas été par suite recruté à Paris et notamment à l’École coloniale puisque l’on sait, grâce aux archives de son dossier personnel, qu’il obtint la plupart de ses nominations, mutations et promotions grâce à ses enseignements en droit colonial.
Pourtant, qu’aurait-il pu faire s’il n’avait ainsi pas été conquis par l’attrait de l’outre-mer ? À Nancy, il a été nommé en droit public pour succéder à l’un des tout premiers administrativistes de l’est de la France qui avait travaillé, jusqu’en 1904, à la tête de la chaire de droit administratif : Jules Liégeois (1833-1908). L’auteur avait été le continuateur et coauteur des répétitions écrites de droit administratif55 initiées par l’un des maîtres aixois du droit public, Cabantous (1812-1872). Cela dit, à Nancy, Liégeois ne s’était pas illustré que dans cette branche administrativiste. Il est effectivement aussi connu comme l’un des fondateurs (avec des médecins et des juristes) d’un mouvement (parfois nommé « École de Nancy » ou « École de la suggestion ») qui étudia l’hypnose et ses répercussions, interactions et possibles utilisations en Droit. Il fut d’ailleurs expert dans plusieurs procès56 dont celui dit de Gabrielle Bompard (1868-1920) pour y exposer57, ès qualité de juriste, l’usage et la force des méthodes hypnotiques dans la recherche de la vérité. On lui doit d’ailleurs des écrits passionnants sur la thématique58 par lequel il essaya de démontrer, au nom du groupe nancéen aux côtés du professeur en médecine Hippolyte Bernheim (1840-1919) et contre le groupe parisien conduit par les docteurs Jean-Martin Charcot (1825-1893) puis Georges Gilles de la Tourette (1857-1904), que l’hypnotisme n’était pas une maladie d’hystérique, une névrose, mais un phénomène rigoureux ainsi qu’une méthodologie de suggestion y compris susceptible d’aider le Droit et les recherches médico-légales.
Et si Louis Rolland, rencontrant Jules Liégeois peu avant son décès (alors qu’il fréquentait assidûment les thermes59 des environs) avait accepté de suivre ses traces non seulement dans la chaire de droit administratif mais encore sur les terrains de l’hypnose et de la suggestion ? Louis ne serait-il pas devenu le nouveau mentaliste du droit public ? On l’imaginerait alors non comme le rigoureux Liégeois avant lui mais peut-être comme un Robert Houdin (1805-1871) ou un Patrick Jane de fictions, mentaliste flamboyant, drapé dans une cape noire et rouge et se donnant en des spectacles pour faire triompher une notion et une seule : le service public. Alors, après avoir hypnotisé toute « l’École de Toulouse » (et Maurice Hauriou à leur tête) et les tenants de la notion première de puissance publique puis, un par un, les membres du Conseil d’État, il aurait réussi à imposer ses vues doctrinales. Cela dit si, comme nous, on considère que la pensée de Rolland par ses « Lois » et sa valorisation du SPIC a réussi à sauver le droit administratif de la sénescence dans laquelle il sombrait, peu importe comment il a convaincu : par ses écrits, ses conversations, ses publications et pourquoi pas, par mentalisme uchronique.
1 Voyez par exemple L’Éclair daté du 8 novembre 1904 ; p. 2. À la différence d’aujourd’hui, il est quasi impossible (et en tout cas peu vraisemblable) que l’homme se soit rendu à Alger en avion au regard des conditions, des habitudes et des tarifs pratiqués à l’époque.
2 On rejoint ici parfaitement l’analyse qu’en a faite L. Bézie, « Louis Rolland, théoricien oublié du service public », RDP, 2006, p. 847 et s. C’est ce que nous avons par ailleurs développé in « Louis Rolland, le Méditerranéen d’Alger, promoteur et sauveteur du service public », in Journées Louis Rolland, le Méditerranéen, Revue méditerranéenne de Droit public (RMDP), n° IV, 2016, p. 17 et s.
3 Si, formellement, l’auteur mentionne bien trois « Lois », il passe toujours un chapitre liminaire à cet exposé pour marquer cette « Loi » fondamentale de rattachement organique préalable à ses yeux ce qu’il fait par exemple, in L.Rolland, Cours de droit administratif (répétitions écrites issues du cours de doctorat), Paris, Les cours de Droit, [quasi annuel de 1935 à 1947], par exemple avec l’édition de 1941 où (p. 31 et s.) un paragraphe premier examine le rattachement organique puis un second les « trois Lois » connues.
4 Il connut 11 éditions de 1926 à 1957, la dernière étant posthume. À son propos, voir M. Meyer, « Relire le Précis de droit administratif de Louis Rolland », RMDP, n° IV, 2016, p. 39 et s.
5 Il fut édité de 1931 à 1959 sous plusieurs appellations et fut notamment continué grâce à l’aide de son ami Pierre Lampué. Le concernant : J.-B. Pierchon, « Le Précis de législation coloniale de Louis Rolland & Pierre Lampué : une nouvelle conception du droit colonial au cours de l’entre-deux-guerres ? », RMDP, n° IV, 2016, p. 53 et s.
6 À propos duquel on a déjà consacré une courte biographie parue inF. Renucci (dir.), Dictionnaire des juristes ultramarins (XVIIIe-XXe siècles), publié en 2012 en version « rapport », Rennes, PUR, 2022, p. 313 et s.
7 Comme on espère l’avoir démontré à l’article précité à la RMDP, IV, préc.
8 L. Rolland, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, Paris, Pedone ; 1901 et Du secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe, Paris, Pedone,1901.
9 Lors de ce concours, dont triompha notamment Gaston Jèze, il y eut seulement deux agrégés en section de droit public et 17 candidats dont Louis Rolland.
10 Lors de cette seconde tentative, il y eut 13 candidats au concours en section de droit public.
11 Qui proposa même un exposé publié de ses leçons : M. Colin, Cours élémentaire de droit administratif, précédé de notions sur l’organisation des pouvoirs publics en France, à l’usage des candidats aux examens de licence, Alger, Jourdan, 1890.
12 Question sur laquelle on a déjà travaillé dans nos études doctorales à travers les premières nominations de professeurs tels que Maurice Hauriou (1856-1929) ou encore (le précédant) Ernest Wallon (1851-1921) à Toulouse ; tous deux ayant – dans un premier temps au moins – répugné sinon dédaigné l’enseignement du droit public et n’y étant arrivés que contraints, inM.Touzeil-Divina (dir.), Miscellanées Maurice Hauriou, Le Mans, L’Épitoge, 2013, p. 86 et s.
13 Voyez, aux Archives nationales : A.N. F 17 / 25230 & AJ 16/1456.
14 Cf. J. Mélia, […] Histoire de l’Université d’Alger, Alger, Maison des Livres, 1950. Sur l’enseignement juridique à Alger, mentionnons également (avec quelques belles photographies de juristes) le bel ouvrage réalisé en 1959 pour le cinquantenaire de l’établissement (Université d’Alger 1909-1959, Alger, Racim, 1959).
15 Sur cette novation, on retrouve la présence du doyen Berthélémy qui fit partie des promoteurs de cette transformation aux côtés de Louis Liard ; cf. Université d’Alger 1909-1959, op. cit., p. 59.
16 À l’égard du passage du grand Laferrière à Alger, on consultera le numéro spécial (n° 18 ; septembre 1900) de la Revue illustrée qui fut consacré à l’Algérie (spécialement aux pages 12 et s.).
17 Cf. J. Mélia, […] Histoire de l’Université d’Alger, préc.
18 R. Estoublon, Code de l’Algérie annoté, Alger, 1898.
19 Cité par J. Mélia, op. cit., p. 63.
20 Ainsi qu’en témoignent plusieurs documents et photographies insérés à la RMDP, IV préc., p. 84 et s.
21 L’homme y accomplit deux mandats successifs (de 1928 à 1936) comme député indépendant puis « démocrate populaire » pour la deuxième circonscription de Cholet (Maine-et-Loire).
22 Chambre des Députés, Tables analytiques des annales, deuxième partie, table nominative, quatorzième législature (1928-1932), p. 779.
23 M. Touzeil-Divina, « Louis Rolland », in F. Renucci (dir.), préc., p. 258. Sur la Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, voir F. Renucci, « La Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence (1885-1916). Une identité singulière », in J.-P. Bras (dir.), Faire l’histoire du droit colonial cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, Paris, Karthala, 2017.
24 L. Rolland, Précis de droit administratif, Paris, Dalloz, 1934 (5e éd.), p. 14. On reprend et continue ici certains des écrits précités.
25 L. Rolland, P. Lampué, Précis de législation coloniale, Paris, Dalloz, 1940 (3e éd.).
26 Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence (publiée à Alger), 1908, II, p. 349 et s.
27 Par exemple inL. Rolland, Cours de droit administratif, 1944, Les Cours du Droit, p. 209.
28 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, Fontemoing, 3e éd., 1928, Tome II, p. 59.
29 L. Rolland, Cours de droit administratif […], Paris, Les cours de Droit, 1936, p. 127.
30 Ainsi, Duguit ne pose-t-il aucun critère de définition, mais relève-t-il seulement des indices d’identification : « il y a service public quand les trois éléments suivants sont réunis : une mission considérée comme obligatoire à un moment donné pour l’État ; un certain nombre d’agents hiérarchisés ou disciplinés institués pour accomplir cette mission ; et enfin une certaine quantité de richesse affectée à la réalisation de cette mission » (Manuel de droit constitutionnel, Paris, Fontemoing, 1907, p. 416).
31 Foucart aura, en ce sens, la très belle formule suivante : « l’intérêt général constitue la demande et le service public sa réponse ». À propos de cette citation (1838), voyez Éléments d’histoire du droit administratif ; un père du droit administratif moderne, le doyen Foucart (1799-1860), Paris, LGDJ, 2019, § 220.
32 L. Rolland, Cours de droit administratif, 1944, Les Cours du Droit, p. 209.
33 CE, 28 juin 1963, Narcy, req. n° 43834, Rec., p. 401.
34 À propos de laquelle on lira avec grand profit l’exceptionnelle thèse de D. Païva de Almeida, L’école du service public, thèse Université Paris I, 2008.
35 On se permet à cet égard de renvoyer à notre Dictionnaire de droit public interne, Paris, LexisNexis, 2017 à l’occurrence « École ».
36 L. Duguit, Les transformations du droit public, Paris, Armand Colin, 1913, p. 52.
37 L. Rolland, Cours de droit administratif…, Paris, Les cours de Droit, 1945, p. 181 et s.
38 À son propos, on se permettra de renvoyer au chapitre que nous avons consacré à la naissance de ladite notion de Spic in Dix mythes du droit public, Paris, Lextenso, 2019.
39 En ce sens, voir J.-L. de Corail, La crise de la notion juridique de service public en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1954.
40 Par exemple en 1943 dans la huitième édition du précis de droit administratif.
41 L. Rolland, Cours de droit administratif, 1944, Les Cours du Droit, p. 209.
42 S. Regourd, « Le Service public et la doctrine : pour un plaidoyer dans le procès en cours », RDP, 1987, p. 5 et s.
43 J.-J. Bienvenu et L. Richer, « Le socialisme municipal a-t-il existé ? », Revue historique de droit français et étranger, 1984, p. 205 et s. ; J. Joana, « L’action publique municipale sous la IIIe République (1884-1939) » Politix, n° 42, 1998, p. 151 et s.
44 L. Bézie Laurent, préc., p. 863 et s.
45 Voir respectivement G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif ; la notion de service public…, Paris, Giard, 1930, 3e éd. ; M. Waline, Manuel élémentaire de droit administratif, Paris, Sirey, 1939, p. 64 ; D. Truchet, « Nouvelles d’un illustre vieillard : Label de service public et statut de service public », AJDA, Paris, 1982, p. 427 et s. ; M. Touzeil-Divina, Recueil Dalloz, 6 octobre 2011, n° 34, p. 2375 et s.
46 P. Delvolvé, « Service public et libertés publiques », RFDA, 1985, n° 1, p. 3 et s.
47 L. Rolland, Précis de droit administratif, Paris, Dalloz, 1951, 10e éd., p. 17.
48 TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, Req. n° 00706) et notre commentaire aux Dix mythes préc.
49 L. Rolland, Du secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe, Thèse de doctorat, Paris, Pedone, 1901.
50 J.-M. Mayeur, « Les catholiques français et la paix du début du XXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale », Les internationales et le problème de la guerre au XXe siècle. Actes du colloque de Rome (22-24 novembre 1984), Rome, École française de Rome, 1987, p. 151 et s.
51 J. Jolly, Dictionnaire des Parlementaires français de 1889 à 1940, Paris, PUF, tome VIII, p. 2890.
52 On sait même que le navire changea de nom puisque de 1892 à 1900, il voguait sous l’identification de « Tewfik Rabbani » : voir B. Bernadac, « Petite histoire de la Compagnie de Navigation mixte… » in L’Algerianiste, 2003, n° 105.
53 Voir C. Chauvin Clotilde, Louise Michel en Algérie, Paris, Les éditions libertaires, 2007 ; M. Touzeil-Divina, G. Koubi, C. Cerda-Guzman, C. Benelbaz et M. Jaoul (dir.), Louise Michel & le(s) droit(s), Toulouse, L’Épitoge, 2022.
54 La lecture des archives nous apprend ainsi (Le Petit Marseillais du 28 mai 1906, p. 2) que le 27 mai 1906 le député Colin que remplaçait Rolland, rentra en Algérie en ayant traversé sur le Duc-de-Bragance et ce, au moment même où, vraisemblablement, Rolland rentrait en métropole vers le concours d’agrégation puis Nancy. Cela dit, à la même page, on apprend qu’un autre « Louis Rolland » de Montélimar a épousé une demoiselle Lestringue. Il ne s’agit pourtant que de l’un de ses nombreux homonymes.
55 Voyez ainsi par ex. : L. Cabantous et J. Liégeois, Répétitions écrites sur le droit administratif : contenant l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques, Paris, Marescq Aîné, 1873, 5e éd.
56 Également nommé le procès de la « malle sanglante de Millery », il mettait en accusation ladite Mme Bompard qui, pour sa défense, invoquait avoir été hypnotisée par son criminel amant, Michel Eyraud (1843-1891).
57 Parmi les autres spécialistes amici curiae signalons l’un des médecins légistes les plus célèbres ayant également été appelé à délivrer son expertise audit procès : le lyonnais Alexandre Lacassagne (1843‑1924).
58 On a particulièrement été quasi « hypnotisé » par J. Liégeois, De la suggestion et du somnambulisme dans leurs rapports avec la jurisprudence et la médecine légale, Paris, Doin, 1889.
59 Liegeois va d’ailleurs finir sa vie en cure, à Bains-les-Bains, non du fait d’un accident de santé mais de voiture. Il a fait partie des juristes à propos desquels la recherche de sa sépulture fut, de ce fait, compliquée. Son corps repose bien, cela dit, à Nancy.
Mathieu Touzeil-Divina, « Et si Louis Rolland n’avait pas embarqué pour Alger & pour la sauvegarde du service public ? », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4602.