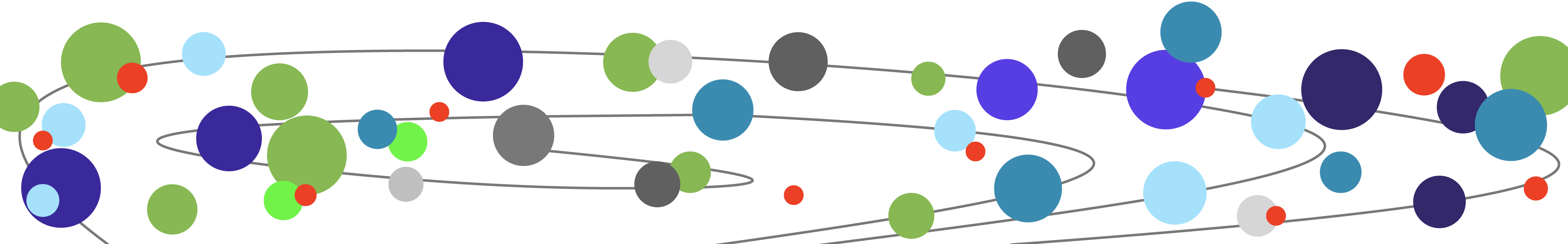Chloë Geynet-Dussauze
Maître de conférences à Sciences Po Lille, CRDP-ERDP
L’article met en lumière l’hypothèse d’un gouvernement privé de la faculté d’engager sa responsabilité sur un texte, qui, tout en conservant certains réflexes hérités du passé, demeure attaché à la recherche du compromis et à la préservation d’un espace de délibération parlementaire. La Ve République conserve ainsi une dimension parlementaire significative. Toutefois, la consolidation de multiples mécanismes assurant la domination gouvernementale sur les assemblées, combinée à une captation présidentielle précoce des instruments du parlementarisme, consacre malgré tout un déséquilibre structurel favorable à l’Exécutif. Ce dernier, peu enclin à l’autoritarisme, n’en détient pas moins la maîtrise du jeu institutionnel ».
The article considers the counterfactual hypothesis of a Government deprived of the capacity to tie its survival to the fate of a bill. In such a setting, while certain institutional reflexes inherited from the past endure, the Government would remain oriented toward compromise and the preservation of a space for parliamentary deliberation, albeit more limited than under previous republics. The Fifth Republic would thus retain a meaningful parliamentary dimension. Yet, the entrenchment of numerous mechanisms securing governmental dominance over the assemblies, together with the early presidential appropriation of parliamentarism’s instruments, entrenches a structural imbalance in favor of the Executive. Although not inherently authoritarian, the Executive nonetheless retains decisive control over the institutional game.
« Déni de démocratie »1, « arme absolue »2 ou « disposition dégradante »3, l’article 49, alinéa 3 est-il la source des plus grands maux de l’actuel régime ? Tel l’aviateur face au Petit Prince4, l’objectif est ici de dessiner les contours d’une Ve République exempte de cette disposition. En permettant l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi sans vote de l’Assemblée nationale5, parfois même avant que la discussion générale n’ait débuté6, ce « chef-d’œuvre de la rationalisation »7 est sans doute l’article le plus connu et le plus impopulaire de la Constitution du 4 octobre 19588. Parce qu’il porte une atteinte manifeste aux droits du Parlement, en particulier à sa fonction délibérative, celui-ci symbolise, à lui seul, la puissance de la machinerie institutionnelle favorable à l’Exécutif mise en place en 1958.
À travers l’efficacité gouvernementale qu’il garantit, d’aucuns ont pu le rattacher au « legs institutionnel gaulliste »9. En réalité, l’article 49, alinéa 3 n’a nullement été inspiré ou même souhaité par Charles de Gaulle et constitue « moins une révolution que l’aboutissement logique d’une évolution amorcée dès 1946 »10. Les prémices de cet article se retrouvent dans divers projets et propositions de révision constitutionnelle antérieurs à 195811. Sous la IVe République, l’aboutissement de la réflexion née de la pratique de la question de confiance depuis 1947 se concrétise particulièrement le 16 janvier 1958, par le dépôt du projet Gaillard12. Porté par le président du Conseil du même nom, celui-ci prévoit qu’un texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité puisse être considéré comme adopté dès lors qu’aucune motion de défiance ne lui a été opposée. La logique retenue est simple : une fois la confiance accordée au Gouvernement lors du vote d’investiture, celle-ci lui est, par principe, acquise, tant qu’elle ne lui « a pas été retirée »13. Ce faisant, si le Gouvernement lie son existence au sort d’un texte, il n’est pas attendu que la majorité renouvelle sa confiance, puisqu’elle lui a déjà été manifestée. En revanche, il appartient à l’opposition de démontrer par un vote de censure qu’elle est devenue majoritaire14. Voté après quelques modifications par l’Assemblée, ce texte ne sera cependant jamais adopté par le Conseil de la République, le Gouvernement Gaillard étant renversé en avril 195815. Si aucune des réformes conduites sous la IVe République en ce sens n’a pu aboutir, l’évolution des esprits ainsi amorcée sert, par la suite, de prélude à l’élaboration de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Absente des premières réflexions relatives au futur texte constitutionnel, « cette petite révolution »16 permettant l’adoption d’un texte sans vote par la décision du Gouvernement d’engager sa responsabilité est finalement soumise au Conseil de cabinet du 25 juillet 1958. Malgré le soutien marqué de trois anciens présidents du Conseil à son égard17, cette disposition est l’une des plus controversées et donne lieu à de vifs débats18. Alors que le général de Gaulle a exprimé ses doutes quant à la nouvelle mesure19, plusieurs membres du Comité consultatif constitutionnel s’y opposent nettement20. La plus célèbre critique émane de son président, Paul Reynaud, qui estime notamment que le Parlement serait, de la sorte, condamné à ne voter que des lois d’importance secondaire, ajoutant qu’« il n’est pas un Parlement au monde qui soit, comme le sera le Parlement français si l’article 45 [futur article 49] est maintenu tel quel, privé du droit de voter la loi »21. De son côté, s’il reconnaît que l’adoption d’un texte sans vote « du fait qu’aucune motion de censure n’a été déposée » heurte son « sens du parlementarisme »22, Michel Debré tente d’apaiser les craintes des membres réticents, précisant que les dispositions du troisième alinéa « ne doivent être qu’une ultime sauvegarde, jalousement gardée en réserve ; […] dangereuses pour le régime, […] si elles étaient employées à tout instant, ces dispositions [lui] paraissent au contraire essentielles pour les cas exceptionnels »23. L’objectif est bien de discipliner les députés rétifs, afin qu’émerge une majorité « nette »24 et « cohérente »25 au soutien du Gouvernement.
Près de soixante-cinq ans après son entrée en vigueur26, l’article 49, alinéa 3 a, certes, offert au Gouvernement les moyens nécessaires à l’adoption de textes clivants en période de majorité relative, mais il a également permis d’écourter de nombreux débats législatifs, notamment à des fins de lutte contre l’obstruction parlementaire (avérée ou prétendue). S’il devait, à l’origine, permettre de remédier à l’absence de majorité, il a été mobilisé pour pallier « l’étroitesse de majorité (1967), puis la division de la majorité (1976), puis l’hostilité ponctuelle de la majorité (1982), pour finir par l’impatience de la majorité (1986, 2003) »27 et la récente « autodéfense »28 d’un gouvernement potentiellement minoritaire. En d’autres termes, l’article 49, alinéa 3 a échappé à l’interprétation originelle de ses promoteurs. C’est la raison pour laquelle, voyant son application s’éloigner progressivement des fins qu’il lui avait attribuées, Michel Debré dénonçait un « détournement de procédure », tout en rappelant la portée de cet article, « destiné à éviter une crise gouvernementale, non à dessaisir le Parlement d’une manière définitive »29. Loin de demeurer exceptionnel et de se cantonner à la neutralisation des dissidences majoritaires, le recours à cette disposition s’est progressivement banalisé30, se muant en une « arme multifonctionnelle, donnée à des Premiers ministres qui abusèrent des facilités qu’elle leur offrait »31, tandis que le Conseil constitutionnel s’est refusé à en limiter l’exercice32. En réaction33, le Comité Balladur proposait, en 2007, « que le champ d’application de l’article 49, alinéa 3 soit limité aux seules lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux textes les plus essentiels à l’action du Gouvernement »34. La révision constitutionnelle de 2008 a finalement circonscrit cette procédure à ces deux catégories de projets de loi ainsi qu’à un autre texte par session. Désormais, la responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée sur le fondement du troisième alinéa de l’article 49 qu’à l’égard de textes « objectivement vitaux pour la Nation » et « pour un texte jugé subjectivement essentiel pour le Gou-vernement »35.
Pour autant, cette restriction n’a pas réduit l’hostilité populaire à l’encontre de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution36. Ainsi, le 16 mars 2023, lorsque la Première ministre Élisabeth Borne annonce engager la responsabilité de son gouvernement sur le fondement de cet alinéa durant la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale portant réforme des retraites37, de nombreux rassemblements spontanés ont lieu dans plusieurs villes, dénonçant cette décision. Par ailleurs, la critique ne se cantonne pas au cadre national : quelques mois plus tard, à la demande du président de la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Commission de Venise émet un avis intermédiaire sévère à l’encontre de cet alinéa, soulignant notamment qu’il « renverse la charge de l’initiative » du rejet d’un texte et autorise l’adoption d’une loi « sans une discussion réelle et approfondie de son contenu »38. Point d’orgue de l’ingénierie constitutionnelle consacrée en 1958, cette disposition concentre, à elle seule, la majorité des critiques dirigées à l’encontre du texte constitutionnel de la Ve République, car elle symboliserait, plus que toutes les autres, une pratique autoritaire de gouvernement et illustre avec force la prépondérance de l’Exécutif dans le jeu institutionnel. À l’instar de ce dernier, le « 49.3 » incarne le « parlementarisme par défaut »39, ne conférant qu’une influence négative aux assemblées, et illustre, au plus haut degré, la marginalisation de la fonction délibérative des assemblées parlementaires. Pour autant, s’il apparaît comme présumé coupable des plus grands travers du régime, le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution surdétermine-t-il réellement la pratique et le fonctionnement des institutions actuelles ?
Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir40. Aussi « périlleux »41 soit-il, l’exercice d’uchronie ici proposé permet d’offrir une esquisse de réponses. Cette « entreprise de politique-fiction » consistant « à rechercher ce qui se serait passé si ce qui s’est passé ne s’était pas passé »42, invite à bousculer l’histoire et les représentations qui l’accompagnent, en se demandant dans quelle mesure l’absence de consécration du troisième alinéa de l’article 49 aurait influencé les marqueurs actuels de la Ve République43. Dans cette perspective, penser la Ve République sans la « Grosse Bertha »44, conduit à envisager d’autres issues possibles aux cent utilisations qui ont eu lieu depuis l’origine45. Cependant, l’objectif n’est pas de prétendre réécrire l’histoire de chaque texte, qu’il s’agisse des diverses lois de finances, de celles relatives aux nationalisations, aux privatisations, à l’enseignement privé, aux programmations militaires ou encore à celles portant réforme des retraites. Il s’agit ici de dresser les contours de ce qu’aurait pu être la pratique institutionnelle du régime de la Ve République en l’absence de cette disposition pivot. En s’inspirant des précautions méthodologiques prises par le doyen Vedel face à « l’océan des incertitudes »46 qu’offre l’uchronie, la réalité ne sera donc modifiée qu’au plus près de ce qui est nécessaire pour les besoins de l’exercice visé et les comportements des acteurs seront supposés en fonction de ce qu’ils furent réellement dans des circonstances similaires47. Par ailleurs, si les normes d’habilitation évoquées comportent de « puissantes virtualités contraignantes »48, elles ne préjugent en rien de l’usage qui pourrait en être fait par les différents acteurs institutionnels. C’est la raison pour laquelle les supputations formulées tiennent compte de la pratique institutionnelle installée, puis déployée, dès les premiers pas du régime, par ceux-là même (pour ne pas dire celui-là) qui l’avai(en)t pensé.
Ces précautions prises, il faut désormais laisser place à l’imagination. Admettons qu’à l’été 1958, la charge menée par Paul Reynaud contre le troisième alinéa du futur article 49 de la Constitution ait finalement convaincu les autres membres du Comité consultatif constitutionnel. Selon eux, les spécificités de l’histoire constitutionnelle française ne sauraient conduire le constituant à priver une assemblée parlementaire de la possibilité de voter une loi. Par conséquent, le quarante-neuvième article de la Constitution du 4 octobre 1958 ne contient donc pas quatre, mais trois alinéas : le premier alinéa consacre implicitement la question de confiance, en prévoyant qu’après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre « engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale » ; le deuxième alinéa permet aux députés de mettre en cause « la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure » ; et le troisième alinéa a trait à la faculté, pour le Premier ministre, « de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale ». Ainsi privé de toute possibilité de lier son existence au sort d’un texte en discussion devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement conserve certains réflexes hérités du passé, valorisant la recherche du compromis et maintenant un espace dédié à la délibération parlementaire, bien que son périmètre s’avère moins étendu que sous les Républiques précédentes. Dès lors, la culture institutionnelle propre à la Ve République conserve une dimension parlementaire marquée (II). Néanmoins, la multitude de canaux consacrant la domination politique du Gouvernement sur les assemblées parlementaires associée à l’apparition, dès les premiers mois du régime, d’une « captation présidentielle »49 instrumentalisant les ressorts du parlementarisme, consacrent un déséquilibre institutionnel favorable à l’Exécutif (I). Peu enclin à des comportements autoritaires, ce dernier détient, malgré tout, la maîtrise du jeu institutionnel.
I. L’irrésistible déséquilibre institutionnel favorable à l’Exécutif
À l’instar de l’actuelle Ve République, le croquis uchronique contient les marques d’un déséquilibre institutionnel favorable à l’Exécutif. En effet, en 1958, il faut panser les traumatismes des précédentes Républiques : la principale ambition est d’assurer la stabilité et l’autorité des gouvernements par la rationalisation des règles de fonctionnement du parlementa-risme. Afin de pallier l’absence supposée d’une majorité parlementaire constante, l’appareil juridique consacré assure une prévalence gouvernementale dans la conduite du travail législatif (B). En parallèle, quelques années seulement après les débuts du nouveau régime, un système de gouvernement effectif à « captation présidentielle » se met en place, qui assoit durablement l’emprise du président de la République sur le jeu institutionnel (A).
A) Le maintien de l’emprise présidentielle sur le jeu institutionnel
Avec ou sans « 49.3 », la précellence présidentielle caractérise le régime de la Ve République. Tel est notre sentiment à propos des faits ayant marqué l’automne 1962. Absente des premières dispositions constitutionnelles, l’élection du président de la République au suffrage universel direct correspond pourtant à l’idée que le général de Gaulle s’est toujours faite du chef de l’État, « placé au-dessus des partis »50, dont la légitimité procède du rapport direct qu’il entretient avec le peuple souverain. Dès les premiers pas du régime, il indique qu’« il convient que, seul, le chef de l’État soit l’élu de toute la nation »51. Après l’attentat manqué du Petit-Clamart d’août 1962, il affirme vouloir asseoir la légitimité de ses successeurs et propose l’élection du président de la République au suffrage universel direct, « par la voie la plus démocratique, celle du référendum »52. Face à la réduction de « ce qui restait encore de parlementaire dans le régime instauré en 1958 »53 et au contournement du Parlement54, ce dernier renverse le Gouvernement de Georges Pompidou sur le fondement de l’article 49, alinéa 2 de la Constitution. En riposte, le général de Gaulle dissout l’Assemblée nationale, tandis que le référendum offre une large victoire au « oui ». Alors qu’une majorité parlementaire homogène est consacrée par les élections législatives des 18 et 25 novembre, Georges Pompidou est confirmé au poste de Premier ministre. En seulement deux mois, la Ve République est « devenue ce qu’elle est »55, marquée par la primauté d’un président élu au suffrage universel direct, l’allégeance d’un Premier ministre se vivant comme subordonné au chef de l’État et la force d’une majorité parlementaire acquise à ce dernier. L’ensemble de ces traits saillants est ici retenu, dès lors que la présence ou l’absence de « 49.3 » ne paraît pas influencer le cours de ces événements : d’une part, la volonté du général de Gaulle d’établir l’élection du président de la République au suffrage universel direct a toujours été vive56 et aurait, dans tous les cas, été consacrée et, d’autre part, qu’importe le moment choisi, face à cette « forfaiture »57, le Parlement aurait réagi à l’identique.
Dès lors, la présente épure retient des conséquences similaires : si, durant les premières années de la Ve République, le cadre constitutionnel ne serait sans doute pas parvenu, à lui seul, « à produire une discipline parlementaire et une majorité véritablement cohérente »58, ces événements auraient tout de même donné naissance au « miracle de la Ve République que constitue le fait majoritaire »59 et qui permet au Gouvernement de disposer « d’une majorité stable et fidèle, sur laquelle il peut s’appuyer tout au long de son mandat »60. Renversant « le présupposé qui avait été au fondement de l’œuvre constituante de l’été 1958 »61, ce dernier favoriserait également la stabilité des gouvernements, les majorités ne dépendant plus des alliances de circonstances. Comme l’indiquait Guy Carcassonne, le rôle des députés du camp vainqueur n’est donc pas de créer des difficultés à l’Exécutif choisi par le suffrage universel, mais au contraire de le soutenir, dès lors qu’ils ont été élus avant tout pour cela62. Si l’on peut imaginer que « l’effet de Gaulle »63 aurait marqué la pratique des institutions de manière similaire, favorisant notamment l’émergence de cette majorité disciplinée, d’autres facteurs politiques indépendants du « 49.3 » contribuant à la prééminence présidentielle se seraient également déployés (personnalisation de la compétition électorale, augmentation du poids des partis politiques ou encore nationalisation progressive des élections locales64).
Par ailleurs, malgré le lien spécifique qui l’unit au Gouvernement, la majorité parlementaire aurait aussi tendance à reconnaître le président de la République comme son « leader réel »65. La majorité parlementaire œuvrerait, de la sorte, en faveur du programme de son leader et de ses initiatives politiques. Dans la perspective de ce « présidentialisme programmatique »66, le Premier ministre « tra-vaille[rait] pour le compte de la politique présidentielle, non pour sa seule ligne politique propre »67. La subordination du premier des ministres à la volonté présidentielle semblait, d’emblée, aller de soi pour Charles de Gaulle, selon qui, « étant donné l’importance et l’ampleur des attributions du Premier ministre », celui-ci ne pouvait être que le « [sien] »68. D’ailleurs, sans « 49.3 », de Gaulle aurait certainement tout de même procédé au remplacement abrupt de Michel Debré (homme politique et parlementaire) par Georges Pompidou (banquier alors non élu et devenu directeur de cabinet du général), suscitant les mêmes critiques de la part des parlementaires d’opposition, qui dénonçaient une marque supplémentaire d’irrespect à l’encontre du Parlement. Par ce geste, marquant le « fait du Prince »69 – en dehors de toute crise politique et sans explication70 –, le président dissociait davantage les fonctions de Premier ministre et de chef de la majorité parlementaire. En 1962, l’acquisition d’une légitimité politique supérieure pour le chef de l’État assoit durablement cette servitude71. Ce faisant, hors cohabitation, l’absence de « 49.3 » n’y change rien : le président de la République dominerait tout de même le jeu institutionnel, en captant les ressorts du gouvernement parlementaire72.
Certes, dans le cadre du pilotage des politiques publiques, l’Élysée serait dépendant de Matignon. Néanmoins, le défaut de « 49.3 » n’influence pas le caractère hétéronome de la présidence de la République : celle-ci ne dispose pas d’une « autonomie opérationnelle »73 identique à celle du Premier ministre. C’est la raison pour laquelle le président s’appuie fréquemment sur des « relais péri-gouvernementaux »74 ou développe des arènes parallèles de discussion, voire de prise de décision75. D’ailleurs, dès 1959, avant même tout déploiement du « 49.3 », le président de la République a pris l’habitude de réunir à l’Élysée les membres du Gouvernement concernés par l’actualité ou des problèmes spécifiques, parfois une à deux fois par semaine76. À l’instar de la pratique actuelle, la multiplication de ces conseils restreints conduirait à une « absorption »77 du pouvoir de direction gouvernemental et participerait de la marginalisation du Premier ministre sur plusieurs dossiers. Dès lors, il paraît évident que le truchement de la conduite de la politique gouvernementale par le président de la République aurait bien lieu, confortant ainsi l’emprise de ce dernier sur le jeu institutionnel.
En outre, cette captation pourrait conduire à l’apparition d’une responsabilité non écrite du Gouvernement devant le président de la République78. Autrement dit, la pratique consistant à admettre que la démission du Premier ministre puisse découler d’une demande en ce sens du président de la République serait sans doute aussi déployée par les successeurs du général de Gaulle, leur permettant, de la sorte, de disposer d’un droit de vie et de mort collectif sur le gouvernement, mais également individuel, sur les ministres, chacun devant rendre compte de son action au président et au Premier ministre79. Dans cet esprit, Valéry Giscard d’Estaing déclarait que « le texte constitutionnel permet au président de révoquer le Premier ministre, parce que le pouvoir de nomination implique le pouvoir de révocation »80. Sans article 49, alinéa 3, aucun élément ne semble fragiliser cette lecture.
L’absence de « 49.3 » ne semble donc pas modifier la force de l’emprise présidentielle sur le jeu institutionnel. L’association d’éléments structurels favorisant cette prééminence (statut du président, pouvoirs propres81 ou mode d’élection depuis 1962) et de la pratique institutionnelle, en particulier de celle issue de la volonté originelle du général de Gaulle d’exercer l’impulsion et la direction de la politique de la nation, ont profondément façonné le costume présidentiel et convaincu l’ensemble des acteurs constitutionnels de l’évidence d’un tel « leadership »82. Sur ce point, le croquis uchronique ne diffère donc pas de l’actuelle Ve République. Pour autant, ses lignes sont susceptibles de varier quant au sort qui peut être réservé au Gouvernement en cas de blocage politique.
B) La prévalence gouvernementale dans le travail parlementaire
D’abord, se pose la question de l’investiture parlementaire du Gouvernement. À l’inverse de la pratique actuelle, aurait-il pu être déduit de la formule retenue par l’article 49, alinéa 1 que chaque nouveau gouvernement nommé devait obtenir l’investiture de l’Assemblée nationale ? Deux hypothèses peuvent ici être dressées. En premier lieu, il est possible d’avancer que les mêmes faits se seraient tout de même produits. Dès lors, avec l’accord du général de Gaulle, Georges Pompidou aurait également considéré, dès les années 1960, que le présent de l’indicatif ne valait pas l’impératif83 et les gouvernements successifs ne se seraient pas systématiquement sentis liés par cette interprétation. Prévaudrait ainsi un système de confiance présumée, autorisant le Gouvernement à exister sans légitimation parlementaire positive initiale84. En second lieu, le schéma inverse peut être envisagé : afin de ménager leurs rapports avec les députés et, plus précisément, avec ceux de leur majorité, les Premiers ministres successifs auraient systématiquement engagé leur responsabilité après leur nomination, s’estimant liés par cette disposition. Ce faisant, la légitimation du Gouvernement procéderait davantage du Parlement, atténuant, de facto, la captation présidentielle sus-évoquée. Néanmoins, cette piste paraît fragile : d’abord, en partie du fait de la légitimité qu’il tire de son mode d’élection et de la pratique institutionnelle mise en œuvre par le général de Gaulle, le président de la République souhaiterait certainement conserver la maîtrise de la nomination du Premier ministre. Dans cette perspective, la « déconnexion entre nomination du Premier ministre et le scrutin législatif » a parfois été recherchée pour rappeler « que le Premier ministre n’avait pas d’autre légitimité que celle que le président voulait bien lui prêter »85. Plus encore, la tentative de déconnexion de cette nomination avec les parlementaires aurait peut-être conduit certains présidents à nommer le chef du Gouvernement alors que les parlementaires étaient en vacances, empêchant ou repoussant, par la force des choses, tout discours du Premier ministre à l’Assemblée nationale86. Ensuite, il n’est pas garanti que des Premiers ministres confrontés à des majorités relatives auraient pris le risque d’engager leur responsabilité sur ce fondement87. In fine, rien ne permet d’affirmer que chaque chef du Gouvernement aurait d’emblée et systématiquement engagé sa responsabilité sur le fondement de ce premier alinéa : le Premier ministre n’a pas besoin d’une investiture parlementaire, dès lors, qu’en cas de désaccord, l’Assemblée nationale dispose de la motion de censure. Demeurant l’unique maître du mécanisme, le Premier ministre pourrait discrétionnairement estimer qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir son investiture auprès de l’Assemblée. Tout « relâchement »88 de la responsabilité parlementaire du Gouvernement jouerait alors, à nouveau, en faveur du président de la République.
Ensuite, sans « 49.3 », le Gouvernement est privé d’un important moyen de pression lui garantissant l’adoption d’un texte. Dans ce cadre, il faut esquisser les contours de sa probable attitude en cas de blocage ou de désaccord de fond avec ses soutiens parlementaires. Confronté à une majorité réticente ou hésitante (malgré d’importants efforts de négociations89), le Gouvernement pourrait décider d’engager sa responsabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 49 de la Constitution. Après délibération du Conseil des ministres, celui-ci permet au Premier ministre d’engager la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale, « sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». À l’instar de la pratique déployée sous la IVe République en marge du texte constitutionnel, le Premier ministre pourrait, par exemple, s’en remettre à cette procédure et annoncer « lier son existence à l’adoption de mesures législatives qu’il estime indispensables »90 ou indiquer que si le texte proposé était rejeté (ou un autre texte adopté), le Gouvernement ne serait plus en mesure de poursuivre sa tâche91. « Polyvalente et meurtrière »92, cette pratique de la question de confiance ou de la « pseudo-question de confiance » a favorisé l’instabilité gouvernementale, dès lors que le vote abstentionniste jouait contre le Gouvernement. En effet, lorsque « la question de confiance était posée sur un texte, celui-ci était adopté à la majorité des suffrages exprimés (c’est-à-dire déduction faite des abstentions), et repoussé lorsque le nombre de suffrages contre excédait celui des suffrages pour »93. Ainsi, le Gouvernement démissionnait, alors même qu’il n’y était pas tenu constitutionnellement, la majorité absolue n’ayant pas été atteinte.
Dans un monde sans « 49.3 », le schéma pourrait être similaire : quand bien même le Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que le vote a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés94, les députés abstentionnistes étant réputés avoir voté la confiance au Gouvernement, rien n’empêcherait un gouvernement de démissionner dès lors que le texte sur lequel il aurait annoncé engager sa responsabilité n’aurait pas été adopté. La Ve République pourrait alors tomber dans les pires travers de celle qui l’a précédée. Néanmoins, cette hypothèse paraît peu probable, dans la mesure où « quelque chose a changé en 1958 »95. D’abord, l’exercice du droit de dissolution a été largement facilité et placé entre les mains du président de la République (art. 12 C.). Cette contrepartie à la responsabilité ministérielle96 – rapidement utilisée par Charles de Gaulle – place donc les députés dans une position bien différente. Le potentiel chantage de la majorité au gouvernement peut être neutralisé, permettant, au demeurant, une immixtion accrue du président dans la procédure parlementaire. Ensuite, pour inciter les ministres à se battre pour la survie de leur gouvernement et à dissuader les parlementaires de le renverser, les fonctions de ministre sont désormais incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire (art. 23 C.). En outre, à la demande du Gouvernement, l’assemblée parlementaire saisie peut se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Considérée à l’origine comme un « aménagement d’apparence modeste »97, cette procédure du « vote bloqué » (art. 44, al. 3 C.) est rapidement devenue « la pierre angulaire »98 du nouveau régime, mobilisée au sein de l’Assemblée nationale mais également du Sénat. Précisant la portée de cet instrument, le Conseil constitutionnel a indiqué que « ces dispositions ont pour objet de permettre au Gouvernement d’obtenir, par une procédure ne mettant pas en jeu sa responsabilité politique, un résultat analogue à celui qui ne pouvait être atteint sous le régime de la Constitution de 1946 et en vertu de la coutume parlementaire, que par la pratique de la question de confiance »99. Le but de ce dispositif était, en effet, précisément d’empêcher les Gouvernements d’utiliser à outrance la question de confiance afin de la « réserver à des occasions plus solennelles »100.
Plus largement, cette procédure s’insère dans un appareil juridique global mis au service de la stabilité gouvernementale. En 1958, par « réaction »101 aux Républiques précédentes, le parlementarisme « rationalisé »102, « corseté »103 ou « brisé »104, instaure un ensemble de règles juridiques encadrant limitativement les assemblées parlementaires, tout en garantissant une liberté de mouvement à l’exécutif105. L’objectif est de réduire – avec « fermeté »106 – le Parlement à des fonctions prédéterminées et de confier au Gouvernement les moyens d’action nécessaires à l’adoption des projets de loi. D’un côté, le Parlement perd sa traditionnelle autonomie : sa compétence normative est strictement limitée (art. 34 C.), la vie intérieure des Chambres est encadrée (art. 61 C.), le nombre de commissions permanentes est restreint (art. 43 C.), l’exercice du droit d’initiative législative des parlementaires est conditionné à des règles de recevabilité financières et législatives (art. 40 et 41 C.), etc. De l’autre, le Gouvernement dispose d’une panoplie de moyens lui assurant une prépondérance générale dans la conduite du travail parlementaire : chargé de déterminer et de conduire la politique de la Nation (art. 20 C.), il est, à l’origine, maître de l’ordre du jour (art. 48 C.), et peut notamment s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’aurait pas été antérieurement soumis à la commission (art. 44, al. 2 C.), mettre en œuvre la procédure d’urgence (art. 45 C.), intervenir dans le domaine de la loi (art. 38 C.), ou encore s’appuyer sur le Conseil constitutionnel, « organe privilégié de la concrétisation des énoncés constitutionnels » qui accentue, par ses décisions, « la tendance au cantonnement des assemblées »107. L’absence de « 49.3 » n’y change donc rien : l’appareil juridique consacré se révèle largement favorable à l’Exécutif (sous la bienveillance globale du Conseil constitutionnel). À nouveau, l’esquisse uchronique ne s’éloigne donc guère de l’actuelle Ve République : le Gouvernement dispose des moyens nécessaires à l’aboutissement de son programme législatif.
Ainsi, qu’importent les scenarii envisagés, l’ébauche uchronique ne recouvrerait probablement pas les traits d’une IVe République bis. Superfétatoire « 49.3 » ? L’affirmative est ici séduisante, car celui-ci n’apparaît pas nécessaire pour sortir de la IVe République. La rupture a bien été consommée : les potentialités offertes par l’arsenal juridique consacré en 1958 auraient sans doute été exploitées par l’Exécutif dans un sens similaire et à des fins identiques à ceux de l’actuelle Ve République. En revanche, la présente esquisse diffère quant à la teneur des relations qui unissent le cabinet hexagonal au Parlement. En effet, privé de sa « béquille constitutionnelle »108, le Gouvernement serait certainement contraint d’entretenir des rapports privilégiés avec ce dernier, favorisant, de la sorte, le maintien d’une culture institutionnelle parlementaire, davantage propice à la délibération et à la recherche du consensus.
II. Le relatif maintien d’une culture parlementaire
Aussi spectaculaire soit-il, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution ne modifie pas le fonctionnement global de la Ve République. Néanmoins, son absence met en lumière l’influence manifeste qu’il exerce sur les pratiques et les représentations institutionnelles. Comparant les cultures institutionnelles propres à l’Allemagne, à l’Italie, à la France et au Royaume-Uni, Céline Vintzel estime que « la plus conflictuelle de toutes […] et donc la plus défavorable à l’Exécutif, se retrouve en France »109. La « culture »110 institutionnelle d’un pays correspond à l’ensemble des éléments juridiques et extrajuridiques (contexte historique, idéologique, etc.111) qui conditionnent le comportement des acteurs de la procédure législative. Elle caractérise les relations entre le Gouvernement et le Parlement, exerçant de manière invisible une influence déterminante « sur l’exercice concret du pouvoir »112. Le fait est connu : l’actuelle Ve République (dotée du « 49.3 ») est marquée par une « culture autoritaire »113, qui se manifeste par un « manque d’égards »114, voire une « déconsidération »115, du Gouvernement pour le Parlement. À l’inverse, lorsqu’il est privé de cette disposition constitutionnelle, le Gouvernement est incité à conserver – au moins en partie – la culture parlementaire issue des régimes précédents. En effet, cette configuration oblige les membres du Gouvernement à favoriser la recherche du compromis, non seulement auprès de leur propre majorité, mais également vis-à-vis de l’opposition (B). Toutefois, si le Premier ministre apparaît ainsi contraint de laisser la délibération se dérouler au sein de l’arène parlementaire, il dispose, malgré tout, de moyens d’action lui permettant d’influer sur la durée de celle-ci (A).
A) Une délibération limitée
Préalable nécessaire à la prise de décision démocratique, la délibération est consubstantielle au Parlement116. En favorisant l’échange et la confrontation des arguments, celle-ci permet aux représentants de préciser leur information et, le cas échéant, de modifier leur point de vue initial, faisant de la loi le « résultat de la délibération générale »117. Selon Maurice Hauriou, la délibération étant « une forme de la discus-sion dont est censée jaillir la lumière, les décisions prises par le pouvoir délibérant sont considérées comme présentant des qualités de fond supérieures à celles des décisions prises par le pouvoir exécutif »118. La délibération est ainsi la raison d’être du Parlement, « ce pour quoi il existe et qu’il est le seul à pouvoir faire »119.
Pour autant, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution autorise le Premier ministre à mettre un terme à la délibération parlementaire, qu’importe l’état d’avancement de cette dernière. En effet, au-delà du reproche lié à son emploi excessif, dans des délais parfois restreints sur l’ensemble des lectures d’un même texte, cet article se révèle d’autant plus « préjudiciable à la délibération parlementaire »120 lorsqu’il intervient avant même qu’un « large débat »121 ait pu s’installer122. À l’inverse, sans « 49.3 », le Gouvernement est davantage contraint de laisser libre cours au déroulement de la délibération parlementaire123. Il serait, dès lors, aisé d’imaginer de longs débats entre les élus, à l’instar des pratiques déployées sous les Républiques précédentes, prolongeant ainsi une culture de la discussion. La chose ne surprend guère : les parlementaires sont à même de faire durer le processus délibérant, avec davantage de vigueur lorsque le texte en discussion est jugé important. Si le Gouvernement est armé pour maîtriser une partie du contenu de la délibération (ordre du jour, droit d’amendement, vote bloqué…), il ne dispose toutefois pas de moyen coercitif lui permettant d’y mettre un terme lorsqu’il le désire. Ainsi confronté au déploiement de certaines délibérations, il est envisageable de considérer que le Gouvernement aurait davantage usé du mécanisme du crédit-temps, ancêtre du « temps législatif programmé »124, et n’aurait pas souhaité sa suppression, en 1969125. Ce dernier permet, en effet, de fixer les dates limites de chaque étape de la discussion, jusqu’au vote du texte. Il a été consacré en 1935126, puis maintenu dans le Règlement de l’Assemblée nationale de 1959, offrant à la Conférence des présidents, soit à sa demande, soit sur l’initiative d’un parlementaire approuvée sans débat par l’Assemblée, la possibilité d’organiser l’ensemble de la discussion d’un texte (art. 49 et 55). Lorsque cette procédure est utilisée, la Conférence fixe un agenda précis à l’examen dudit texte, puis répartit le temps de parole dans le cadre des séances prévues par l’ordre du jour et fixe une heure limite à laquelle les votes auront lieu127. Ce dispositif apparaît donc séduisant pour un gouvernement désireux de contenir l’étalement de la délibération parlementaire128.
Néanmoins, si, en dehors de l’application du dispositif du « temps global », le champ dévolu au processus délibérant pourrait paraître infini, il est, en réalité, « nettement amenuisé par rapport à la IIIe ou à la IVe Républiques »129 – avec ou sans « 49.3 ». En premier lieu, le Gouvernement dispose d’instruments juridiques lui permettant de réduire le périmètre délibératif130. Par exemple, dès 1958, l’article 47 de la Constitution enserre la discussion parlementaire des projets de loi de finances dans des délais précis : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai déterminé (40 jours), « le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours ». Par la suite, « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Depuis la révision constitutionnelle de 1996, une logique similaire existe à propos des projets de loi de financement de la sécurité sociale (article 47-1 de la Constitution131). Dans cette même perspective, la Constitution du 4 octobre 1958 offre également au Gouvernement la possibilité d’accélérer la navette parlementaire en cas d’urgence, par l’inapplication des délais prévus à l’article 42 de la Constitution entre le dépôt du texte et sa discussion en séance, ainsi que la réunion d’une commission mixte paritaire après une seule lecture par chacune des assemblées132. S’il le souhaite, le Gouvernement est donc en mesure de réduire drastiquement le temps de la délibération. Dès lors, sans pouvoir couper court à la délibération lorsqu’il l’estime nécessaire133, le Gouvernement n’est pas complètement impuissant à maîtriser son déroulé. Par ailleurs, face à l’exigence croissante de célérité et l’accélération du temps de l’action politique, on peut supposer que les parlementaires auraient aussi été confrontés à une réduction croissante de leur temps de parole pour la discussion des articles, des amendements ou des motions, réduisant ainsi davantage le champ de la délibération.
En second lieu, au-delà du texte constitutionnel, la « captation présidentielle » précédemment évoquée accorderait également une prévalence à la décision, au détriment de la délibération, dès lors que la loi est supposée traduire les engagements politiques pris devant les électeurs par le président de la République. À l’instar des pratiques actuelles, l’association du parlementarisme rationalisé au fait majoritaire contraindrait les parlementaires, en particulier les députés, à mettre leurs discours en cohérence avec leurs votes. Parce que la primauté est accordée à la décision politique plutôt qu’à la délibération, le débat parlementaire ne serait « souvent que l’expression d’un manichéisme exacerbé »134. Cette radicalisation des affrontements parlementaires inciterait la majorité à soutenir le Gouvernement pendant la durée de la législature, et l’opposition à s’opposer avec force, notamment par le déploiement de manœuvres d’obstruction. Plus encore, l’essentiel des processus menant à la décision se serait probablement « déplacé de la séance publique aux processus informels »135, la préparation même des textes relevant moins de la délibération que de l’influence de l’Exécutif (cabinets ministériels, cabinets privés, etc.).
Le régime de la Ve République amputé du « 49.3 » ne confèrerait pas pour autant un périmètre illimité à la délibération parlementaire. Le Gouvernement serait toujours en mesure d’influer sur sa temporalité et, à l’inverse de la tradition républicaine jusqu’alors consacrée, le processus délibérant des assemblées parlementaires ne serait plus sacralisé. Certes, la délibération ne serait pas susceptible de prendre soudainement fin par la volonté gouvernementale et le vote d’un texte serait (presque136) toujours nécessaire à son adoption, mais elle demeurerait contrainte par un ensemble de règles et de réflexes (si caractéristiques de la Ve République) favorables au Gouvernement.
B) Une conciliation imposée
De nos jours, la conciliation n’apparaît pas comme un réflexe institutionnel propre à caractériser les relations entre, d’une part, le Gouvernement et sa majorité et, d’autre part, le Gouvernement et l’opposition. S’agissant de la majorité, celle-ci est parfois comparée à « ces ombres de la caverne qu’évoquait Platon », se vivant avant tout comme des soutiens à l’Exécutif et maintenant « l’Assemblée dans une servitude volontaire »137. Imprégnée de cette culture « autoritaire » dont elle ne parvient pas à se départir, la majorité fait, certes, occasionnellement part de ses réticences, mais se laisse surtout « faire violence »138. Comme le souligne Armel Le Divellec, depuis les prémices de la Ve République, le Gouvernement accepte difficilement « les sujétions qui représentent les contreparties de cette position constitutionnellement et politiquement privilégiée : “Soutenez-moi, dit-il en substance aux parlementaires de la majorité : nous sommes de la même sensibilité (je suis oiseau) ; mais, ajoute-t-il, laissez-moi définir seul la politique de la Nation : je détiens le monopole de l’intérêt général (je suis souris)” »139. Ce faisant, le Gouvernement a tendance à pallier les conséquences du déficit de concertation intramajoritaire par le recours à l’article 49, alinéa 3. Conçue pour discipliner un Parlement sans majorité cohérente et stable, cette disposition joue paradoxalement contre la construction d’une relation pérenne et qualitative au sein du bloc gouvernement140. Le couple majoritaire ne semble pouvoir exister que dans la violence. À l’inverse, privé de cette faculté, il est possible d’envisager que le Gouvernement modifie ses représentations et ses réflexes, y compris en situation de majorité absolue141. Tout en gardant à l’esprit sa fonction décisionnelle (art. 20), le Gouvernement se montrerait sans doute plus enclin à entretenir des relations apaisées et discursives avec sa majorité. Dans cette perspective, on peut imaginer que les députés membres de cette dernière seraient davantage associés à la préparation ainsi qu’à la confection des textes, en vue de favoriser le compromis et de s’assurer de leur soutien. En outre, au-delà du système de « dissuasion réciproque »142 liant le Gouvernement au Parlement par la motion de censure et la dissolution, la majorité serait en mesure d’imposer certaines contraintes à un gouvernement qui se ferait trop oppressant ou bien désinvolte à l’égard du travail parlementaire. À l’instar de la « doctrine Urvoas » consistant, en commission des lois, à s’opposer « par principe aux articles additionnels – sauf coordination nécessaire – que le Gouver-nement pourrait créer sur ses propres projets »143, les députés membres de la majorité se positionneraient en garde-fou du travail parlementaire et, plus largement, de l’institution elle-même. Placé dans l’impossibilité de les contraindre ou de faire fi des querelles internes, le Gouvernement conserverait – au moins en partie – la culture parlementaire façonnée et héritée des IIIe et IVe Républiques.
Cependant, la valorisation de cette culture n’empêcherait certainement pas l’apparition de dissidences majoritaires, particulièrement difficiles à contenir, surtout en période de majorité relative. Dans ce cadre, la relation que nourrit le Gouvernement avec l’opposition prendrait, elle aussi, une autre tournure. Le rapport de force entre le Gouvernement et la minorité opposante serait altéré, car le premier aurait, plus que d’ordinaire, besoin du soutien de la seconde144. Sous l’actuel régime, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution a été, dès 1982145, détourné de sa vocation initiale à des fins de lutte contre l’obstruction parlementaire. S’estimant démunis face au dépôt de milliers d’amendements, aux demandes répétées de rappels au Règlement, de suspensions de séance, de vérification de quorum ou encore de scrutins publics, les Gouvernements successifs ont usé de cette disposition constitutionnelle afin de couper court au déploiement de telles manœuvres. Pour autant, priver le Gouvernement de la possibilité d’engager sa responsabilité sur un texte en proie à l’obstruction ne signifie pas nécessairement que le vote du texte sera empêché ou que les débats s’enliseront jusqu’au retrait dudit texte. L’expérience institutionnelle en atteste : il est possible de venir à bout d’une obstruction parlementaire sans « 49.3 ». Tel fut notamment le cas à de nombreuses reprises sous les Républiques précédentes146, mais aussi sous la Ve République : par exemple, à propos de la proposition de loi relative au Pacte civil de solidarité147, en 1998, mais aussi s’agissant du projet de loi portant réforme des retraites, en 2003148, ou dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l’énergie, en 2006149, ou encore en ce qui concerne le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, en 2013150. Alors même que ces exemples sont constitutifs, à plusieurs égards, de « records » en matière d’obstruction, le Gouvernement est parvenu, malgré tout, à les faire adopter, dans des délais parfois très longs151, se préservant par-là même du coût politique que constitue l’emploi de cette disposition152. Suivant Hans Kelsen, « l’obstruction a servi souvent, non pas à empêcher absolument toute décision parlementaire, mais à orienter finalement la décision dans le sens d’un compromis entre majorité et minorité »153. Dans cette perspective, le Gouvernement est incité à rechercher la conciliation et à négocier avec la minorité opposante. Il ne fait plus seulement que tolérer cette dernière mais lui reconnaît, dans une certaine mesure, le droit de collaborer à l’exercice du pouvoir. Plus encore, l’attitude coopérative des membres du Gouvernement pourrait inciter la minorité opposante à adopter des comportements constructifs. Il est d’ailleurs significatif que les démocraties parlementaires les moins en proie au déploiement de manœuvres obstructionnistes se caractérisent par une « culture parlementaire coopérative »154.
Ainsi, sans « 49.3 », le Gouvernement, désireux de parvenir à l’adoption de ses textes, serait contraint d’adopter des comportements conciliants à l’égard de l’ensemble des parlementaires ; qu’ils soient députés ou sénateurs, membres de la majorité, de la minorité de la majorité ou encore de la minorité opposante. Plus largement, sa position institutionnelle dominante n’irait probablement pas de pair avec des signes de déconsidération et de dévalorisation du Parlement aussi marqués que ceux que nous connaissons. Pour autant, l’entretien de cette culture parlementaire ne saurait faire oublier la dimension conflictuelle qui anime et caractérise les rapports entre les différents acteurs de la vie institutionnelle et politique française. Avant même la consécration de la Ve République, alors que les majorités n’étaient souvent que de circonstances, les « rébellions ouvertes » des parlementaires et les prises de position virulentes étaient supposées traduire « la bonne santé »155 du Parlement français. La quête d’une culture harmonieuse, notamment proche du système allemand, ne pourrait assurément pas être atteinte par la simple ablation de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Dans les dernières lignes du Petit Prince, l’aviateur s’aperçoit soudain qu’il a oublié d’ajouter la courroie de cuir à la muselière dessinée pour le mouton demandé. Par conséquent, la rose, si chère à son protégé, est menacée de mort. L’aviateur s’interroge : « que s’est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur… ». Loin d’être un symbole protecteur, le mouton constitue alors une menace pour la rose. Puis il se rassure : « Sûrement non ! Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton… ».
À l’instar des sentiments contrastés de l’aviateur, cette esquisse uchronique révèle plusieurs ambivalences : tant décrié, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution n’est, en réalité, que le point culminant d’une ingénierie constitutionnelle toute pensée pour contenir le Parlement et garantir la stabilité du Gouvernement. Sans être banale, cette disposition n’en reste pas moins une pièce à un édifice sophistiqué : qu’importe sa présence (ou non), les traits les plus grossiers de la Ve République demeurent. Néanmoins, son absence aurait sans doute joué en faveur d’une culture parlementaire propice à « civiliser la démocratie majoritaire »156 par une coopération plus positive entre l’Exécutif et les représentants de la Nation. S’il n’est pas responsable de tous les maux de la Ve République, le « 49.3 » favorise assurément les réflexes les plus autoritaires du Gouvernement. Les contours de cette uchronie, tout comme le droit constitutionnel, demeurent naturellement soumis à la pesanteur des hommes et des choses. Comme l’aviateur, il faut nourrir l’espoir de la vigilance des acteurs institutionnels, car, à trop focaliser sur les errements passés ou fantasmés du Parlement, le constituant originel a sans doute omis que l’Exécutif était, lui aussi, capable d’excès.
1 B. François, « Vie et mort du 49.3 ? », La Grande conversation, 5 avril 2023.
2 B. Baufumé, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Cinquième République, Paris LGDJ, 1993, p. 534.
3 P. Reynaud, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. vol. 2. Le Comité consultatif constitutionnel : de l’avant-projet du 29 juillet 1958 au projet du 21 août 1958, La Documentation française, p. 499.
4 Pour mémoire, le Petit Prince demande à l’aviateur, qui est aussi le narrateur de l’histoire, de lui dessiner un mouton. Après plusieurs esquisses refusées, l’aviateur dessine finalement le mouton tel que désiré par le Petit Prince.
5 Ce dispositif combine les procédures de la question de confiance et de la motion de censure : après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre peut décider d’engager l’existence du Gouvernement sur l’adoption d’un texte de loi en cours de discussion devant l’Assemblée nationale. Le projet est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est adoptée, c’est-à-dire si plus de la moitié des membres composant l’Assemblée nationale la vote. Dans ce cas, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé. Seuls les votes favorables à la motion sont comptabilisés, l’abstention étant considérée comme l’expression d’un soutien au Gouvernement. En engageant sa responsabilité sur le vote d’un texte, le Gouvernement place ainsi l’Assemblée nationale devant une alternative : accorder sa confiance au gouvernement ou, à l’inverse, le renverser, par l’adoption d’une motion de censure.
6 Tel fut notamment le cas lors de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, en 2003.
7 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 32e éd., 2018‑2019, p. 702.
8 Par exemple, en mars 2023, un sondage réalisé par l’Ifop révèle que 78 % des Français estiment le recours à cette disposition illégitime (v. Sondage Ifop, « Le regard des Français sur le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites », 16 mars 2023).
9 J. Charlot, « Le legs institutionnel gaulliste », in Institut Charles de Gaulle, De Gaulle en son siècle, tome 2 « La République », Paris, La documentation française, 1990, p. 422.
10 J.-C. Colliard, « Article 49, Article 50, Article 51 », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française ; analyses et commentaires, Economica, 3e éd., 2009, p. 1229.
11 Voir en ce sens : S. Aromatario, « La genèse du 49 al. 3 », Revue générale du droit, 2019, n° 43719.
12 Projet de loi no 6327 portant révision des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution. Ce projet a été voté par l’Assemblée le 21 mars 1958 avec quelques modifications, dont un ajout précisant que « pour être recevable, une motion de défiance doit être revêtue d’un nombre de signatures au moins égal à l’effectif réglementaire minimum des groupes politiques de l’Assemblée nationale ». Le projet Gaillard s’inspirait, en réalité, de la révision constitutionnelle engagée depuis 1955, reprenant les mesures d’une proposition annexée, le 26 mars 1957, au rapport déposé par Paul Coste-Floret.
13 Article 49, alinéa 5 du projet de révision de Félix Gaillard, Pouvoirs, 1996, n° 76, p. 134.
14 S. Aromatario, « La genèse du 49 al. 3 », art. cité. D’ailleurs, le projet Gaillard obligeait l’opposition à indiquer, dans sa motion de censure éventuelle, « un programme de gouvernement » ainsi que le nom du successeur possible, dans l’hypothèse où la motion renversait le président du Conseil, s’inspirant ainsi de la motion de censure constructive allemande.
15 Le 22 mai 1958, son successeur, Pierre Pflimlin, ajoute à la révision en cours un projet de révision constitutionnelle allant dans le même sens, mais les événements d’Alger l’empêcheront, lui aussi, d’aboutir. Dès le 12 juin 1958, la rédaction d’une nouvelle Constitution est en cours.
16 J.-C. Colliard, « Article 49, Article 50, Article 51 », préc., p. 1235.
17 Il s’agit de Pierre Pflimlin, Guy Mollet et Antoine Pinay.
18 Faisant de cet article « l’un des plus débattus du projet » (M. Lascombes, « Le Premier ministre, clef de voûte des institutions ? L’article 49, alinéa 3 et les autres… », RDP, 1981, p. 117).
19 « Le moyen le plus inefficace est cependant celui qui consiste à enlever à l’Assemblée, par l’article 45, le droit de voter la loi quand la question de confiance est posée et à ne lui laisser qu’un simple droit de veto. C’est le type de la muraille de papier » (Intervention du général de Gaulle devant le Comité Consultatif constitutionnel, 8 août 1958).
20 Par exemple, Jean-Paul David estime que le Gouvernement « a dans ses mains une arme terrible : […] il pourra toujours considérer qu’un texte est indispensable et il viendra devant le Parlement. Il saura que l’on ne pourra pas réunir la majorité de la motion de censure et que, par conséquent, son texte sera adopté » (Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution…, op. cit., p. 501).
21 P. Reynaud, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution…, op.cit., p. 499. Quelques années plus tard, en janvier 1961, Paul Reynaud adressera une lettre au Premier ministre reprenant l’argumentation développée devant le Comité, critiquant à nouveau le mécanisme consacré par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution (P. Reynaud, Le Monde, 21 janvier 1961 ; M. Debré, Le Monde, 3 février 1961).
22 M. Debré, Trois Républiques pour une France. Mémoires, tome 2, 1988, p. 380.
23 Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution…, Paris, La Documentation française, p. 502. Plus tard, lors de son discours au Conseil d’État du 27 août 1958, Michel Debré confirmera le caractère exceptionnel de cet instrument, affirmant que « l’expérience a conduit à prévoir en outre une disposition quelque peu exceptionnelle pour assurer, malgré les manœuvres, le vote d’un texte indispensable » (Discours de M. Debré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, 27 août 1958).
24 M. Debré, Documents pour servir à l’histoire…, tome 2, op. cit. p. 506.
25 Discours de M. Debré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, 27 août 1958.
26 Sous la Ve République, aucun gouvernement n’a été renversé sur le fondement de cet alinéa.
27 G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution introduite et commentée, Paris, Éditions du Seuil, 2017, 14e éd., p. 259.
28 D. Baranger, « Le nouveau visage de l’article 49-3 », JP Blog, 16 novembre 2022.
29 JOAN, 1re séance du 14 juin 1977, p. 3735.
30 Plus encore, « l’examen de la nature des textes ainsi adoptés montre qu’il s’agit de projets qui ne sont pas tous appelés à passer à la postérité » (Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur, Une Ve République plus démocratique, 29 octobre 2007, p. 34).
31 G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution introduite et commentée, op. cit., p. 259-260.
32 Le Conseil constitutionnel se refuse notamment à contrôler les motifs politiques de recours à cet article, estimant que « l’exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l’article 49 n’est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte » (voir notamment : CC, déc. no 89‑268 DC du 29 décembre 1989, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité, JORF du 24 janvier 1990, p. 972, cons. 4). Ce considérant n’a d’ailleurs pas été modifié après la révision de 2008 (CC, déc. no 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JORF du 7 août 2015, p. 13616, cons. 13).
33 Auparavant, des députés avaient proposé d’encadrer le recours à cet alinéa, voire de l’interdire purement et simplement (v. not. en ce sens : Y. Piat, Proposition de loi constitutionnelle tendant à interdire l’usage de l’article 49, alinéa 3, lors du vote des projets de loi de finances, Assemblée nationale, n° 2915, 4 août 1992 ; G. Teissier, Proposition de loi constitutionnelle visant à interdire l’usage de l’article 49-3 pour l’adoption de la loi de finances, Assemblée nationale, n° 724, 25 février 1998.
34 Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation…, op. cit., p. 34.
35 G. Tusseau, « La réactivation du 49-3 », D., 2015, p. 560.
36 Il faut dire que, hormis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni l’actuel président n’ont incité leur(s) Premier(s) ministre(s) à renoncer à cette disposition constitutionnelle bien commode pour mettre en œuvre un programme sur lequel ils se sont présentés.
37 Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
38 L’avis indique notamment rechercher si cet article « viole les principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur (Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), France, avis intérimaire sur l’article 49.3 de la constitution, adopté par la Commission de Venise lors de sa 135e session plénière (Venise 9-10 juin 2023)).
39 P. Avril, « Le rôle du Parlement », France-Forum, 1971, no 107, cité par A. Le Divellec, « La nature du régime de la Ve », in La République. Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, p. 356.
40 A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, II.
41 G. Vedel, « Rétroactions : Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969 », RFSP, 1984, 34e année, n° 4-5, p. 719.
42 G. Vedel, ibid.
43 Parmi lesquels la primauté du président de la République élu au suffrage universel direct qui capte les ressorts du gouvernement parlementaire, la subordination du Premier ministre, la domination du jeu institutionnel par l’Exécutif, la domestication des assemblées parlementaires (l’Assemblée nationale étant traditionnellement dominée par une majorité acquise au président), la marginalisation de la délibération parlementaire ou encore le déploiement d’une culture parlementaire autoritaire.
44 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, préc., p. 793.
45 Le premier engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le fondement de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution a eu lieu lors de la séance du 24 novembre 1959, à propos de la loi de finances pour 1960 (JOAN, 3e séance du 24 novembre 1959, p. 2977). Pour une énumération des engagements de responsabilité du Gouvernement et motions de censure depuis 1958.
46 G. Vedel, « Rétroactions : Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969 », préc., p. 720.
47 La présente uchronie n’a donc pas vocation à envisager des changements du cours de la vie politique.
48 A. Le Divellec, « Vers la fin du “parlementarisme négatif” à la française ? Une problématique introduc-tive à l’étude de la réforme constitutionnelle de 2008-2009 », Jus Politicum, 2011, no 6, p. 29.
49 Id., « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la Cinquième République », in La République. Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, op. cit., p. 350.
50 Ch. de Gaulle, Discours de Bayeux, 16 juin 1946.
51 Id., Mémoires de guerre – Le Salut : 1944-1946 (tome III), Plon, 1973, p. 311.
52 Id., allocution télévisée du 20 septembre 1962.
53 F. Rouvillois, Droit constitutionnel. La Ve République (tome 2), Paris, Flammarion, 2001, p. 57.
54 L’article 11 de la Constitution ayant été privilégié à l’article 89, pourtant unique article du Titre XVI, intitulé « De la révision ».
55 G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution introduite et commentée, préc., p. 60.
56 Comme le soulignent Guy Carcassonne et Marc Guillaume, Léon Blum l’avait rapidement déduit du discours de Bayeux (Le Populaire, 21 juin 1946) et le général de Gaulle le souhaitait clairement dès 1958 (Ibid.).
57 G. de Monnerville, 29 septembre 1962, Tribune du Congrès du parti radical réuni à Vichy.
58 M.-C. Ponthoreau, « L’opposition comme garantie constitutionnelle », RDP, 2002, no 4, p. 1148.
59 P. Monge, Les minorités parlementaires sous la Ve République, Paris, Dalloz, 2015, p. 1. Le fait majoritaire désigne « la présence, dans une assemblée parlementaire, d’une majorité d’élus appartenant au même parti ou à une coalition de partis, et se comportant (au premier chef à travers leurs votes) de manière dis-ciplinée » (M. de Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 13e éd. 2022, p. 173).
60 J.-F. Kerléo, « Le fait majoritaire, chronique d’une mort annoncée ? », Jus Politicum, 2017, no 18, p. 338. Ainsi, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution n’a parfois pas été utilisé pendant certaines législatures (IIe, IVe, XIe, XIIIe). En outre, l’organisation de la domination majoritaire résulte également du mode de scrutin retenu dans le cadre des élections législatives (scrutin majo-ritaire uninominal à deux tours).
61 J. Benetti, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime », LPA, 10 juillet 2008, no 138, p. 20.
62 G. Carcassonne, Petit dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Seuil, 2015, p. 168.
63 D. Gaxie, « Explication du vote (1985) », RFSP, 2022, HS n° 2, p. 54.
64 Id., « Les fondements de l’autorité présidentielle – transformations structurelles et consolidation de l’institution », in B. Lacroix et J. Lagroye, Le président de la République – usages et genèses d’une institution, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992, p. 333-375 ; id., « Sur la présidentialisation des régimes politiques », Silomag, janvier 2022.
65 A. Le Divellec, « Le prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la présidence de la Ve République (simultanément une esquisse sur l’étude des rapports entre droit de la constitution et système de gouvernement) », Droits, 2006, no 44, p. 122.
66 B. Daugeron, « Élection présidentielle : les illusions du présidentialisme programmatique », JP Blog, 7 avril 2017.
67 A. Le Divellec, « Vers la fin du “parlementarisme négatif” à la française ? … », préc., p. 17.
68 Ch. de Gaulle, Mémoires d’espoir, T. I, Plon, 1970, p. 287-288. À la question d’une éventuelle dyarchie, le général de Gaulle avait répondu clairement lors de sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, en déclarant : « il est normal chez nous que le président de la République et le Premier ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien ».
69 C. Fuzier, « Le Fait du Prince », Le Populaire, 12 avril 1962.
70 Voir en ce sens : D. Dulong, Premier ministre, CNRS Éditions, 2021, p. 27.
71 Avant même l’écriture de la Constitution, Charles de Gaulle indiquait que c’est « du chef de l’État […] que doit procéder le pouvoir exécutif » (Ch. de Gaulle, Discours de Bayeux, 16 juin 1946). Par ailleurs, comme le démontre Delphine Dulong, en signant les décrets relatifs à la nomination des membres du Gouvernement, le président de la République « dispose de facto d’un droit de regard sur la composition du Gouvernement » et n’hésite pas à « placer des hommes à lui au Gouvernement » (D. Dulong, Premier ministre, op. cit., p. 83-85).
72 A. Le Divellec, « Vers la fin du “parlementarisme négatif” à la française ? … », préc., p. 29-30. Le général de Gaulle aurait, en ce sens, affirmé : « N’employez pas l’expression chef du Gouvernement pour parler du Premier ministre. Le chef du Gouvernement, c’est moi » (A. Peyrefitte, C’était De Gaulle, Tome 1, Paris, Éd. de Fallois, Fayard, 1994, p. 117).
73 M. Caron, L’autonomie organisationnelle du Gouvernement. Recherche sur le droit gouvernemental de la Ve République, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2015, p. 726.
74 T. Mulier, Les relations extérieures de l’État en droit constitutionnel français, Paris, Mare & Martin, 2020, p. 716.
75 Selon Charles Debbasch, L’« Élysée est une Rolls-Royce avec un moteur de deux chevaux » (C. Debbasch, L’Élysée dévoilé, Paris, Albin Michel, 1982, p. 34). Dans une perspective plus contemporaine, Thibaud Mulier affirme que « l’Élysée a les moyens d’une startup avec le cahier des charges d’un GAFAM » (T. Mulier, « La fabrique de la diplomatie française à l’Élysée », in J.-F. Kerléo, S. Lamouroux, L’Élysée. De l’ombre à la lumière, IFJD, 2023, p. 148).
76 D. Dulong, Premier ministre, op. cit., p. 54.
77 C. Geynet-Dussauze, « Le Conseil de défense écologique, quelle légitimité ? », Blog de droit administratif, 9 mai 2022.
78 Ici encore hors cohabitation.
79 B. Dolez, « Quitter le gouvernement. Démission et révocation des ministres sous la Ve République », in O. Beaud, J.-M. Blanquer, La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes & Cie, 1999, p. 279.
80 V. Giscard d’Estaing, « Témoignage », entretien réalisé par J.-M. Blanquer et Ch. Guettier, RDP, 1998, n° spécial « 40 ans de la Cinquième République ».
81 Notamment la possibilité d’accorder, ou non, la tenue d’une session extraordinaire (à l’instar du refus opposé, en 1960, par le général de Gaulle, en vertu de l’article 30 de la Constitution) ou la présidence du Conseil des ministres (art. 9 C.).
82 A. Le Divellec, « Le prince inapprivoisé. … », préc., p. 113.
83 Si le premier alinéa précise que « le Premier ministre engage… », le troisième alinéa indique que « le Premier ministre peut… », tandis que le quatrième contient la mention suivante : « le Premier ministre a la faculté… ». La comparaison entre ces alinéas et la logique parlementaire propre à Michel Debré semblaient, dès lors, aller dans le sens d’une obligation découlant du premier alinéa. En ce sens, Pierre Avril évoque une « convention contra legem » (P. Avril, « Une convention contra legem : la disparition du programme de l’article 49 de la Constitution », in Constitutions et pouvoirs – Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, Montchrestien, 2008, p. 9).
84 A. Le Divellec, « Parlementarisme négatif, gouvernement minoritaire, présidentialisme par défaut : la formule politico-constitutionnelle perdante de la démocratie française », JP Blog, 5 avril 2023.
85 D. Dulong, Premier ministre, op. cit., p. 75.
86 Par exemple, Pierre Messmer a été nommé durant le mois de juillet 1972, alors que les parlementaires étaient en vacances. Cette nomination estivale avait notamment été dénoncée par François Mitterrand : « Député de l’opposition, peu m’importe aujourd’hui que le chef du gouvernement se nomme Messmer ou Chaban-Delmas. Mais, élu du peuple, j’ai le droit de savoir pour quelle raison et pour quoi faire » (L’Unité, 21 juillet 1972, cité par D. Dulong, Premier ministre, op. cit., p. 249).
87 Comme souligné dans le Dictionnaire de droit constitutionnel, « il est significatif que Michel Rocard n’ait jamais estimé entre 1988 et 1991 avoir l’obligation de demander une approbation des orientations politiques de son gouvernement » (O. Duhamel, Y. Mény, « Responsabilité du gouvernement », in Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 926). Pour rappel, lors de la IXe législature (1988-1993), ni Michel Rocard, ni Édith Cresson, ni Pierre Bérégovoy n’ont sollicité la confiance, faute de disposer d’une majorité absolue au Palais-Bourbon.
88 F. Rouvillois, Droit constitutionnel. La Ve République (tome 2), préc., p. 56.
89 V. infra.
90 J. Solal-Séligny, « La question de confiance sous la IVe République », RDP, 1952, p. 737.
91 Voir not. : « Le Gouvernement ne pourrait pas continuer à prendre la responsabilité des affaires de ce pays si l’un des deux amendements était voté » (Schuman, JOAN, séance du 2 janvier 1948, p. 18, cité par M. Lascombes, « Le Premier ministre, clef de voûte des institutions ? L’article 49, alinéa 3 et les autres… », préc., p. 112).
92 P. Avril, J. Gicquel, « La IVe entre deux Républiques », Pouvoirs, 1996, n° 76, p. 36.
93 Ibid., p. 37.
94 Art. 152 RAN.
95 G. Vedel, « Rétroactions : Si de Gaulle avait perdu en 1962… Si Alain Poher avait gagné en 1969 », préc., p. 730.
96 Pour désigner le droit de dissolution dans son discours devant le Conseil d’État, Michel Debré évoque d’ailleurs « l’instrument de la stabilité gouvernementale » (Discours de M. Debré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, devant l’Assemblée générale du Conseil d’État, 27 août 1958).
97 P. Avril, « Le vote bloqué », RDP, 1965, p. 400.
98 Ibid.
99 CC, déc. no 59-5 DC du 15 janvier 1960, Résolution modifiant les articles 95 et 96 du Règlement de l’Assemblée nationale, JORF du 27 janvier 1960, p. 940, cons. 1. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel précise la portée de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution, affirmant : « qu’en vertu desdites dispositions, le Gouvernement peut, d’une part, en cours de discussion, demander qu’il soit émis un seul vote portant à la fois sur une partie du texte – laquelle peut, le cas échéant, être la partie d’un article quand un vote par division intervient – et sur les amendements proposés ou acceptés par lui, dont cette partie du texte viendrait à faire l’objet ; Que le Gouvernement peut, d’autre part, obtenir que l’assemblée se prononce par un seul vote sur tout le texte en discussion en ne retenant que les amendements qu’il a proposés ou acceptés ; que le vote à émettre ainsi sur la totalité du texte porte alors nécessairement et simultanément sur tous les articles ou parties d’articles du texte, amendés le cas échéant par les dispositions nouvelles proposées ou acceptées par le Gouvernement ; que ces articles ou parties d’articles aient été ou non déjà mis aux voix et qu’ils aient été ou non réservés lors de leur examen par l’assemblée saisie ; Qu’enfin, les dispositions de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution permettent au Gouvernement de choisir le moment de la discussion auquel il entend faire usage de la procédure prévue par lesdites dispositions ; Que, toutefois, et en aucun cas, l’application de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est demandé à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote » (ibid.).
100 C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Paris, Dalloz, 2011, p. 5.
101 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, préc., p. 551.
102 V. not. : P. Lauvaux, Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif, Bruxelles, Bruylant, 1988. À l’origine, la rationalisation du parlementarisme a été conceptualisée par Boris Mirkine-Guetzévitch à partir des nouvelles constitutions d’Europe centrale et orientale de l’Entre-deux-guerres (B. Mirkine‑Guetzévitch, Le régime parlementaire dans les constitutions européennes d’après-guerre, Paris, Sirey, 1937 ; id., Les Constitutions de l’Europe nouvelle, avec les textes constitutionnels, Librairie Delagrave, 10e éd., 1938) et s’entendait comme la codification, par un ensemble de techniques juridiques, des relations entre l’Exécutif et les assemblées parlementaires qui reposaient jusqu’alors sur des pratiques politiques et des règles non écrites.
103 Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, par J.-L. Warsmann, Doc. AN, no 892, 15 mai 2008, p. 9.
104 D. Bellamy, « Le gaullisme fut-il une critique du régime d’assemblée ? », Parlement[s], 2013/3, n° HS 9, p. 122.
105 A. Le Divellec, « Vers la fin du parlementarisme négatif à la française ? … », préc., p. 27. En ce sens, eu égard à la rédaction des Constitutions des IIIe et IVe Républiques, il faut ici rappeler que celle de la Ve République innove en consacrant un titre expressément dédié au Gouvernement.
106 M. Habib Deloncle (rapporteur), JOAN, séance du 26 mai 1959, p. 554.
107 A. Le Divellec, « Vers la fin du parlementarisme négatif à la française ? … », op. cit., p. 15.
108 D. Turpin, Le régime parlementaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 99.
109 C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, préc., p. 720.
110 Voir not. en ce sens : G. Carcassonne, « Majorité », Politeia, 2009, no 16, p. 381-386 ; A. Le Divellec, « Vers la fin du parlementarisme négatif à la française ? … », préc., p. 6 ; C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, préc., p. 712.
111 Comme Marie-Anne Cohendet le développe via le « système de variables déterminantes », les éléments extrajuridiques sont notamment composés de la personnalité des gouvernants, de leur conception des institutions, des positions et débats, des habitus, etc. Ces variables sont susceptibles d’avoir, « seules ou combinées, une influence sur la mise en œuvre des règles constitutionnelles » (M.‑A. Cohendet, « Cohabitation et Constitution », Pouvoirs, 1999, n° 91, p. 42-43).
112 C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, préc., p. 17.
113 G. Carcassonne, « Majorité », préc., p. 384.
114 M. Mauguin-Helgeson, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude comparative (Alle-magne, France, Royaume-Uni) », Paris, Dalloz, 2006, p. 283.
115 A. Vidal-Naquet, « Les relations entre le Gouvernement et le Parlement », in P. Blachèr, La Constitution de la Ve République : 60 ans d’application (1958-2018), Paris, LGDJ, 2018, p. 254.
116 En droit parlementaire, la délibération cor-respond à « l’opération de confrontation publique et contradictoire des opinions des membres de l’assemblée, sanctionnée par un vote qui exprime la décision » (M. de Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, préc., p. 122).
117 B. Manin, « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération poli-tique », Le Débat, 1985, no 33, p. 84.
118 M. Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1930, p. 167.
119 J. Benetti, « Éprouver la délibération », in J.-P. Derosier, M. Doray, La délibération après la révision constitutionnelle de 2008. Actes de la Journée de la Commission de la Jeune Recherche Constitutionnelle, Paris, Mare & Martin, 2015, p. 95.
120 Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, par J.-L. Warsmann, préc., p. 390.
121 M. Duverger, « Politique : centre ou marais ? », Le Monde, 5 juillet 1988, p. 2.
122 Certains présidents de l’Assemblée nationale ont pu manifester leur mécontentement de voir cette disposition trop souvent utilisée, à l’instar du président Jean-Louis Debré, en 2004, lors de l’examen du projet de loi relatif au transfert de compétences des collectivités locales. Il estimait « regretter » ce choix, dans la mesure où, « dans une démocratie parlementaire, le droit d’amendement est une prérogative fondamentale des députés, notamment de ceux de l’opposition » (J.-L. Debré, cité in A. Fouchet, « Le Président de l’Assemblée nationale regrette le recours au 49-3 et propose un crédit-temps pour les députés », La Croix, 28 juillet 2004, p. 18).
123 Il se retrouve ainsi dans une configuration identique à celle qui prévaut au sein du Palais du Luxembourg, exception faite de la question préalable dite positive (qu’il soit permis de renvoyer à nos travaux sur ce point : C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la Ve République. Étude de droit constitutionnel, Paris, IFJD, 2020, p. 347-357).
124 Cette procédure de temps global a été restaurée à l’Assemblée nationale après la révision de l’article 44 de la Constitution, en 2008, et la réforme du Règlement de la Chambre du 27 mai 2009 (art. 49 RAN). D’ailleurs, l’instauration de ce dernier a été conçue comme une contrepartie à la limitation du recours à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
125 Ce mécanisme a, en effet, été supprimé sans débat (après être tombé en désuétude) par la première grande réforme du Règlement de l’Assemblée nationale, en 1969 (Résolutions no 146 du 23 octobre 1969 et no 199 du 17 décembre 1969).
126 Reprenant la proposition formulée par Léon Blum en 1918 dans ses Lettres sur la réforme gouvernementale, Fernand Buisson expose son souhait de voir instaurer une durée maximale aux débats, le 10 janvier 1935, lors de son discours de réélection à la présidence de la Chambre des députés (JO Chambre des députés, Débats, 11 janvier 1935, p. 34). Par la suite, cette mesure est présente dans le contre-projet socialiste de Vincent Auriol défendu le 17 janvier 1935 et sera adoptée sans discussion le 22 janvier 1935.
127 Lorsqu’un amendement est déposé par un membre du groupe dont le temps de parole est épuisé, cet amendement doit être lu par le président et mis aux voix sans débat.
128 Ce dispositif a d’ailleurs pu être couplé à l’utilisation de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, notamment lors de la discussion du projet de loi de programmation militaire (Loi de programme no 60-1305 du 8 décembre 1960 relative à certains équipements militaires), témoignant ainsi de l’impatience du Gouvernement à voir la discussion se terminer. Voir not. en ce sens : JOAN, Débats, 1re séance du 18 octobre 1960, p. 2547.
129 J. Garrigues, « L’opposition parlementaire : deux siècles d’hésitations », in O.Rozenberg, É. Thiers (dir.), L’opposition parlementaire, Paris, La documentation française, 2013, p. 62.
130 Il lui est également possible de supprimer la nécessité de la délibération dans certains cas, comme le prévoit notamment l’article 35, al. 3 de la Constitution. Dès lors, aucun vote du Parlement n’est nécessaire pour l’engagement des forces armées avant un délai de 4 mois.
131 Désormais célèbre, cet article prévoit que si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai de 20 jours, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
132 Si, sous la Ve République, la procédure d’urgence est une compétence exclusive du Gouvernement, sous les IIIe et IVe Républiques, elle était une prérogative réservée au Parlement.
133 Pour rappel, l’article 49, alinéa 3 de la Constitution a été utilisé à 32 reprises à propos de projets de lois de finances.
134 J.-P. Camby, « Le droit parlementaire, droit de la minorité ? », in La République. Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, préc., p. 420.
135 A. le Divellec, « Le Parlement en droit constitutionnel », in O. Rozenberg, É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 162. Comme le souligne Armel Le Divellec, « si ces processus informels paraissent inhérents au fonctionnement du gouvernement parlementaire, une grande opacité semble cependant régner sur ces réseaux » (A. Le Divellec, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme… », préc., p. 358).
136 Exception faite des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
137 J.-J. Urvoas, « Retour sur la révision de 2008 et sur les pouvoirs du Parlement », Commentaire, 2018, n° 163, p. 566.
138 G. Carcassonne, « Majorité », préc., p. 384.
139 A. Le Divellec, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme… », préc., p. 357.
140 L’idée de bloc gouvernement est ici entendue au sens de la « fusion des pouvoirs » telle que définie par Bagehot (W. Bagehot, La Constitution anglaise, Paris, Germer-Baillière, 1869, p. 14).
141 Pour rappel, sous l’actuelle Ve République, quatre Premiers ministre n’ont jamais eu recours à cette disposition, à savoir : Lionel Jospin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault et Jean Castex.
142 J.-É. Gicquel, « La lutte contre l’abus du droit d’amendement au Sénat », RDP, 1997, n° 5, p. 1372.
143 J.-J. Urvoas, « Retour sur la révision de 2008 et sur les pouvoirs du Parlement », préc., p. 566.
144 D’ores et déjà, en cas de majorité relative, il semble que les gouvernements adoptent plus que d’ordinaire une attitude « de compromis et de conciliation » à l’égard de l’opposition (V. Boyer, La gauche et la seconde chambre de 1945 à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 175).
145 La première utilisation en ce sens est réalisée par Pierre Mauroy, lors de la discussion du projet de loi relatif aux nationalisations, juste après que la discussion générale a pris fin, le 21 janvier 1982.
146 À nouveau, qu’il soit permis de renvoyer à nos travaux : C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la Ve République. Étude de droit constitutionnel, préc., p. 64-77.
147 In fine, la discussion a duré plus de soixante heures. Plusieurs « records » d’obstruction y ont été établis. Par exemple, la simple défense des motions de procédure par l’opposition a duré 13 heures. Les députés d’opposition s’étaient particulièrement mobilisés contre ce texte, organisant des relais de prises de paroles, déposant des amendements souvent ironiques et contradictoires, déclenchant des incidents et demandant constamment des rappels au Règlement et suspensions de séance. À titre d’illustration, le 9 novembre 1998, après trois jours de débat et l’examen de 550 amendements, l’article 1er de la proposition de loi n’avait toujours pas pu être adopté.
148 Lors de la discussion de ce projet de loi, l’obstruction a eu lieu en séance mais aussi en commission, le groupe communiste ayant notamment déposé plus de 6 000 amendements en commission des affaires culturelles.
149 Ce texte a fait l’objet de 137 634 amendements, équivalant ainsi à 11 416 heures de débats, soit 475 jours en continu, seulement pour présenter ces amendements. Ceci n’eut cependant pas lieu. En effet, le 19 septembre, alors que la discussion était engagée depuis le 7 septembre, la majorité est parvenue à obtenir un accord politique avec les auteurs de ces amendements. Le groupe socialiste a, par exemple, accepté de défendre très rapidement des milliers d’amendements. C’est ainsi qu’une série de 5 920 amendements a été défendue en 30 minutes et une autre de 5 888 amendements en 40 minutes. La discussion s’est finalement achevée le 28 septembre, après 121 heures 46 de débats (soit 16 jours de séance). Cet exemple illustre l’importance de la médiation présidentielle, car grâce à celle du président Jean-Louis Debré, un accord a été trouvé entre les groupes de l’opposition (socialiste et communiste) et le Gouvernement : « les premiers acceptèrent de limiter leur obstruction de façon que la discussion puisse s’achever au bout d’une dizaine de jours. En échange de cette concession, le second renonça à engager sa responsabilité, ce qui aurait bloqué toute discussion » (F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 35e éd., 2014, p. 681).
150 Ceux-ci déposèrent notamment plus de 5 000 amendements (dont de nombreux étaient en réalité identiques), obtinrent plus de 260 rappels au Règlement, multiplièrent également les suspensions et les incidents de séance. Une séance dura même 22 heures, se terminant le lundi 4 février à 8h du matin. Pour limiter les effets chronophages de l’obstruction, le temps législatif programmé sera déployé avec succès en seconde lecture.
151 Par exemple, le Gouvernement n’a pas souhaité engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution lors de la première lecture du projet de loi sur la presse, qui détient le record absolu du temps de discussion sous la Ve République, à savoir 166 h 50. À l’inverse, l’usage du « 49.3 » pour contrer l’obstruction parlementaire déployée à l’encontre du texte relatif au contrat de première embauche, en 2006, atteste les limites de cette disposition comme outil de sortie de crise, le projet de loi ayant été promulgué puis « retiré » par le président de la République, Jacques Chirac.
152 Comme le rappelle Delphine Dulong, le « 49.3 » apparaît souvent comme un « révélateur du manque d’autorité du Premier ministre » (D. Dulong, Premier ministre, préc., p. 248). Le recours à cet article se traduit souvent par des points d’impopularité dans les sondages et, parfois, par l’impossibilité à mettre en œuvre le texte.
153 H. Kelsen, La démocratie. Sa nature. – Sa valeur, Paris, Recueil Sirey, 1932, p. 75.
154 M. Mauguin-Helgeson, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude comparative…, préc., p. 15. En ce sens, Céline Vintzel précise que « la culture coopérative gouvernement/Parlement (majorité et opposition confondues) en Allemagne s’explique par le fait que le régime parlementaire n’y a jamais été vu comme un régime de conflit mais comme un régime de divisions technique et harmonieuse des pouvoirs au profit de l’Exécutif » (C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative. Étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, préc., p. 719-720).
155 Ibid, p. 720.
156 A. Le Divellec, « Parlementarisme négatif, gouvernement minoritaire, présidentialisme par défaut : la formule politico-constitutionnelle perdante de la démocratie française », préc.
Chloë Geynet-Dussauze, « S’il te plaît… Dessine-moi la Ve République sans article 49, alinéa 3 », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4609.