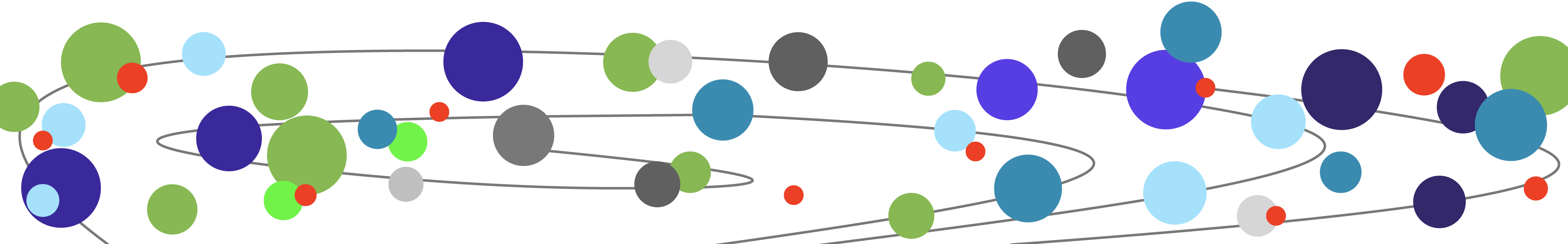Pierre-Yves Gahdoun
Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP
Et si la grande crise financière et économique de 1929 n’avait pas eu lieu ? C’est le point de départ de cette uchronie qui propose de relire l’histoire française et internationale en formulant quelques hypothèses de ce que le monde aurait pu devenir à partir des années 1930. Ce texte est surtout l’occasion de montrer que les évènements économiques ont eu – et ont encore – de nombreuses répercussions sur la formation du droit constitutionnel d’hier et d’aujourd’hui.
What if the great financial and economic crisis of 1929 had not happened? This is the starting point for this alternate history, which offers a reinterpretation of French and international history by proposing a number of hypotheses about what the world might have become from the 1930s onwards. Above all, this text is an opportunity to show that economic events have had—and continue to have— many repercussions on the development of constitutional law, both past and present.
1. Commençons par la « vraie » histoire.
Novembre 1929 : la crise boursière américaine de Wall Street atteint les rivages du continent européen encore marqué par la Grande Guerre. En cette fin d’année 1929, le chômage frappe 1,3 million de travailleurs en Grande-Bretagne et presque le double en Allemagne. La crise économique amène sur les routes des milliers de familles qui tentent d’échapper à la misère et à la faim.
En France cependant, on se montre confiant dans les fondements de l’économie nationale qui semble mieux résister qu’ailleurs au séisme économique qui fragilise toute l’Europe depuis le krach boursier américain. Les chiffres officiels indiquent seulement 13 000 chômeurs au début de l’année 1930, ce qui donne à la population un étrange sentiment de supériorité et de fierté qui restera longtemps dans les esprits1.
À l’inverse en Allemagne, l’économie subit de plein fouet la crise qui est avant tout une crise financière : les capitaux américains et anglais qui avaient abondé après 1918 pour reconstruire les pays vaincus sont immédiatement retirés par les entreprises étrangères, ce qui provoque l’effondrement de tout le système bancaire allemand.
Pour sortir de la crise, les Anglais sont les premiers à réagir en décidant en septembre 1931 une dévaluation de leur monnaie, dévaluation considérée par beaucoup comme une solution de la dernière chance avant l’écroulement de l’économie britannique. La dévaluation prend concrètement la forme d’un « découplage » de la livre sterling et de l’or, ce qui fait perdre à la livre plus de 50 % de sa valeur d’échange sur les marchés. Les Français se réjouissent au départ de ce malheur britannique qui renforce mécaniquement la valeur du franc par rapport à la livre : c’est une revanche des « mauvaises » années de la monnaie hexagonale après la guerre qui avait creusé le déficit des Français et alourdi la dette envers les alliés (surtout les Américains, mais aussi les Anglais). Rapidement, l’économie anglaise reprend des couleurs et d’autres pays qui étaient plus ou moins liés au Commonwealth (pays scandinaves, Australie, Japon…) connaissent eux aussi un regain d’activité et une baisse du chômage. Les Américains suivent le même chemin tracé par les Britanniques et décident à contrecœur une dévaluation historique du dollar qui profite aux États dont l’économie fonctionnait totalement ou partiellement avec la monnaie de l’Oncle Sam. Partout les prix baissent grâce aux mesures de dévaluation, ce qui favorise les investissements et encourage la production des entreprises. Au début de l’année 1934, l’économie mondiale semble montrer quelques signes d’une reprise inespérée.
Mais en France, et dans quelques autres pays (Belgique, Suisse et Italie notamment), les gouvernements refusent d’ordonner une dévaluation de leur monnaie au motif qu’elle serait la preuve d’un échec de la politique libérale menée depuis les Années folles. Cette politique de protection « à tout prix » de la monnaie2 fait malheureusement fuir les investissements et grève sérieusement la balance commerciale en empêchant les exportations. La crise boursière qui avait épargné pendant quelques mois l’économie française concerne tous les secteurs au début de l’année 1932. Les gouvernements sont renversés les uns après les autres, ne pouvant répondre aux multiples faillites d’entreprises et à une forte augmentation du chômage.
La lutte contre le déficit budgétaire est à ce moment l’objectif principal du Cartel des gauches au pouvoir : on pense en effet que le train de vie de l’État, jugé trop important, explique à lui seul les difficultés qui frappent le pays. On diminue ainsi les traitements des fonctionnaires, on limite les programmes de construction et de rénovation, on baisse les pensions de retraite, on va même jusqu’à réduire les allocations des Anciens Combattants. Malheureusement, cette politique d’austérité n’a aucun effet sur l’économie française qui continue sa descente aux enfers.
Quelques conseillers présents dans les bureaux des ministères préconisent alors ce que les économistes appellent un « malthusianisme économique »3, c’est-à-dire une baisse généralisée de l’offre. L’objectif est simple : en réduisant la quantité de produits disponibles sur le marché, on espère recréer un équilibre entre l’offre et la demande, et à terme un retour à la croissance. Cela explique que, durant les années 1930, la France renonce à sa politique de libre-échange pour débuter une phase de protectionnisme agressif (avec notamment une taxe de 15 % de tous les produits importés) dans le but de réduire l’entrée de produits étrangers sur le marché national. La réponse est immédiate puisque la plupart des partenaires commerciaux de la France répliquent par des mesures protectionnistes similaires, ce qui creuse encore davantage la balance commerciale et empêche le redressement économique.
En juin 1935, le gouvernement Laval arrive au pouvoir avec un mandat simple : « défendre le franc » et éviter une dévaluation de la monnaie, au besoin en utilisant des mesures impopulaires d’austérité. L’idée est surtout de faire baisser les prix (déflation) pour ramener les tarifs français au niveau de ceux pratiqués par les Anglais et stopper de cette manière la spirale infernale de la crise. La IIIe République libérale des premières heures se transforme ainsi à partir de 1935 en un système dirigiste et autoritaire : baisse des prix des loyers, du pain, du charbon, de l’électricité ; baisse du train de vie de l’État qui se répercute dans tous les ministères ; réduction immédiate du traitement des fonctionnaires de 10 % ; etc. Mais toutes ces mesures n’y font rien : le gouvernement Laval ne parvient pas à redresser l’économie française et subit maintenant un mécontentement profond de la population qui annonce déjà la victoire prochaine du Front populaire.
Tout cela est bien connu.
2. Mais puisqu’il s’agit dans cet ouvrage de proposer aux lecteurs des récits alternatifs, il peut être intéressant de remonter le fil du temps jusqu’au Great Crash de 1929 et tenter d’écrire une nouvelle histoire en modifiant deux ou trois paramètres a priori sans conséquence dans le grand jeu des évènements. Si bien entendu, il existe un certain plaisir à changer le cours du temps pour déposer ici et là quelques grains de sable dans la machine, l’objectif de ce texte est surtout de montrer, grâce à un exemple « typique », que l’économie a pu jouer dans l’histoire – et joue encore aujourd’hui – un rôle essentiel dans la production et dans l’application du droit constitutionnel.
Avant d’en venir là, retour à 1929, cette fois-ci dans un récit purement fictif, mais dont on espère qu’il collera au plus près des évènements réels.
Nous sommes aux États-Unis, le 4 mars 1929, c’est-à-dire le jour de l’élection du président Herbert Hoover. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche débute son mandat dans une période de croissance économique qui touche tous les secteurs. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont en effet réussi un formidable développement économique, en partie réalisé par une bonne gestion des nouvelles industries (chimie, électricité, automobile). La classe moyenne composée principalement d’ouvriers et de petits exploitants peut espérer tirer profit, elle aussi, de cette croissance en achetant à crédit des réfrigérateurs et des voitures. Les banques de dépôt fleurissent partout sur le territoire américain et proposent aux travailleurs d’emprunter des sommes parfois considérables à moindre coût. Les investisseurs américains et étrangers n’hésitent pas à soutenir les projets même les plus risqués, espérant profiter de la belle conjoncture économique.
Mais quelques conseillers soufflent à l’oreille du président que la croissance pourrait ne pas durer en l’absence de mesures d’accompagnement, notamment dans le domaine bancaire. Herbert Hoover, qui était Secrétaire au commerce avant de devenir président, prend très au sérieux ces menaces et décide de mener une politique préventive visant à empêcher la surchauffe boursière qui s’annonce faute d’une intervention de l’État fédéral. L’une des premières mesures économiques du nouveau président consiste ainsi à créer la Securities and Exchange Commission4 dont la mission est de garantir la stabilité des marchés financiers, de protéger les investisseurs et d’éviter les actions spéculatives. Les interventions répétées de cette commission poussent les banques à réduire leur offre de crédit. Certaines font faillite, mais beaucoup se contentent de simplement durcir les contrôles, ce qui a pour effet d’épurer les marchés financiers dès le début des années 1930.
En Europe, l’Angleterre connaît à ce moment une croissance lente mais relativement stable. Elle peine à se remettre des lourds efforts financiers de la Première Guerre mondiale. La livre sterling est encore surévaluée par rapport au dollar, ce qui plombe l’exportation des produits manufacturés. Pour lutter contre la crise (que les Anglais considèrent comme mondiale), le gouvernement travailliste de Ramsay MacDonald décide d’abandonner la convertibilité de ses devises en or, ce qui empêche les spéculations et provoque immédiatement une dévaluation de la monnaie britannique. Les Allemands, les Américains et les Français répondent rapidement à cette « offensive » britannique et renoncent eux aussi à utiliser l’étalon or. Le libre-échange reprend sur ces bases plus saines sans susciter aucune mesure protectionniste.
En Allemagne, le redémarrage de l’économie américaine annonce une stabilisation de l’économie, encore très dépendante des entreprises anglo-saxonnes depuis 1918. Heinrich Brüning, nouveau chancelier en 1930, encourage les investissements nationaux, ce qui permet de réduire la dépendance du pays à l’égard des puissances économiques étrangères. Il tente également de mettre en place une politique inédite de relance par la demande en soutenant la hausse des salaires et en pilotant de nombreux chantiers publics. Les élections de juillet et de novembre 1932 marquent en Allemagne une percée du parti nazi, qui ne parvient pas toutefois à obtenir la majorité des sièges au Parlement. Le SPD reste majoritaire, et Brüning est reconduit en 1933 pour un nouveau mandat grâce à une reprise économique inespérée.
En France, la dévaluation du franc provoque d’abord la chute du gouvernement André Tardieu face à la colère du milieu des affaires. Mais la France poursuit sa bonne croissance en dépit des craintes des « experts », et renforce même sa présence dans quelques secteurs clés de l’industrie, notamment le secteur automobile qui profite des lourds investissements réalisés quelques années plus tôt par Citroën dans le domaine de la voiture électrique. Le nouveau gouvernement Herriot mène une politique de type keynésienne, s’inspirant des mesures prises aux États-Unis et en Allemagne pour soutenir la demande. Le libéralisme des premières heures de la IIIe République s’assouplit progressivement face aux nécessités d’appuyer les grands chantiers et d’accompagner le secteur bancaire pour éviter la surchauffe financière. Herriot fait voter quelques réformes importantes en faveur des travailleurs, notamment les premières lois sur les conventions en collectives en 1936 ou la semaine de travail à trente-deux heures en 1937. Il obtient ainsi une stabilité politique inédite depuis la fin de la guerre. Les années 1930 confirment ainsi la reprise économique et permettent à la France de tourner définitivement la page de la Grande Guerre avec un remboursement intégral de la dette de guerre aux Américains.
24 février 2025 : le président du Conseil, Emmanuel Macron, lance les festivités des cent cinquante ans de la Constitution de la IIIe République. Au même moment, l’Armée rouge remporte une bataille majeure dans la ville de Kiev et obtient la capitulation sans réserve des troupes ukrainiennes. Craignant une poussée des Russes au-delà des frontières de l’Ouest, Viktor Orban engage une division blindée face aux lignes ennemies sur le territoire ukrainien. Les forces de l’OTAN sont en alerte maximum. La communauté internationale est au seuil de la Seconde Guerre mondiale…
3. Laissons là le monde parallèle de l’uchronie pour revenir à des considérations plus réalistes. Si la crise de 1929 n’avait pas eu lieu, le monde – et en particulier l’Europe – aurait sans doute suivi une trajectoire bien différente, peut-être même le capitalisme des trusts dénoncé par Karl Polanyi n’aurait-il pas entraîné dans sa chute les gouvernements démocratiques en Allemagne, en Espagne, au Portugal et ailleurs. Mais tout ceci reste purement hypothétique, et disons assez peu « scientifique ».
On peut en revanche utiliser cette uchronie pour éclairer un phénomène, qui – lui – paraît suffisamment solide : il se trouve que l’économie a joué – et joue encore – sur le droit constitutionnel une influence considérable, bien plus en tout cas qu’on ne le dit en France lorsque l’on présente la succession des différents régimes dans l’histoire politique de notre pays. Bien souvent en effet, cette histoire politique apparaît aux yeux des spécialistes du droit constitutionnel comme une histoire en quelque sorte fermée sur elle-même : les évènements politiques découlent du droit et produisent des conséquences juridiques, conséquences qui à leur tour impliquent en boucle des réactions politiques, etc. Ainsi la séparation des pouvoirs serait-elle responsable de l’échec de la Constitution de 1793 ; ainsi le régime présidentiel permettrait-il de comprendre les institutions de la IIe République ; ainsi le gouvernement d’assemblée caractériserait-il la IIIe République… Tout cela n’est évidemment pas faux, mais il nous semble que l’histoire constitutionnelle de la France dépend aussi des évènements économiques qui ont secoué notre Nation. Sans la crise de 1929 aux États-Unis, sans doute le Front populaire n’aurait pas été élu, le Conseil national économique n’aurait pas vu le jour, et sans doute même l’élan social qui a inspiré le programme du CNR et après lui le Préambule de 1946 n’aurait pas été aussi fort. Dit autrement et en bref, si la crise 1929 n’avait pas eu lieu, peut-être n’aurions-nous aujourd’hui ni droit de grève ni droit à l’emploi ! C’est par conséquent de belles et grandes pages du droit constitutionnel contemporain qui découlent plus ou moins directement d’un évènement économique certes majeur, mais pourtant étranger au monde juridique.
4. Essayons maintenant d’observer plus précisément, au-delà de l’exemple de 1929, si et dans quelle mesure le domaine économique peut influencer d’une façon ou d’une autre le droit constitutionnel.
Il existe sur le thème des relations entre le droit et l’économie d’innombrables écrits qui alimentent depuis longtemps les colonnes des revues juridiques en France et à l’étranger. Du côté des publicistes, ce sont surtout les spécialistes du droit administratif qui ont mené les recherches les plus abouties depuis les années 1970. À l’inverse, la doctrine constitutionnaliste s’est montrée assez peu intéressée par l’analyse des relations entre les normes constitutionnelles et les événements économiques actuels ou passés. Cette situation peut s’expliquer par deux éléments.
D’abord, les juristes ont tendance, d’une façon générale, à étudier en priorité l’influence du droit sur l’économie, et non l’inverse. Il s’agit par exemple d’évaluer l’impact de telle réforme ou telle jurisprudence sur le monde des affaires. On ne s’attardera pas trop sur ce mouvement tout à fait ordinaire, mais on peut simplement observer que la QPC, par exemple, a pu faire naître une nouvelle forme de contentieux impliquant les entreprises qui n’existait pas avant 2008. L’inverse en revanche est moins naturel : les juristes, et en particulier les constitutionnalistes, laissent volontiers à d’autres disciplines le soin de mesurer l’influence de l’économie sur le droit, par crainte sans doute de mal percevoir toutes les nuances de situations parfois complexes à décrypter.
Ensuite, l’économie au sens large intéresse peu les constitutionnalistes depuis au moins une cinquantaine d’années en raison notamment d’une attitude visant à exclure toute considération extrajuridique de la discipline du droit constitutionnel. Là encore, il n’est pas utile de trop détailler ce point, déjà largement exploré par la doctrine5. On soulignera simplement que si l’économie était bien présente dans les travaux des grands constitutionnalistes de la IIIe République – par exemple Duguit et Hauriou – elle a aujourd’hui quasiment disparu des manuels « modernes » de droit constitutionnel.
Ces précisions étant faites, on peut maintenant tenter de schématiser l’influence de l’économie sur le droit constitutionnel en proposant l’idée suivante : l’économie influence non seulement la production du droit constitutionnel par le constituant, mais aussi l’application de ce droit constitutionnel par les autorités constituées. Voyons ces deux idées successivement avec quelques exemples dans les deux cas.
I. Influence de l’économie sur la production du droit constitutionnel
5. Il est arrivé au cours de l’histoire que la production du droit constitutionnel soit plus ou moins guidée par des évènements économiques, par exemple une crise financière, une situation durable de chômage, de mauvaises récoltes, une fronde sociale ou encore une situation particulière sur un marché (notamment un monopole).
Dans un autre ouvrage6, nous avons tenté de faire cette « histoire » du droit constitutionnel de l’économie afin de mesurer l’empreinte de l’économie dans les différents textes constitutionnels adoptés depuis 1789. Il n’est pas utile de refaire ici cette histoire. Nous pouvons en effet, pour les besoins de la démonstration, nous contenter d’évoquer seulement quelques illustrations qui serviront surtout à appuyer le propos, sans trop nous écarter de la feuille de route qui reste celle de l’uchronie.
6. Trois exemples nous paraissent significatifs : la loi constitutionnelle du 10 août 1926, l’adoption du 9e alinéa du Préambule de 1946, et l’écriture de l’article 13 de la Constitution de 1848.
1° – Commençons par l’évènement le moins connu, c’est-à-dire la réforme constitutionnelle du 10 août 1926. Pour comprendre cette loi constitutionnelle, il faut d’abord noter que la fin de la Première Guerre mondiale marque, pour la France, un désastre non seulement humain mais aussi économique7. Toutes les grandes industries du Nord-est sont à l’arrêt et les finances de l’État sont au plus bas après quatre années de lourds investissements pour soutenir l’effort de guerre.
La France doit également rembourser une dette de guerre colossale auprès des alliés, mais malheureusement l’Allemagne, de son côté, se montre assez peu réceptive aux demandes du gouvernement français.
Pour répondre à ce déficit financier de l’État, les dirigeants avaient à l’époque deux possibilités : augmenter les impôts ou faire tourner la planche à billets. La première solution n’a jamais été pratiquée sous la IIIe République, car elle risquait de fâcher l’électorat libéral et bourgeois sur lequel s’appuyait le régime depuis 1875. Restait donc la solution d’augmenter le nombre de billets en circulation, ce qui risquait de provoquer une forte inflation et d’empêcher la reprise économique tant espérée.
Pour éviter cette situation, le gouvernement Poincaré décide d’appliquer une recette originale visant à émettre des « bons de la Défense nationale », c’est-à-dire des titres au porteur émis par l’État avec l’objectif de collecter un maximum d’argent auprès des investisseurs sans accroître le nombre des billets en circulation.
Mais pour que le système des bons fonctionnât parfaitement, il fallait encore respecter deux impératifs. Premièrement, il était indispensable que les investisseurs conservent leurs valeurs suffisamment longtemps sans exiger de l’État un remboursement de leur titre, car toute situation contraire aurait entraîné une forte progression des liquidités, et à terme une situation d’inflation. Cela explique que les bons au trésor émis à cette époque étaient tous accompagnés d’une obligation de conservation à moyen terme, avec un taux de rentabilité augmentant proportionnellement à la durée de détention des titres. Deuxièmement, pour attirer les investisseurs étrangers, il était capital de garantir la stabilité du système des bons de la Défense nationale. D’où la création d’une « caisse » composée pour partie de représentants du monde des affaires (notaires, petits porteurs,…) et dont la mission était d’assurer la gestion comptable des bons. L’autonomie de cette caisse à l’égard du Parlement était assurée, en pratique, par une ligne budgétaire « fixe » alimentée par les taxes sur le tabac et la loterie. De cette façon, la nouvelle institution était à l’abri des batailles partisanes et des aléas de la vie parlementaire de l’époque – assez mouvementée au demeurant.
La loi créant la « Caisse de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique » est ainsi votée le 7 août 1926, sans grande discussion. Mais trois jours après, le 10 août, les parlementaires se réunissent à nouveau, cette fois-ci en « Assemblée nationale », pour débattre d’un projet de loi « destiné à traduire dans une loi constitutionnelle les éléments essentiels de la loi du 7 août »8. Les échanges s’animent rapidement : Blum dénonce un projet de réforme constitutionnelle qui n’a pas d’autre objet que de « frapper les imaginations » et « qui ressemble un peu à ces pilules qu’on administre à des malades nerveux et qui ne peuvent pas faire de mal parce qu’elles ne contiennent rien du tout »9 ; Doriot s’étonne du recours à la procédure constitutionnelle, constate que « c’est la première fois depuis quarante-deux ans qu’un tel fait se produit »10 et propose un amendement visant à… supprimer le Sénat ; mais Poincaré répond longuement à ces différentes accusations en soulignant que « la confiance est la première condition de retour au calme, mais qu’elle ne peut réussir que si elle est elle-même à l’abri de toute surprise ultérieure »11 (le président du Conseil craint l’arrivée prochaine d’un gouvernement socialiste, crainte qui se vérifiera en 1936). Le projet du gouvernement est finalement adopté à une large majorité le jour même et devient la troisième (et dernière) révision constitutionnelle de la IIIe République12.
On voit bien avec cet exemple qu’une donnée purement économique, en l’occurrence les difficultés financières de la France après la Première Guerre mondiale, explique en grande partie l’adoption d’une révision constitutionnelle majeure sous la IIIe République. Sans cette « lecture » économique des évènements en 1926, il est pour ainsi dire impossible de comprendre la réforme et d’en saisir la portée dans le système parlementaire de l’époque.
2° – La doctrine juridique a déjà beaucoup écrit sur la rédaction du 9e alinéa du Préambule de 194613. La seule question que l’on doit se poser ici est celle de savoir dans quelle mesure cette disposition bien connue résulte en totalité ou en partie d’évènements économiques antérieurs à la Constitution de IVe République.
On pourrait en douter, car, après tout, l’obligation de nationaliser les entreprises qui présentent le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait s’inscrit sans doute dans une doctrine « politique », une certaine vision de la société que partageaient de nombreux parlementaires en 1946, c’est-à-dire pour l’essentiel une doctrine « sociale » de l’État revendiquant un interventionnisme de la puissance publique. Ceci n’est pas contestable. Mais au-delà des doctrines, le 9e alinéa est aussi, comme on va le voir, le résultat d’une série d’évènements bien concrets qui ont poussé les constituants de 1946 à introduire cette obligation de nationalisation dans la nouvelle Constitution.
Pour comprendre ce point, il faut remonter à nouveau aux années 1920. Après la Grande Guerre, beaucoup de Français estiment qu’un « retour à la normale » suffira à reconstruire le pays ravagé par quatre années de conflit. C’est une croyance assez habituelle du vainqueur que de souhaiter une reconstruction « à l’identique », sans rien changer du cadre existant avant le conflit. Cela explique que les efforts des gouvernements successifs après 1918 pour relancer la machine économique française se sont portés pour l’essentiel vers une politique visant à rétablir le capitalisme d’avant-guerre marqué par une absence de toute mesure d’encadrement des marchés par la puissance publique. C’est la grande époque des trusts et des cartels qui se développent partout en France et à l’étranger dans une économie où le credo du laissez-faire devient progressivement une sorte de « religion » de l’abstention14. Seules la CGT et quelques autres organisations syndicales réclamaient une refondation de l’économie française autour des « plans » économiques visant à encadrer les dérives du système libéral. Mais la bonne croissance de la France à partir de 1922 empêche les voix discordantes de se faire entendre dans une société où le libéralisme est considéré comme le seul remède aux malheurs du pays. Pour ne point cependant complètement ignorer les revendications sociales qui agitent le monde ouvrier, les gouvernements lancent ponctuellement quelques réformes qui répondent aux exigences des syndicats, notamment la création en 1925 du premier « Conseil économique », dont on refuse toutefois le caractère « parlementaire »…
Lorsque la crise de 1929 arrive en France – avec beaucoup de retard comme on l’a vu – l’économie nationale se structure autour de quelques groupes industriels qui forment ensemble une puissance économique majeure dans la société de l’époque. Pour répondre à la crise, les gouvernements mènent alors une politique de dirigisme économique qui empêche une concurrence naturelle sur les marchés (seules les grandes sociétés peuvent survivre aux baisses de tarifs imposées par l’État). À la fin des années 1930, « la combinaison d’un interventionnisme de l’État élargi et d’une reprise de la cartellisation aboutit à une quasi-suppression de la compétition »15. La France entre donc dans le second conflit mondial avec une économie paradoxalement tournée vers la production massive d’armement et – pourtant – encore très dépendante des puissants trusts qui dominent tous les secteurs clés de l’économie nationale.
Pendant la guerre, certaines de ces grandes entreprises vont collaborer de façon plus ou moins zélée avec le gouvernement de Vichy et les Allemands, notamment dans le secteur automobile (entre 1940 à 1944, 85 % de la production de l’industrie automobile française est destinée aux Allemands16). Conscient de cette connivence entre le milieu des affaires et le régime nazi, les résistants qui composent le Conseil National de la Résistance réclament, dans leur programme rédigé en 194417, « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie » et « le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ». Dans ce même programme, le CNR souhaite également affranchir l’économie « de la dictature professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ».
À la libération, les trois grands partis du moment – PC, SFIO et MRP – affirment leur fidélité au programme du CNR et reprennent logiquement certaines propositions faites par les résistants, notamment – mais pas seulement – l’idée d’une nationalisation des grandes entreprises coupables, comme on disait à l’époque, de « collaboration économique »18. La sanction de cette collaboration passait donc par la destruction de ces « féodalités économiques et financières » accusées d’avoir épaulé le régime de Vichy dans le pillage de l’économie française entre 1940 et 1945. Cette « collusion de la haute administration et du grand patronat à la tête des rouages de l’économie dirigée »19 devait ainsi disparaître à la Libération, et la nationalisation serait le meilleur moyen de parvenir à cette fin. Sans doute ne faut-il pas complètement exclure toute dimension politique du 9e alinéa : les nationalisations s’inscrivent dans un programme de société, une vision d’un monde où le pouvoir politique affirme « sa force dans l’économie »20 ; mais on voit bien là encore, avec cet exemple, qu’une donnée purement économique – la formation de cartels sous la IIIe République – explique la volonté des constituants de 1946 d’instaurer une obligation pour l’État de nationaliser les entreprises dans certaines situations jugées « problématiques ».
3° – On peut prendre un troisième exemple tiré de la Constitution du 4 novembre 1848 qui illustre bien l’influence de l’économie sur la production du droit constitutionnel.
La dernière partie de l’article 13 de la Constitution de 184821 envisage le développement de l’emploi par « l’établissement, par l’État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ». C’est la première fois qu’un texte constitutionnel reconnaît la possibilité pour les pouvoirs publics d’intervenir afin de fournir un emploi aux citoyens dans l’hypothèse où ils ne parviendraient pas à trouver par eux-mêmes une activité rémunérée. Jusqu’à ce moment, les différentes constitutions rappelaient simplement la liberté des hommes en la matière, celle offerte à chacun d’occuper « toutes dignités, places et emplois publics » comme le dit l’article 6 de la Déclaration de 1789 ; mais avec la Constitution de 1848, le travail public n’est plus seulement une « liberté », il devient aussi un moyen d’obtenir un emploi.
Pour autant, il ne s’agit pas à ce moment de consacrer dans le droit constitutionnel français un authentique droit à l’emploi – ce qui arrivera en 1946 –, mais simplement de reconnaître la possibilité pour l’État d’intervenir afin de porter assistance à celles et ceux – nombreux en 1848 – qui en feraient la demande. Comment expliquer cette formule de l’article 13 qui semble hésiter entre la liberté et le droit au travail ? C’est en réalité un évènement économique qui permet de comprendre, là encore, la rédaction retenue en 1848.
Après la révolution de février 1848, le gouvernement provisoire décide l’instauration des « ateliers nationaux » à l’initiative de Louis Blanc, avec l’espoir que ces ateliers offriront un emploi aux nombreux chômeurs de la Capitale. Le peuple parisien répond massivement à cette invitation et se presse devant les mairies d’arrondissement chargées d’accueillir les volontaires. Le succès est tel que les chantiers publics en cours ne suffisent plus à employer tous les nouveaux arrivants, ce qui provoque beaucoup de frustrations parmi les candidats, d’autant plus que les maigres activités proposées sont rarement en adéquation avec les compétences des travailleurs. Le mécontentement de la population s’amplifie et bientôt Paris est à nouveau sous les barricades. Mais l’armée réprime durement le mouvement ouvrier, avec plus de 5 000 manifestants tués. Après seulement quelques semaines de fonctionnement, la nouvelle majorité conservatrice au pouvoir décide donc, sans surprise, la fermeture des ateliers nationaux. Or lorsqu’il faut écrire la constitution à l’automne 1848, si tous les parlementaires acceptent l’idée de consacrer au niveau constitutionnel la fraternité économique dans le domaine du travail, beaucoup hésitent cependant à accorder aux citoyens un authentique « droit à l’emploi » par crainte d’une résurgence des Journées de juin. D’où la formulation volontairement ambiguë présente à l’article 13 de la Constitution de 1848.
II. Influence de l’économie sur l’application du droit constitutionnel
7. Élargissons la démonstration aux situations dans lesquelles une donnée économique influence non pas seulement la production des énoncés constitutionnels, mais aussi l’application de ces mêmes énoncés. On peut évoquer sur ce point à la fois l’action des autorités politiques et celle de la jurisprudence.
8. Personne ne conteste le fait que des évènements économiques peuvent influencer plus ou moins fortement le comportement des autorités politiques. C’est même une réaction assez naturelle pour le pouvoir politique que de répondre aux différentes crises économiques qui se présentent à lui, par exemple pour lutter contre l’inflation ou améliorer la compétitivité des entreprises. La question est en réalité ici plus précise, puisqu’il s’agit seulement de savoir si et dans quelle mesure une donnée économique peut influencer les choix des autorités politiques lorsqu’il faut mettre en œuvre une disposition constitutionnelle – et uniquement cela.
On peut prendre sur ce point un exemple tiré de la pratique gaullienne de la présidence à la fin des années 1960. À ce moment, de Gaulle souhaite appliquer ce qu’il appelle une « troisième voie », c’est-à-dire un plan d’action visant à réconcilier le capital et le travail, avec notamment l’instauration d’une meilleure participation des travailleurs au fonctionnement et aux résultats des entreprises. Mais cette troisième voie subit des critiques nourries à la fois du côté des travailleurs et des patrons, chacun jugeant la réforme trop ou pas assez ambitieuse, ce qui empêche la mise en œuvre du programme souhaité par le Général. Jusqu’à cet épisode, de Gaulle n’avait jamais utilisé les ordonnances de l’article 38 de la Constitution, considérant sans doute qu’un tel procédé de législation devait rester exceptionnel. Mais devant la fronde des partenaires sociaux et l’impossibilité pour lui de trouver une issue acceptable, il se résout finalement à adopter en 196722 une série d’ordonnances qui marqueront le point de départ d’une « pratique » jamais interrompue depuis cette date. On voit bien ici qu’un simple évènement économique a joué un rôle essentiel dans l’application des textes constitutionnels, au demeurant dans un sens qui n’était pas prévu à l’origine en 195823.
9. Du côté de la jurisprudence, les exemples semblent à la fois plus nombreux et plus incertains. Plus nombreux, car tout le monde ou presque perçoit bien l’influence des évènements économiques sur la jurisprudence, en particulier celle du juge constitutionnel. Lorsque par exemple le Conseil valide les restrictions d’accès aux grands magasins ou qu’il accepte l’instauration d’un passe sanitaire pendant la crise du Covid-19, c’est en raison tout à la fois de considérations économiques et de motifs sanitaires, et non pas seulement en application des normes juridiques en présence. Mais les exemples sont également plus incertains, car contrairement aux acteurs politiques – parlementaires, ministres, président… – les juges dévoilent rarement les motifs déterminants de leurs décisions, si ce n’est pour exposer le raisonnement purement juridique qui commande l’application des normes au cas d’espèce. Or personne n’ignore que, derrière ce raisonnement juridique, se trouve souvent tout un univers de « conséquences » qui poussent le juge à agir dans tel sens ou dans tel autre. Mais comment connaître et mesurer ces « conséquences », notamment dans le domaine économique ? C’est en réalité presque impossible.
Dans le cas précis du contentieux constitutionnel, il existe heureusement une source inépuisable d’information : la loi organique du 15 juillet 2008 donne en effet accès aux archives du Conseil constitutionnel, et donc aux délibérations, après une (longue) période de vingt-cinq ans, permettant alors de découvrir – parfois – les différents évènements économiques qui ont conduit les membres à agir comme ils l’ont fait.
On se contentera ici d’évoquer deux exemples, assez connus au demeurant.
1° – Le premier concerne la « grande » décision Négociation collective du 6 novembre 199624. Le Conseil était saisi dans cette affaire d’une disposition législative permettant aux partenaires sociaux de fixer le seuil d’effectifs en deçà duquel les formules dérogatoires de négociation nouvellement instituées (sans délégués syndicaux) étaient applicables. En langage clair, la nouvelle loi avait offert aux syndicats un véritable pouvoir législatif puisqu’en principe la détermination des conditions de mise en œuvre de la participation des travailleurs relève de la compétence du Parlement sur le double fondement de l’article 34 de la Constitution et du 8e alinéa du Préambule de 1946. À la surprise générale, le Conseil valide en l’espèce ce pouvoir normatif accordé aux partenaires sociaux en estimant que le législateur « pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer aux accords de branche la détermination de ces seuils ». La doctrine considère encore aujourd’hui que cette décision Négociation collective a permis le développement d’une démocratie sociale au niveau constitutionnel, en faisant des conventions collectives d’authentiques « lois négociées ». Mais jusqu’à l’ouverture des délibérations, personne ne pouvait expliquer cette solution pour le moins audacieuse. Or ce qui surprend immédiatement en découvrant le rapport rédigé par Jean Cabannes, c’est l’application avec laquelle le conseiller décrit le contexte dans lequel s’insère la nouvelle loi, en particulier, souligne-t-il, « la diminution du nombre d’établissements disposant d’une présence syndicale (ils correspondent au pourcentage d’établissements ayant au moins un délégué́ syndical) : si la présence syndicale reste importante dans les entreprises de grande taille – plus de 1 000 salariés : 92,5 %, de 500 à 999 : 88 %, elle est en forte baisse pour les établissements de moins de 500 salariés ; elle est ainsi égale à 74,9 % pour les établissements comptant de 200 à 499 salariés, à 54,3 % pour ceux ayant entre 100 à 199 salariés et à 34,9 % pour ceux comptant entre 50 à 99 salariés »25. On comprend bien en lisant ceci que, pour le rapporteur, la faible représentation syndicale dans les entreprises françaises justifie à elle seule, sans autre argument juridique, de valider le dispositif présenté comme un moyen d’améliorer le dialogue social. Tout le reste du rapport semble construit autour de cette conviction initiale. Il y a donc bien dans cette affaire, sans doute plus qu’ailleurs, une donnée économique « forte » qui pousse le juge à statuer comme il l’a fait, et notamment à faire une interprétation très extensive de l’article 34 de la Constitution (en faveur des partenaires sociaux).
2° – Le second exemple nous amène vers une autre crise : celle des années 1970 causée par les deux chocs pétroliers. En 1981, lorsque la nouvelle majorité socialiste arrive au pouvoir, l’inflation ronge le pouvoir d’achat des Français et le chômage atteint des niveaux inédits en France (9 % en 1983). Le président Mitterrand mène au départ une politique de relance, qui malheureusement ne produit aucun résultat concret dans le quotidien des Français. Il modifie donc radicalement sa stratégie en 1983 en confiant au duo « libéral » Mauroy/Delors le soin de piloter un plan de rigueur ambitieux (le « tournant de la rigueur »). Le nouveau gouvernement adopte ainsi, notamment26, deux ordonnances pour lutter contre le chômage, celle du 26 mars 1982 abaissant l’âge de la retraite à soixante ans et celle du 30 mars 1982 limitant les possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activités. Il s’agit dans les deux cas de réduire l’offre d’emploi des actifs afin d’ouvrir au maximum les possibilités d’embauche des chômeurs. Les deux ordonnances sont ratifiées au printemps 1983, mais l’opposition saisit le Conseil pour lui demander de censurer ces mesures législatives qui méconnaissent les principes de l’économie libérale, notamment la liberté du travail. Se posait au Conseil, dans cette affaire, une question inédite qui était celle de savoir si la Constitution autorise ou non le législateur à limiter la liberté du travail dans le but – assez paradoxal à première vue – de résorber le chômage. Pierre Joxe, qui est chargé de rédiger le rapport, propose aux autres membres du Conseil d’utiliser de façon inédite le 5e alinéa du Préambule de 1946 au motif que cette disposition consacre un « droit pour chacun d’obtenir un emploi ». Le rapporteur suggère ainsi de retenir la formule selon laquelle « Il appartient au législateur de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en tenant compte des nécessités économiques et sociales ». Mais le doyen Vedel lui répond que cette formule permettrait trop facilement au législateur de contourner la liberté du travail, et propose ainsi aux autres membres de circonscrire le champ d’action du Parlement au seul cas où le droit à l’emploi profite « au plus grand nombre possible d’intéressés » – formule finalement retenue. Ce qui apparaît très clairement dans cette décision du 28 mai 198327, c’est que, ici aussi, le contexte économique semble peser de tout son poids dans le choix des membres de valider le dispositif de lutte contre le chômage imaginé par le gouvernement. On peut même supposer que l’utilisation du 5e alinéa par le Conseil aurait été sans doute bien différente si le chômage n’avait pas été si fort en 1983, et si les deux chocs pétroliers de la décennie précédente n’avaient pas mené l’économie mondiale vers une crise profonde et durable.
Voilà en tout cas de belles perspectives de recherche… pour de prochaines uchronies !
1 « Jusqu’aux premiers mois de 1931, beaucoup de Français purent croire que la crise épargnerait leur pays », F. Braudel et E. Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, t. 4, 1880-1950, PUF, 1993, p. 655.
2 « La croyance en l’étalon-or était la foi de l’époque » note K. Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1944, Gallimard, 1983, p. 64.
3 J.-C. Asselain, Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, T. 2, Depuis 1918, Seuil, 1984, p. 39.
4 Dans l’histoire « réelle », la SEC est créée en 1934, justement pour éviter un nouveau krach boursier. C’est l’une des premières commissions de surveillance des marchés financiers dans le monde. Sur la politique (très critiquée) de Hoover pendant la crise, Voir not. P. Dockès, Le Capitalisme et ses rythmes, t. I, Classiques Garnier, 2019, p. 582 et s.
5 Voir not. A. Viala, « Le positivisme juridique : Kelsen et l’héritage kantien », RIEJ, 2011, vol. 67, n° 2, p. 95.
6 P.-Y. Gahdoun, Droit constitutionnel de l’économie, LexisNexis, 2023.
7 Voir F. Escamps, L. Quennouëlle-Corre (dir.), La mobilisation financière pendant la Grande Guerre : Le front financier, un troisième front, Comité pour l’Histoire économique et financière, 2015.
8 H. Chéron, rapporteur du projet, Séance du 10 août 1926, AN, Débats parlementaires, p. 7.
9 Séance du 10 août 1926, AN, Débats parlementaires, p. 8.
10 Séance du 10 août 1926, AN, Débats parlementaires, p. 13.
11 Séance du 10 août 1926, AN, Débats parlementaires, p. 13.
12 Sur cette révision, v. A. Boyeau-Jenecourt, « La révision constitutionnelle du 10 août 1926 relative à la caisse d’amortissement de la dette publique », RDP, 2010, p. 135.
13 V. not. G. J. Guglielmi, « Débattre d’un… et écrire le… Préambule », in Le préambule de la Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques, PUF, 1996, p. 51.
14 F. Bilger, La pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine, LGDJ, 1964, p. 106.
15 F. Kuisel, Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, 1981, Galimard, 1984, p. 173.
16 T. C. Imlay, « Résistance ou collaboration de l’industrie automobile française pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Ford SAF », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 125, n° 1, 2015, p. 45.
17 Sur ce programme, Voir not. C. Andrieu, Le Programme commun de la Résistance. Des idées dans la guerre, Seuil, 1984 (réédition numérique) ; O. Beaud, « Nationalisations et souveraineté de l’État », Histoire@Politique, 2014, n° 24, p. 72.
18 A. Giovoni, AN, séance du 27 août 1946, JO 28 août 1946, p. 3328 ; M. Hamon, AN, séance du 29 août 1946, JO 30 août 1946, p. 3394.
19 « Car, ce qu’il s’agit de nationaliser, ce sont les affaires des trusts tentaculaires qui écrasent ouvriers, consommateurs, petits producteurs, et de plus trahissent la nation. Non seulement ce sont des états dans l’État, mais des agences de l’étranger au sein même de la patrie, comme l’ont prouvé les actes de collaboration économique, malheureusement si souvent impunis », intervention de Arthur Giovoni, op. cit. Voir plus généralement le chapitre consacré à la collaboration économique dans F. Broche, J.‑F. Muracciole, Histoire de la Collaboration. 1940-1945, Tallandier, « Hors collection », 2017, p. 199 et s.
20 G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 2e éd. 1951, p. 326.
21 Sur cette disposition, Voir not. M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, t. 2, De la chute de l’Empire à l’avènement de la troisième République, 1932, Librairie E. Duchemin, 1977, p. 367.
22 C’est not. l’ordonnance du 17 août 1967 relative à « la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises ».
23 Sur cet évènement, voir not. E. Kocher-Marboeuf, Les grèves de 1967 et l’adoption des ordonnances économiques et sociales, in A. Beltran et G. Le Béguec (dir.), Action et pensée sociales chez Georges Pompidou, PUF, 2004, p. 111.
24 Cons. const., 6 nov. 1996, n° 96-383 DC, R. p. 128.
25 Séance du 6 novembre 1996, p. 4.
26 Sur les mesures adoptées pour lutter contre le chômage au début des années 1980, V. J.-F. Colin, M. Elbaum et A. Fonteneau, « Chômage et politique de l’emploi 1981-1983 », Observations et diagnostics économiques. Revue de l’OFCE, n° 7, 1984. p. 95.
27 Cons. const., 28 mai 1983, n° 83-156 DC, R. p. 41.
Pierre-Yves Gahdoun, « Si la crise de 1929 n’avait pas eu lieu… », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4610.