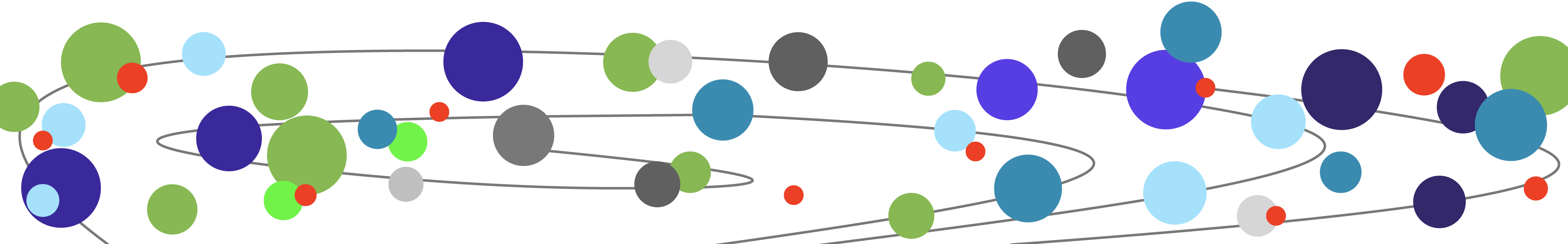Xavier Magnon
Professeur, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF,
Aix-en-Provence, France
Et si le Doyen Favoreu n’avait pas écrit en 1967 à la Revue française de droit public un article intitulé « Le Conseil constitutionnel régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », qui pourrait être considéré, symboliquement au moins, car le contenu de l’article est plus nuancé, comme fondateur d’une certaine approche du Conseil constitutionnel en tant qu’expression d’une justice constitutionnelle en France, mais un tout autre article, « Le Conseil constitutionnel, 3e chambre du Parlement, ultime raffinement du parlementarisme rationalisé ». Telle est l’hypothèse éprouvée par cette uchronie : que serait aujourd’hui la science du droit constitutionnel française sur l’objet « Conseil constitutionnel » si celui-ci n’avait pas été perçu par Louis Favoreu comme participant du constitutionnalisme moderne mais comme l’expression d’un autre modèle, celui du parlementarisme rationalisé ? Pour mieux éprouver cette hypothèse, la contribution proposée est un commentaire dans un ouvrage récent (Les grands discours de la culture juridique, de 2017) sous l’article de Louis Favoreu de 1967, en parti réécrit, dans les extraits qui sont reproduits au-dessus de ce commentaire.
And what if Dean Favoreu had not published, in 1967 in the Revue française de droit public, his seminal article entitled ‘Le Conseil constitutionnel, régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics’—an article that could be seen, at least symbolically, as foundational of a particular approach to the Constitutional Council as an expression of constitutional justice in France—but instead had written a wholly different piece: ‘The Constitutional Council, a Third Chamber of Parliament, the Ultimate Refinement of Rationalised Parliamentarianism’? Such is the counterfactual hypothesis explored in this legal uchronia : what would the current state of French constitutional legal scholarship be with regard to the object ‘Constitutional Council’, had Louis Favoreu not perceived it as a participant in modern constitutionalism, but rather as the embodiment of an alternative model – that of rationalised parliamentarianism ? To more thoroughly test this hypothesis, the proposed contribution takes the form of a commentary, inserted within a recent collective work (Les grands discours de la culture juridique, 2017), placed under Louis Favoreu’s 1967 article – partially rewritten in the excerpts reproduced above the commentary.
(Seront seulement reproduits ici, en raison des contraintes éditoriales, l’introduction, le plan et la conclusion de l’article du Doyen Louis Favoreu, les numéros de notes de la conclusion ne correspondent donc pas aux numéros de note originaux mais suivent ceux de l’introduction)
Nul ne pouvait prévoir, en 1958, la création du Conseil constitutionnel. Premier organe chargé en France du contrôle de la constitutionnalité des lois, règlements des assemblées et engagements internationaux, le Conseil constitutionnel est apparu, par surprise en quelque sorte, dans un pays où l’institution d’un tel contrôle était souhaitée, par certains, depuis plus d’un demi-siècle.
Il est inutile de se tourner vers l’histoire constitutionnelle française du moins pour y trouver un modèle ou une source d’inspiration directe.
À partir de la fin du xixe siècle, l’influence de l’exemple américain est prédominante : la doctrine de droit public1 prône, en vain, l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité par les tribunaux ordinaires, sur le modèle américain, méconnaissant la différence fondamentale opposant le juge anglo-saxon qui participe à la formation du droit sur le même plan que le législateur, et le juge français et européen, simple interprète du droit édicté par le Parlement. Les partis politiques conservateurs inscrivent régulièrement dans leurs programmes et aussi, périodiquement, dans des propositions de lois, la création d’une « Cour suprême » qu’ils croient directement inspirée de l’exemple américain, alors qu’ils visent tous à confier à un organisme spécial le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’action directe et qu’il s’agit donc en fait d’une Cour constitutionnelle2. À la Libération, tandis que parti radical et parti communiste sont hostiles à toute forme de contrôle et que la SFIO, le MRP et l’UDSR se prononcent pour un contrôle populaire par voie de référendum, les partis de droite formulent à nouveau leurs propositions mais sans succès3. Fruit d’un compromis entre toutes les tendances, le Comité constitutionnel de 1946, est principalement sinon exclusivement, « un organe… de conciliation entre les deux chambres »4 ; on ne saurait donc y voir l’origine du Conseil constitutionnel. Pour rechercher cette origine, on remonte alors aux Sénats de l’An VIII et du Second Empire et à la jurie constitutionnaire de Sieyès5. On observera que ce rapprochement se fonde exclusivement sur le caractère préventif du contrôle et sur certaines modalités de saisine : on oublie d’une part que Sieyès avait prévu un contrôle a posteriori s’exerçant au profit des individus, et que les systèmes de l’An VIII et de 1852 sont une version déformée de son projet6, et d’autre part, que les organes de contrôle étaient des assemblées d’une centaine de membres ayant par ailleurs d’importantes attributions politiques.
Peut-on alors rattacher la création du Conseil constitutionnel à un mouvement qui s’est développé en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, en faveur de l’institution de « cours constitutionnelles » ? On notera en effet que ce phénomène, propre à l’Europe continentale et qui s’était déjà manifesté après la Première Guerre, par l’apparition de cours et de tribunaux constitutionnels en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Espagne, s’est traduit depuis 1945, non seulement par le rétablissement de la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, mais aussi par l’apparition d’abord d’un Tribunal constitutionnel fédéral en Allemagne fédérale et d’une Cour constitutionnelle en Italie et récemment de Cours constitutionnelles en Turquie, à Chypre et – fait marquant puisqu’il concerne un pays communiste – en Yougoslavie7.
En fait, en tant qu’institution spéciale, que 3e chambre parlementaire spécifique, le Conseil constitutionnel s’éloigne de ces cours constitutionnelles que de la Cour suprême des États-Unis, d’autant plus que sa création ne répond pas aux mêmes objectifs.
L’existence de ces cours est, en effet, motivée tout d’abord par la structure fédérale ou quasi fédérale des États qui les ont prévues : ainsi en est-il pour les Cours allemande, autrichienne, chypriote, yougoslave et italienne8. L’institution de ces tribunaux spéciaux s’explique ensuite par le souci d’organiser une protection des droits de l’homme à la suite de périodes de troubles plus ou moins graves et même plus largement, pour certains, de garantir le maintien d’un régime démocratique. Ainsi est généralement justifiée l’apparition ou la réapparition après la guerre de cours constitutionnelles en Allemagne, Autriche et Italie9. L’expérience française de 1958, ne peut donc se rattacher à ce courant. Force est alors d’explorer les origines immédiates de la Constitution du 4 octobre. Mais la tâche est rendue délicate sinon impossible par l’absence de travaux préparatoires. La discussion devant le Comité consultatif constitutionnel n’apporte pas d’indication décisive, car le système actuel de contrôle par le Conseil constitutionnel, était déjà décrit de manière très détaillée dans l’avant-projet de Constitution rédigé par le Gouvernement. Il faut donc rechercher les sources d’inspiration des rédacteurs, c’est-à-dire pratiquement de M. Debré, car, défendant personnellement le futur titre VII devant le Comité consultatif, le garde des Sceaux est apparu comme l’auteur de ce texte. Cependant, quoi qu’on ait pu en dire10, on ne trouve pas la « préfiguration » d’une telle institution dans les écrits antérieurs de M. Debré. En 1943, il préconise certes, un « tribunal spécial » dont la composition fasse une large place aux exigences de la politique : d’un côté des magistrats, de l’autre des parlementaires, et le garde des Sceaux président ; mais c’est uniquement parce que « certaines libertés fondamentales dont le respect est indispensable : liberté individuelle, liberté d’opinion, de presse et d’enseignement… doivent être garanties par un contrôle supérieur »11. De même, si le Comité général d’Études de la résistance dont fait partie M. Debré, prévoit dans son projet de Constitution, un tribunal spécial de même type12, il est prévu que « tout citoyen peut demander l’annulation des lois qu’il estime incompatibles avec les libertés fondamentales de la démocratie ». En fait, dans tous les projets présentés par les mouvements de résistance, le contrôle de constitutionnalité a pour but la défense des libertés individuelles13. Toutefois, on trouve dans une étude de M. Lazare Kopelmanas14 un certain nombre de traits caractéristiques de l’actuel système : Cour composée de neuf membres, choisis par accord entre le législatif et l’exécutif exerçant un contrôle préventif sur toutes les lois avant leur promulgation, ceci pour éviter l’« incertitude » qu’un contrôle a posteriori « introduit dans l’ordonnancement juridique » ; et par la promulgation qui n’interviendrait que sur « avis motivé » de la Cour, l’exécutif « endosser(ait)… la responsabilité politique des décisions juridiques de la Cour »15. On ne sait si les auteurs du titre VII de l’avant-projet du 29 juillet 1958 se sont inspirés de cette étude. En toute hypothèse, manquait à l’époque ce qui constitue la motivation essentielle de la création du Conseil constitutionnel, à savoir la nouvelle conception des pouvoirs du Parlement, la rationalisation de l’activité parlementaire et plus particulièrement, la nouvelle distribution des compétences entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire. L’existence du Conseil constitutionnel est liée à cela, ce qui explique que l’on ne puisse trouver de précédent16. Cette rationalisation de l’activité parlementaire a commandé l’institution d’un organe de contrôle, et à partir de là, il semble que le système ait été façonné peu à peu de manière très empirique, ainsi que le confirme M. Prélot : « l’empirisme, dominant la rédaction de la Constitution de 1958 apparaît ici en pleine lumière »17. On aboutit ainsi à une institution « innomée », à un système apparemment assez incohérent18, conçu, semble-t-il, à des fins politiques pour tenir le Parlement en tutelle.
Pourtant, en dépit de cela et de l’utilisation qui a été faite de l’institution, il paraît se dégager des textes une logique interne. La clé de lecture de l’institution se doit précisément d’être recherchée dans la volonté des constituants que de rationaliser le système parlementaire de manière totalement inédite, en instituant une 3e chambre à la fois politique et indépendante du politique, disposant de missions lui permettant à la fois d’améliorer la production normative du Parlement et d’équilibrer juridiquement l’activité des pouvoirs publics. Cette 3e chambre déploie son influence au-delà du Parlement lui-même et de la production de la loi pour embrasser l’action de tous les pouvoirs publics.
Ainsi se révèle à notre avis une mission originale, qui va au-delà de la notion classique de contrôle de constitutionnalité ; et en considération des particularités de cette mission s’expliquent les caractéristiques de cet instrument nouveau que constitue le Conseil dans la rationalisation du régime parlementaire. Cette originalité se révèle dans la nature politique originale de l’institution ainsi que dans des compétences garantissant la rationalisation du régime parlementaire.
§ I – De la nature politique originale de l’institution
A – Le constat : la nature politique
B – Une nuance : les garanties d’un fonctionnement indépendant du politique
§ II – Des compétences garantissant la rationalisation du régime parlementaire
A – Un organe original d’amélioration de la qualité de la production législative
B – Un organe régulateur et stabilisateur des pouvoirs publics
Conclusion
Le Conseil constitutionnel n’est donc pas une juridiction constitutionnelle : c’est une 3e chambre, d’un type spécial qui non seulement n’a pas été créée à partir de modèles préexistants ainsi que nous l’avons vu au début de cette étude, mais encore ne se rattache à aucune des catégories connues19. Troisième chambre du Parlement, le Conseil garantit la qualité de la production législative, tout en étant un organe régulateur des pouvoirs publics.
Il est donc sans objet de lui adresser des critiques au regard des particularités de systèmes étrangers : on ne compare que des entités comparables. Il aurait été absurde par exemple de critiquer le manque de pouvoirs du président de la République française de 1946 en considération des attributions du président des États-Unis. Ils appartiennent au même genre, mais non à la même espèce. Il en va de même pour le Conseil constitutionnel et les juridictions constitutionnelles. Ou bien, on remet en cause toute l’institution, ou bien on l’admet telle qu’elle est c’est-à-dire ayant seulement pour mission la régulation de l’activité normative et non la protection des individus ou le maintien de l’équilibre politique.
En revanche, on peut de l’intérieur, critiquer le fonctionnement de l’institution. Ainsi, au regard de ce qui pourrait être un système de contrôle dont nous avons tenté de faire apparaître la logique interne et les grandes lignes, on regrettera les résultats relativement décevants de l’utilisation par certains des « gardiens de la Constitution » (notamment par le président de l’Assemblée), des pouvoirs de nomination et de saisine, l’emploi parfois abusif des articles 40 et 41 par le Premier ministre, surtout en matière de lois de finances, l’existence dans l’ordre juridique, des ordonnances de l’article 92 qui viennent souvent fausser le mécanisme. Si des réformes ou des améliorations étaient apportées sur ces points, l’institution pourrait pleinement se développer.
En toute hypothèse, il ne semble plus question de remettre en cause le principe du contrôle de constitutionnalité. Certains même demandent l’institution d’une « Cour suprême », qu’il vaudrait mieux dénommer d’ailleurs Cour constitutionnelle, car une Cour suprême est placée au sommet d’une organisation juridictionnelle. Cette appellation est significative cependant, car, à nouveau, l’exemple américain – qui, rappelons-le, n’a rien de commun avec ce que l’on voudrait créer en France – exerce une attraction certaine, encore que la plupart des partisans ignorent en quoi consiste exactement le système américain20, et qu’ils préconisent en réalité l’institution du système allemand qu’ils ne connaissent pas apparemment. Revendication traditionnelle des partis de droite depuis le début du siècle21, le contrôle par une « Cour suprême » est aujourd’hui prôné également par le MRP, et, semble-t-il, par les partis de gauche, non communistes22. Cela marque une évolution par rapport à la Libération et correspond sans doute à un « dédouanement » du contrôle de constitutionnalité23 en même temps qu’à un souci de réagir contre un pouvoir fort. Mais comment ne pas voir qu’un recours ouvert à tous, conduira à soumettre beaucoup plus fréquemment les actes du Parlement au contrôle juridictionnel, ce que les partis de gauche ne sauraient souhaiter semble-t-il24. En toute hypothèse, si l’on veut remettre en cause le système actuel, il nous semble préférable de prévoir une saisine sur renvoi des tribunaux et par la minorité parlementaire comme le proposaient MM. Eisenmann et Hamon25.
Commentaire
Par cette contribution, le Doyen Louis Favoreu pose les bases de ce qui est qualifié aujourd’hui de parlementarisme rationalisé juridique, avec une intuition rare, au moment où l’institution qui le caractérise, le Conseil constitutionnel, n’était encore qu’une institution en devenir au sein de la Ve République. L’apport de Louis Favoreu réside dans la prise de conscience de toute la singularité de l’institution pour en faire un modèle pour le parlementarisme rationalisé contemporain. Son école, l’école aixoise de droit constitutionnel, telle qu’elle sera qualifiée par d’autres26, sera celle qui portera la singularité du Conseil constitutionnel en Europe face au modèle de la Cour constitutionnelle, retenu en Allemagne et en Italie, après la Seconde Guerre mondiale, puis en Espagne et au Portugal après les dictatures de Franco et de Salazar et à celui de la Cour suprême, telle qu’il se révèle, en premier lieu, aux États-Unis d’Amérique du Nord. Le modèle français de parlementarisme rationalisé juridique s’imposera néanmoins en Europe de l’Est, après la chute du mur de Berlin et la chute de l’Union soviétique.
Parmi les éléments qui caractérisent le parlementarisme rationalisé juridique sous la Ve République, une institution doit focaliser l’attention pour la singularité qu’elle représente dans un régime parlementaire : le Conseil constitutionnel. Cette institution est, à la fois, l’expression et l’instrument de ce parlementarisme rationalisé. Alors que cette dernière notion entend décrire un régime dans lequel les pouvoirs accordés au Parlement sont encadrés afin de limiter son pouvoir, ce qui se traduit, en particulier, par l’encadrement des techniques de mise en cause de la responsabilité du gouvernement et par l’accroissement des pouvoirs de l’exécutif dans la conduite de la procédure législative, la présence du Conseil constitutionnel comme concrétisation de cette exigence est tout à fait singulière et même inédite. Elle participe également, et le Haut Conseil en est même la conséquence, d’une autre singularité de la rationalisation du régime parlementaire en France, comme le souligne le Doyen Favoreu : l’établissement dans la Constitution d’un domaine matériel de la loi distinct du domaine réglementaire. Le Conseil constitutionnel témoigne de la juridicisation du processus de rationalisation, qui ne s’apprécie plus seulement en termes de rapports de force politiques entre les différents pouvoirs, mais par l’existence d’une institution indépendante chargée de sanctionner le respect du droit, à différents titres, vis-à-vis des organes politiques : « la politique (est) saisie par le droit »27. Cette dimension conceptuelle esquissée dans l’article commenté fera l’objet de nombreuses autres publications du Doyen, approfondissant cette analyse initiale28.
Sans doute, certains verront dans cette 3e chambre, un lointain écho au Sénat du premier empire, comme l’évoque le Doyen Favoreu dans sa contribution, mais le raffinement est ici plus manifeste et, surtout, cette 3e chambre n’est pas un paravent démocratique mais, bien au contraire, un moteur de la démocratie. Pour D. Rousseau, synthétisant ainsi parfaitement l’analyse de son maître le Doyen Favoreu, le Conseil constitutionnel est un instrument garantissant la démocratie continue29. L’intégration du contrôle de constitutionnalité dans la procédure de production de la loi, et donc du Conseil constitutionnel dans la manifestation de l’expression de la volonté générale et dans la logique représentative, évite ainsi le piège contre-majoritaire. Selon le Conseil constitutionnel, la loi « ne saurait être une loi valide que, pour autant, elle respecte la Constitution »30. Comme a pu le constater M. Troper dans le prolongement de ses travaux sur la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel garantit un équilibre inédit dans la fonction de production de la loi, entre l’opportunité du politique et le respect du droit31.
Plus largement, et sans doute de manière plus fondamentale, la juridicisation de la rationalisation du régime parlementaire se manifeste-t-elle dans l’exercice d’un contrôle juridique de la répartition du domaine de la loi et de celui du règlement au cœur de la mission du Conseil constitutionnel. La répartition des compétences entre la loi et le règlement, nouveauté de la Ve République, ne renvoie pas seulement à un jeu d’équilibres politiques, mais, également, à une question de régularité juridique sous le contrôle d’un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Celui-ci est ainsi un instrument de rationalisation du régime parlementaire dans sa mission de respect du droit dans le fonctionnement du régime.
L’on pourrait s’étonner de la qualification du Conseil constitutionnel de 3e chambre dans la mesure où il ne compose pas, d’un point de vue organique avec l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement. Selon les termes de l’article 24 de la Constitution, celui-ci est composé de ceux-là. Dans le prolongement, le Conseil constitutionnel fait l’objet d’un titre spécifique dans la Constitution, distinct de celui consacré au Parlement. Il est donc en dehors du Parlement, d’un point de vue organique, même s’il entretient sous cet angle des liens avec celui-ci, nous le verrons ; mais d’un point de vue fonctionnel, il apparaît comme un organe de perfectionnement du travail législatif et, plus largement, de garantie du respect du droit dans le fonctionnement du régime parlementaire.
Avec le Conseil constitutionnel, le choix du constituant l’a conduit à la fois à externaliser, tout en maintenant un lien fort avec la représentation nationale, la rationalisation du travail parlementaire par la création d’une institution extérieure au Parlement, mais qui emprunte, largement, à la logique parlementaire dans la constitution du Conseil constitutionnel en tant qu’organe politique. Dans les missions qui lui sont attribuées, il apparaît comme un organe politique de contrôle du respect du droit par le Parlement, tout en entretenant, à plusieurs égards, un lien avec celui-ci, au point d’en faire une 3e chambre. Une compétente mérite plus particulièrement d’être mise en avant comme illustrant ce positionnement original : l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois a priori. Par l’exercice de ce contrôle, le Conseil constitutionnel pourrait apparaître comme un juge de la constitutionnalité de la loi, même si, nous le verrons, il ne présente aucune des conditions permettant de lui reconnaître cette qualité, tout en insérant l’exercice de son contrôle dans la procédure de production de la loi. Cette fonction permet non seulement de garantir le respect de la répartition des domaines de la loi et du règlement telle qu’elle est fixée par les articles 34 et 37 de la Constitution, mais aussi, depuis la révision constitutionnelle du 16 juillet 1971 intégrant, dans l’article 1er de la Constitution, la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et celle du 1er mars 2005 ajoutant la Charte de l’environnement ainsi qu’une liste de droits et libertés constitutionnellement garantis. Le parlementarisme est rationalisé juridiquement par la préservation de la compétence du législateur, comme par le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Dans cet article, le Doyen a pris la mesure de la singularité de l’institution qui, tout en étant un organe de nature politique, s’est vu confier l’exercice de fonctions proprement juridictionnelles ou, du moins, juridiques. D’un point de vue organique, le Conseil constitutionnel n’est en effet pas une juridiction, alors même que, d’un point de vue matériel, il exerce un contrôle de régularité constitutionnelle de différents actes, dont la loi ordinaire. Loin d’être un paradoxe, voire un oxymoron, comme ont pu l’écrire certains32, cette dualité constitue la raison même de la réussite de l’institution. Les différentes compétences du Conseil constitutionnel lui permettent d’être, selon l’expression du Doyen Favoreu, « l’arbitre institutionnel » de la Ve République « au nom du respect du droit »33. De plus, le contrôle interne à la procédure législative garantit un équilibre entre opportunité politique et respect du droit en faisant qu’une loi en vigueur est effectivement une loi conforme à la Constitution. Cette dimension a d’ailleurs été renforcée grâce à la révision constitutionnelle du 8 juin 1974 qui a rendu obligatoire le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, comme l’a toujours défendu, avec d’autres, le Doyen Louis Favoreu34.
Ainsi, avec cet article, le Doyen a posé les bases de la construction d’un nouveau modèle de parlementarisme rationalisé (I) ; la diffusion du modèle de parlementarisme rationalisé juridique (II) ayant été considérable.
I. La construction d’un nouveau modèle de parlementarisme rationalisé
La force de l’analyse du Doyen Favoreu repose sur une pure description de l’institution, s’appuyant sur une lecture historique de la tradition constitutionnelle française, sans tenter de forcer un quelconque rapprochement du Conseil constitutionnel avec le modèle Cour constitutionnelle. Dans sa contribution, le Doyen Louis Favoreu met en évidence toute la spécificité de la création du Conseil constitutionnel qui en fait un organe singulier, non comparable aux cours constitutionnelles européennes. Le Conseil n’est pas une cour constitutionnelle35, ce qui fait obstacle à toute tendance prescriptive visant à modifier cette institution afin qu’elle devienne une Cour constitutionnelle. La singularité est assumée, sans que ne soient préconisées d’éventuelles adaptations pour rapprocher l’institution d’autres cours constitutionnelles.
Dans sa singularité, le Conseil constitutionnel apparaît comme un organe mixte auquel la qualification de « troisième chambre » ne rend que partiellement compte. D’un point de vue structurel, il est à la fois un organe politique, mais qui demeure indépendant des autres organes politiques (A). D’un point de vue substantiel, le Conseil constitutionnel dispose de compétences qui sont à la fois, juridictionnelles et politiques, faisant de lui un organe régulateur de la vie politique garantissant un parlementarisme rationalisé par le respect du droit (B).
A) La dimension structurelle : un organe politique indépendant
Mixte, le Conseil constitutionnel apparaît comme un organe politique, mais pleinement indépendant des autres pouvoirs dans l’État, ce qui le place à part au regard des équilibres institutionnels entre les différents pouvoirs.
La composition du Conseil est politique. Les anciens présidents de la République y sont membres de droit et la seule exigence posée à la nomination de ses membres est qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques. Aucune compétence juridique particulière n’est exigée de ses membres, contrairement aux prescriptions existantes pour la composition des cours constitutionnelles européennes. Le Conseil constitutionnel n’est qu’une troisième chambre participant de la volonté de Michel Debré de rationaliser le régime parlementaire. Sa légitimité provient des autorités qui en nomment les membres et sur lesquels, à un titre ou à un autre, il exerce un contrôle. À l’origine, 3 de ses membres étaient nommés par le président de la République, 3 par le président de l’Assemblée nationale et 3 par le président de la République. Avec la réforme du 17 janvier 2008, 3 membres, nommés conjointement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le président de la Cour des comptes, sont venus s’ajouter aux autres membres nommés36. Cette réforme a ainsi intégré les critiques doctrinales récurrentes et constantes37 autour de la légitimité « juridictionnelle » du Conseil constitutionnel, en permettant une représentation des plus hautes juridictions françaises parmi les autorités de nomination. Le Haut Conseil bénéficie ainsi d’une légitimité provenant des organes institutionnels représentatifs des différents pouvoirs : exécutif, législatif et juridictionnel. La légitimité démocratique n’est qu’indirecte, pour autant, le Conseil constitutionnel tire sa légitimité de ses conditions de nomination qui font intervenir chaque organe susceptible, d’une manière ou d’une autre, de faire l’objet d’un contrôle juridique de la part du Conseil.
Les modalités de cette dernière réforme des conditions de nomination se sont d’ailleurs inspirées du rapport du comité Vidal-Naquet, du nom de sa présidente, chargé par le président de la République Alain Juppé de présenter un rapport sur la réforme des institutions dont il s’est inspiré pour la révision constitutionnelle de 2008. La pratique de ces nominations « juridictionnelles » témoigne du fait que ce ne sont pas toujours des magistrats qui sont nommés par cette voie. En effet, la Cour de cassation et la Cour des comptes ont pu désigner des professeurs d’université38 ou des présidents d’association humanitaires. Cette nouvelle voie de nomination n’est pas, pour autant, un moyen de renforcer les compétences juridiques du juge constitutionnel mais, plus exactement, de permettre une représentation des juridictions au sein du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel demeure un organe politique. À cet égard, on l’a rappelé, la seule exigence à la nomination posée par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel est de jouir de ses droits civils et politiques. Le législateur organique, dans le prolongement de l’esprit du texte constitutionnel, n’a pas entendu réserver l’accès à l’institution aux seuls juristes, bien au contraire. Le respect de la Constitution révèle un savant mélange entre politique et droit39, qui doit se retrouver dans la composition de l’institution. Les grands hommes d’État, comme les juges et les universitaires ont ainsi leur place au sein de l’institution pour pouvoir, ensemble, prendre la mesure des dimensions politique et juridique des questions de constitutionnalité qui lui sont soumises, comme, plus largement d’ailleurs, des autres compétences confiées au Conseil constitutionnel.
Ce choix du constituant, appuyé par le législateur organique, s’est vérifié dans la pratique. De grands hommes politiques, anciens premiers ministres ou ministres, de même que des universitaires quelle que soit leur discipline40, et donc pas seulement des juristes ont pu être membres du Conseil constitutionnel, même si, parfois, des hauts magistrats et même des professeurs ou anciens professeurs de droit ont pu également intégrer l’institution. L’on se souviendra ici, plus particulièrement et à titre illustratif, sans souci toutefois d’exhaustivité et en priant de bien vouloir excuser tous ceux qui seraient oubliés : pour les hommes politiques, O. Besancenot, S. Veil, A. Laguiller, G. Marchais, Ph. Seguin, D. de Villepin, J. Toubon, pour les universitaires L. Hamon, C. Euzet, C Villani, P. Bourdieu, P. Virilio, M. Pinçon-Charlot, T. Piketty, A. Supiot, C. Boltanski, P. Delvolvé, M. Delmas-Marty, M. Troper, C. Fleury, D. Rousseau, A. Roux, B. Mathieu, D. Verpeaux, J.-Ph. Agresti, O. Pfersmann, T.-S. Renoux, D. Krajeski, J. Théron une place, rare mais notable, ayant pu être laissée à part aux écrivains, qu’il s’agisse de M. Houellebecq ou d’A. Ernaux41 ou aux journalistes comme G. Erner, E. Plenel ou F. Aubenas…
Les éventuelles difficultés, dans l’exercice de certaines compétences du Conseil constitutionnel, liées à l’absence de connaissance juridique de ses membres sont compensées par le rôle décisif qu’occupe le secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui doit être, quant à lui, selon les exigences de la loi organique, soit une personne susceptible d’exercer les plus hautes fonctions juridictionnelles, soit un juriste aux compétences notoires42. En tant que coordinateur de l’activité du Conseil constitutionnel, il s’appuie sur un service juridique renforcé capable de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de décision des membres du Haut Conseil. La place prépondérante qu’ont pu occuper certains secrétaires généraux a été dénoncée par la doctrine43. L’on peut penser ici, en particulier, à Emmanuel Macron ou à Anne Levade, souvent qualifiés de 10e ou 13e membre, voire, selon une qualification quelque peu ironique de chief justice44. Pour autant, et pour retenir une lecture objective du passage de ces deux chief justice au secrétariat général du gouvernement, ceux deux secrétaires généraux ont eu une influence décisive dans la rationalisation du fonctionnement interne du Conseil constitutionnel.
Le caractère politique de l’institution se manifeste d’une autre manière : l’absence de motivation véritable des décisions. Cette faiblesse de la motivation, à l’opposé de celle que l’on retrouve dans les décisions rendues par l’ensemble des cours constitutionnelles européennes, exclut tout modèle juridictionnel dans la formalisation des décisions. Le Conseil constitutionnel rend en effet des décisions et non pas des jugements ou des arrêts. Il n’a pas à justifier ces choix. Il « décide » ; il ne rend pas une décision de type juridictionnelle, nécessitant une motivation et donc une justification des choix45. C’est pourquoi, et le Doyen Favoreu s’est d’ailleurs longtemps opposé sur ce point avec le professeur Wanda Mastor46, la pratique des opinions séparées ne saurait avoir de sens avec le Conseil constitutionnel. La légitimité de la décision d’un organe politique ne repose pas sur sa motivation, mais sur les conditions de nomination de ceux qui la rendent, renvoyant au modèle d’organisation de l’État. La légitimité populaire indirecte comme la représentation des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et juridictionnel permet au Conseil constitutionnel de ne motiver que de manière très succincte, sans jamais mettre en évidence ni les choix auxquels il a pu être confronté dans sa décision, ni celui qu’il a retenu parmi ceux qui étaient possibles. L’existence de procès-verbaux des délibérations du Conseil constitutionnel, mis en ligne, aujourd’hui, en même temps que la décision, ce qui s’oppose au principe même du secret des délibérés qui s’impose pour les juridictions47, vient confirmer cette nature politique de l’institution, de même que la logique de 3e chambre, de chambre délibérative.
Tout en étant un organe politique, et c’est précisément ce qui témoigne de la singularité de l’institution, il n’en est pas moins indépendant des autres organes politiques, dont il régule l’action et d’où il tire sa légitimité. À cet égard, plusieurs garanties statutaires méritent d’être mentionnées à l’appui de cette indépendance : un mandat de 9 ans, non renouvelable, le décalage des renouvellements de 3 puis, à partir de 2008, 4 membres tous les 3 ans, un mandat irrévocable sauf procédure disciplinaire interne, une interdiction de toute nomination à un emploi public et une interdiction de recevoir une promotion pendant la durée de leurs fonctions48. La singularité du Conseil constitutionnel dans le cadre du parlementarisme rationalisé juridique s’exprime également d’un point de vue substantiel.
B) La dimension substantielle : un régulateur de l’activité des pouvoirs publics
Les termes sont significatifs sous l’angle du parlementarisme rationalisé, le Conseil constitutionnel est une troisième chambre qui apparaît comme un régulateur de l’activité des pouvoirs publics, même si, son activité a été, du moins à l’origine, concentrée sur le contrôle du respect de la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Le bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs est ainsi garanti par un organe tiers aux trois pouvoirs, aux deux pouvoirs classiques exécutif et législatif, et au pouvoir juridictionnel, totalement indépendant des autres pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel représente une externalisation partielle d’une dimension « arbitrale » du fonctionnement des pouvoirs publics. Le modèle des autorités administratives indépendantes doit d’ailleurs beaucoup à cette tendance externalisatrice du contrôle de l’activité politique des pouvoirs publics49. C’est à un organe distinct des pouvoirs publics classiques, tout en étant une émanation, qu’est confiée une mission de régulation juridique de l’activité politique des institutions. Chacune des compétences qui lui sont attribuées témoigne de cette volonté.
Il est d’abord un organe « authentificateur des choix du peuple » selon la formule du Doyen Favoreu50 souverain grâce à ses compétences en matière électorale, qu’il s’agisse d’apprécier la régularité des élections du président de la République, au-delà d’ailleurs des compétences spécifiques dont il dispose dans le déroulement de cette élection (art. 7 C.), de celles des députés et des sénateurs ou de la régularité des opérations référendaires. Les compétences électorales du Conseil constitutionnel permettent de préserver le respect du droit dans l’expression de la volonté du peuple, que celle-ci ait pour but de désigner des représentants ou d’adopter une loi ou une modification de la Constitution.
Par le contrôle obligatoire des règlements des assemblées et des lois organiques, selon la formule du Doyen dans l’article commenté, « il surveille la codification des “règles du jeu politique” ». Alors que la loi organique complète la Constitution et que les règlements des assemblées concrétisent les règles constitutionnelles devant chacune des deux chambres, le Conseil constitutionnel veille à ce que ces différentes règles, qui prolongent la Constitution, ne soient pas contraires à cette dernière. Il préserve ainsi la volonté du constituant dans l’encadrement du pouvoir de concrétisation de la Constitution par le législateur organique et par chacune des deux chambres. Le parlementarisme est rationalisé par le contrôle du respect du droit dans l’exercice du pouvoir d’autoréglementation des assemblées et d’explicitation de normes constitutionnelles sur renvoi de celles-ci par ces dernières.
Plus largement, la mission décisive qui lui est confiée est celle de « la régulation de l’activité “normative” des pouvoirs publics ». Elle emprunte plusieurs voies et pas seulement la question du respect des domaines de la loi et du règlement.
Déjà, la fonction précédemment exposée, de surveillance des règles du jeu politique, par le contrôle obligatoire des règlements des assemblées et des lois organiques (art. 61 alinéa 1 C.) marque un contrôle de l’activité normative des pouvoirs publics dans leur fonction de concrétisation de la Constitution. Tout détournement de procédure conduisant à modifier la Constitution par d’autres procédures que celle prévue à l’article 89 de la Constitution est encadré.
Selon la formule du Doyen Favoreu, le Conseil constitutionnel est le « coordinateur positif des rapports de systèmes interne et internationaux »51. La procédure de l’article 54 de la Constitution impose en effet, avant toute ratification d’un engagement international, une éventuelle mise en cohérence de la Constitution avec les stipulations de ce dernier. Si le Conseil constitutionnel a jugé que celles‑ci étaient contraires aux dispositions de celle-là. Le Conseil veille ici au respect des engagements internationaux, dans le prolongement des alinéas 14 et 15 du Préambule de la Constitution de 1946 qui marque l’ouverture de l’ordre juridique français au droit international public, en imposant une révision de la Constitution pour mettre en compatibilité cette dernière avec les engagements internationaux de la France avant que celle-ci ne s’engage à les respecter.
La compétence la plus aboutie du Conseil constitutionnel demeure le contrôle de constitutionnalité a priori qui est inséré dans la procédure de production de loi de sorte que le Conseil constitutionnel apparaît, selon la formule du Doyen Favoreu, comme « la troisième chambre du Parlement chargée du respect du droit »52. D’abord facultatif, devenu obligatoire avec la révision constitutionnelle du 8 juin 197453, ce contrôle témoigne d’une exigence forte de régularité des lois dans l’ordre juridique français : une loi promulguée ne saurait être qu’une loi régulière. L’adoption d’une déclaration des droits et libertés, moderne, introduisant toutes les générations de droits et libertés dans la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 16 juillet 1971, a permis d’intégrer dans le respect de la régularité juridique les droits et libertés.
Le Conseil constitutionnel est encore et surtout gardien de la répartition des compétences entre le domaine de la loi, posé par l’article 34 de la Constitution, et du règlement, prévu par l’article 37 du même texte. Cette fonction est d’ailleurs assurée grâce à plusieurs procédures, à chaque moment de la production législative : au stade de l’initiative avec la procédure de l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution, une fois que le texte de la loi est définitivement adopté mais avant que celle-ci ne soit promulguée, avec la procédure de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution et une fois la loi promulguée grâce à la procédure de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution.
Pour reprendre une autre formule du Doyen Favoreu, le Conseil constitutionnel apparaît comme un aiguilleur54 des compétences normatives dans l’ordre constitutionnel : il tranche non seulement la question des domaines de compétences entre la loi et le règlement, mais également celle des domaines de compétences entre la loi ordinaire, la loi organique et la loi de révision constitutionnelle
II. La diffusion du modèle de parlementarisme rationalisé juridique
À partir de l’exemple du Conseil constitutionnel, le Doyen Favoreu a construit un modèle de parlementarisme rationalisé juridique qu’il a rapproché d’un constitutionnalisme politique original, distinct de celui qui a cours au Canada, au Royaume-Uni et en Australie55, qui tend aujourd’hui à évoluer vers le modèle dialogique56, et distinct des modèles européen et américain de justice constitutionnelle. Ce modèle qu’il conviendra d’exposer (A) a bénéficié d’une postérité qui a conduit à l’adoption de ce modèle par de nombreux États d’Europe de l’Est (B).
A) Un modèle repris et pensé par la science du droit constitutionnel en Europe
Le modèle de constitutionnalisme politique défendu par le Doyen Favoreu n’est pas le modèle politique faible dans lequel le législateur a le dernier mot face aux décisions juridictionnelles (constitutionnalisme politique classique) ou fort, dans lequel, le dernier mot n’est que le résultat d’équilibres entre le juge et le législateur (modèle dialogique57), ni celui, en substance, du constitutionnalisme juridique, de contrôle de constitutionnalité concentré, qualifié le plus souvent de « modèle européen » de justice constitutionnelle, ou de contrôle de constitutionnalité diffus, modèle américain58.
Le modèle proposé par le Doyen Favoreu mérite d’être explicité dans sa spécificité, en le comparant avec les autres modèles.
Il participe en partie du constitutionnalisme juridique, dans la mesure où le législateur n’a pas le dernier mot, pas plus d’ailleurs que le Conseil constitutionnel, ce dernier mot revient au pouvoir de révision constitutionnelle. La représentation nationale, dans son expression ordinaire, ne peut donc remettre en cause l’appréciation de la régularité constitutionnelle à laquelle se livre le Conseil constitutionnel. Elle ne peut remettre en cause les décisions du Conseil, en présence d’un projet de loi de révision et du choix du Chef de l’État de ne pas le soumettre au référendum, comme le prévoit l’article 89 de la Constitution, qu’à une majorité renforcée. Le Haut Conseil est une 3e chambre dont les décisions s’imposent aux deux autres (art. 62 de la Constitution). Pour le dire autrement, dans une certaine mesure le Conseil constitutionnel est au-dessus des deux chambres, car ses décisions s’imposent à elles, le parlementarisme rationalisé de la Ve République, concrétisé par l’existence de cette 3e chambre, est inégalitaire sous cet angle également.
Pour autant, le parlementarisme rationalisé juridique s’éloigne du constitutionnalisme juridique en ce que la mission de contrôle de la régularité juridique n’est pas confiée à une juridiction mais bien à un organe politique. D’un point de vue organique, comme des modalités de fonctionnement, ce n’est donc pas à une juridiction qu’est confié le soin de mettre en évidence l’irrégularité constitutionnelle de la loi.
Le modèle emprunte également au constitutionnalisme politique. Le Conseil constitutionnel inscrit le contrôle de constitutionnalité dans la procédure législative, avec l’exercice du contrôle a priori. Plus généralement, il apparaît comme une 3e chambre. Le contrôle de régularité constitutionnelle est interne à la procédure de production de la loi, ce qui fait du Conseil constitutionnel un co-producteur de la loi avec le Parlement. La dimension politique de l’organe prend, là encore, tout son sens. L’opposition sur la question de la régularité constitutionnelle de la loi n’oppose pas une juridiction et le Parlement mais bien ce dernier avec un autre organe politique, empruntant à la logique parlementaire, à savoir le Conseil constitutionnel.
Pour ce qui concerne la 3e voie, le constitutionnalisme politique fort, il n’est pas certain qu’il puisse, en droit, être valablement distingué du constitutionnalisme politique faible. En droit, dans les deux cas, le dernier mot est confié au législateur ordinaire même si, en pratique, et c’est la spécificité du constitutionnalisme politique fort, rien n’empêche que ce dernier mot soit précédé d’une discussion informelle entre la juridiction et le Parlement permettant de parvenir à un compromis acceptable. L’on sait d’ailleurs, avec le Conseil constitutionnel, qu’il existe des discussions informelles59, ce qui en l’occurrence paraît logique compte tenu de sa nature politique, quoique formalisées dans la procédure délibérative60, entre celui-ci et le gouvernement pour parvenir, le cas échéant, à un compromis politique sur le contenu de la loi permettant de la préserver d’une censure. En définitive, s’il fallait qu’il existe une troisième voie du constitutionnalisme, ou un constitutionnalisme politique fort, c’est dans le parlementarisme rationalisé juridique qu’il faut le trouver. L’existence d’un organe politique de contrôle de la régularité constitutionnelle constitue un élément objectif certain différenciant le parlementarisme rationalisé juridique des constitutionnalismes juridique et politique.
Ce modèle constitue bien un modèle original dans la mesure où il participe précisément d’un système mixte, contribuant au respect de la régularité constitutionnelle, sans pour autant remettre en cause l’expression de la volonté générale, en intégrant la dimension juridique du respect de la Constitution dans la procédure de production de la loi. Ce mécanisme permet ainsi de repousser l’argument contre-majoritaire développé à l’encontre du contrôle de constitutionnalité des lois. La question de la régularité constitutionnelle est confiée à un organe politique représentatif.
Cette lecture du parlementarisme rationalisé juridique comme une 3e voie entre le constitutionnalisme juridique et le constitutionnalisme politique a été diffusé d’un point de vue doctrinal au point d’en recevoir des concrétisations en droit positif.
B) Un modèle concrétisé par les droits positifs d’Europe de l’Est
La postérité de l’analyse du Doyen Favoreu a d’abord été doctrinale avant de rencontrer des prolongements sous l’angle des droits positifs. Cette influence doctrinale a été mise en évidence de manière pertinente et exhaustive par N. Danelciuc-Colodrovsci et nous nous contenterons de renvoyer à son travail et aux éléments bibliographiques qui y sont mentionnés pour illustrer cette influence61. Celle-ci a été telle que les Constitutions d’Europe de l’Est post-communiste se sont largement inspirées de ce modèle, non sans quelques mises en œuvre de droit positif originales62.
Sur le plan de l’emprunt aux éléments généraux du modèle, le contrôle de constitutionnalité des lois est confié à une 3e chambre du Parlement, en Pologne, Hongrie, Croatie, Arménie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Russie et Roumanie, à un Conseil constitutionnel, le terme est parfois repris, dont les conditions de nomination en font l’expression de la représentation nationale, sans que celle-ci ne s’exprime de manière directe. Ainsi, souvent, la moitié au moins63 ou les deux tiers64 des membres de cette 3e chambre sont nommés par les membres de ou des deux autres chambres ; pour le reste des membres, ce sont les exécutifs qui disposent du pouvoir de nomination. Les pratiques de nomination témoignent d’une présence majoritaire d’anciens parlementaires ou de membres du gouvernement disposant d’une expérience politique manifeste, ainsi que, dans une moindre mesure, de celle d’avocats, de membres de hautes juridictions ou d’universitaires65. Les garanties d’indépendance demeurent globalement les mêmes : mandat unique, interdiction des promotions ou autre nomination durant le mandat, mandat irrévocable, mandat d’une durée significative (de 9 à 12 ans selon les systèmes juridiques) pouvoir d’autodiscipline… Les compétences des hauts conseils s’inscrivent parfaitement dans la logique de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, entre le législateur ordinaire et le pouvoir de révision constitutionnelle et la fonction d’aiguilleur dans la double expression de la majorité parlementaire, simple ou renforcée. Le contrôle a priori de constitutionnalité est prévu de manière systématique, qu’il soit facultatif, avec des autorités de saisines classiques (exécutif, parlementaires ou cours suprêmes) ou obligatoire66. Le contrôle de constitutionnalité est inséré dans la procédure de production de la loi. Les contrôles a posteriori demeurent rares67, ils sont exclus dans les systèmes dans lesquels il existe une saisine du Haut Conseil par les cours suprêmes68, ce qui peut se justifier d’un point de vue logique. Il existe alors un lien entre les cours suprêmes et le Haut Conseil et le contrôle de la régularité de la loi peut être enclenché à l’occasion d’une application concrète de la loi.
Cette dimension commune permettant le rattachement au modèle se combine à des procédures plus originales qui, si elles ne remettent pas en cause les principes du modèle, n’en illustrent pas moins de concrétisations différentes de celui-ci. Nous en retiendrons trois qui témoignent de singularités dignes d’être mises en évidence. Ces trois mécanismes visent tous à pallier les omissions législatives et donc à sanctionner l’inertie du législateur dans la concrétisation régulière des dispositions constitutionnelles. De manière contingente, bien que logique, chacun des systèmes qui institue de tels mécanismes n’en consacre qu’un à la fois, sans combiner ou cumuler ces procédures. Sans doute faut-il y voir une volonté de ne pas multiplier les procédures de sanction des inerties législatives, en évitant de conférer au Haut Conseil un trop large pouvoir.
Si cette possibilité demeure rarement attribuée à des cours constitutionnelles, les Conseils constitutionnels polonais, roumains et moldaves disposent d’un droit d’initiative législative69. L’attribution de ce droit d’initiative au Haut Conseil s’avère plus cohérent dans le cadre du parlementarisme rationalisé, en raison de la dimension politique du Haut Conseil et de la logique de 3e chambre. Ce droit appartient ainsi à tous les représentants du peuple, y compris ceux qui sont plus spécialement chargés du contrôle de constitutionnalité et de la régulation juridique des pouvoirs publics. Il permet au Haut Conseil d’initier des réformes législatives en lien avec l’exercice de sa fonction, lorsque, par exemple, l’une ou les deux autres chambres du Parlement n’adoptent pas une réglementation imposée par la Constitution ou lorsque le Parlement ne modifie pas une loi censurée pour inconstitutionnalité. Le Haut Conseil apparaît comme un initiateur technique à la production législative, spécialisé dans le respect des règles constitutionnelles, gardien d’une meilleure concrétisation de celles-ci. Ce droit d’initiative ne fait cependant pas l’objet de restriction quant aux motifs sur le fondement desquels il peut être exercé. Il s’agit d’un droit d’initiative général qui n’est pas associé, strictement, à l’exercice du contrôle de constitutionnalité de la loi. En tout état de cause, si le Haut Conseil propose, les autres chambres disposent de la proposition de loi. La maîtrise de la production normative appartient toujours aux autres chambres.
Une autre compétence, en Russie, en Ukraine et en Biélorrusie, permet au Haut Conseil d’édicter une réglementation provisoire dans des circonstances particulières. Le Haut Conseil pose directement la réglementation applicable, imposée par la Constitution, ce qui, compte tenu du modèle de parlementarisme rationalisé, est moins choquant que dans les autres modèles : c’est toujours un organe politique qui produit la loi. L’étendue de ce pouvoir est tel qu’il est en général fortement encadré. Il ne peut être mobilisé que si une censure de l’irrégularité constitutionnelle aboutit à priver de toute réglementation l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale au point d’en empêcher l’exercice effectif. Il est ainsi lié à la censure d’une loi et c’est dans la décision de censure que la réglementation provisoire est posée. Si le pouvoir du Haut Conseil est fort, en termes de production normative, son domaine d’application est restreint. Le Haut Conseil ne saurait proposer une réglementation provisoire que si la censure d’une loi aboutit à priver de garanties légales des droits et libertés constitutionnels70.
Il est enfin une voie spécifique de recours en carence, en Arménie et en Croatie71, accompagnée, au sein de ce dernier ordre juridique, d’un pouvoir d’injonction à l’encontre du Parlement. Ce recours peut être mobilisé dans deux circonstances particulières : lorsqu’un droit ou une liberté reconnu par la Constitution n’a pas fait l’objet d’une concrétisation législative ou lorsque, suite à une censure pour irrégularité constitutionnelle, le législateur n’est pas intervenu pour adopter, dans le même domaine, une réglementation régulière pour la concrétisation d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garanti. La décision du Haut Conseil constate éventuellement la carence du législateur et lui enjoint, le cas échéant, lorsque cette possibilité est prévue, d’adopter une loi dans un certain délai.
Ces différentes compétences, parfois reconnues à des cours constitutionnelles, en s’inscrivant dans le modèle du constitutionnalisme politique français, heurtent de manière moins frontale la souveraineté parlementaire. L’intégration fonctionnelle du Haut Conseil dans le Parlement inscrit son action dans une division des tâches plutôt que dans une concurrence dans l’exercice du pouvoir. Le pouvoir législatif se perfectionne grâce à la présence d’une 3e chambre plutôt qu’il ne se voit heurter dans l’exercice de sa fonction par une autre institution qui lui est extérieure. Plus largement, ce seront l’ensemble des organes constitutionnels qui bénéficieront d’une régulation juridique et extérieure de leur activité politique.
L’article fondateur du Doyen Favoreu pose les bases de la singularité du parlementarisme rationalisé juridique intégrant un contrôle de constitutionnalité des lois par un organe politique. Il a ouvert la voie pour une étude singulière de l’institution Conseil constitutionnel à l’ensemble de la science du droit constitutionnel française. Plus largement, il a contribué au rayonnement et à la diffusion dans le monde juridique d’un nouveau modèle d’organisation du pouvoir politique.
1 Jèze, Larnaude, Duguit, Hauriou, Duez, etc.
2 Cette tradition parlementaire de la « fausse imitation » de Cour suprême américaine est représentée sous la IIIe République par Charles Benoist et Jules Roche (cf. J. Lemasurier, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur, Paris, 1952, p. 19 et s.). En revanche, le projet de Constitution du maréchal Pétain prévoyait une Cour suprême pouvant être saisie par voie d’exception sur le modèle américain (Duverger, Constitut. et Doc. Pol., 2e éd., p. 121).
3 Cf. J. Lemasurier, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur, op. cit. En 1961, s’est tenu à Heidelberg un important colloque sur La juridiction constitutionnelle à l’époque contemporaine. Des rapports sur chacun des pays cités (sauf la Yougoslavie) figurent dans l’ouvrage rassemblant les différentes études. Sur les cours constitutionnelles on peut consulter : A. de Valles, « Contre les cours constitutionnelles », Rev. int. sc. adm., 1952 ; et surtout sur les Cours allemande, italienne et autrichienne : T. Cole, « Three constitutional Courts : a comparison », American Political Science Review, 1959, p. 963-985. Allemagne : Cl. Lasalle, « Les limites du contrôle de la constitutionnalité des lois en Allemagne occidentale », RD publ., 1953, p. 106 ; P. Chenut, La justice constitutionnelle en Allemagne, thèse, Paris, 1956 ; W. Buerstedde, « La Cour constitutionnelle de la République Fédérale allemande », RID comp. 1957, p. 56 ; W. Leisner, « La conception du “politique” selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », RD publ. 1961, p. 754. Italie : D. M. Aspotolides, La Cour constitutionnelle d’Italie, thèse, Paris, 1952 ; Th. Godechot, « Indépendance de la Cour constitutionnelle italienne », Rev. sc. pol. (Toulouse), 1962, n° 5 et 6. Autriche : Ch. Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, thèse, Paris, 1928 ; R. Dallmayr, « Background and development of the Austrian constitutional Court », Journal of Central European Affairs, 1962, p. 403-433. Yougoslavie : J.‑P. Ferretjans, « La Constitution du 7 avril 1963 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et l’unité marxiste du pouvoir d’État », RD publ., 1963, p. 948 et s. Chypre : G. Vlachos, « L’organisation constitutionnelle de la République de Chypre », RID comp., 1961, p. 527 et s. ; NED n° 2800 (28 juillet 1961), « La République de Chypre ». Turquie : NED n° 3074 (21 mars 1964), « Les institutions de la Turquie ».
4 Selon la formule de M. Prélot, in Préface à l’ouvrage de J. Lemasurier, p. 8.
5 On assortit même parfois la comparaison, d’un rapprochement entre Sieyès et M. Debré.
6 Cf. P. Bastid, Sieyès et sa pensée, Paris, 1939.
7 En 1961, s’est tenu à Heidelberg un important colloque sur La juridiction constitutionnelle à l’époque contemporaine. Des rapports sur chacun des pays cités (sauf la Yougoslavie) figurent dans l’ouvrage rassemblant les différentes études. Sur les cours constitutionnelles on peut consulter : A. de Valles, « Contre les cours constitutionnelles », Rev. int. sc. adm., 1952 ; et surtout sur les Cours allemande, italienne et autrichienne : T. Cole, « Three constitutional Courts : a comparison », American Political Science Review, 1959, p. 963-985. Allemagne : Cl. Lasalle, « Les limites du contrôle de la constitutionnalité des lois en Allemagne occidentale », RD publ. 1953, p. 106 ; P. Chenut, La justice constitutionnelle en Allemagne, thèse, Paris, 1956 ; W. Buerstedde, « La Cour constitutionnelle de la République Fédérale allemande », RID comp. 1957, p. 56 ; W. Leisner, « La conception du “politique” selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », RD publ. 1961, p. 754. Italie : D. M. Aspotolides, La Cour constitutionnelle d’Italie, thèse, Paris, 1952 ; Th. Godechot, « Indépendance de la Cour constitutionnelle italienne », Rev. sc. pol. (Toulouse), 1962, n° 5 et 6. Autriche : Ch. Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, thèse, Paris, 1928 ; R. Dallmayr, « Background and development of the Austrian constitutional Court », Journal of Central European Affairs, 1962, p. 403-433. Yougoslavie : J.-P. Ferretjans, « La Constitution du 7 avril 1963 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et l’unité marxiste du pouvoir d’État », RD publ., 1963, p. 948 et s. Chypre : G. Vlachos, « L’organisation constitutionnelle de la République de Chypre », RID comp. 1961, p. 527 et s. ; NED n° 2800 (28 juillet 1961), « La République de Chypre ». Turquie : NED n° 3074 (21 mars 1964), « Les institutions de la Turquie ».
8 Du fait, pour celles-ci, de l’existence de régions.
9 Cf. T. Cole, op. cit., p. 967 : « But it was definitely the reaction to excesses of the Fascist and Nazi regimes which was the most important factor in the decision finally taken in Austria to restore the Constitution of 1920 as amended in 1925 and 1929, with its provision for a constitutional court; and in Italy and Germany; to establish new courts. There was remarkable unanimity among most of the democratic parties in all three countries to grant the power of judical review to some type of court. This same reaction helps explain the incorporation of elaborate bills of rights, to protect the individual and of federalistic arrangements which, while borrowing from the past, were directed against the centralization of the Fascist period. Judicial review, in some hands, was widely accepted as necessary to safeguard these guaranted liberties and arrangements ».
10 N. Wahl, « The French Constitution of 1958 » (II. The initial draft and its origins), American Political Science Review, 1959, p. 374.
11 D.-M. Jacquier-Bruère, Refaire la France, l’effort d’une génération, Paris, Plon, 1945, p. 155. D’ailleurs, passé le danger communiste – qui le poussait d’après M. Wahl (op. cit., p. 374) à prévoir ce tribunal – M. Debré n’en fera plus mention.
12 Présidé par le garde des Sceaux et composé de 2 sénateurs, 2 députés, 2 conseillers d’État et 2 conseillers à la Cour de cassation, cf. Les Cahiers Politiques, octobre 1945, p. 1 et s.
13 Cf. par exemple enquête menée par E. Mounier dans la Revue Esprit, 1945.
14 L. Kopelmanas, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois » in Refaites une Constitution, Paris, 1946. L. Kopelmanas, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois » in Refaites une Constitution, Paris, 1946.
15 Op. cit., p. 285 : « La solution consisterait à placer l’exécutif entre la décision de la Cour et le législatif dont l’acte serait censuré, à faire endosser à l’exécutif, la responsabilité politique des décisions juridiques de la Cour… Le processus serait à peu près le suivant. La Cour se prononcerait sur la constitutionnalité d’une mesure législative donnée. Sa décision serait reprise par l’exécutif qui le ferait valoir vis-à-vis du législatif et vis-à-vis du pays. En cas de conflit, le législatif se trouverait non plus en présence d’une institution sous forme politique à proprement parler, mais en face d’un organe dont le poids politique serait comparable au sien. Et comme dans l’équilibre des pouvoirs que la Constitution aura à établir notre solution irait dans le sens du renforcement du pouvoir exécutif, dont la France ressent un besoin urgent, son avantage serait indéniable. Avantage d’autant plus indéniable qu’il serait acquis non pas au profit de l’arbitraire gouvernemental, mais au profit d’une action liée par une décision juridique, par une décision concernant la légalité, la conformité nécessaire des actes législatifs à la Constitution ».
16 M. Wahl (op. cit., p. 380) a recherché l’origine de ce mouvement en faveur de la rationalisation de l’activité parlementaire et il est remonté fort loin, avant la Première Guerre mondiale. Mais lorsqu’il déclare qu’en 1907, un parti (« Parti républicain modéré et progressiste ») recommande « la création d’une institution ressemblant au présent Conseil constitutionnel », nous ne le suivons plus car ce qui est demandé dans le programme de ce parti, c’est qu’il soit institué une « Cour suprême à laquelle tous les individus auront accès » : il est certes souhaité « que la vérification des pouvoirs des sénateurs et des députés soit faite en cas de contestation par une commission extra-parlementaire composée d’un nombre égal de conseillers à la Cour de cassation et au Conseil d’État » mais la ressemblance avec le Conseil actuel est assez lointaine (sur tous ces points. Cf. L. Jacques, Les partis politiques sous la IIIe République, thèse, Paris, 1912, p. 488 et p. 209).
17 Institutions politiques, 3e éd., p. 795.
18 Encore que M. Coste-Floret ait déclaré lors des débats, devant le Comité consultatif : « Le titre VII amendé par les dispositions techniques que nous avons adoptées est, à mes yeux, l’un des mieux venus de l’avant-projet » (Trav. préparatoires, 1, p. 76).
19 C’est ce qu’a parfaitement marqué M. Prélot, Institutions politiques, 3e éd., p. 794 : « [Le Conseil constitutionnel] est, sans doute, une juridiction, mais qui ne ressemble guère aux cours suprêmes existant dans divers pays. Les compétences du Conseil constitutionnel ne découlent pas d’un système logique de contrôle, selon l’un des divers types connus dans le passé ou actuellement en vigueur… ».
20 Cf. proposition de la loi A. Peretti déjà citée (n° 640, AN, 1re session ordinaire 1963-1964, annexe au PV de la séance du 7 novembre 1963, Distribution du 8 mars 1966) : « comme aux USA, elle (la Cour suprême) pourrait statuer sur toute action en inconstitutionnalité soulevée par n’importe quel citoyen à l’encontre d’un texte législatif » (souligné dans le texte). Cf. également déclaration de M. Coste‑Floret lors d’une enquête menée par C.-R. Legros dans la Rev. pol. et parl. février 1964, p. 6 et 7 : « La Cour suprême… pourrait être saisie par tout citoyen, par voie d’action, de l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un règlement, c’est le système qui fonctionne aux États-Unis… » (souligné par nous). Nous rappellerons simplement ce que disait M. Kopelmanas, à propos du projet Ch. Benoist de 1903 : « Dans la méconnaissance totale du système américain qu’il prétendait suivre et qui ne permet pourtant pas la critique d’une loi en dehors d’un procès déjà né, son auteur voulait qu’un particulier qui “se croirait lésé par une loi” puisse s’adresser à la Cour constitutionnelle » (in Refaites une Constitution, p. 286).
21 Cf. J. Lemasurier, op. cit.
22 Cf. déclarations F. Mitterrand, Rev. pol. et parl. mars 1964, p. 6.
23 En ce sens, est significative l’institution d’une Cour constitutionnelle en Yougoslavie, en 1963.
24 Il est vrai que les actes du Gouvernement seraient également soumis au contrôle.
25 Cf. leur rapport au Colloque de Heidelberg, op. cit.
26 Voir par exemple : O. Beaud, « Les grandes écoles du droit constitutionnel en France », Jus juridicum, 1996, p. 34-58, spécial. p. 37-47. Voir également : A. Viala, « Pour une typologie modale épistémologique des écoles françaises de droit constitutionnel », Théorie(s) du droit, n° 6, 2010, p. 23-54, spécial. p. 34‑40.
27 L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Economica, 1988, 153 p.
28 Voir, en particulier, L. Favoreu, « Le modèle français de parlementarisme rationalisé juridique », RFDC, n° 1, 1990, p. 25-78 ; « L’exemple du Conseil constitutionnel français peut-il constituer un modèle pour le constitutionnalisme contemporain », in L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Troper, 2006, Economica, p. 551-578 ; « Le parlementarisme rationalisé juridique : une nouvelle forme de constitutionnalisme politique », in Les constitutionnalismes aujourd’hui, sous la direction de P. Bon et F. Moderne, Dalloz, Les grands colloques, 2002, p. 45-65.
29 D. Rousseau, « Le Conseil constitutionnel, instrument de la démocratie continue », RFDC, n° 1, 1990, p. 34-65.
30 Conseil constitutionnel, n° 85-186 DC, 25 août 1985, État d’urgence en Provence Sud, cons. 6.
31 M. Troper, « L’équilibre des pouvoirs grâce à l’institution d’une 3e chambre. Une lecture théorique », Droits, n° spécial, Le parlementarisme rationalisé moderne, 2001, p. 56-78.
32 O. Jouanjan, « L’impasse du contrôle de constitutionnalité français : le cas du contrôle politique juridique du Conseil constitutionnel », Revue des grands professeurs de Strasbourg, n° 7, 2000, p. 27-56.
33 L. Favoreu, « L’exemple du Conseil constitutionnel français peut-il constituer un modèle pour le constitutionnalisme contemporain ? », précit., p. 553.
34 Voir en particulier : L. Favoreu, « Pour un renforcement de l’exigence de régularité dans la production des lois : le contrôle obligatoire des lois ordinaires », Rec. Dalloz, Édito, 1970, p. 1123. B. Mathieu, M. Verpeaux, « Sur le caractère inéluctable du contrôle de constitutionnalité obligatoire », Revue des amis du Conseil constitutionnel, n° 7, 1974, p. 478-482. Voir également : F. Delpérée, « Un regard belge sur le droit français, la Sainte Victoire masquant le Garlaban : le contrôle de constitutionnalité a priori ne saurait être qu’obligatoire », Le Soir, Tribune, 16 décembre 1972 ; F. Moderne, « Une loi valide ne saurait être qu’une loi effectivement conforme à la Constitution », RFDA, 1972, n° 2, p. 583-578 ; R. Badinter, « Le Conseil constitutionnel doit contrôler toutes les lois », Le Monde, 17 janvier 1933.
35 Voir en particulier : L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel n’est pas une Cour constitutionnelle », RFDC, n° 4, 2000, p. 24-45.
36 Cette réforme ayant conduit à une augmentation du nombre de membres nommés au sein du Haut Conseil, celui-ci passant de 9 à 12 membres.
37 Voir cependant, contra : J. Jeanneney, « La légitimité juridictionnelle du Conseil constitutionnel : un faux débat », Revue officielle du Conseil constitutionnel, 2021, n° 66, p. 23-36. Il convient toutefois de rappeler que cet auteur n’a été membre du Conseil constitutionnel qu’après la publication de cet article, en 2022. J. Jeanneney n’a ainsi pas écrit cet article alors qu’il était membre de l’institution.
38 L’on peut penser, par exemple, aux nominations récentes des professeurs Didier Krajeski et Julien Théron.
39 Voir sur ce point L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel, entre le politique et le droit », Revue aixoise de droit constitutionnel, n° 1, 1990, p. 4-56.
40 Voir sur cette question, bien que quelque peu agiographique : J. Jeanneney, « Le Conseil constitutionnel, une composition sans question : élégie en l’honneur de ses membres », Revue officielle du Conseil constitutionnel, Numéro spécial Tous derrière le Conseil constitutionnel !, 2021, n° 67, p. 128‑178.
41 Même s’ils n’auront pas siégé au même moment.
42 Ce qui correspond en l’occurrence aux conditions exigées pour la nomination de membres des cours constitutionnelles européennes et, au-delà, à celles qui s’imposent pour les juges à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour européenne des droits de l’homme.
43 Voir cependant J. Jeanneney, « Le secrétaire général du Conseil constitutionnel, pilier indispensable du fonctionnement régulier de la 3e chambre parlementaire », Revue officielle du Conseil constitutionnel, n° 4, 2019, p. 23-45.
44 A. Bachert, « Le secrétaire général du Conseil constitutionnel, d’un simple rôle de coordinateur à un véritable chief justice à la française : retour sur un paradoxe français », Revue messine de droits international et comparé, 2018, n° 6, p. 56-78.
45 Voir d’ailleurs sur les modalités de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel : P. Égéa, « De l’écriture des décisions du Conseil constitutionnel », Revue Droit, poésie et Littérature, n° 1, 1998, p. 54‑58.
46 Voir pour un dernier état de cette opposition doctrinale et en faveur des opinions séparées : W. Mastor, « Nouveau retour sur les opinions séparées des juges constitutionnels. Pour une rédaction des opinions séparées en langues minoritaires et régionales », Édito, U populu Cursu, n° 0, 2000, p. 1.
47 Le secret des délibérations pouvant également expliquer, de manière partielle, l’obligation de motivation des jugements ou des arrêts.
48 F. Luchaire relève cependant qu’en pratique la nomination ou la promotion dans un ordre national, de la légion d’honneur ou du mérite a été admise. La Chancellerie de l’ordre du mérite a ainsi considéré que l’article 5 de l’ordonnance de 1958 devait être interprété strictement (Le Conseil constitutionnel, Tome I : Organisation et attributions, Economica, 1997, p. 80-81).
49 Voir sur cette question : G. Kalflèche, J.-G. Sorbara, « De la rationalisation du régime parlementaire à la régulation rationalisée de l’action administrative : l’exemple des autorités administratives indépendantes », Revue administrative du droit administratif, n° 467, 1999, p. 345-378.
50 L. Favoreu, « Les compétences du Conseil constitutionnel, illustration du modèle du parlementarisme rationalisé juridique », La Revue des amis du Conseil constitutionnel, n° 1, 1980, p. 45‑67.
51 L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel et le droit international », Revue européenne de droit international public, n° 1, 1978, p. 35. Voir également pour une approche dans le même sens : B. Bonnet, « Des rapports de systèmes aux systèmes des rapports », RTDE, n° 6, 2012, p. 34-67.
52 L. Favoreu, « Des modèles de justice constitutionnelle à l’anti-modèle français : l’exemple du Conseil constitutionnel », Revue critique du droit public, n° 4, 1985, p. 456.
53 Il faut rappeler que le projet de loi de révision constitutionnelle sur la saisine obligatoire avait été concurrencé par un autre projet de révision ouvrant la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 30 sénateurs, ainsi qu’à la Cour de cassation, au Conseil d’État et à la Cour des comptes. Ce projet permettait, non seulement à l’opposition d’accéder au Conseil constitutionnel pour lui faire trancher juridiquement le conflit politique qui l’oppose à la majorité, mais également au pouvoir juridictionnel de contester devant le Conseil constitutionnel une loi dont l’application concrète pouvait révéler son inconstitutionnalité.
54 L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel, aiguilleur de la production normative sous la Ve République », RFDC, n° 4, 1998, p. 567.
55 Voir sur ce point, pour une synthèse en français : M. Altwegg-Boussac, « Regard sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle : la garantie des droits entre constitutionnalismes politique et juridique », Jus juridicum, vol. VII.
56 Voir M. Tushnet, « Dialogic Judicial Review », Arkansas Law Review, vol. 61, 2008, p. 205.
57 Voir pour une analyse comparée de ce constitutionnalisme A. Bachert, Les rapports entre Cours suprêmes et législateurs dans les systèmes constitutionnels de Common law : recherches comparées sur la troisième voie du constitutionnalisme et la protection renouvelée des droits et libertés États-Unis, Canada, Royaume-Uni, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 2019, 542 p.
58 Voir sur les différentes modélisations la thèse de référence, proposant elle-même une nouvelle modélisation : J. Padovani, Essai de modélisation de la justice constitutionnelle. Pour une approche téléologique du contentieux constitutionnel, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 2022, 640 p. Voir, plus généralement, sur la distinction même entre concept, modèle et notion : X. Bioy, « Notions, concepts et modèles en droit : interrogation sur l’intérêt d’une distinction… », in Les notions juridiques, sous la direction de G. Tusseau, Economica, 2010, p. 21-34. Voir, surtout, pour une lecture lumineuse de toutes ces questions, l’ouvrage à paraître de R. Ponsard, De la modélisation des systèmes de justice constitutionnelle à l’analyse pluridimensionnelle du droit, Dalloz, Essai, 2025.
59 Voir pour un certain nombre d’anecdotes sur le contenu de ces discussions : O. Besancenot, Pour une lecture politique du Conseil constitutionnel. Témoignages d’un ancien membre du Conseil constitutionnel, Albin Michel, Essai, 2010, 345 p., spécial. le chapitre 3 de l’ouvrage : Des décisions fruits d’un compromis politique, p. 56 et s.
60 Sur l’exposé de la procédure délibérative devant le Conseil constitutionnel, celle-ci débutant, pour ce qui nous intéresse ici, par une discussion contradictoire entre le secrétariat général du gouvernement, le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les membres de cette dernière institution : A. Roblot‑Troizier, J. Bonnet, « La procédure délibérative du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois », La Revue des amis du Conseil constitutionnel, n° 2, 2010, p. 55-77.
61 N. Danelciuc-Colodrovsci, La Justice constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions et perspectives, Fondation Varenne, Collection des thèses, 2013, chapitre consacré à la réception doctrinale en Europe de l’Est du modèle du parlementarisme rationalisé juridique, p. 77-128.
62 Voir en l’occurrence pour une lecture détaillée des seuls systèmes juridiques des États membres de la CEI étudiés ensuite selon une lecture à partir du modèle parlementarisme rationalisé juridique : N. Danelciuc-Colodrovsci, La Justice constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions et perspectives, op. cit., 688 p.
63 Pologne, Arménie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Croatie.
64 Hongrie, Russie, Roumanie.
65 Voir plus largement sur cette question, XXXe Table ronde internationale de justice constitutionnelle, Les conditions de nominations des organes de contrôle de constitutionnalité des lois, AIJC, 1997, p. 148‑565.
66 Il est obligatoire en Russie, Biélorussie, Pologne, Croatie et Hongrie.
67 Russie, Biélorussie.
68 Arménie, Ukraine, Roumaine et Moldavie.
69 Voir plus spécialement sur le sujet : N. Danelciuc-Colodrovsci, C. Geynet-Dussauze, M. Stefanini-Fatin-Rouge (dir.), Repenser l’initiative législative dans et en dehors du Parlement. Approche comparée, Aix-en-Provence, PUAM, Collection de l’Institut Louis Favoreu, 2025, 506 p.
70 Voir pour une analyse approfondie sur cette notion : A. Vidal-Naquet, Les garanties légales d’exigences constitutionnelles dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : entre tout, rien, leurs contraires et réciproquement, Éditions Panthéon-Assas, Thèses, 2007, 672 p.
71 Voir pour une étude détaillée de ce recours au Portugal : L. Gay, « Le recours en omission législative inconstitutionnelle : gadget ou parachèvement de l’État de droit », in 40 ans d’application de la Constitution portugaise, sous la direction de D. Connil et D. Löhrer, Institut Universitaire Varenne, Collection Colloques et Essais, 2018, p. 219-235.
Xavier Magnon, « Commentaire de l’article du Doyen Louis Favoreu “Le Conseil constitutionnel, 3e chambre du Parlement, ultime raffinement du parlementarisme rationalisé”, RD publ. 1967, p. 5-120, in Les grands discours de la culture juridique, sous la direction de X. Magnon et A. Roblot-Troizier, Dalloz, Grands arrêts, 2017, 1re édition, p. 866-887 », Petites et grandes uchronies de droit public. Penser et voir le droit autrement [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 11 | 2025, mis en ligne le 17 novembre 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4611.