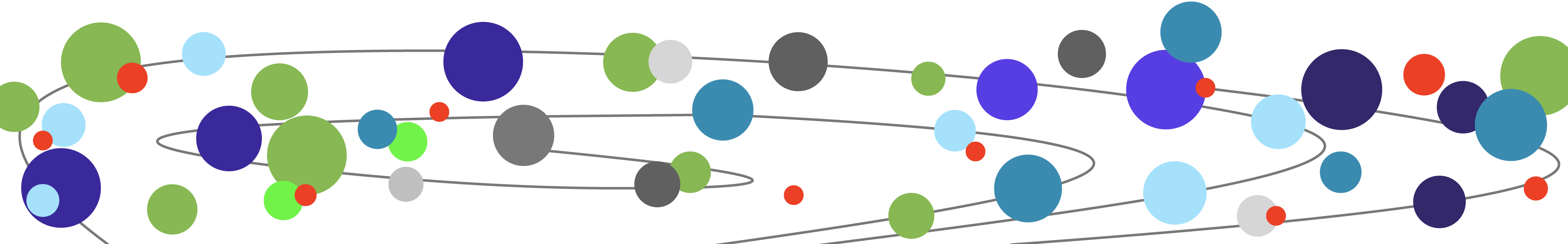Olivier Corten1
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Résumé : Dans cet entretien, le professeur Olivier Corten répond à diverses questions concernant la manière dont le droit international régit et peut régir la guerre. À quel point est-il exact de dire que la guerre est interdite ? Comment les États justifient-ils l’emploi de la force ? Quels sont les mécanismes de contrôle ? Quelle est leur efficacité et comment l’améliorer ? Faut-il réformer les Nations Unies et abolir le veto des membres permanents ? Le droit peut-il espérer contenir la force ? Autant de questions qui se sont posées avec acuité dans l’actualité récente.
Quel rapport le droit international entretient-il avec l’idée de guerre ? Comment ce rapport a-t-il évolué ?
Les rapports entre le droit international et la guerre ont toujours été ambivalents. D’un côté, en tant qu’héritier sécularisé du concept de « guerre juste », le droit international a historiquement été utilisé pour justifier la guerre. Tout comme l’Espagne a légitimé la conquête des Amériques par des arguments fournis par l’école de Salamanque au xvie siècle, les États européens ont fondé la colonisation sur des raisonnements proposés par les juristes de cette époque. Aujourd’hui encore, toute entrée en guerre (en Irak, en Syrie, au Yémen, en Ukraine ou ailleurs) s’accompagne d’une justification faisant appel au registre légal. En ce sens, le droit international et la guerre semblent inextricablement liés : car, dans la mesure où il n’existe par définition pas de super-gouvernement apte à faire respecter les règles qui le composent, ce n’est que par la force que les sujets de cet « ordre juridique » peuvent assurer son respect. D’un autre côté, cependant, la notion de guerre apparaît incompatible avec le postulat qui est à la base d’un droit international « libéral », fondé sur la souveraineté et l’égalité des États. Comment, en effet, concevoir qu’un État soit tenu de respecter un traité bilatéral (pacta sunt servanda) tout en admettant qu’il puisse envahir le territoire ou renverser par la force le gouvernement de l’autre État contractant (jus ad bellum) ? De ce point de vue, le droit ne peut se définir que par opposition à la guerre. Celle-ci ne peut donc qu’être prohibée, quitte à ce que cette prohibition soit assortie de limites ou d’exceptions dont l’interprétation est, en l’absence du fonctionnement effectif de mécanismes centralisés de qualification et de sanction, largement laissée à l’appréciation des États.
À première vue, on pourrait penser que l’association du droit international à la guerre serait plutôt associée à la période historique de sa constitution (xve‑xixe siècle), dans les conditions définies sous l’égide des puissances européennes, tandis que l’opposition entre les deux concepts correspondrait plutôt à la période contemporaine caractérisée par l’égalité des États (xxe–xxie siècle). Mais la réalité est plus complexe. D’abord parce que les deux schémas, loin de se succéder, ont plutôt historiquement cohabité : au xixe siècle, par exemple, l’interdiction (même limitée en comparaison avec la période actuelle) de la guerre ne valait qu’entre les sujets de l’ordre juridique en constitution, les États, les autres organisations politiques de la planète étant réduites à des terrae nullius sur lesquelles pouvaient se déployer les conquêtes militaires. Ensuite, parce que certaines traces de cette dualité de régimes n’ont pas disparu. Dans la lignée des réflexions mettant en lumière une lecture décoloniale du droit international, on peut estimer que la notion de « guerre contre la terreur » renvoie précisément à la possibilité de mener des actions militaires (qu’elles soient conventionnelles ou constituées de campagnes d’exécutions ciblées) contre des acteurs qui, quant à eux, ne pourraient se prévaloir des règles juridiques existantes. On pense en particulier aux groupes qualifiés de « terroristes », mais aussi aux « États défaillants » qui ne seraient plus habilités à se prévaloir de leur souveraineté. Les règles énoncées dans la Charte des Nations Unies ne seraient, finalement, applicables qu’aux relations entre certains acteurs des relations internationales qui, en définitive, renvoient essentiellement aux grandes puissances. Bien sûr, cette conception est contestée, spécialement par les pays du sud qui, au sein notamment des non-alignés, défendent une conception « horizontale » de l’ordre juridique en reconnaissant une applicabilité universelle et impérative de la prohibition de la guerre. Mais ces États admettent en même temps que cette horizontalité est brouillée, ne fût-ce que par la reconnaissance de pouvoirs étendus au Conseil de sécurité.
À quel point est-il exact de dire que la guerre est interdite ? Existe-t-il des exceptions à cette interdiction ?
Formellement, la guerre est explicitement et rigoureusement interdite dans l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, lequel étend même la prohibition à l’usage mais aussi à la menace d’usage de la force. On ne peut donc plus jouer sur la qualification de « guerre » pour justifier des opérations militaires, qu’elles soient « spéciales » (pour reprendre l’euphémisme utilisé par la Russie pour caractériser son attaque massive de l’Ukraine du 24 février 2022) ou non. Mais, au-delà de l’accord de principe sur cette interdiction, de profonds désaccords se font jour sur sa portée et ses limites, et ce bien au-delà de la question des sujets qui peuvent se prévaloir de cette règle qui a été exposée plus haut.
Ces désaccords portent d’abord sur la portée de l’article 2 § 4, qui ne vise que l’usage de la force « incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cette formulation permet, a contrario, de justifier des interventions militaires menées sur le territoire d’un État avec son consentement, lesquelles semblent relever de la coopération internationale plus que de la force. Mais à quelles conditions ? Comme l’illustre la crise actuelle du Niger (ou, plus anciennement, la situation au Yémen), des questions peuvent se poser au sujet de l’autorité habilitée à donner son consentement, spécialement en cas de pouvoirs concurrents. Par ailleurs, une intervention consentie peut-elle être considérée comme conforme aux principes des Nations Unies (dont celui du droit de chaque peuple, compris ici comme la population d’un État à déterminer sans ingérence extérieure son régime politique) lorsqu’elle consiste à aider un gouvernement à réprimer un mouvement interne de révolte ou de rébellion ? Enfin, et on peut penser ici aux retraits récents de l’armée française du Mali ou du Niger, lorsqu’un consentement à la présence de troupes sur un territoire est retiré, quel est le délai dont disposent ces troupes pour évacuer le territoire concerné ? Un autre problème d’interprétation lié à la portée de l’article 2 § 4 renvoie à la possibilité d’une action militaire autorisée par le Conseil de sécurité. Comme la guerre d’Irak de 2003 l’a illustré, il se peut que la portée dans le temps de certaines résolutions soit discutée, spécialement dans la mesure où ces résolutions ne sont pas formellement abrogées. Par ailleurs, et on peut cette fois se tourner vers le précédent de la Libye en 2011, comment déterminer quelles sont les « mesures nécessaires » (la formule généralement utilisée dans les résolutions pertinentes) pour remplir les objectifs énoncés ? La poursuite d’objectifs humanitaires énoncés dans une résolution peut-elle justifier une opération militaire visant à un changement de régime ? Paradoxalement, la centralisation du recours à la force n’ôte pas le pouvoir de qualification des États intervenants, avec toutes les conséquences que cela entraîne, y compris sur la crédibilité du mécanisme. C’est sans doute ce qui explique que, après la crise libyenne, le Conseil de sécurité ait vu son autorité largement compromise, notamment lors de la crise syrienne. Reste, et ceci est sans doute plus controversé encore, le cas de la légitime défense énoncé à l’article 51 de la Charte. Certains y voient une exception, d’interprétation stricte, à l’article 2 § 4. En résulte généralement l’exclusion de toute guerre préventive ou menée, sans guère d’encadrement, contre des groupes terroristes. D’autres mettent l’accent au contraire sur sa qualité de « droit naturel » nommément énoncé dans la Charte, et ont tendance à en élargir la portée. Ici encore, il est difficile de dégager une interprétation qui serait juridiquement la seule correcte. Tout au plus peut-on constater que la majorité des États privilégie une conception stricte limitant les possibilités d’user de la force, ce qui s’explique en grande partie par le fait que ces États (pour la plupart du sud) en sont les principales cibles.
Comment la Russie a-t-elle justifié son intervention en Ukraine au regard de ces règles ? Cette justification était-elle pertinente ?
La Russie a immédiatement élaboré une argumentation juridique pour justifier son « opération militaire spéciale ». En application de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, elle a envoyé, dès le 24 février 2022, jour de son lancement, une lettre au Conseil de sécurité en se prévalant de la « légitime défense ». Si on suit son raisonnement, les « Républiques » de Donetsk et de Louhansk seraient devenues des États indépendants trois jours plus tôt, le 21 février. Comme l’Ukraine a poursuivi des opérations militaires contre ces entités sécessionnistes dans les jours qui ont suivi, la Russie en a déduit qu’il s’agissait d’une agression armée menée contre deux nouveaux États souverains. Ceux-ci se seraient donc trouvés en situation de légitime défense, et auraient pu valablement appeler la Russie à l’aide pour repousser l’agresseur.
L’argument juridique de la Russie présente, il faut l’admettre, une certaine originalité. Elle s’appuie sur une institution reconnue, la légitime défense collective, en l’associant avec une reconnaissance unilatérale d’État et qui se veut constitutive des deux entités sécessionnistes. On ne connaît guère comme précédent que celui de Panama (reconnu unilatéralement par les États-Unis au début du xxe siècle pour justifier ensuite une opération militaire à l’appui de ce qui était alors une entité qui tentait alors de faire sécession de la Colombie), un précédent bien antérieur à la mise en place du régime de la Charte des Nations Unies. Un régime qui apparaît en décalage profond avec l’argument russe : la définition de l’agression énoncée dans la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale exclut clairement que le critère de la reconnaissance puisse jouer pour justifier un recours à la force. Selon cette définition, en effet, une agression est l’usage de la force d’un État contre un autre État, une « note explicative » ajoutant que « dans la présente Définition, le terme État : a) est employé sans préjuger la question de la reconnaissance […] ». En d’autres termes, l’existence d’un État doit être envisagée de manière objective, et non sur la base de la volonté de tel ou tel autre État. Dans la mesure où les « Républiques » du Donbass ne disposaient pas de gouvernements souverains, c’est-à-dire indépendants d’un pouvoir supérieur (en l’occurrence ukrainien, mais aussi russe), on ne pouvait les considérer comme des États. Les opérations militaires entre ces entités et l’armée ukrainienne ne relevaient donc pas des relations internationales et devaient être envisagées dans le contexte d’un conflit interne, sans possibilité de se prévaloir de la légitime défense (individuelle ou collective). C’est pourquoi l’Assemblée générale a explicitement condamné la Russie pour son opération militaire, de nombreux États estimant d’ailleurs que la reconnaissance des entités sécessionnistes était elle-même problématique au regard du droit international.
De manière plus indirecte, la Russie a également prétendu qu’elle réagissait à un génocide dont auraient été victimes les populations de l’est de l’Ukraine. De ce point de vue, Moscou semblait (mais, de manière significative, une telle argumentation n’a finalement pas été assumée) se prévaloir d’une sorte de « droit d’intervention humanitaire » qui pourrait être exercé, au nom d’une nécessité impérieuse et urgente, sans l’autorisation du Conseil de sécurité. L’Ukraine a quant à elle saisi la Cour internationale de Justice en estimant à la fois qu’aucun génocide n’avait été commis et que, en tout état de cause, la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide n’ouvrait à aucun droit d’action militaire unilatérale pour la faire respecter. Dans une ordonnance rendue le 3 mars 2022, la Cour a donné suite aux arguments de l’Ukraine en estimant qu’il était « douteux que la convention, au vu de son objet et de son but, autorise l’emploi unilatéral de la force par une partie contractante sur le territoire d’un autre État, aux fins de prévenir ou de punir un génocide allégué » (§ 59). Cette position reflète une interprétation largement dominante : la « responsabilité de protéger », admise en 2005 par les membres de l’ONU, permet au Conseil de sécurité de prendre des mesures, y compris militaires, contre un État qui ne veut ou ne peut pas mettre fin à des crimes graves de droit international (Assemblée générale, résolution 60/1, § 138 et 139). A contrario, des États ou des groupes d’États ne peuvent s’ériger en justiciers de la communauté internationale en agissant de manière unilatérale.
Au-delà du cas ukrainien, l’interdiction de la guerre fait-elle consensus au sein de la communauté internationale ou est-elle encore l’objet d’un débat ?
Les autorités russes avaient sans doute parfaitement conscience de la faiblesse de leur argumentation juridique. Mais elles ont préféré en produire une, fondée essentiellement sur l’institution classique de la légitime défense, plutôt que d’opter pour un discours cynique mettant en cause l’existence même du droit international, ou encore pour l’invocation de nouvelles justifications susceptibles de légitimer plus largement un recours à la force. Le constat est significatif : personne, même dans les cas apparemment les plus flagrants de mise en cause de la prohibition du recours à la force, ne semble assumer formellement une telle mise en cause. On vient de le voir avec la Russie, mais une même conclusion pourrait être tirée en élargissant l’analyse, qu’il s’agisse de la guerre contre l’Irak de 2003 ou de l’intervention militaire de l’OTAN contre la Yougoslavie en 1999, par exemple.
De ce point de vue, l’interdiction de la guerre fait toujours consensus. Après le 11 septembre 2001, l’idée avait été émise d’assouplir considérablement le régime de la Charte pour permettre une lutte plus efficace contre le terrorisme. Mais, après plusieurs années de débat, la résolution adoptée par l’Assemblée générale a explicitement consacré le maintien d’une conception orthodoxe basée sur les textes de 1945 (résolution 60/1, Sommet mondial 2005). Ni la guerre préventive ni, on l’a vu, le droit unilatéral d’intervenir pour des motifs humanitaires n’ont été admis, les risques d’instabilité étant considérés comme trop élevés par rapport aux avantages supposés d’un tel assouplissement. Plus fondamentalement, le maintien de l’interdiction du recours à la force correspond d’ailleurs bien aux fonctions du droit dans une société internationale de type libéral. D’une part, la guerre est nuisible à la bonne marche des affaires : elle entrave la fluidité des échanges et entrave la sécurité des investissements. D’autre part, elle reste, à raison, considérée comme la plus grande menace pour le respect des droits humains, lesquels ne sont jamais autant bafoués qu’en situation de conflit armé. Il existe donc des facteurs structurels qui expliquent le maintien du régime prohibitif, au moins dans l’ordre du discours.
Quels sont les mécanismes de contrôle en charge de faire respecter cette interdiction ?
Formellement, les mécanismes de contrôle sont variés. On pense en premier lieu au Conseil de sécurité, auquel les États ont confié la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil a ainsi le pouvoir non seulement de superviser une riposte à une agression (comme il l’a fait en 1990‑1991 à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak) mais aussi de mener ou autoriser des opérations militaires en cas de menace contre la paix (comme l’illustrent de nombreux précédents, de la Yougoslavie, le Rwanda ou la Somalie dans les années 1990 à la Libye ou à la Côte d’Ivoire dans les années 2010). Au-delà de cet organe politique, la Cour internationale de Justice est un organe judiciaire qui peut jouer un rôle dans la résolution de différends portant sur la licéité de conflits. Elle a ainsi forgé une jurisprudence relativement cohérente, que ce soit pour condamner les États-Unis pour leur intervention au Nicaragua (1986), l’Ouganda pour la guerre menée en République du Congo (2005) ou encore pour critiquer incidemment certaines argumentations juridiques, comme lors des guerres contre la Yougoslavie (1999) ou l’Ukraine (2022). Ainsi a-t-elle fourni des arguments en faveur d’une interprétation plutôt rigoureuse de l’interdiction du recours à la force. La Cour pénale internationale, de son côté, est théoriquement compétente pour juger des individus coupables du crime d’agression, même s’il n’existe à ce jour aucun précédent. Enfin, au-delà des institutions, et comme cela a d’emblée été indiqué, le caractère (encore ?) largement décentralisé de l’ordre juridique international délègue aux États la possibilité de réagir, y compris militairement, aux violations graves de l’interdiction du recours à la force. L’exemple des mesures prises contre la Russie à la suite de son agression de l’Ukraine montre toute l’étendue des sanctions qui peuvent être adoptées en ce sens, même si l’engagement militaire reste minimisé pour des raisons essentiellement politiques.
Ces mécanismes sont-ils efficaces ?
Les institutions existantes offrent un cadre et fournissent des outils qui peuvent permettre de sanctionner des États agresseurs. Cela peut présenter une certaine efficacité, comme on a pu le voir, une fois encore, avec le précédent de la guerre du Golfe de 1991, présentée comme fondateur d’un nouvel ordre mondial. À l’époque, Saddam Hussein avait d’ailleurs utilisé l’argument du « deux poids, deux mesures », en relevant que les sanctions frappant l’Irak contrastaient avec l’impunité d’Israël qui, pourtant, occupait les territoires palestiniens depuis plus de 20 ans. Son argument avait été rejeté : la question palestinienne serait rapidement traitée, avait-on aussitôt assuré, et les accords d’Oslo avaient semblé donner dans un premier temps un certain crédit à cette soudaine aspiration à faire respecter universellement la Charte des Nations Unies. Les décennies qui ont suivi ont rapidement montré toutes les limites d’un tel récit. En dépit de la très large reconnaissance de la Palestine comme État, de la poursuite de l’occupation israélienne des territoires palestiniens et du développement de leur colonisation, aucune mesure n’a été prise pour régler la question. Les outils, qu’il s’agisse du Conseil de sécurité (bloqué par les États-Unis y compris lorsqu’il s’agit de condamner les crimes commis sur le terrain et d’en appeler à une aide humanitaire aux victimes) ou des juridictions internationales (y compris la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide), sont toujours disponibles. Mais ils ne sont pas opérationnels. L’inefficacité patente du régime de la Charte, et plus généralement du droit international, est alors logiquement soulignée. En même temps, si l’on envisage ce dernier comme un discours dont l’application est toujours subordonnée à une volonté et à des combats politiques, le problème change de nature. Il est, avant tout, à poser et à traiter dans le champ politique, et non dans le champ juridique lui-même. Pour le dire autrement, il ne sert peut-être à rien (ou en tout cas pas à grand-chose) d’adopter de nouveaux accords ou de nouvelles résolutions pour régler un conflit de ce type. Il faudrait, avant tout, avoir le courage politique de faire appliquer les principes qui existent déjà…
Comment pourraient-ils être améliorés, à la fois dans l’idéal et de façon plus réaliste ?
Si on pose la question de cette manière, une réforme du régime juridique n’apparaît pas comme la priorité. Mais rien n’empêche pour autant d’y réfléchir. Bien sûr, on pourrait penser à la création d’une armée et d’un comité d’état-major de l’ONU, qui agirait de manière indépendante et impartiale et déciderait, au cas par cas, de sanctionner un État agresseur ou dangereux. Il suffirait d’ailleurs d’interpréter certaines dispositions de la Charte pour s’engager dans cette voie. Deux tempéraments doivent cependant aussitôt être apportés. D’une part, le scénario bute immédiatement sur des considérations plus réalistes, les États n’étant pas prêts à renoncer à ce qu’ils estiment comme relevant du cœur de leur souveraineté : la décision d’entrer en guerre. D’autre part, et quand bien même une telle utopie devait se réaliser un jour, ce jour marquerait paradoxalement la fin du droit international, en tout cas dans sa forme contemporaine. Car, si l’ONU disposait d’un pouvoir centralisé de sanction à l’encontre de tous ses membres, on serait sans doute devant un modèle juridique plus assimilable à une (con)fédération que d’un authentique droit interétatique. Sans aller jusqu’à un tel bouleversement (qui, pour radical qu’il soit, peut parfaitement être envisagé), on pourrait, plus modestement, imaginer renforcer le pouvoir de qualification des juridictions internationales existantes. La Cour internationale de Justice, qui ne peut actuellement exercer sa compétence que moyennant un accord des États, serait ainsi ouverte à toute saisine unilatérale, ce qui lui permettrait d’objectiver les qualifications liées à la licéité ou à l’illicéité d’une guerre. À tout le moins, on pourrait envisager que la Cour puisse rendre, d’initiative, des avis consultatifs sur une telle question. Ici encore, un tel scénario tend à dépasser une optique réaliste. Mais, après tout, se complaire dans cette dernière revient à se cramponner à une vision conservatrice, voire justificatrice, de la situation existante.
Une réforme de la Charte des Nations Unies aurait-elle changé quelque chose au conflit en Ukraine ?
Non, il est difficile de l’imaginer. La Russie a envahi l’Ukraine, qui est un État agressé et qui dispose d’un droit de légitime défense, individuelle ou collective. Cela signifie que tout autre État appelé à l’aide par Kiev pourrait juridiquement riposter militairement, y compris sur le territoire de la Russie, État agresseur. Dans ce contexte, la paralysie du Conseil de sécurité, dû au veto russe (qui, on l’a vu, a mené l’Assemblée générale à se saisir de la question), ne pose aucun obstacle particulier à l’usage de la force de la part des États tiers sur le fondement de l’article 51 de la Charte. Ceux-ci, en tout cas ceux qui ont souhaité soutenir l’Ukraine, s’en sont gardés, et ont préféré fournir des armes à l’Ukraine, tout en niant être eux-mêmes devenus des parties au conflit. Dans la réalité juridique, ces États ont pourtant parfaitement le droit, au titre de la légitime défense collective, d’entrer en guerre contre la Russie. Cette dernière ne pourrait en tirer aucun argument justifiant une riposte contre les alliés de l’Ukraine. Mais le discours des alliés de Kiev s’explique par des considérations non pas juridiques mais politiques. Pour des raisons évidentes liées aux rapports de force, personne ne souhaite assumer une entrée dans un conflit contre une puissance nucléaire… Une fois encore, le problème ne renvoie pas à l’inexistence ou à l’insuffisance d’outils spécifiquement juridiques. Il relève, avant tout, du champ politique.
Plus spécifiquement, la disparition du veto dont disposent les membres permanents du Conseil de sécurité serait-elle de nature à pacifier les relations internationales ?
Il est difficile de le démontrer. La disparition du veto permettrait évidemment au Conseil de sécurité d’adopter plus facilement des résolutions. Pour autant, serait-ce de nature à pacifier les relations internationales ? Deux éléments incitent au scepticisme. D’abord, l’adoption d’une résolution contre la volonté d’une grande puissance risque bien de rester lettre morte, à défaut de coopération. Or, l’idée fondant le droit de veto, basée sur un réalisme bien compris entre les alliés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, était précisément de s’assurer que les résolutions aient une chance d’être respectées. Pendant la période de la Société des Nations, l’absence du droit de veto avait ainsi abouti à la multiplication de textes restés sans suite, ce qui tendait à miner la crédibilité de l’organisation et, par répercussion, à menacer la paix internationale. En deuxième lieu, le droit de veto peut être perçu comme une garantie empêchant qu’une décision aussi importante que le déclenchement d’une guerre soit prise directement à l’encontre d’une superpuissance, nucléaire de surcroît. La préoccupation est réaliste (on veut éviter un conflit mondial) mais témoigne aussi d’une préoccupation liée à la légitimité : on veut aussi empêcher qu’une majorité impose une décision aussi cruciale à une minorité, le cas échéant à la suite de pressions ou de manœuvres diverses visant des membres non permanents dont le vote est requis pour atteindre la majorité spéciale de neuf voix. On se souvient à cet égard du discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité au début de l’année 2003, dans lequel le ministre des Affaires étrangères a très clairement brandi la menace d’un veto français pour contrer les velléités étasuniennes d’obtenir un vote en faveur d’une guerre contre l’Irak. À l’époque, le veto a pu être considéré comme un outil légitime prévenant les abus et comme un moyen d’éviter de justifier par le droit une guerre meurtrière qui a déstabilisé durablement la région. La question du veto n’est donc pas simple. Peut-être pourrait-on le maintenir pour certaines questions comme l’usage de la force, et l’écarter lorsqu’il s’agit plus simplement de condamner un usage de la force, ou de transférer une situation à la Cour pénale internationale. Ou, alternativement, on pourrait imaginer que l’Assemblée générale interprète souplement ses compétences pour pallier le blocage du Conseil, toujours dans les hypothèses où il ne s’agit pas de décider d’un recours à la force. Ici encore, les considérations réalistes doivent être articulées avec une indispensable dose d’idéalisme, seul à même de faire progresser un système imparfait.
Le droit peut-il espérer contenir l’emploi de la force armée ? Peut-il le faire à lui seul ? Quelles seraient les conditions d’une paix perpétuelle ?
La question est particulièrement vaste, et ouvre à des réflexions de philosophie politiques aussi variées que complexes. De manière générale, je reste plus séduit par une justice procédurale, basée sur un débat ouvert et pluriel à mener au sein d’une institution, que sur une justice substantielle qui permettrait à chaque État (ou groupe d’États, autoproclamé comme incarnant la civilisation ou la communauté internationale) d’agir unilatéralement. Dans cette optique, la question est moins de déterminer à quelles conditions on peut recourir à la force que de savoir qui peut prendre la décision, et dans le cadre de quelle procédure. C’est pourquoi le régime de la Charte, qui renvoie à un débat au sein du Conseil de sécurité, me semble présenter, avec toutes ces limites, une certaine légitimité. Cependant, comme on l’aura compris à la lecture des pages qui précèdent, je pense quant à moi que, en tant que tel, le droit ne peut rien « faire », et encore moins « à lui seul ». Le droit peut en revanche être mobilisé et utilisé par les acteurs du champ juridique international, qu’il s’agisse des États mais aussi des ONG ou des individus. Son évolution comme son application dépendent de rapports de force et non (en tout cas essentiellement) de l’imagination de juristes. Il revient à chacun·e d’entre nous de s’engager, si on l’estime légitime, pour éviter les affres de la guerre. Cet engagement peut prendre la forme d’une argumentation juridique. Car le droit reste un cadre de référence symboliquement fort pour contester la légitimité d’une guerre, quand bien même la mobilisation de ce cadre ne constitue nullement une garantie de succès. Pour en augmenter les chances, d’autres combats, plus politiques ceux-là, apparaissent comme incontournables.
Propos recueillis par Romain Le Bœuf (Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France) et Caterina Severino (Professeur à Sciences Po Aix, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France).
1 L’entretien a été mené avant les attaques terroristes du 7 octobre 2023 et la réplique militaire du gouvernement israélien dans la bande de Gaza.
Olivier Corten (propos recueillis par Romain Le Bœuf et Caterina Severino), « Le droit international et la guerre », Le retour de la guerre [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 12 | 2023, mis en ligne le 17 décembre 2023. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2461.