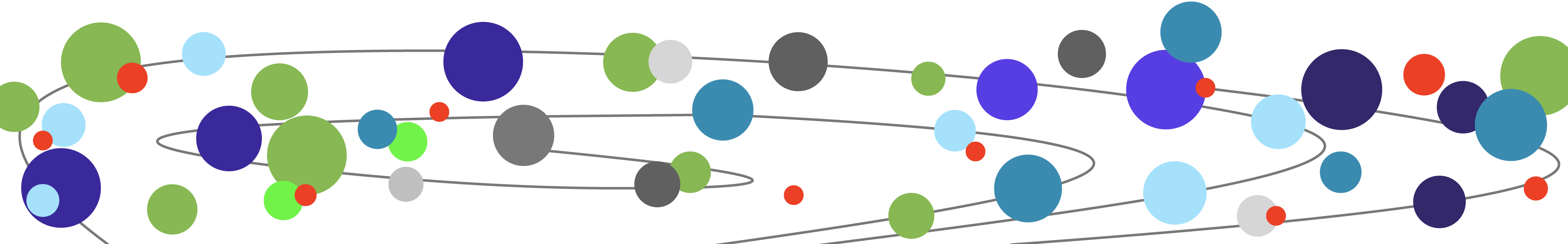Michel Levinet, Professeur honoraire de l’Université de Montpellier
Dans tout humanisme il y a un élément de faiblesse qui vient […] de sa tolérance et de son penchant pour un scepticisme indulgent, en un mot de sa bonté naturelle. Et cela peut, en certaines circonstances, lui devenir fatal. Ce dont nous aurions besoin aujourd’hui, ce serait un humanisme militant, un humanisme qui affirmerait sa virilité et qui serait convaincu que le principe de la liberté, de la tolérance et du libre examen n’a pas le droit de se laisser exploiter par le fanatisme sans vergogne de ses ennemis […][1].
1. Évoquer un abus de droit suppose un dépassement des limites de l’exercice d’un droit, autrement dit l’hypothèse de son exercice illégitime. Présente également dans d’autres instruments normatifs relatifs aux droits et libertés, internationaux (DUDH, Art. 30 ; PIDCP, Art. 5 § 1) et internes (Loi fondamentale allemande, art. 18 ; Constitution turque, art. 14), la clause inscrite dans l’article 17 de la CEDH a pour fonction d’empêcher les individus et les groupes d’instrumentaliser les droits et libertés qu’elle garantit en vue de leur destruction. Elle vise la sauvegarde des valeurs de la société démocratique qui en sont le support, à savoir les valeurs constitutives de l’ordre public européen, conçu comme « un ensemble de règles perçues comme fondamentales pour la société européenne et s’imposant à ses membres »[2], autrement dit comme un ensemble de valeurs au centre desquelles figure les principes du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, « sans lesquels il n’est pas de société démocratique » (selon les formulations de l’arrêt fondateur Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49[3]). En sanctionnant le possible détournement de ses dispositions, la CEDH fait donc du mécanisme de l’article 17 l’un[4] des instruments de sauvegarde de la société démocratique, laquelle, ainsi que le montre l’analyse de l’imposant corpus prétorien bâti par le juge européen, constitue le standard « qui domine la Convention tout entière »[5], permettant de juger de la normalité des limitations apportées aux droits et libertés qu’elle énonce. Cet élément est essentiel quand on considère que la Cour EDH qualifie la CEDH d’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » (Loizidou c. Turquie, [exceptions préliminaires], 23 mars 1995, § 75).
2. Étant donné qu’il autorise la déchéance du droit dont la violation se trouve invoquée, l’étude critique de l’application de l’article 17 par le juge de Strasbourg s’impose afin de lever les doutes que ne peut pas ne pas soulever la mise en œuvre d’un mécanisme susceptible d’être jugé anormal voire indigne d’une authentique démocratie – dans la mesure où, alors même qu’il a été pensé comme un mécanisme d’autodéfense de cette dernière, il semble consister pour la liberté à réprimer la liberté en paraissant emprunter les armes de ses adversaires – et qui, de ce fait, se trouve fortement discuté (III). De telles réserves sont compréhensibles eu égard à la rigueur des effets radicaux induits par ce dispositif (I). Elles doivent néanmoins être relativisées lorsque l’observateur examine de près l’usage particulièrement parcimonieux voire erratique qu’en fait la Cour EDH, au point qu’il est permis de se demander si elle satisfait à son office de gardien de l’ordre public européen (II).
I. Un mécanisme redoutable
3. Il faut d’emblée rappeler que la Cour EDH a très tôt précisé que son invocation ne saurait légitimer la déchéance des droits intangibles (Art. 2 : droit au respect de la vie ; Art. 3 : droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Art 4. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé ; Art. 7 : pas de peine sans loi), ou du droit à la liberté et à la sûreté (Art. 5) ou encore de ceux liés au principe de la prééminence du droit (articles 6, 7 et 13)[6].
4. La possibilité de recourir à la clause de l’article 17 est très souvent présentée[7] comme illustrant la formule No freedom for the fœs of freedom/Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, laquelle renvoie à l’un des leaders montagnards de la Révolution française : Saint-Just. Pourtant, si l’expression se trouve utilisée le 10 octobre 1793 dans son Rapport sur la nécessité de déclarer le gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix, il ne faut pas en faire une lecture anhistorique en perdant de vue le contexte singulier dans lequel intervient un tel propos : instauration de la Terreur et de la dictature de salut public à l’égard des contre-révolutionnaires. En effet, la formulation est conçue par lui comme indissociable de sa distinction – présente également chez Robespierre – entre le « gouvernement révolutionnaire » (qui suppose le recours à la Terreur) et le « gouvernement constitutionnel »[8] ; elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime démocratique qui chercherait à se défendre contre des propos et/ou des actes visant à le détruire[9].
5. Les commentateurs de la jurisprudence européenne évoquent nécessairement la radicalité inhérente à la clause d’interdiction de l’abus de droit. Ils se réfèrent à son « effet couperet », ou « effet guillotine », selon la formulation de Jean-François Flauss[10]. En effet, dès lors que son invocation est estimée opportune, le juge de Strasbourg déclare la requête qui lui est présentée comme incompatible ratione materiae avec la Convention. Puisque son usage a révélé une intention de nuire/de détruire les valeurs de la société démocratique, le droit dont la violation est invoquée ne saurait constituer un droit garanti par la Convention : en effet, l’auteur de la requête invoque un droit absent, non garanti, bref introuvable dans la Magna carta européenne. Par exemple, un usage de la liberté d’expression en vue de diffuser un message incitant à la haine, à la violence, au racisme, à la xénophobie, à l’antisémitisme ou encore à l’islamophobie constitue un usage abusif qui ne peut bénéficier, en tant que message ouvertement liberticide, de la protection du système de garantie de la CEDH. Ce faisant, la Cour n’entre aucunement dans l’interrogation classique sur la réalité de l’existence de l’ingérence contestée, sa prévisibilité, ou encore sur la légitimité du ou des buts poursuivis ainsi que dans le contrôle habituel de la proportionnalité de l’ingérence étatique qui implique une mise en balance argumentée entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels. Ici, au contraire, l’office du juge européen s’arrête au simple stade de la recevabilité de la demande ; il se borne à vérifier si le propos et/ou le comportement litigieux vise ou non à la destruction des droits et libertés protégés par la CEDH. Il se traduit par une décision (brutale ?) d’irrecevabilité – « sanctionn[ant] immédiatement et définitivement l’abus de droit »[11] – et non par un arrêt se prononçant sur le fond de la prétention des requérants.
II. Une pratique erratique
6. Le juge de Strasbourg a toujours considéré que le mécanisme de l’article 17 était doté d’un « caractère accessoire » et devait faire l’objet d’un usage « exceptionnel »[12], s’agissant de discours ou de comportements suffisamment graves et non équivoques. Cette disposition constitue donc « un moyen exorbitant qui ne saurait être accepté que dans les cas les plus graves et pour certains types de droits »[13]. Pour autant, nombre d’auteurs[14] – y compris des juges de la Cour[15] – ont relevé les incohérences de sa mise en œuvre. Établie régulièrement par le Greffe, une typologie utile, destinée à classer les hypothèses susceptibles de relever de la clause de l’article 17 existe (Guide sur l’article 17 de la CEDH. Interdiction de l’abus de droit[16][17]. Cependant, elle ne permet pas de construire une présentation synthétique et critique des solutions retenues. La démarche retenue ci-dessous comporte trois temps distinguant les situations[18] ayant abouti à une application directe de la clause de déchéance ; celles où la Cour se refuse – de façon parfois discutable – de le faire ; celles, enfin, où l’article 17 fait l’objet d’une application indirecte, à savoir qu’il sert, dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de l’ingérence contestée dans l’exercice des droits du requérant, en tant qu’aide à l’interprétation afin de conforter une conclusion allant dans le sens de la nécessité de l’ingérence litigieuse. Le fait qu’un requérant cherche à faire usage d’un droit garanti par la Convention dans un but contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention pèse alors d’un grand poids.
7. a) Le recours direct à la clause d’interdiction de l’abus de droit a d’abord été le fait de la Commission EDH : Parti communiste d’Allemagne, déc. 20 juillet 1957 (les objectifs avoués de ce parti dissous étaient l’instauration de « l’ordre social communiste par la voie de la révolution prolétarienne et la dictature du prolétariat » ; « le recours à la dictature […] est incompatible avec la Convention en ce qu’il comporte la destruction de nombre des droits ou libertés consacrés par la CEDH »)[19] ; Glimmerveen et a. c. Pays-Bas, déc. 11 octobre 1979 (condamnation de deux hommes politiques, membres d’un parti xénophobe ayant comme projet d’expulser des Pays-Bas tous les étrangers n’étant pas de race blanche, auteurs de propos racistes : « le but général de l’article 17 est d’empêcher que des groupements totalitaires puissent exploiter en leur faveur les principes posés par la Convention »).
b) La Cour l’a utilisée à propos : de la lettre adressée à un historien connu niant l’imputation à Hitler et au parti nazi des camps de concentration visant à éliminer les Juifs (Hans-Jürgen Witzsch c. Allemagne (déc. 13 décembre 2005, n° 7485/03) ; de la condamnation pour des publications incitant à la haine envers le peuple juif (Pavel Ivanov c. Russie (déc. 20 février 2007, n° 35222/04), du refus de la création d’une Association des victimes polonaises victimes du bolchevisme et du sionisme (W. P. et a. c. Pologne (déc. 2 septembre 2004, n° 42264/98) ; de propos islamophobes (déc. 16 novembre 2004, n° 23131/03, Nordwood c. Royaume-Uni, requérant ayant apposé sur la fenêtre de son appartement une affiche présentant une photographie des tours jumelles du Word Trade Center en flammes avec l’inscription « L’islam, dehors ! – Protégeons le peuple britannique »)[20] ; de l’interdiction des activités d’une association islamiste préconisant le recours à la violence dans le but de détruire l’État d’Israël, d’expulser et de tuer ses habitants et de renverser les gouvernements dans le monde musulman (déc. 12 juin 2012, n° 31098/08, Hizb at-Tahrir et a. c. Allemagne ; d’une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste (Hizb at-Tahrir) aspirant à imposer la règle islamique et un régime fondé sur la charia dans le monde entier, si nécessaire en recourant à la violence [Kasymakhunov et Saybatalov c. Russie, 14 mars 2013] ; d’une condamnation pénale consécutive à la diffusion de vidéos mises en ligne sur la plateforme YouTube dans lesquelles figuraient des appels à dominer les non-musulmans et à les combattre [déc. 27 juin 2017, n° 34367/14, Belkacem c. Belgique] ; d’une condamnation pénale prononcée pour diffusion de matériel de propagande communiste appelant à un renversement violent du régime politique [Romanov et a. c. Ukraine, 16 juillet 2020]. De même dans une affaire où une société exploitant une chaîne de télévision s’était vu retirer sa licence de diffusion en raison de son apologie des actes terroristes du Parti kurde des travailleurs [déc. 17 avril 2018, n° 24683/14, Roj TV A/S c. Danemark]. Autre exemple d’application directe de l’article 17 à propos de la dissolution d’une association d’extrême droite à visée d’endoctrinement paramilitaire, raciste et antisémite qui exprimait sa sympathie à l’égard de figures de la collaboration avec l’Allemagne nazie, faisait l’apologie de l’idéologie du régime de Vichy, et notamment de ses lois raciales, et organisait des camps d’entraînement paramilitaires aux fins d’endoctriner de jeunes militants [Ayoub et a. c. France, 8 octobre 2020, § 130-134, 137 et 139].
c) Il faut aussi citer et s’arrêter quelque peu sur deux décisions particulièrement importantes (déc. 24 juin 2001, n° 65831/01, Garaudy c. France, condamnation pour contestation de crimes contre l’humanité[21] ; déc. 20 octobre 2015, n° 25239/13, M’Bala M’Bala c. France[22], condamnation de l’artiste Dieudonné pour injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou confession juive) qui intéressent la question essentielle du négationnisme du génocide juif[23]. En 1982, à propos d’une interdiction d’exposer des brochures niant l’assassinat de millions de Juifs, qualifié de « mensonge » et d’« escroquerie sioniste » sans appliquer directement l’article 17, la Commission EDH avait mis en évidence la singularité de la Shoah en affirmant que ce « fait historique » constituait « un fait notoire, établi avec certitude par des preuves écrasantes de tous genres » (déc. 16 janvier 1982, n° 9235/81, X. c. RFA). Naturellement, la dénégation de ce crime absolu entre pleinement dans le cadre de l’interdiction de l’abus de droit. Ainsi que l’écrit Patrick Wachsmann, « la négation du génocide perpétré par les nazis et leurs complices à l’encontre des Juifs fait partie du projet génocidaire lui-même »[24]. Ce faisant, il dévoile sa véritable nature : indissociable du racisme, il est un facteur d’exclusion profondément destructeur du tissu social. »[25].
Ancien membre éminent du PCF, stalinien intransigeant puis communiste réformateur avant de se convertir au catholicisme puis à l’islam, Prix Kadhafi des droits de l’homme (2002), Roger Garaudy[26] contestait sa condamnation pénale pour contestation de crimes contre l’humanité sur le fondement d’une législation[27] qu’il présentait comme « un mécanisme de censure restreignant de façon abusive sa liberté d’expression », visant « à imposer une seule version de la vérité historique ». Dans son livre Les mythes fondateurs de la politique israélienne (1996), il niait l’existence des chambres à gaz et des fours crématoires pour exterminer des millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Plus généralement, il alléguait que les juges internes avaient méconnu le sens d’écrits visant non à contester l’existence de crimes nazis ou la persécution raciste contre les Juifs mais à aborder des questions faisant toujours l’objet de débats entre historiens (ainsi, le sens du terme « solution finale », le chiffre des victimes ou encore l’existence des chambres à gaz). Pour le juge de Strasbourg, l’écrit contesté « ne relev(ait) en aucune manière d’un travail de recherche historique s’apparentant à une quête de la vérité » ; il s’agissait « en fait de réhabiliter le régime national-socialiste et, par voie de conséquence, d’accuser de falsification de l’histoire les victimes elles-mêmes », ce qui allait « à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telles que les exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix ». En niant l’existence d’un crime absolu, en cherchant à nous faire oublier « l’idée froide et lugubre du camp, de la mort mécanique. »[28], Roger Garaudy ne pouvait que se voir refuser l’invocation du droit à la liberté d’expression, si nécessaire, absolument.
Une conclusion du même ordre vaut pour la solution retenue dans l’affaire M’Bala M’Bala c. France. Lors de son spectacle J’ai fait l’con, donné dans la salle du Zénith à Paris le 26 décembre 2008, l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala avait fait monter sur scène le négationniste notoire condamné plusieurs fois pour injure raciale et provocation à la haine, Robert Faurisson[29] – celui qui avait évoqué « la magique chambre à gaz » et déclaré que le « mythe des chambres à gaz est une gredinerie » – afin de le faire acclamer par son public[30] et de se faire remettre le Prix de l’infréquentabilité et de l’insolence — formulation ne pouvant que faire référence à ce par quoi cet ancien universitaire s’est fait largement connaître, à savoir la négation de la réalité du génocide des Juifs perpétré par le régime nazi. La cérémonie s’était traduite par la remise d’un chandelier à trois branches coiffées de trois pommes (version abâtardie du chandelier juif à sept branches) par un acteur revêtu d’un pyjama rayé sur lequel était cousue une étoile de David. L’article 17 est invoqué par l’État défendeur, s’agissant d’actes manifestant la volonté « d’offenser délibérément la mémoire » du peuple juif. La Cour EDH souscrit à l’exception d’irrecevabilité[31]. Le recours au couperet de l’article 17 s’impose dans la mesure où la mise en scène contenait une « valorisation du négationnisme à travers la place centrale donnée à l’intervention de Robert Faurisson et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination » et constituait « une démonstration de haine et d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de l’holocauste » (§ 39).
Une difficulté tenait au fait que pour le requérant, les faits litigieux s’étaient produits à l’occasion d’un spectacle, ce qui impliquait nécessairement qu’il devait être présumé avoir agi en tant qu’artiste. Il invoquait l’argument de la dérision, de l’humour. Le propos ne manquait pas d’habileté puisque la jurisprudence européenne considère que la protection conférée par l’article 10 de la CEDH s’applique également à « la satire, qui est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à s’exprimer par ce biais » (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, 25 janvier 2007, § 33)[32][33]. La formulation est rappelée dans l’arrêt Alves da Silva c. Portugal (20 octobre 2009, § 27, condamnation d’une satire visant un maire, présentée lors du carnaval). Pour autant, quand bien même une caricature « peut être une forme d’expression artistique, par définition provocatrice », son auteur ne saurait échapper à une condamnation pénale dès lors que, dans un contexte particulier (en l’occurrence, le contexte politiquement sensible du Pays basque), la légende accompagnant son dessin atteste qu’il « juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre de milliers de victimes et une atteinte à leur dignité » (Leroy c. France, 2 octobre 2008, § 43, dessinateur condamné pour apologie de terrorisme pour avoir publié dans un hebdomadaire basque, deux jours après les attentats du 11 septembre 2001, une caricature de presse représentant l’effondrement des tours du Wold Trade Center accompagnée de la légende : « Nous en avons tous rêvé, le Hamas l’a fait »). Pas davantage que les juges internes, le juge européen n’accepte d’entrer dans la parade du contexte artistique. À l’évidence, Dieudonné n’avait pas agi en qualité d’artiste. D’ailleurs, l’intéressé avait annoncé préalablement à la scène litigieuse que l’un de ses précédents spectacles avait été qualifié (par Bernard-Henri Lévy) de « plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale » et qu’il voulait « faire mieux » (§ 34). La montée de Robert Faurisson sur scène, afin que Dieudonné puisse l’honorer du Prix de l’infréquentabilité et de l’insolence et lui laisse la parole, avait constitué l’achèvement de ce glissement sur le terrain politique. Robert Faurisson était tout à fait étranger au monde du spectacle et de la satire. Dès lors, l’alliance de ces deux personnages sur une même scène ne pouvait plus laisser présumer l’intention comique de la scène mais convergeait vers la nature politique de leur réunion. Le constat est sans appel[34]. Comme le remarque Monique Canto-Sperber, l’excuse de l’humour ne pouvait être acceptée : en effet, « [l]’humour présente le réel de façon partielle et décalée, en démasquant, désacralisant et exhibant les ambiguïtés. L’effet comique est assuré si l’humoriste fait voir le décalage entre ce que chacun prétend être et ce qu’il est vraiment. L’humour aurait pour cette raison une utilité cognitive : montrer un sujet sous un jour non conventionnel et amener le public à se détacher de ses convictions. » Condamné plusieurs fois pour injure raciale et provocation à la haine, Dieudonné avait exprimé son antisémitisme en dehors de ses spectacles (singulièrement, après les attentats du 15 janvier 2015 à Paris visant la rédaction de Charlie Hebdo et la supérette Hyper Cacher de Vincennes, son affirmation : « Je me sens Charlie Coulibaly »)[35]. Le spectacle n’était qu’un prétexte à la cérémonie scandaleuse constituée par la remise du prix à Robert Faurisson. À l’opposé, l’humoriste Pierre Desproges est parfaitement clair sur l’antisémitisme en dehors de la scène et sur la possibilité de considérer au premier degré ses propos provocateurs, par exemple, ceux tenus dans ses Chroniques de la haine ordinaire sur France Inter en 1986 (« Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande : “On ne peut être à la fois au four et au moulin” ») ou dans ses sketchs (« On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle »). Ici, l’argument de l’humour est vraiment recevable quand bien même aujourd’hui l’émission de tels propos ne se ferait pas sans difficulté tant est puissante la pression du politiquement correct. Par contre, « [f]aire acclamer le vrai révisionniste Faurisson par le public, le faire accueillir par un homme déguisé en rescapé des camps et portant une étoile jaune pour bien montrer qu’il ne s’agit pas de n’importe quel type de rescapé, ne relève pas de l’humour mais de l’incitation à la haine des juifs. Dieudonné fait ici de la politique, franchit une étape supplémentaire dans la provocation antisémite, et il en est entièrement comptable. »[36].
8. Quelques exemples de solutions problématiques.
a) Selon la Cour EDH, « il ne fait aucun doute qu’à l’égal de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, des expressions visant à propager, inciter ou à justifier la haine fondée sur l’intolérance, y compris l’intolérance religieuse, ne bénéficient pas de la protection de l’article 10 de la Convention » (Gündüz c. Turquie, préc., § 51). Aussi les allégations xénophobes et racistes « ne bénéficient pas de la protection de l’article 10 » (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35). Dans l’affaire Seurot c. France, déc. 18 mai 2004 (n° 57383/00)[37], le couperet de l’article 17 avait été invoqué à titre principal par le Gouvernement. Non sans s’interroger sur sa pertinence (« la Cour se demande si l’expression des opinions du requérant ne devrait pas être exclue de la protection de l’article 10 en vertu de l’article 17 »), la Cour EDH juge inutile de recourir à la clause de déchéance, estimant suffisant d’insister sur les « devoirs et responsabilités particuliers » qui incombent aux enseignants, « symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation » et instruments essentiels de l’édification d’une « éducation à la citoyenneté démocratique », alors pourtant que « la teneur des écrits (était) exempte de toute ambiguïté » et leur « caractère raciste », incontestable. Dans le même sens, la mise en avant de l’article 17 est rejetée dans l’affaire Soulas c. France (10 juillet 2008, amende infligée pour délit de provocation à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes déterminées, à la suite de la publication d’un ouvrage intitulé La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur l’immigration et l’islam). La Cour approuve le raisonnement des juges internes pour lesquels le livre visait à provoquer chez les lecteurs « un sentiment de rejet et d’antagonisme » envers les communautés musulmanes d’origine maghrébines et de l’Afrique sub-maghrébine, désignées comme « l’ennemi principal » et à les convaincre de se rallier à la solution de « la reconquête ethnique », mais se borne à affirmer que « les passages incriminés (de l’ouvrage) ne sont pas suffisamment graves pour justifier (son) application » (10 juillet 2008, § 48).
b) Pour le juge européen, « un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci […] ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs » (Yazar, Karatas, Aksoy et Parti du Peuple [HEP] c. Turquie, 9 avril 2002, § 49 ; Refah Partisi et a. c. Turquie, Gr. Ch., 13 février 2003, § 98 ; Partidul Comunistilor [Nepeceristi] et Ungureanu c. Roumanie, 3 février 2005, § 46, refus d’inscription d’un parti sur le seul fondement de son statut et de son programme politique : assurer la défense des intérêts des travailleurs et respecter l’essence de la doctrine communiste). Selon elle, la légitimité de l’action partisane dépend des moyens utilisés (être légaux et démocratiques ») et du changement souhaité (être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux ») (Refah Partisi et a., préc., § 98). Dans l’affaire Parti communiste d’Allemagne, les requérants affirmaient que le parti n’envisageait la conquête du pouvoir que par des moyens constitutionnels et qu’on ne pouvait pas lui reprocher des actes de violence. Pour la Commission EDH, à supposer ces éléments établis, « il n’en résulterait aucunement une renonciation à ses fins traditionnelles, lesquelles supposent le passage à la dictature du prolétariat », « le recours à la dictature pour l’instauration d’un régime incompatible avec la Convention »). Étonnamment, dans l’affaire Refah Partisi – terreau de l’actuel A.K.P./Parti de la Justice et du Développement, actuellement au pouvoir, la formation politique en cause est d’une tout autre envergure – le recours à la clause de déchéance n’est pas envisagé, alors que la Cour EDH « considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après avoir prospéré sous le régime démocratique. » (§ 99) et que les projets du Refah Partisi « étaient en contradiction avec la conception de la “société démocratique” et que les chances réelles qu’[il]avait de les mettre en application donnaient un caractère plus tangible et plus immédiat au danger pour la démocratie. » (§ 132). Mais, il est vrai que le juge européen entendait saisir l’occasion de l’espèce pour rendre un grand arrêt, ce qui lui aurait été interdit en utilisant directement l’article 17. Et l’arrêt est effectivement un grand arrêt qui énonce solennellement les contradictions entre la vision islamique de la société et les exigences de la société démocratique au sens de la CEDH (institution d’un système multijuridique établissant une distinction entre les particuliers fondée sur la religion ; incompatibilité entre la Convention et l’application de la sharia, s’agissant notamment des règles de droit pénal et du rôle des femmes[38].
c) Selon le juge de Strasbourg, « tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’article 17 de la protection de l’article 10 », ce qui serait le cas pour « la justification d’une politique pro-nazie » (Lehideux et Isorni c. France, Gr. Ch., 23 septembre 1998, § 47 et 53, publication dans un journal connu d’un encart publicitaire glorifiant l’action du Maréchal Pétain en 1940-1944)[39]. Fortement critiquée[40], la solution à laquelle aboutit la Cour EDH dans cette affaire contribue à la banalisation de Vichy et de la politique du chef de l’État français, alors pourtant que celle-ci s’identifie clairement avec la collaboration avec l’ordre hitlérien, fondé sur le racisme et l’antisémitisme. Le juge européen entend se tenir à égale distance des thèses en présence (thèse du double jeu du Maréchal Pétain/thèse du Gouvernement) et « estime qu’il ne lui appartient pas d’arbitrer cette question qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens » (§ 47). Plus généralement, il considère que « la recherche de la vérité historique fait partie de intégrante de la liberté d’expression » et que, partant, « il ne lui revient pas d’arbitrer » les « débat(s) toujours en cours entre historiens » (Monnat c. Suisse, 21 septembre 2006, § 57, mise en garde de l’autorité indépendante de régulation après un reportage télévisé critique sur le rôle des dirigeants suisses durant la période 1939-1945 et sur celui des banques et des assurances helvétiques quant aux fonds juifs en déshérence), surtout si « les événements historiques » en cause « se sont produits (depuis) plus de cinquante ans », donnée s’inscrivant dans les « efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire » (§ 64). Cette dernière indication figurait déjà dans l’arrêt Lehideux et Isorni (§ 55).
d) Le génocide des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale est-il doté d’un statut à part ? La contestation d’un génocide est-elle à géométrie variable ? Ce sont là des questions qui se posent naturellement quand on examine la solution retenue par la Grande Chambre de la Cour EDH dans l’affaire Perinçek c. Suisse (17 décembre 2013)[41]. En l’espèce, un homme politique turc avait été pénalement condamné pour avoir publiquement exprimé en Suisse l’opinion selon laquelle les massacres et les déportations massives subis par les Arméniens aux mains de l’Empire ottoman au début du xxe siècle ne s’analysaient pas en un génocide et que le génocide arménien allégué était un « mensonge international » « inventé par les impérialistes ». L’arrêt rappelle que « [l]a Cour et la Commission ont invariablement présumé que la négation de l’Holocauste incitait à la haine ou à l’intolérance. En particulier, en criminaliser la négation ne se justifie pas tant parce que l’Holocauste constitue un fait historique clairement établi que parce que, au vu du contexte historique dans les États en question, sa négation, même habillée en recherche historique impartiale, traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite » (§ 234 et 243). L’arrêt récuse le recours à l’article 17 et conclut à une violation de l’article 10 de la CEDH. Les propos litigieux ne pouvaient pas être assimilés à une forme d’incitation à la haine, à la violence ou à l’intolérance envers les Arméniens, le requérant n’ayant pas traité les Arméniens de menteurs, ni usé de termes injurieux à leur égard ni cherché à les caricaturer (§ 246). Il n’avait pas non plus relativisé la gravité de ces événements tragiques ni cherché à les cautionner (§ 240). En dépit de l’importance considérable que la communauté arménienne attachait à la qualification de génocide pour ces événements, la Cour ne saurait accepter que les propos du requérant, qui visaient « les impérialistes », fussent attentatoires à la dignité des victimes et de leurs descendants au point de nécessiter des mesures d’ordre pénal en Suisse, en particulier au vu de leur impact plutôt limité et des quatre-vingt-dix années qui s’étaient écoulées depuis ces événements (§ 250, 252 et 254). On peut ne pas être véritablement convaincu par cette démonstration qui traduit le souci du juge de Strasbourg de ne pas adouber la thèse de l’existence du génocide arménien. Sans doute, applique-t-il en l’occurrence les deux critères justifiant selon lui la mise en œuvre de la clause de déchéance, à savoir que la remise en cause des valeurs de la Convention soit suffisamment grave et non équivoque. Il n’empêche : ces critères, comme l’écrit Thomas Hochmann[42], « semblent avoir inéluctablement comme effet d’introduire une certaine dose de subjectivité dans le raisonnement de la Cour de Strasbourg », tout particulièrement le premier susceptible d’« engendrer une certaine forme de hiérarchisation des comportements prohibés en fonction d’une échelle de valeurs propre au juge européen » et, du coup, « le risque d’en déduire, au prix d’une lecture trop rapide voire biaisée de la jurisprudence européenne, que l’apologie du terrorisme serait par exemple “moins grave” que l’homophobie qui, elle-même serait “moins grave” que l’islamophobie ou encore, que la négation de la Shoah serait, par principe, plus intolérable que celle du génocide arménien. »
e) Faut-il recourir à la clause de déchéance lorsque la remise en cause des valeurs de la CEDH intervient dans le cadre d’une création artistique et/ou les requérants s’abritent derrière l’argument de l’humour ? L’interrogation a déjà été examinée à propos des affaires françaises Leroy et M’Bala M’Bala. Il n’est en effet pas exclu de voir la création artistique conduire à encourager la violence terroriste ou à légitimer les thèses négationnistes. Dans l’affaire Leroy, l’État défendeur plaidait pour le recours à l’article 17 alors que la légende accompagnant la caricature litigieuse publiée seulement deux jours après les attentats du 11 septembre 2001 (« Nous en avons tous rêvé, le Hamas l’a fait »). La Cour balaie l’argument du message antiaméricain via une image satirique visant à illustrer le déclin de l’impérialisme des États-Unis. Quand bien même une caricature « peut être une forme d’expression artistique, par définition provocatrice » (§ 39), en l’espèce, elle y voit « une œuvre (qui) ne critique pas l’impérialisme américain mais glorifie sa destruction par la violence », la légende l’accompagnant attestant que le requérant « juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre de milliers de victimes et une atteinte à leur dignité » (§ 43). Convenant que l’apologie du terrorisme relève bien de la clause de déchéance, le juge de Strasbourg estime curieusement que, eu égard à « la forme humoristique certes controversée d’une caricature », « le message de fond » poursuivi « ne vise pas la négation des droits fondamentaux » et que le dessin et la légende « ne constituent pas une justification à ce point non équivoque de l’acte terroriste qui les feraient échapper à la protection garantie par l’article 10 de la liberté de la presse » (§ 27).
Dans l’affaire Z. B. c. France (2 septembre 2021)[43], le requérant avait été frappé d’une peine d’emprisonnement de deux mois et d’une amende de quatre mille euros pour apologie de crimes volontaires d’atteinte la vie. Il avait fait fabriquer pour son neveu âgé de trois ans, prénommé Jihad, et lui avait demandé de le porter dans son école maternelle, un T-Shirt sur lequel était inscrit sur la poitrine mention « Je suis une bombe ! » et dans le dos « Jihad, né le 11 septembre » et ce, quelques mois après les attentats commis par Mohamed Merah et la tuerie d’une école juive à Toulouse. L’intéressé invoquait une plaisanterie dénuée de toute arrière-pensée liée à une idéologie terroriste qui se référait en réalité à la beauté de son parent, ajoutant que l’interdiction qu’il subissait revenait à interdire toute forme d’humour vis-à-vis de tout événement tragique lié au terrorisme. Extrêmement grossier, l’argument n’est pas examiné par la Cour qui, curieusement, une nouvelle fois, sans aucune démonstration, estime que les mentions figurant sur le vêtement en question « ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente que le requérant tendait à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 26).
9. a) Le recours indirect à l’article 17 a été utilisé par l’ancienne Commission EDH dans le cadre du contrôle de proportionnalité pour apprécier la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, particulièrement lorsqu’elle sert à diffuser l’idéologie nationale-socialiste – « doctrine incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme » (déc. 1er février 2000, Schimanek c. Autriche, n° 32307/96 ; déc. 9 septembre 1998, Nachtmann c. Autriche, no 36773/97) – ou des propos niant l’existence de chambres à gaz dans les camps de concentration, lesquels « vont à l’encontre de l’une des valeurs fondamentales de la Convention » ; déc. 16 janvier 1982, X c. RFA, exposition de brochures niant l’assassinat de millions de Juifs, qualifié de « mensonge » et d’« escroquerie sioniste » ; déc. 6 septembre 1995, Remer c. Allemagne, n° 25096/54 ; déc. 12 mai 1988, Kühnen c. RFA, n° 12194/86 ; déc. 29 novembre 1995, N.D.P., Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, n° 25992/94 ; déc. 24 juin 1996, Marais c. France, n° 31159/96.
b) La Cour EDH ne manque pas de l’actionner voire de le privilégier. Ainsi, à propos de la condamnation d’un évêque britannique négationniste pour avoir déclaré dans une interview accordée à une chaîne de télévision suédoise « qu’il croyait qu’il n’y avait pas eu de chambres à gaz sous le régime nazi » (déc. 8 janvier 2019, n° 64496/17, Williamson c. Allemagne, § 21-22), ou de celle d’un député régional du parti pronazi NPD pour avoir nié l’Holocauste au cours d’un discours devant le Parlement régional (3 octobre 2019, Pastörs c. Allemagne), ou encore à propos de condamnations et d’amendes administratives à la suite d’appels aux électeurs de s’abstenir de voter lors du prochain scrutin présidentiel (5 avril 2022, Teslenko et a. c. Russie). Dans cette dernière affaire, faisant explicitement référence à l’article 17, la Cour conclut à une violation de l’article 10 : en effet, en l’absence d’une obligation légale de voter, les requérants n’ont pas appelé les électeurs à se livrer à des activités illégales ni incité à la haine, à l’intolérance ou à la discrimination, ni appelé à la violence ou à la commission d’autres actes criminels ni exercé une influence indue sur des électeurs. Il n’a pas été établi de manière convaincante que l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression ait été de nature à porter atteinte aux fondements d’une véritable démocratie » (§ 134-144). L’usage indirect a été mis en œuvre de façon cohérente dans l’affaire Zemmour c. France (arrêt du 22 décembre 2022). Le polémiste contestait sa condamnation au paiement d’une amende de trois mille euros pour provocation à la discrimination, à la haine raciale ou à la violence à l’égard des musulmans en raison de propos tenus en septembre 2016 lors d’une émission télévisée diffusée en direct à une heure de grande écoute dans le cadre de la promotion de l’un de ses ouvrages. Sollicité à maintes reprises par le journaliste quant aux musulmans vivant en France, il avait dénoncé une « invasion », une « colonisation » et une « lutte pour islamiser un territoire », ajoutant : « je pense qu’il faut leur donner le choix entre l’islam et la France ». Une telle appréhension, globalisante, s’en prenant indistinctement à l’ensemble des musulmans, ne pouvait que provoquer un sentiment d’hostilité et d’exclusion et constituait, comme l’avait relevé la Cour de cassation, « un appel au rejet et à la discrimination des musulmans en tant que tels ». L’État défendeur revendiquait l’usage direct de l’article 17, mais le juge de Strasbourg, pour lequel cette disposition « ne s’applique qu’à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes. », considère que « dans les circonstances de l’espèce », « les propos tenus par le requérant […] ne suffisent pas, quels que controversés et choquants qu’ils puissent être, à révéler de manière immédiatement évidente que ce dernier tendait, en les proférant, à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention. » (§ 26-28). Cette conclusion est bienvenue ainsi que celle admettant la légitimité de l’ingérence litigieuse. Devant le juge européen, Éric Zemmour arguait de ce que le constat d’une islamisation du territoire français, grosse d’une menace pour la cohésion sociale, participait d’un débat d’intérêt général et invoquait une violation de son droit à la liberté d’expression. À l’évidence, l’interrogation sur les problèmes liés à l’installation et à l’intégration des immigrés dans les pays d’accueil et, plus spécifiquement la place de l’islam dans la société française (montée du fondamentalisme religieux dans les banlieues), dans un contexte d’attentats terroristes, visait bien un sujet d’intérêt général. La Cour EDH en convient (§ 56) comme elle l’avait fait en 2010 dans une espèce concernant un leader politique d’extrême droite bien connu (déc. 20 avril 2010, Jean-Marie Le Pen c. France, n° 187188/09, irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement), eu égard a fortiori à la notoriété et à la personnalité du requérant. Néanmoins, dans sa décision Le Pen, s’agissant de sujets aussi sensibles, elle avait admis au profit des autorités publiques une large marge d’appréciation afin qu’elles puissent faire face aux expressions incitant à la discrimination et à la haine. Elle le redit ici et constate que l’État défendeur ne l’a pas dépassée : « le recours à des termes agressifs exprimés sans nuance pour dénoncer une « colonisation » de la France par « les musulmans » avait des visées discriminatoires et non pour seul but de partager avec le public une opinion relative à la montée du fondamentalisme religieux dans les banlieues françaises. » (§ 60) ; ces propos « ne se limitaient pas à une critique de l’islam mais comportaient, compte tenu du contexte général dans lequel ils s’inscrivaient[44] et des modalités de leur diffusion, une intention discriminatoire de nature à appeler les auditeurs au rejet et à l’exclusion de la communauté musulmane dans son ensemble et, ce faisant, à nuire à la cohésion sociale. » (§ 63).
c) Pour autant, l’application indirecte manque parfois de clarté, comme le montrent les exemples suivants. Dans l’affaire Molnar c. Roumanie (23 octobre 2012), le requérant avait été condamné pour propagande chauviniste en raison d’affiches retrouvées chez lui contenant différents messages faisant référence à la minorité rom et à la minorité homosexuelle (« Un futur pour les enfants blancs », « Le métissage : un crime contre la nation roumaine », « Empêchez la Roumanie de devenir un pays de Roms », « La Roumanie a besoin d’enfants non pas d’homosexuels », « Pour une Roumanie et une Europe pures », « L’impérialisme américano-sioniste : un seul ennemi pour la Roumanie et pour l’Europe ! »). Pour la Cour EDH, par leur contenu, ces messages visaient à instiguer à la haine contre ces minorités, étaient de nature à troubler gravement l’ordre public et allaient à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention et d’une société démocratique. Il s’agissait d’actes incompatibles avec la démocratie et les droits de l’homme de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la Convention, le requérant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la Convention (§ 24). Une fois ce constat effectué, elle examine néanmoins l’existence et la légitimité de l’ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressé et juge le grief manifestement mal fondé. L’affaire Šimunić c. Croatie (déc. n° 20373/17, 22 janvier 2019) concernait un joueur de football célèbre condamné pour avoir, pendant un match, crié à plusieurs reprises « Pour la patrie ! ». À chaque fois, les spectateurs avaient répondu « Prêts ». Le message litigieux constituait le salut officiel du mouvement Oustacha, issu du fascisme et du régime totalitaire de l’État indépendant de Croatie (établi en 1941 sous la protection de l’Allemagne nazie et de l’Italie mussolinienne). La Cour juge important de faire référence à l’article 17, mais « elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de cette disposition car ce grief est en tout état de cause irrecevable dès lors que l’ingérence alléguée était justifiée au regard de l’article 10 » (§ 37-39) ! ! Une telle incohérence voire une confusion des genres comparable se retrouve dans le traitement de l’affaire Gollnisch c. France (déc. n° 48135/08, 7 juin 2011). Homme politique d’extrême droite et universitaire, Bruno Gollnisch contestait son interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement ou de recherches au sein de l’Université de Lyon III pour une durée de cinq ans pour avoir dit en conférence de presse que, concernant la question de l’existence des chambres à gaz dans les camps de concentration et du nombre de personnes qui y ont trouvé la mort, il appartenait aux historiens d’en discuter librement. L’État défendeur invoquait l’article 17. La Cour rappelle sa jurisprudence relative à cette disposition mais n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors (! !) que le grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention est lui-même irrecevable : le requérant ne pouvait pas ignorer que ses déclarations étaient de nature à semer le doute sur l’ampleur de l’extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout compte tenu de la controverse qu’avaient suscitée à l’université (« compte tenu notamment de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon III sur un sujet particulièrement sensible ») les opinions négationnistes et racistes défendues par certains membres du corps enseignant. La contribution éventuelle du requérant aux thèses négationnistes et le désordre qui pouvait en résulter, au sein de l’université étaient incompatibles avec les devoirs et responsabilités qui lui incombaient en tant qu’enseignant (de tels impératifs figuraient déjà dans le traitement de l’affaire précitée : Seurot c. France). Toujours à propos du négationnisme, dans l’affaire Bonnet c. France (déc. 24 février 2022, n° 35364/19), s’agissant de la condamnation d’Alain Bonnet (Alain Soral) à une amende de dix mille euros pour injure publique à caractère racial envers les personnes d’origine ou de confession juive et contestation de crime contre l’humanité. Le négationniste notoire, condamné à de multiples reprises, avait publié sur le site Internet Égalité et Réconciliation une page de l’hebdomadaire Charlie-Hebdo comportant un encart indiquant « historiens déboussolés » et un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, posant la question « Shoah où t’es ? », à laquelle répondaient des bulles indiquant « ici », « là », « et là aussi », placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque. Eu égard à l’impact du message véhiculé utilisant un support susceptible d’un impact considérable comme Internet (§ 43 et 51) et au fait que l’Holocauste entrait dans la catégorie des faits historiques clairement établis (§ 53), le juge européen considère que les juges internes se sont appuyés sur des motifs pertinents et suffisants pour établir que le dessin litigieux visait bien la communauté juive, notamment en s’appuyant sur le recours à des symboles renvoyant à l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et à l’interrogation « Shoah, où t’es ? », lesquels tendaient à tourner en dérision ce fait historique et à mettre en doute sa réalité. Elles avaient pointé à juste titre un message et un dessin ne pouvant être considérés comme contribuant à un quelconque débat d’intérêt général (§ 49). Aussi la requête était-elle manifestement mal fondée. À deux reprises, l’ombre de la clause de l’article 17 se trouve évoquée : sur le terrain de l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant « dans la mesure où il peut invoquer l’article 10 de la Convention » ; sur celui de sa nécessité dans une société démocratique « à supposer même que l’article 10 trouve à s’appliquer » (§ 31 et 50). Une rédaction aussi alambiquée conduit à regretter la non-application directe de l’article 17 à la requête d’une personne qui n’a cessé de professer un négationnisme caractérisé, comme dans l’affaire Garaudy c. France. Alain Bonnet (Soral) méritait, lui aussi, de se voir opposer la clause de déchéance de l’article 17, purement et simplement.
III. Un instrument discuté
10. a) Cette réserve est compréhensible. La possibilité pour une démocratie de frapper de déchéance certains droits et libertés est contestée, une partie de la doctrine y voyant un mécanisme inadéquat qui ferait obstacle à la plénitude de l’office du juge de Strasbourg – lequel suppose le plein exercice d’un contrôle de proportionnalité – et reviendrait pour la société démocratique à se discréditer en usant des mêmes armes que ses adversaires, en ayant recours à des mesures restrictives des droits et libertés afin de lutter contre les propos et comportements liberticides. La mise en œuvre du mécanisme laisse nombre de juges européens et d’auteurs circonspects. Il faut donc prendre en considération « le soupçon doctrinal largement partagé concernant l’utilité théorique de l’article 17 au sein du système conventionnel de limitation des droits et libertés »[45]. Certains auteurs insistent sur le danger pour la démocratie d’emprunter « les propres armes de ses ennemis », en mettant en œuvre un mécanisme « frustre », « une mesure mécanique », « peu nuancée. »[46] et estiment, au nom du principe de l’intangibilité des droits de l’homme, que « la démocratie doit […] répondre au totalitarisme et à l’intolérance érigée en politique par des moyens démocratiques, sous peine de prendre peu à peu le visage de ses pires ennemis »[47]. Ils s’étonnent que « la « la démocratie semble nier les principes de tolérance et de pluralisme qui constituent son identité. »[48]. Un temps membre de la Cour EDH (1998-2012), Françoise Tulkens relève qu’employée « de manière parcimonieuse mais judicieuse […] pour traduire vigilance et fermeté à l’endroit du négationnisme et du révisionnisme », la clause de déchéance de l’article 17 de la CEDH constitue une arme qui « pourrait être le prétexte des pires abus »[49]. Certains analystes de la jurisprudence européenne, comme David Szymczak, préconisent même la solution radicale de la neutralisation du mécanisme et de la limitation de son usage au recours indirect : « peut-être conviendrait-il que la Cour de Strasbourg renonce à l’avenir à utiliser l’article 17 de la Convention comme clause d’irrecevabilité autonome et s’en serve exclusivement comme guide d’interprétation des dispositions matérielles de la Convention, en particulier de son article 10. Ce qui n’empêcherait pas de continuer à faire passer le message que certains propos sont particulièrement intolérables, le cas échéant en en concluant au caractère manifestement mal fondé. »[50]. La proposition est étonnante. Il semble plutôt que si l’on recherche un effet pédagogique chez certains requérants qui tiennent « des propos particulièrement intolérables » ou cherchent à légitimer des comportements inacceptables, l’application directe de la clause de déchéance constitue une méthode bien plus appropriée que son application indirecte dont on a pu mesurer le caractère parfois erratique. D’autre part, une irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement n’a pas la même signification d’une incompétence ratione materiae.
b) Les réticences à l’égard de la clause d’interdiction de l’abus de droit permettent de mettre en relief la différence d’approche, particulièrement en matière de liberté d’expression, entre celle de la France et celle des États-Unis[51]. Dans ce pays, le free speech bénéficie d’une très grande protection. Il est même possible d’affirmer qu’il fait l’objet d’un véritable culte[52] et que « (l)a protection constitutionnelle de la liberté d’expression aux États-Unis est la plus étendue du monde »[53]. Sauf danger avéré de violences imminentes, la Cour suprême veille au respect des opinions dissidentes, choquantes voire scandaleuses (possible expression – y compris lors de manifestations sur la voie publique – d’opinions ouvertement racistes [Ku Klux Klan, suprématistes blancs, de propos et saluts fascistes, nazis, accompagnés de croix gammées]. Un tel culte se retrouve chez Ronald Dworkin : « [j]e m’oppose à toute restriction de la liberté de parole, à toute forme de censure contre un discours, même raciste et sexiste. Je ne ferai qu’une exception : si vous arrivez au milieu d’une foule en colère, une corde à la main, et si vous désignez un Noir en criant : « Pendez-le ! », alors vous méritez d’être poursuivi. L’incitation au crime doit être poursuivie, mais non la simple incitation à la haine ou au mépris. » Et le philosophe politique américain d’ajouter : « Je sais que vous, Européens, vous n’êtes pas d’accord. En France, il y a la loi Gayssot ; en Allemagne, on risque la prison si on dit que la Shoah n’a pas eu lieu. Je comprends les raisons pour lesquelles on a fait ces lois. Et peut-être (ce « peut-être » est plutôt inquiétant) que moi-même, si les nazis étaient au coin de la rue, je raisonnerais autrement. Mais tant que ce n’est pas le cas, je trouve ces lois antidémocratiques. La démocratie, j’y insiste, n’est pas un système dans lequel la majorité pourrait imposer sa volonté aux autres sans se soucier de ce qu’ils pensent. C’est un partenariat dont nul ne doit être exclu sous prétexte que ses opinions sont stupides ou haïssables. »[54]. Cette valorisation de la liberté d’expression tient au fait qu’il s’agit d’une liberté indispensable à l’effectivité de toutes les autres, ainsi que l’a affirmé le juriste Robert McKay : « il n’est pas exagéré de dire qu’en l’absence de la liberté d’expression et de pensée, les autres dispositions de la Constitution manqueraient de fondement, et on peut se demander si elles pourraient survivre. À l’inverse, si toutes les dispositions de la Constitution étaient supprimées à l’exception de celles concernant ces libertés, une société libre pourrait être reconstruite »[55]. Une loi comme la Loi Gayssot précitée[56] n’y serait pas envisageable. Un simple exemple pour le démontrer : la polémique ayant opposé le célèbre linguiste libertaire américain Noam Chomsky à l’historien français Pierre Vidal-Naquet à propos des articles de Robert Faurisson niant l’existence des chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale. Connu pour ses prises de position radicales [notamment, sur la politique étrangère des États-Unis et Israël], Chomsky avait signé en 1979 une pétition demandant l’abrogation de la Loi Gayssot et défendant Robert Faurisson, en qualifiant la recherche menée par ce dernier de « recherche historique approfondie et indépendante sur la question de l’Holocauste », puis rédigé un texte ensuite inséré comme préface [« Quelques commentaires élémentaires sur le droit à la liberté d’expression »][57] au livre de Faurisson, Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire. La question des chambres à gaz [Éditions La Vieille Taupe, 1980]. Noam Chomsky justifiait sa signature au nom de la conception absolutiste de la liberté d’expression [droit de toutes les opinions même ignobles de s’exprimer librement], celle des Lumières et du free speech américain. Sans avoir vraiment lu les écrits de cet auteur, il entendait soutenir son droit de s’exprimer librement. Cette démarche devait subir la critique sévère de Pierre Vidal-Naquet[58] dans une réfutation implacable du « mensonge et de l’escroquerie révisionniste ». Noam Chomsky devait persister dans cette attitude : dans une lettre du 5 septembre 2010, il s’associe à une pétition lancée le 6 août 2010 contre l’application de la Loi Gayssot au militant nazi Vincent Reynouard [« Je ne connais rien à propos de Monsieur Reynouard, mais je considère la loi Gayssot comme complètement illégitime et en contradiction avec les principes d’une société libre, tels qu’ils ont été compris depuis les Lumières »].
Le linguiste américain s’inscrit pleinement dans l’appréhension de l’étendue de la liberté d’expression dans son pays : le débat public doit représenter toute idée quelle qu’elle soit, afin qu’elle puisse faire l’objet d’un débat démocratique, ce qui – selon une vision optimiste – devrait permettre en fin de compte de décrédibiliser les idées les plus extrêmes. Se retrouve ici une vision de la liberté rencontrée chez John Stuart Mill, particulièrement mise en relief dans des études récentes[59]. Mill est un philosophe politique majeur dont l’approche est marquée par « sa répulsion à l’égard de toute forme de pensée systématique et nécessairement autoritaire selon lui »[60] et sa réserve à l’égard de toute censure, laquelle est a priori toujours pire que le mal causé par la parole et qui, quand elle est nécessaire, doit être minimale, justifiée et circonstanciée. Le philosophe britannique aborde la question des limites de la liberté humaine dans son maître ouvrage paru en 1859, De la liberté)[61]. La liberté – en relation avec le droit de chaque être humain de cultiver sa personnalité – est appréhendée de façon extensive comme « le droit de façonner son existence librement et à sa guise, la production de circonstances dans lesquelles les hommes puissent développer leur nature avec autant de diversité et de richesse – ou au besoin d’excentricité – que possible »[62]. Elle inclut la liberté du choix du mode de vie, c’est-à-dire « la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan de notre vie suivant notre caractère, d’agir à notre guise et risquer toutes les conséquences qui en résulteront, et cela sans en être empêché par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, même s’ils trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. » (De la liberté, p. 78-79)[63]. Le libéralisme prôné par Mill, qui implique le maintien maximal du pluralisme des idées et des comportements, découle logiquement du postulat de l’imperfection présente de l’humanité. En effet, « [p]our Stuart Mill […], [l]’homme est a progressive being et chaque individu trouve dans son indéfectible liberté le moyen essentiel de ce progrès. »[64]. Ainsi, au début du Chapitre III (De l’individualité comme l’un des éléments du bien-être) de son ouvrage, écrit-il : « qu’il est utile, tant que l’humanité est imparfaite, qu’il y ait des opinions différentes […] » (p. 146). Ce pluralisme trouve également sa raison d’être dans la considération – aussi forte chez Mill que chez Tocqueville – du risque du conformisme propre à la société démocratique, la tyrannie n’étant pas simplement celle du magistrat mais aussi celle de l’opinion et du sentiment dominant. Certes, la liberté d’expression comporte comme limite le tort fait à autrui, mais il est essentiel de préserver la valeur éminente que représente la diversité des opinions. Pour Mill, « [l]’utilité même d’une opinion est affaire d’opinion : elle est un objet de dispute ouvert à la discussion, et qui l’exige autant que l’opinion elle-même. Il faudra un garant infaillible des opinions tant pour décider qu’une opinion est nuisible que pour décider qu’elle est fausse, à moins que l’opinion ainsi condamnée n’ait toute latitude pour se défendre. » (De la liberté, p. 93-94). La diversité des opinions constitue la « condition nécessaire de la recherche de la vérité », une vérité simplement humaine et non transcendante car, à partir d’opinions diverses, « la vérité ne peut […] surgir que de la confrontation rationnelle d’opinions humainement évaluées et pesées, sans autre gage de rigueur que les exigences mêmes de l’entendement. »[65]. Ainsi, sous réserve de ne pas nuire à autrui[66], Mill plaide en faveur de l’utilité des opinions fausses qui sont « autant d’aiguillons incitant à constamment défendre ce qu’on tient pour vrai et à perfectionner les arguments qui le justifient. La tolérance à l’égard de l’erreur sonne chez Mill comme une injonction à considérer qu’aucune opinion, même la plus certaine, n’est définitivement vraie, qu’elle demeure toujours, du moins en théorie, susceptible d’être réfutée puisqu’elle est le produit d’une discussion où […] la recherche [n’est] jamais achevée. »[67][68]. Ainsi, la « diversité d’opinions » n’est pas un mal, « mais un bien tant que l’humanité n’est pas mieux à même de reconnaître toutes les facettes de la vérité. » (De la liberté, p. 146). On le voit, s’inscrivant dans le cadre de son optimisme rationaliste[69], ce plaidoyer en faveur du pluralisme doit être bien compris : « si Mill et ses disciples […] préconisaient la liberté de parole et portaient un regard approbateur sur la diversité des styles et des croyances, ils ne considéraient pas le pluralisme comme une fin souhaitable ; ils le tenaient plutôt pour un moyen commode. Laisser les gens exprimer diverses opinions pour trouver la vérité. Laisser les gens explorer des modes de vie variés pour déterminer la conduite optimale. La tolérance ou diversité constitue le moyen le plus intelligent pour encourager la réflexion et la recherche de la vérité. L’utiliser pour justifier le rejet d’une telle recherche – sans parler de l’abandon de la notion de vérité universelle – équivaut à renoncer à l’essence même de la quête humaine. »[70].
11. Si la réserve à l’égard de la clause de déchéance est compréhensible, ne serait-ce que parce qu’un usage énergique de la clause de l’article 17 peut s’ajouter aux dérives propres à certains dispositifs institués en vue de défendre la démocratie (maccarthysme, Patriot Act du 26 octobre 2001, internement sur la base de Guantanamo […]), elle semble perdre de vue que la société démocratique, au sens de la CEDH, doit être une démocratie apte et déterminée à se défendre (wehrhafte Demokratie).
Les adversaires des droits et libertés savent très bien instrumentaliser ces derniers. C’est d’ailleurs là le point de moindre résistance des démocraties. En effet, si « la démocratie trouve sa raison d’être et sa force dans le pluralisme qu’elle professe, dans l’encouragement qu’elle porte à l’expression de toutes les dissidences […] cette force de la démocratie est aussi sa faiblesse »[71]. Comme l’écrit François Ost, « la démocratie est un jeu dont la règle la plus fondamentale est de consentir à être démocrate »[72]. Dans un ouvrage devenu en la matière un ouvrage de référence, Karl Popper se réfère à un droit de ne pas tolérer les intolérants, ce qu’il désigne comme le paradoxe de la tolérance : « une tolérance illimitée a pour conséquence fatale la disparition de la tolérance. Si l’on est d’une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu’on ne défende pas la société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolérance. Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours empêcher l’expression de théories intolérantes. Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les contenir avec l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que ce faisant, ils se placent hors la loi et que l’incitation à l’intolérance est criminelle au même titre que l’incitation au meurtre, par exemple. »[73]. Sans se référer explicitement à la thèse de l’abus de droit, John Rawls aborde également la question des limites de la tolérance dans sa célèbre Théorie de la justice, parue en 1971 : « La justice n’exige pas que les hommes restent sans rien faire pendant que d’autres détruisent la base de leur existence. » ; « La nécessité de limiter la liberté des intolérants pour préserver la liberté dans le cadre d’une juste constitution dépend des circonstances. » ; la liberté d’une secte intolérante « devrait être limitée seulement quand ceux qui sont tolérants croient sincèrement et avec de bonnes raisons que leur propre sécurité et celle des institutions de la liberté sont en danger »[74]. Il y a là une manifestation essentielle du paradoxe de la liberté[75].
La clause de déchéance est malheureusement nécessaire pour la préservation de l’ordre public européen – surtout aujourd’hui face à la montée des fondamentalismes religieux, la virulence du terrorisme ou encore la force du discours négationniste – afin de sauvegarder la société démocratique, qui ne doit aucunement être une démocratie frileuse incapable de préserver les principes supérieurs qui sont à son fondement, mais une démocratie militante/combattante (streitbare Demokratie). Cette dernière formulation est utilisée par le juriste et politologue allemand Karl Lœwenstein, dans deux articles parus en 1937[76][77]. L’auteur, dont le cabinet avait été saccagé en avril 1933 par les SS et son droit d’enseigner retiré par les autorités universitaires, qui a émigré aux États-Unis après l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933, analyse avec une grande lucidité les discours et méthodes des groupes fascistes et déplore la faiblesse, la léthargie suicidaire de la République de Weimar – cette « république incertaine » » selon la formulation d’Olivier Jouanjan[78] – des autres démocraties européennes devant la montée des autoritarismes/totalitarismes et insiste sur la nécessité de doter les démocraties de moyens légaux de lutter contre le fascisme, de dispositifs plus énergiques de défense de leurs valeurs fondamentales, notamment en mettant en place des législations d’exception[79][80]. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale (à New York, en 1942), le philosophe chrétien Jacques Maritain le rappelait tout aussi fermement : « Une société démocratique n’est pas nécessairement : une société désarmée que les ennemis de la liberté peuvent tranquillement conduire à l’abattoir au nom de liberté ». Et d’ajouter : « ce qui distingue en cette matière une société d’hommes libres d’une société despotique, c’est que cette restriction des libertés destructrices ne s’accomplit elle-même, dans une société d’hommes libres, qu’avec les garanties institutionnelles de la justice et du droit »[81]. La démocratie doit pouvoir se défendre, lutter contre ses ennemis qui cherchent à exploiter/instrumentaliser ses ressources pour la miner de l’intérieur : « le libéralisme ne doit pas […] faire preuve d’un angélisme libertaire qui favoriserait les courants totalitaires »[82]. En tenant ces derniers propos, le Doyen Cohen-Jonathan ne pouvait ne pas penser à la terrifiante boutade de Joseph Gœbbels (« Cela restera toujours l’une des meilleures farces de la démocratie d’avoir elle-même fourni à ses ennemis mortels le moyen par lequel elle fut détruite »). Karl Lœwenstein en avertissait ses lecteurs en 1937 : « the mechanism of democracy is the Trojan horse by which the ennemy enters in the city »[83]. Dans son opinion dissidente relative à l’arrêt de la Cour EDH Zdanoka c. Lettonie (Gr. Ch., 16 mars 2006), le juge slovène Zupancic exprimait la même conviction : « (l)a logique sous-tendant l’article 17 est explicite. L’arme juridique des droits de l’homme ne doit pas être pervertie. Son usage ne doit pas servir les intérêts de ceux qui eux-mêmes violeraient les droits de l’homme »[84]. Toutes ces affirmations sont essentielles pour rappeler que dans le contexte singulier de l’après-guerre, marqué par les souvenirs douloureux du nazisme et du fascisme, face à la montée des démocraties populaires, l’article 17 a été intégré dans la CEDH en tant qu’instrument de défense du Conseil de l’Europe, conçu comme le club des démocraties libérales européennes[85]. Elles le demeurent encore aujourd’hui quand on considère, notamment, les possibles effets du nouvel espace de liberté que représente le cyberespace, lequel véhicule avec une puissance de diffusion inédite des messages de haine.
12. Un ultime propos. Le champ d’application n’est pas défini une fois pour toutes. Jusqu’à présent, son usage s’est cantonné aux libertés d’expression, de religion, d’association et au droit à de libres élections. Une interrogation demeure quant à la possibilité d’y avoir recours lorsque sont en jeu des écrits, des propos ou des comportements autres que racistes, xénophobes, antisémites ou islamophobes ou faisant l’apologie de la guerre ou du terrorisme. Par exemple, lorsque les requérants se plaignent – sur le terrain du droit au respect de leur vie privée (CEDH, Art. 8), lequel ne constitue pas un droit insusceptible de dérogation ou un droit procédural – de la violation de leur droit à l’autonomie personnelle, sous l’angle de leur droit de disposer de leur corps comme ils l’entendent, y compris pour justifier des actes d’une très grande cruauté susceptibles de se voir qualifiés d’actes dégradants et/ou de tortures s’ils devaient être examinés sous l’angle de l’article 3 de la Convention[86]. La question se posait dans l’affaire K.A et A.D c. Belgique (17 février 2005)[87]. Le constat de non-violation de la Convention se fondait sur le critère majeur du consentement, à savoir sur le fait que la femme participant à ces actes avait plusieurs fois crié « stop »/« pitié » et, donc, exprimé son désir de ne pas les poursuivre. La Cour EDH ne pouvait/voulait pas, en vertu du principe de l’autonomie personnelle[88] – qui implique le « droit à l’épanouissement personnel » et, par conséquent, le « droit d’entretenir des relations sexuelles [qui] “découle du droit de disposer de son corps” (§ 83)[89] –, se prononcer sur la légitimité du sadomasochisme et s’aventurer sur le terrain, fort problématique, s’agissant de ce genre de pratiques, de la réalité du consentement[90] [91]. En l’espèce, vecteur de l’autonomie personnelle, le critère du consentement semble constituer la clé du partage entre les pratiques conformes à la dignité de l’être humain et celles qui s’y opposent. Il semble très artificiel de la part de la Cour de rechercher s’il y a consentement ou pas. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir consentement. [outre l’aliénation de l’esclave], du côté du sadique, il n’y a aucune place pour le consentement, le sadisme ne laissant aucune autonomie à la personne traitée en objet. » À cet égard, le raisonnement des juges belges semble bien plus satisfaisant. Dans son arrêt du 30 septembre 1997, la Cour d’appel d’Anvers considère que « la morale publique et le respect de la dignité de la personne humaine imposaient des limites qui ne sauraient être franchies en se prévalant du “droit à disposer de soi” ou de la “sexualité consensuelle”. Même à une époque caractérisée par l’hyper-individualisme et une tolérance morale accrue, y compris dans le domaine sexuel, les pratiques […] étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine et ne sauraient en aucun cas être acceptées par la société. Le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien. » Quant à la Cour de cassation (arrêt du 6 janvier 1998), elle estime que pour que les dispositions pénales pertinentes trouvent application, « il suffit […] que le prévenu ait consciemment et volontairement porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne en lui infligeant des coups ou des blessures, quels que soient les motifs et intentions subjectifs de l’auteur des actes » (citations figurant dans l’arrêt K. A. et A. D., § 23 et 27).
Les requérants prétendaient que l’épouse du magistrat « était non seulement consentante, mais demandait à pouvoir évoluer comme “esclave” dans des clubs ». Ils ajoutaient que « [l]es mœurs dans la société moderne ayant changé, le besoin de protection de celles-ci devrait être interprété en fonction de ce changement. (§ 72). Quant à l’affirmation selon laquelle les mots « stop » ou « pitié », prononcés par l’intéressée auraient été ignorés, ils « contest[ai]ent la portée exacte de ces mots et soulign[ai]ent qu[‘elle] était consentante […] n’a[vait] jamais déposé plainte et ne s’[était] jamais constituée partie civile » (§ 76). À l’évidence, ils invoquaient une violation de leur droit au respect de la vie privée en vue de justifier des actes odieux contraires au principe de la dignité de la personne humaine, autrement dit de détruire les valeurs fondamentales de la CEDH[92]. Dans cette hypothèse extrême, le recours à la clause de déchéance de l’article 17 s’imposait.
Michel Levinet, « La clause d’interdiction de l’abus de droit de l’article 17 de la CEDH. Un instrument légitime de l’ordre public européen ? », Confluence des droits_La revue [En ligne], 03 | 2023, mis en ligne le 21 mars 2023, URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2322.
[1] T. Mann, Avertissement à l’Europe (traduction française), Préface d’André Gide, Gallimard, 1937.
[2] F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, PUF, coll. « Que sais-je ? », 8e éd., 2010, Introduction, p. 4.
[3] Voy. : F. Sudre, « Le pluralisme saisi par le juge européen », in L. Fontaine (dir.), Droit et pluralisme, Bruylant, 2007, p. 261-286 ; P. Wachsmann, « Pluralisme », in J. Andriantsimbazovina et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 769-771 ; M. Levinet, « Propos introductifs » in M. Levinet (dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme, op. cit., p. 1-9. Adde : l’arrêt Müslüm Gündüz c/ Turquie, 4 décembre 2003, § 40 (« la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste »).
[4] À côté de la clause d’ordre public qui accompagne certains articles de la Convention ou encore de la clause dérogatoire inscrite dans l’article 15 (existence d’un danger public menaçant la vie de la nation), sans oublier les limitations implicites d’autres droits et libertés, découvertes de façon prétorienne par le juge de Strasbourg.
[5] Cour EDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42. Voy., F. Jacquemot, Le standard européen de société démocratique, Université Montpellier I, coll. « Thèses », 2006.
[6] Cette limitation est rappelée au paragraphe 93 de l’arrêt Ayoub et a. c. France (8 octobre 2020) : « [l]’article 17 couvre essentiellement les droits qui permettraient, si on les invoquait, d’essayer d’en tirer le droit de se livrer effectivement à des activités, visant à la destruction “des droits ou libertés reconnus dans la Convention” ». À noter la formulation de l’article 18 de la Loi fondamentale allemande : « Quiconque abuse de la liberté d’expression des opinions, notamment de la liberté de la presse (article 5, alinéa 1er), de la liberté de l’enseignement (article 5, alinéa 3), de la liberté de réunion (article 8), de la liberté d’association (article 9), du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (article 10), de la propriété (article 14) ou du droit d’asile (article 16 a) pour combattre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, est déchu de ces droits fondamentaux. La déchéance et son étendue sont prononcées par la Cour constitutionnelle fédérale ».
[7] Parmi de nombreux exemples possibles : M. de Salvia in P. Tavernier (dir.), « La France et la Cour européenne des droits de l’homme. La jurisprudence en 2003 », Cahiers du CREDHO, n°10 (2004), Bruylant, 2005, p. 205 (l’article 17 « est un peu la version juridique du principe politique : point de liberté pour les ennemis de la liberté »).
[8] « Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l’être par la justice. » ; « Il est impossible que les lois révolutionnaires soient exécutées, si le gouvernement lui-même n’est constitué révolutionnairement. » (Archives Parlementaires, 1° série, t. 76, p. 313 et 315). Voy. B. Manin, Saint-Just, la logique de la Terreur, Payot, 1979, p. 165-231.
[9] Les formulations de Saint-Just devant la Convention nationale sont explicites : « Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l’être par la justice. » ; « Il est impossible que les lois révolutionnaires soient exécutées, si le gouvernement lui-même n’est constitué révolutionnairement. » (Archives Parlementaires, 1° série, t. 76, p. 313 et 315). Voy., également : B. Manin, Saint-Just, la logique de la Terreur, Payot, 1979, spéc. p. 165-231 ; P. Rolland, Un débat sous la Terreur. La politique dans la République, Éditions Universitaires de Dijon, 2018, Conclusion (La démocratie et ses ennemis), p. 131-143.
[10] « L’abus de droit dans le cadre de la CEDH, Revue Universelle des Droits de l’Homme, 1992, p. 464. D’autres auteurs évoquent le « glaive de la déchéance de protection conventionnelle pure et simple » (S. Van Drooghenbrœck, « L’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme est-il indispensable ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, p. 541-566, spéc. p. 565.
[11] G. Cohen-Jonathan, « Abus de droit et libertés fondamentales », in Mélanges Louis Dubouis, Dalloz, 2002, p. 517-543, spéc. p. 527.
[12] Examinant la jurisprudence européenne, Frédéric Sudre ne manque pas de relever que la clause de l’article 17 y « tient une place marginale » (« Convention européenne des droits de l’homme. Caractères généraux », in JurisClasseur Europe Traité, Fasc. 6500, LexisNexis, 2007, § 31).
[13] G. Cohen-Jonathan, « Discrimination raciale et liberté d’expression », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1995, p. 4.
[14] Voy., par exemple, M. Levinet, « Le pluralisme confronté à la clause d’interdiction de l’abus de droit de l’article 17 de la CEDH », in M. Levinet (dir.), Pluralisme et juges européens des droits de l’homme, Bruylant, 2010, p. 125-150, spéc. p. 135-142) et S. Van Drooghenbrœck, « L’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme est-il indispensable ? », op. cit., p. 548 (l’auteur pointe « sa très large sous-utilisation jurisprudentielle », particulièrement dans le domaine fondamental de la liberté d’expression). Adde : J. Andriantsimbazovina, « L’abus de droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Dalloz, 2014, p. 1854-1859.
[15] Ainsi Alphonse Spielmann, regrettant « une approche jurisprudentielle à géométrie variable » (« La CEDH et l’abus de droit », in Au diapason des droits de l’homme. Écrits choisis (1975-2003), Bruylant, 2006, p. 390).
[16] Guide sur l’article 17 de la CEDH. Interdiction de l’abus de droit, mise à jour au 31 août 2022, Strasbourg, Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 2022 (ce guide est établi régulièrement au sein du Greffe de la Cour).
[17] Le Guide (§ 86-192) distingue sept cas : A. Apologie et justification du terrorisme et des crimes de guerre ; B. Incitation à la violence ; C. Menaces contre l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel ; D. Promotion des idéologies totalitaires (communisme, idéologie nazie, charia) ; E. Incitation à la haine (xénophobie et discrimination raciale, haine ethnique (antisémitisme, Roms, autres types de haine ethnique), homophobie, haine religieuse (des non-musulmans, islamophobie, autres types de haine religieuse) ; F. Négation de l’Holocauste et questions connexes ; G. Débats historiques.
[18] L’inventaire n’est pas exhaustif.
[19] Il n’est évidemment pas indifférent que, dans le contexte de la Guerre froide, face à l’affirmation de la légitimité des démocraties populaires, cette première application soit intervenue à propos d’un parti communiste.
[20] Pour la Cour EDH, « l’affiche constituait l’expression publique d’une attaque dirigée contre tous les Musulmans du Royaume-Uni. Une attaque aussi véhémente, à caractère général, contre un groupe religieux, qui établit un lien avec l’ensemble du groupe et un acte terroriste grave, est contraire aux valeurs proclamées et garanties par la Convention, à savoir la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination ».
[21] M. Levinet, « La fermeté bienvenue de la Cour européenne des droits de l’homme face au négationnisme. Obs. s/ la décision du 24 juin 2003, Garaudy c/ France », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2004, p. 653-662.
[22] JCP G., 2015, n° 51, 1405, note H. Surrel, « La Cour de Strasbourg donne une leçon de droits de l’homme à Dieudonné » ; X. Bioy, « Affaire Dieudonné : l’unisson franco-européen », AJDA, 2015, p. 2512 ; B. Nicaud, « Dieudonné M’Bala c. les droits de l’homme », Revue des Droits et des Libertés Fondamentaux, 2016, chron., n° 10.
[23] Sur ce sujet, Voy. : P. Vidal-Naquet, Les Assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, La Découverte, 1987 (nouvelle édition, 2005) ; H. Rousso, « Les racines du négationnisme en France », Cités, 2008/4, p. 51-62 ; D. Acke, « Révisionnisme et négationnisme », Témoigner. Entre histoire et mémoire, 122/2016, p. 53-63 ; T. Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, étude de droit comparé, Éditions Pédone, 2013 ; T. Hochmann et P. Kasparian (dir.), L’extension du délit de négationnisme, Institut Universitaire Varenne, 2019 ; V. Igounet, Histoire du négationnisme en France, PUF, 2020 ; S. Courouble Share, Les idées fausses ne meurent jamais… Le négationnisme, histoire d’un réseau international, Éditions Le Bord de l’eau, 2021 (Adde, sa thèse : Le négationnisme et son émergence dans l’espace public : analyse comparative : France, Angleterre, Allemagne et États-Unis. 1946-1981, Université Paris VII, 2008.
[24] « Liberté d’expression et négationnisme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001 (n° spécial : Le droit face à la montée du racisme et de la xénophobie), n° 46, p. 585.
[25] G. Cohen-Jonathan, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme des Nations Unies », in La lutte contre le négationnisme. Bilan et perspectives de la loi du 13 juillet 1990, La documentation Française, 2003, p. 77.
[26] M. Prazan et A. Minard, Roger Garaudy. Itinéraire d’une négation, Calmann-Lévy, 2007.
[27] Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse, issu de la Loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Cette disposition institue un délit pour ceux qui nient « l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».
[28] O. Jouanjan, Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, PUF, 2017, Introduction, p. 10.
[29] Voy., l’ouvrage de Valérie Igounet, Robert Faurisson : portrait d’un négationniste, Denoël, 2012.
[30] Robert Faurisson avait brièvement pris la parole, notamment pour tenir le propos suivant : « Je n’ai pas le droit de vous dire ce qu’est en réalité le révisionnisme, que ces gens-là appellent le négationnisme mais je peux vous dire […] Oui enfin s’ils tiennent à m’appeler négationniste, je les appelle affirmationnistes ».
[31] § 35 : [la Cour] n’a aucun doute quant à la teneur fortement antisémite du passage litigieux du spectacle du requérant. Elle remarque que ce dernier a honoré une personne connue et condamnée en France pour ses thèses négationnistes, en le faisant applaudir avec “cœur” par le public et en lui faisant remettre le “prix de l’infréquentabilité et de l’insolence“ ».
[32] En l’espèce, la Cour fait prévaloir « la nature artistique et satirique (du) portrait » et le défaut de limitation dans le temps et dans l’espace de l’injonction sur la réputation de l’homme public (§ 38). L’arrêt est particulièrement libéral s’agissant de l’interdiction judiciaire d’exposer une toile faite de collages de corps peints et de visages à partir d’agrandissements de photos de trente-quatre personnalités publiques nues s’adonnant à des pratiques sexuelles. Dans l’œuvre en question d’Otto Mühl, un homme politique se trouvait représenté agrippant le pénis éjaculant de Jörg Haider pendant qu’il était touché par deux autres membres de son parti (FPÖ) et éjaculant sur Mère Teresa. Parmi les personnalités visées, il y avait des personnalités religieuses : le cardinal autrichien Hermann Grœr et Mère Teresa, celle-ci représentée la poitrine nue en train de prier entre deux hommes – dont ledit cardinal – qui éjaculent sur elle. Pour le juge européen, les corps étant peints de manière irréaliste et exagérée, le tableau ne visait pas à refléter la réalité ; se trouvait donc en cause « une caricature des personnes concernées au moyen d’éléments satiriques » (§ 33). On notera également le constat de violation dans Dickinson c. Turquie (2 février 2021, exposition devant et dans un tribunal d’un collage représentant un corps de chien affublé de la tête du Premier ministre de l’époque et d’un missile en guise de queue, le chien étant entouré de symboles représentant le drapeau et les dollars US, avec sur la couverture l’inscription « Nous ne serons pas les chiens de Bush », en guise de protestation contre l’approbation par la Turquie de l’action américaine en Irak).
[33] Voy., à cet égard, la thèse soutenue de Baptiste Nicaud : La réception du message artistique à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme, Université de Limoges, 2011.
[34] « § 39. La Cour considère […] qu’au cours du passage litigieux, la soirée avait perdu son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le requérant ne saurait prétendre, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’ensemble du contexte de l’affaire, avoir agi en qualité d’artiste ayant le droit de s’exprimer par le biais de la satire, de l’humour et de la provocation. En effet, sous couvert d’une représentation humoristique, il a invité l’un des négationnistes français les plus connus, condamné un an auparavant pour contestation de crime contre l’humanité, pour l’honorer et lui donner la parole. En outre, dans le cadre d’une mise en scène outrageusement grotesque, il a fait intervenir un figurant jouant le rôle d’un déporté juif des camps de concentration, chargé de remettre un prix à Robert Faurisson. Dans cette valorisation du négationnisme à travers la place centrale donnée à l’intervention de Robert Faurisson et dans la mise en position avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination, la Cour voit une démonstration de haine et d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de l’holocauste. Elle ne saurait accepter que l’expression d’une idéologie qui va à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir la justice et la paix, soit assimilée à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui relèverait de la protection de l’article 10 de la Convention. ; « § 40. En outre, la Cour souligne que si l’article 17 de la Convention a en principe été jusqu’à présent appliqué à des propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, elle est convaincue qu’une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte. […] les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans leur but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué […]. (§ 41) ».
[35] Sauver la liberté d’expression, Éditions Albin Michel, 2021, p. 260-266, spéc. p. 260.
[36] M. Canto-Sperber, op. cit., p. 260.
[37] Professeur d’histoire-géographie dans un collège catholique sous contrat d’association, le requérant avait rédigé un texte – publié dans un bulletin d’information hebdomadaire destiné aux élèves et à leurs parents – mettant violemment en cause la communauté musulmane (« Les illusionnistes n’avaient pas prévu qu’en échange de la fuite éperdue de ces maudits Français d’Afrique du Nord, des hordes musulmanes inassimilables débarqueraient et investiraient les plus reculés de nos cantons » ; « Ils sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles […] ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes ! »). Cet article, à ses yeux « humoristique », lui avait valu, non simplement une condamnation à 5 000 francs d’amende pour délit d’incitation à la haine raciale, mais aussi la résiliation du contrat d’enseignement.
[38] Voy., notre commentaire de l’arrêt : « L’incompatibilité entre l’État théocratique et la CEDH », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 57, 2004, p. 207-221.
[39] Il en va de même « des propos ayant sans équivoque pour but de justifier des crimes de guerre tels que la torture ou des exécutions sommaires » (Orban et a. c. France, 15 janvier 2009, § 35, amendes et dommages-intérêts à la suite de la publication de l’ouvrage du général Paul Aussaresses relatif à leur pratique durant la Guerre d’Algérie).
[40] R. de Gouttes, « À propos du conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection contre le racisme », in Mélanges Louis-Edmond Pettiti, Bruylant, 1998, p. 258-260 ; M. Oetheimer, « La Cour européenne des droits de l’homme face au discours de haine », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, p. 65-68 ; note G. Cohen-Jonathan, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1999, p. 366 et s. (pour l’auteur, la Cour « épouse sans nuance les thèses développées par les requérants » et commet « un contresens historique ») ; RDP, 1999, chron. M. Levinet, p. 897.
[41] T. Hochmann, « Négationnisme du génocide arménien : défauts et qualités de l’arrêt Perinçek contre Suisse », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2016, chron., n° 27.
[42] Op. cit..
[43] Voy., le commentaire percutant de David Szymczak (« Rire de tout, même du terrorisme ? », Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, 2022, chron. n° 30).
[44] Actes terroristes revendiqués par l’organisation « État islamique » (attentats perpétrés à Paris en janvier et novembre 2015, puis à Nice et dans l’église Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016).
[45] S. Van Drooghenbrœck, op. cit., p. 543.
[46] C. Tomuschat, « Democratic Pluralism: the Right to Political Opposition », in A. Rosas, J. Helgesen et D. Goodman (eds.), The Strenght of Diversity. Human Rights and Pluralism Democracy, Nijhoff, 1992, p. 27-47, spéc. p. 33. Adde : les réticences d’Andras Sajo, qui a siégé à la Cour EDH au titre de la Hongrie de 2001 à 2007 (A. Sajo (éd.), Militant Democracy, Utrecht, Eleven International Publishing, 2004) et la circonspection de Guy Haarscher (« Les périls de la démocratie militante », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 80, 2010, p. 445-466, spéc. p. 458-462 : « chacun conviendra des dangers potentiels d’une telle théorie qui risque de corrompre les démocraties en les faisant ressembler de plus en plus à leurs ennemis »).
[47] O. De Frouville, L’intangibilité des droits de l’homme en droit international. Régime conventionnel des droits de l’homme et droit des traités, Pédone, 2004, p. 237.
[48] P. Gerard, « La protection de la démocratie contre les groupements liberticides », in H. Dumont, P. Mandoux, A. Strowel et F. Tulkens (dir.), Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, Bruylant, 2001, p. 84-85.
[49] M. Fabre-Magnan, M. Levinet, J.-P. Marguenaud, F. Tulkens, « Controverse sur l’autonomie personnelle et la liberté du consentement », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 48, 2008, p. 33.
[50] op. cit.. L’auteur écrit néanmoins : « Nous restons convaincus par la forte dimension symbolique de l’article 17, mais nous le sommes de moins en moins par son utilité tant pratique que pédagogique. », s’agissant d’une « clause [qui] pourrait finalement être assez contreproductive, tant pour l’office de la Cour, que du point de vue du message adressé aux requérants ».
[51] G. Haarscher, « Les périls de la démocratie militante », op. cit., p. 458-462. L’auteur met en relief la différence existant entre l’approche européenne et celle des États-Unis, incarnée par la jurisprudence de la Cour suprême. Adde : L. Grosclaude, La liberté d’expression dans la jurisprudence constitutionnelle des États-Unis, Thèse Université Paris Ii, 2003 ; P.-F. Docquir, Variables et variations de la liberté d’expression en Europe et aux États-Unis, Bruylant, 2007 ; G. Haarscher, « Liberté d’expression, blasphème, racisme : essai d’analyse philosophique et comparée », Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, n° 2007/1, http://www.philodroit.be, p. 15-19 (l’étude est reproduite in J. Allard, G. Haarscher, L. Hennebel et G. Lewkowicz, Juger les droits de l’homme, Europe et États-Unis face à face, Bruylant, 2008, p. 139-230 ; E. Zoller et al. (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Dalloz, 2008 ; D. Lacorne, Les frontières de la tolérance, Gallimard, 2016 ; E. Zoller, « La liberté d’expression aux États-Unis : une exception mal comprise », in G. Muhlmann, E. Decaux et E. Zoller (dir.), La liberté d’expression, Dalloz, 2019, p. 179-224.
[52] E. Zoller, « Propos introductifs : la liberté d’expression “bien précieux” en Europe, “bien sacré” aux États-Unis », in E. Zoller et al. (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, op. cit., p. 1-7.
[53] M. Rosenfeld et E. L. Cohen, « La Cour suprême des États-Unis, les sessions 2008-2009 et 2009-2010 : un clivage idéologique marqué dans l’interprétation de la Constitution », RDP, 2011, p. 1345-1366.
[54] Le Monde, 27 avril 1999, Horizons-Entretiens, p. 16 (l’intéressé répond ici à une question sur l’utilisation croissante d’Internet pour diffuser des messages incitant à la haine religieuse ou raciale et la possibilité de les interdire).
[55] Rapporté par Karen Bird, «« L’impossible réglementation des propos à caractère raciste aux États-Unis » », RFDC 2001, p. 665-687, spéc. p. 267, note 12.
[56] Voy., R. Dhoquois, « Les thèse négationnistes et la liberté d’expression, Ethnologie française, 2006/1, vol. 36, p. 27-33. Depuis son origine, ce dispositif subit de nombreuses critiques de la part d’historiens (par exemple, Pierre Nora ou François Furet), de juristes (par exemple, J.-Ph. Feldman, « Il faut abolir la loi Gayssot ! », Le Monde, 17 octobre 2006) et de femmes et d’hommes politiques – y compris de celles et de ceux issus de familles victimes de la Shoah (comme Simone Veil) – qui y voient la marque d’un délit d’opinion et considèrent qu’il n’appartient pas à la loi ou au juge de déterminer le contenu de la vérité historique. Il est vrai, comme l’écrit Jean-Philippe Feldman, que la loi ne vise pas tous les génocides et qu’elle peut être instrumentalisée par les négationnistes pour se poser en martyrs de la liberté d’expression. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel à l’issue d’une argumentation appropriée (Décision n° 2015-512 QPC, 8 janvier 2016, M. Vincent R. [Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité]). Voy. : T. Hochmann, « Négationnisme : le Conseil constitutionnel entre ange et démon », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2016, chron. n°03). Après avoir précisé que le législateur « peut instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers (considérant 5) et qu’« en réprimant les propos contestant l’existence de tels crimes, [il] a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme » (considérant 6), le Conseil affirme que « les propos contestant l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers » (considérant 7) et que les dispositions contestées […] visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d’antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques […] » (considérant 8).
[57] Tout en protestant que son texte remis à son « ami » Serge Thion, figure de l’ultra gauche négationniste, ait été mis en préface.
[58] « De Faurisson à Chomsky (1981) », in P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire. Un « Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, La Découverte, 1987, p. 93-103. Dans son avant-propos (p. 9-10), l’historien français écrit : « on peut, et on doit discuter sur les “révisionnistes” […] on ne discute pas avec les “révisionnistes” ».
[59] Li Hongtu, De la liberté. John Stuart Mill et la naissance du libéralisme, Éditions Kimé, 2021 ; A. Knüfer, La philosophie de John Stuart Mill. Repères, Vrin, 2022 ; C. Dejardin, John Stuart Mill, libéral utopique. Actualité d’une pensée visionnaire, Gallimard, 2022.
[60] C. Audard, « John Stuart Mill (1806-1873), Revue internationale de philosophie, 2015/2, n° 272, p. 153-156, spéc. p. 153.
[61] Traduction française, Gallimard, 1990, avec une substantielle préface de Pierre Bouretz (p. 14-60).
[62] I. Berlin, La liberté et ses traîtres. Six ennemis de la liberté, Éditions Payot, 2009, p. 29.
[63] Débouchant sur le relativisme des valeurs (le relativisme éthique), une telle valorisation du pluralisme des comportements ne saurait être absolue. Comme le rappelle Norbert Rouland, « l’acceptation du pluralisme ne peut s’accompagner que du tracé des limites souvent posées par le droit. » (À la découverte des femmes artistes. Une histoire de genre, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016, Conclusion générale [Morales, égalité et différenciations], p. 429). C’est reconnaître que le souci du pluralisme rencontre ses limites quand il conduit à l’ignorance des valeurs universelles, par exemple, s’il est invoqué pour justifier le cannibalisme, l’ignominie des châtiments corporels – comme l’amputation des membres ou l’infamie de la lapidation –, celle de l’excision, ou pour légitimer la polygamie, le mépris des femmes, le racisme ou l’antisémitisme.
[64] R. Polin, L’obligation politique, PUF, 1971, p. 133. L’auteur ajoute : « La liberté est pleinement efficace lorsque l’humanité est devenue capable de s’améliorer par l’usage d’une discussion libre et égale. C’est à l’individu qu’il appartient de se développer par lui-même, sans que nul autre, individu ou collectivité, ne puisse lui dicter son intérêt ou sa conduite ».
[65] C. Dejardin, op. cit., p. 162.
[66] « [L]es opinions perdent leur immunité lorsqu’on les exprime dans des circonstances telles que leur expression devient une instigation manifeste à quelque méfait. L’idée que ce sont les marchands de blé qui affament les pauvres ou que la propriété privée est un vol ne devrait pas être inquiétée tant qu’elle ne fait que circuler dans la presse ; mais elle peut encourir une juste punition si on l’exprime oralement, au milieu d’un rassemblement de furieux attroupés devant la porte d’un marchand de blé, ou si on la répand dans ce même rassemblement sous forme de placard. » (De la liberté, p. 145-146) (souligné par nous). Le propos n’est pas sans rappeler l’un des critères employés par la Cour suprême américaine pour accepter la censure de certaines opinions.
[67] M. Canto-Sperber, Sauver la liberté d’expression, Albin Michel, 2021, p. 146.
[68] Comme l’écrit l’universitaire américain Mordecai Roshwald, « [l]a réponse bien connue de Mill combine simple bon sens et ingénieuse sophistication. Selon l’argument simple, la certitude que l’opinion établie est absolument juste et que de ce fait aucune opinion contradictoire ne saurait être admise, peut être remise en cause : il se peut que l’opinion dominante s’avère fausse ou seulement partiellement juste. C’est pourquoi il faut offrir aux opinions dissonantes la possibilité de corriger ou de compléter les notions établies. D’après l’argument sophistiqué, même si nous sommes absolument certains que l’opinion établie constitue la vérité, la possibilité d’exprimer les notions erronées reste importante, car elle oblige les tenants de la vérité à prouver et à justifier la pertinence de leur position. En d’autres termes, l’expression de l’opinion erronée sert la vérité en obligeant ses partisans à la réexaminer et à l’endosser à nouveau avec conviction et compréhension, au lieu d’y croire tout simplement de manière dogmatique. » (« Tolérance, pluralisme et vérité », Diogène, 2007/3, n° 219, p. 31-44, spéc. p. 33).
[69] Cette « interprétation optimiste » du principe du pluralisme tient au fait que « laisser s’exprimer les opinions qu’on croit fausses, à condition d’avoir la possibilité de les discuter au sein de ce que Mill appelait un market-place of ideas, un forum, nous met en mesure de les critiquer. On a l’espoir que la discussion rationnelle permettra d’élargir le spectre des valeurs fondamentales sur lesquelles s’accordent les citoyens, avec l’idée que cette diversité intrinsèque est un moyen d’amélioration constant. » (M. Canto-Sperber et R. Ogien, La philosophie morale, PUF, 4e éd., 2017, 115-116).
[70] M. Roshwald, op. cit., p. 34-35.
[71] M.-F. Rigaux, « Préface », in Hugues Dumont et al. (dir.), op. cit., p. 11.
[72] « Conclusions. Quelle liberté pour les groupements liberticides ? Six questions pour un débat », in H. Dumont et al. (dir.), Ibid., p. 451. Ce faisant, François Ost prolonge le propos du philosophe Éric Weil : « la tolérance n’est possible que lorsqu’elle est réciproque […] elle ne s’applique que là où chaque groupe est tolérant […] Si un individu ou un groupe n’est pas prêt à se soumettre à la discussion suivant les lois bien connues de la discussion, il peut être toléré mais n’a aucun droit à la tolérance » (in Le temps de la réflexion, Gallimard, 1981, p. 193, cité par Jérôme Sohier, « Les dispositifs juridiques en droit comparé », in Hugues Dumont et al. (dir.), op. cit., p. 126).
[73] La société ouverte et ses ennemis, Le Seuil, 1978, t.1, p. 299.
[74] Le Seuil, 1987, § 35, La tolérance à l’égard des intolérants, p. 252-257, spéc. p. 254 et 256). Adde : A. Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, 13. La tolérance, PUF, 1995, p. 209-228. Pour l’auteur, une tolérance universelle « serait […] contradictoire en pratique […] puisqu’elle laisserait les mains libres à ceux qui veulent la supprimer. La tolérance ne vaut donc que dans certaines limites, qui sont celles de sa sauvegarde et de la préservation de ses conditions de possibilités. » (p. 213).
[75] P. Rolland, « Conclusion (La démocratie et ses ennemis) », Un débat sous la Terreur. La politique dans la République, Éditions Universitaires de Dijon, 2018, p. 131-143.
[76] « Militant Democracy and Fundamental Rights I, II », in The American Political Science Review, vol. 31, n° 3 et 4, p. 417-432 et 63-658 (articles reproduits en annexe de l’ouvrage précité : Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit, p. 231 et s.).
[77] Voy., l’analyse d’Augustin Simard : « L’échec de la Constitution de Weimar et les origines de la “démocratie militante” », Jus Politicum. Revue de droit politique, n° 1 (Le droit politique), décembre 2008. L’auteur insiste sur le lien existant dans la Loi fondamentale allemande de 1949 entre les dispositions de l’article 18 (clause de déchéance), des articles 9 et 21 (dissolution des partis politiques antidémocratiques) et de l’article 79 (clause d’éternité), dispositions ayant pour objet de s’assurer du loyalisme à l’égard de la Constitution. Cette spécificité allemande a récemment fait l’objet d’un arrêt de la Cour EDH (Godenau c. Allemagne, 29 novembre 2022), à propos de l’inscription d’une enseignante d’établissements secondaires du land de Hesse sur une liste d’enseignants inaptes à un poste dans des écoles publiques, inscription motivée, non par son comportement en présence de ses élèves, mais du doute quant au respect de son obligation de loyauté envers la Constitution du fait de son appartenance et de ses activités militantes au sein d’une formation politique proche de l’extrême droite, le Parti des Républicains. Le juge européen s’en remet ici à la marge nationale d’appréciation et considère que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à l’article 10 de la CEDH.
[78] Hermann Heller. La crise de la théorie de l’État, traduction et présentation par Olivier Jouanjan (Crise de l’État, crise de la théorie), Dalloz, 2012, p. 3. Olivier Jouanjan rappelle le défaut initial de véritable base démocratique du régime issu de la défaite et également que « [d]epuis 1930, le Reich fédéral ne fonctionnait plus qu’à l’ordonnance de nécessité et la parlementarisation du régime, inscrite dans le texte de la Constitution de Weimar, était devenue lettre morte. » (p. 13).
[79] Voy., l’analyse d’Augustin Simard : « L’échec de la Constitution de Weimar et les origines de la “démocratie militante” », Jus Politicum. Revue de droit politique, n° 1 (Le droit politique), décembre 2008.
[80] Pour autant, Karl Lœwenstein ne visait pas à proprement parler des mécanismes du type de la clause de déchéance, mais plutôt des mesures (y compris la possibilité de les dissoudre) relatives à l’organisation des partis fascistes, tout particulièrement de leurs moyens de propagande et d’intimidation (tenues militaires, parades militarisées dans les rues).
[81] Les droits de l’homme et la loi naturelle (1942), Éditions Desclée de Brouwer, 2005, p. 186-187.
[82] G. Cohen-Jonathan, « Abus de droit et libertés fondamentales », in Mélanges Louis Dubouis, Dalloz, 2002, p. 525. En effet, « [s]i on laisse à certains la possibilité d’utiliser la Convention pour porter atteinte à ses institutions [démocratiques], on risque d’aboutir à une situation où le principe même de toute liberté sera nié » (G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Economica, 1989, p. 553).
[83] op. cit., p. 424.
[84] Le juge slovène en appelle à « Karl Popper (qui) l’a génialement et très clairement formulé, en déclarant que la démocratie était pour tous, excepté ceux qui la détruiraient. Nous pouvons tout tolérer, sauf l’intolérance ».
[85] Voy. P. Le Mire, « Article 17 », in L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Éditions Economica, 1995, p. 509-522.
[86] Muriel Fabre-Magnan critique à juste titre « un arrêt qui refuse en effet de se prononcer sur les pratiques consistant pour une femme à se faire suspendre par les seins par des poulies, à sa faire coudre le sexe, à être marquée au fer rouge, à se voir versée de la cire brûlante sur la vulve, ou encore à se faire introduire une barre creuse dans l’anus par laquelle on versait de la bière pour la faire déféquer ». M. Fabre-Magnan, M. Levinet, J.-P. Marguenaud et F. Tulkens, « Controverse sur l’autonomie personnelle et la liberté du consentement », op. cit., spéc. p. 15).
[87] Magistrat et médecin fréquentant un club sadomasochiste, condamnés pour coups et blessures volontaires. Le premier requérant, également condamné pour incitation à la débauche ou à la prostitution (il proposait aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme « esclave » et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution ; il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et conduit quelques fois son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, pendant des mois), à cet devait être ultérieurement destitué.
[88] Sur ce principe, Voy. : M. Levinet, « La notion d’autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour EDH », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 49, 2009/1, p. 3-18 ; M. Fabre-Magnan, « Le domaine de l’autonomie personnelle. Indisponibilité du corps humain et justice sociale », Dalloz, 2008, p. 31 et s. ; H. Hurpy, Fonction de l’autonomie personnelle et protection des droits de la personne humaine dans les jurisprudences constitutionnelle et européenne, Bruylant, 2015.
[89] Au § 83 de son arrêt, la Cour EDH rappelle les formulations de son arrêt Pretty c. Royaume-Uni (29 avril 2002, § 66) : « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne ». Pour le juge de Strasbourg : « le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. […] (K. A. et A. D., § 84) ; « Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la “victime” de ces pratiques, dont le propre droit au libre choix quant aux modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti » (§ 85).
[90] M. Marzano et A. Milon, « Le corps transgressé : du consentement au souci de soi », in D. Borillo et D. Lochak (dir.), La liberté sexuelle, PUF, 2005, p. 114-116 (la contribution traite largement de l’affaire belge, peu de temps avant l’adoption de l’arrêt par la Cour EDH) ; M. Marzano, « Le mythe du consentement. Lorsque la liberté sexuelle devient une forme de servitude volontaire », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, PUF, n° 49, 2009, p. 109-130.
[91] Plus généralement, le consentement demeure une notion équivoque (Voy. R. Ogien, L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes, Gallimard, 2007, p. 173-196.
[92] À propos de la controverse doctrinale à ce sujet, Voy. : M. Fabre-Magnan, M. Levinet, J.‑P. Marguenaud et F. Tulkens, op. cit., spéc. p. 10-11, 13-14, 22-24, 30, 32-33. Si les deux premiers intervenants (Adde : M. Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Dalloz, 2005, p. 2979) souscrivent au recours direct à l’article 17 dans l’affaire (d’autres partagent cette opinion : G. Gonzalez, « La liberté sexuelle vue par la Cour EDH : une conception outrancière outrancière ? », in Liber Amicorum Françoise Ringel, PUAM, 2007, p. 122 ; F. Sudre, chron., JCP G., 2005, I, 159, n°12), le troisième est réticent, ne serait-ce qu’en raison de sa crainte de voir la Cour EDH privée de l’opportunité de rendre un « bel arrêt » sur le respect de la liberté sexuelle entre adultes consentants (Voy. J.‑P. Marguenaud (« Sadisme, masochisme et autonomie personnelle », in O. Dubos et J.-P. Marguenaud (dir.), Sexe, sexualité et droits européens. Enjeux politiques et scientifiques des libertés individuelles, Pédone, 2007, p. 85-92 ; « Liberté sexuelle et droit de disposer de son corps », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 49, 2009/1, p. 19-27). Quant à Françoise Tulkens, elle écarte fermement un recours à la clause de déchéance, étant donné le « risque de s’engager dans une croisière morale » (p. 33).