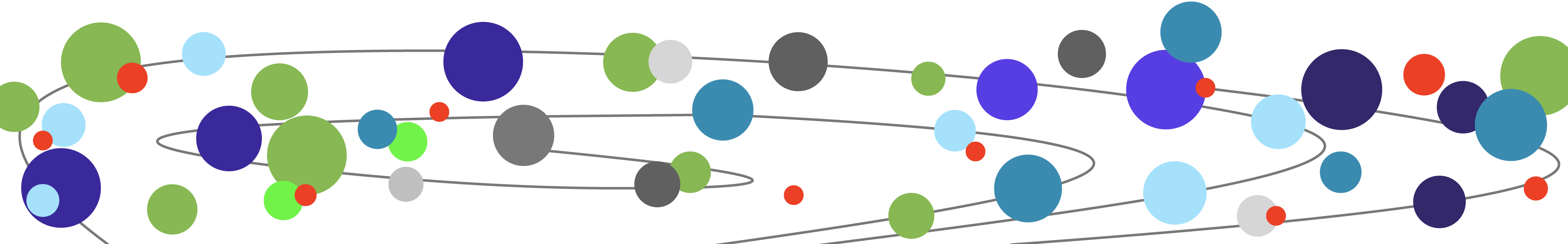François Molins, Procureur général près la Cour de cassation

Bonjour François Molins, merci d’avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour la revue Confluence des droits. Vous êtes Procureur général près la Cour de cassation et la revue souhaiterait avoir votre position sur plusieurs thèmes qui l’intéressent.
Qu’évoque pour vous la « confluence des droits » ? Quel est l’intérêt de diriger notre regard à la confluence des droits, là où les frontières se brouillent, que ce soit entre droit dur et droit mou, droit international et national, entre droits nationaux peut-être, emportés dans un processus d’internationalisation ?
Cette démarche est intéressante parce que l’on vit dans un monde où les influences réciproques sont très fortes et où il y a effectivement des frontières qui sont parfois difficiles à délimiter entre la norme nationale, la norme européenne, la norme internationale. Je vois et j’apprécie cela avec un regard de magistrat. C’est une vraie préoccupation parce que l’on est vraiment au cœur de notre office aujourd’hui car selon moi, le magistrat est dans une démarche non plus simplement d’application de la loi mais de coproduction du droit. Il doit effectivement, à travers ces phénomènes de confluence, essayer de conjuguer et d’articuler des normes qui sont d’origines diverses, nationales et européennes. Je pense qu’il s’agit là d’une approche extrêmement intéressante.

Vous œuvrez aussi quotidiennement pour la création d’un lien étroit entre la Cour de cassation et les facultés de droit. Dans ce contexte, quelle place le juriste, qu’il soit praticien ou théoricien, devrait-il aujourd’hui accorder au phénomène de l’internationalisation du droit, ou du moins à l’européanisation de la justice et plus globalement du droit ?
Il y a en effet un intérêt à renforcer le lien qu’il y a entre la Cour, Cour suprême et les Universités, parce que les étudiants, quels qu’ils soient et quel que soit le métier auquel ils se destinent, qu’ils soient magistrats, qu’ils soient avocats, qu’ils soient commissaires de justice par exemple se retrouveront dans un office qui consistera à travailler dans un paysage qui s’est beaucoup européanisé, beaucoup internationalisé. Je pense que nous aurons l’occasion de l’évoquer mais il peut parfois y avoir des conflits entre la norme nationale et les normes supranationales telles que les normes européennes.

Dès lors, comment appréciez-vous l’impact de ce phénomène sur l’évolution de la justice pénale française ? L’on sait, l’on voit, l’on constate partout en Europe la montée de l’euroscepticisme, notamment dans certains États. Doit-on se méfier de ce phénomène ? Doit-on se résoudre à constater l’échec de la construction européenne et revenir à un modèle fondé sur la primauté de la souveraineté nationale ? Doit-on au contraire, condamner ce phénomène et le combattre ?
Tout d’abord et il s’agit là d’une opinion personnelle, je ne pense pas qu’il faille tirer un constat d’échec de la construction européenne comme certains le font. En revanche, je pense qu’il faut se méfier de ce raisonnement parce que l’on voit qu’il peut avoir des effets extrêmement dangereux et pervers. S’il était poussé au bout, ce type de raisonnement pourrait justifier des volontés de sortir de l’Union européenne. C’est ce qui a conduit au Brexit. On sait très bien que le refus de certains aspects de la Convention européenne a peut-être pu pousser les Anglais à vouloir sortir de l’Union et cela a pu alimenter le Brexit.
Par ailleurs, je pense que cela a aussi des effets pervers parce que les tenants de ces théories qui consistent à dire « il faut absolument préserver la souveraineté nationale » adoptent des raisonnements dans lesquels finalement, c’est un peu haro sur le baudet ! On tire sur le juge en l’accusant d’être l’artisan de la destruction de la souveraineté nationale alors que ce n’est pas du tout la réalité. Ceux qui appliquent les textes appliquent aussi la Constitution. Et l’on vit dans un monde où l’article 55 de la Constitution donne une valeur supérieure aux traités internationaux. Le juge se contente donc d’appliquer le droit ! Il est simplement l’instrument des choix que l’on (le politique) a pu faire.
Je ne remets pas du tout en cause la construction européenne, bien au contraire – je pense que l’Europe a apporté beaucoup de choses en termes de progression des droits fondamentaux et des libertés publiques – et peut encore permettre de réaliser des progrès dans ce domaine. Mais je pense également qu’aujourd’hui, nous faisons face à des problèmes que le traité fondateur de l’Union ne résout plus. Le cas des données de connexion ou plutôt de la conservation et de l’accès aux données de connexion est un exemple très parlant. Il existe en effet aujourd’hui des tensions très fortes entre une exigence de liberté et une exigence de sécurité et le monde actuel n’avait peut-être pas été vu comme cela par les fondateurs de l’Union. Je pense donc qu’il faudrait vraiment qu’à un moment donné les politiques reprennent l’examen de cette situation, ses différentes exigences et décident quels équilibres doivent être ceux de l’Union européenne de demain. Il faudra résoudre ces tensions un jour ou l’autre pour éviter que cela ne devienne dangereux. Il revient donc aux dirigeants de lutter contre toute instrumentalisation à l’origine des peurs dont se nourrissent certains partis politiques désignant, de manière regrettable et dommageable, l’Union européenne comme le responsable de tous les maux de la société.
La réponse est donc à mon sens politique. C’est aux politiques à prendre leurs responsabilités et à déterminer si les normes du traité doivent rester les mêmes ou si elles doivent évoluer et dans quels sens ? Les grandes orientations doivent être définies par les politiques et les juges doivent appliquer les choix que se sera assignés l’ensemble des pays de l’Union européenne. Le juge est donc un acteur et un instrument qui n’est là que pour appliquer et conjuguer à la fois le droit supranational, le traité fondateur de l’Union, les directives les règlements et le droit national. Mais ce n’est pas à lui d’arbitrer les grands choix qu’il doit y avoir derrière tout cela.

La revue Confluence des droits accueille des recherches qui sont conduites à la croisée des ordres juridiques et aujourd’hui l’on constate que les flux de personnes, de capitaux et de données, qu’ils soient perçus comme une source d’enrichissement ou d’appauvrissement du droit, intéressent et questionnent nos systèmes notamment à l’aune du respect des droits fondamentaux. S’agissant par exemple de la criminalité transfrontalière, comment pourrait-on maintenir un équilibre entre la préservation de la sécurité et des droits fondamentaux de nos citoyens et l’abaissement des frontières pour permettre la circulation et la régulation de ces flux ?
Oui et normalement, encore une fois, la réponse devrait se trouver dans le traité fondateur de l’Union et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. C’est une question politique. Mais en tant que juriste, je pense aussi à certaines décisions de la Cour de justice, notamment liées aux flux, au fait que les gens voyagent, etc. Il existe tout de même une vraie action de la Cour de justice s’agissant du respect des droits à travers les migrations des gens pour s’assurer effectivement que ces droits fondamentaux ne soient pas écornés à cause des flux et des passages dans des États dont les législations sont différentes.

L’équilibre serait-il atteint si l’on arrivait à mettre en place des conditions qui garantissent les droits fondamentaux tout en permettant l’existence de ces flux ?
Tout à fait. L’un des fondements de l’Union européenne est la libre circulation des personnes et des marchandises, c’est là-dessus que tout repose. Mais pour autant, le travail des juridictions européennes et des juridictions nationales consiste à préserver cet équilibre et à faire en sorte que les libertés de personnes et de circulation soient assurées et qu’elles ne puissent pas remettre en cause les droits et les libertés fondamentaux de tout un chacun.

Dans un contexte de mondialisation, il y a nécessairement des répercussions, des dommages collatéraux. La situation en Ukraine et la position de l’Union européenne et des États membres par exemple posent la question de savoir si un État peut être interventionniste et dans l’affirmative jusqu’où peut-il aller sans contrevenir à la souveraineté d’un autre État ? La communauté internationale semble parfois démunie et peine à mettre en œuvre des actions suffisamment dissuasives face à la détermination de certains États. Pensez-vous qu’il soit alors utopique de vouloir maintenir cet équilibre ?
De toute façon, nous sommes nécessairement concernés, ne serait-ce qu’à raison des flux de populations que va générer cette situation. Par conséquent, même si tout cela est politique, je ne pense pas qu’il soit utopique de croire que cet équilibre peut être atteint. Mais l’on touche aussi ici nos propres limites parce que certains États voisins ne sont pas vraiment dans notre logique.
Si vous prenez l’exemple du fonctionnement de l’ONU, on ne reconnaît pas le caractère normatif de certaines recommandations et même si beaucoup en ont, d’autres n’en ont pas. Pour certaines, il y a des sanctions et dans ce cas, la question pourrait être posée : quel dispositif prend-on pour que les sanctions soient effectives ? Prend-on des dispositifs particuliers pour sanctionner les personnes qui violent les sanctions qui ont été instaurées par l’Union européenne, par exemple en lien avec le conflit ukrainien ? Mais il y a nécessairement des limites. Si le conseil de sécurité de l’ONU veut se saisir d’un problème, il suffit que l’un des pays membre de ce conseil fasse valoir son droit de véto pour bloquer tout processus.
Nous vivons tout de même dans un monde où tout est fondé sur le consensus et le partenariat autour du droit. Tout conflit armé n’est pas légitime. Le principe est celui du non-recours à la force sauf en cas de légitime défense comme le stipule l’article 51 de la charte des Nations Unies. Pour autant, en cas d’agression d’un pays par un autre, que peut-on faire ? Et l’on voit bien que si la culture du droit, et du respect des droits fondamentaux et des libertés publiques progresse et infuse, ce sont toujours les mêmes pays qui sont concernés. Il y a des pays avec lesquels on essaye de développer ces droits au travers d’actions de coopération, mais il y a tout une tranche du monde dans laquelle cela ne progresse pas vraiment.

Ne pensez-vous pas que des actions plus radicales devraient pouvoir être menées et que le principe de souveraineté devrait céder face à des situations intolérables lorsque l’on constate par exemple des violations manifestes du droit international ?
Je pense que dans ce cas, tout le monde a essayé en utilisant le levier des sanctions économiques. Mais ces dernières ont aussi leurs limites, elles peuvent aussi avoir des effets pervers. On le vit au quotidien !
Quant aux sanctions portant interdiction de vente d’armes, l’expérience montre que malgré l’interdiction générale de vente de matériel militaire, le matériel circule. Ce n’est donc pas pour autant qu’il n’y en a pas. Il y a toujours des États qui contourneront la règle pour permettre des convois clandestins de livraisons d’armes pour ne pas faire d’histoires. Je pense donc que cette idée est très séduisante sur un plan intellectuel mais sa mise en œuvre est beaucoup plus compliquée, parce qu’en termes de souveraineté, les gens sont égoïstes et les États pensent d’abord à leurs intérêts propres. Certains pays occidentaux sont des gros exportateurs d’armements. Par exemple, ce sont les Américains qui ont réarmé les talibans au moment du conflit avec l’Union soviétique. Il faut le savoir !

L’année 2022 s’achevant, quel bilan peut-on dresser de notre justice pénale ? Et quels sont, selon vous, les principaux défis que doit relever la justice pénale du XXIe siècle ? Quel regard aussi portez-vous sur son évolution ?
Le bilan n’est pas très positif. Je dirais même qu’il est plutôt négatif puisqu’en France, l’on vit dans un monde où tous les acteurs judiciaires, magistrats, greffiers, dénoncent les conditions de travail intenables qui sont les leurs et la perte de sens de leur office au quotidien. Tout cela s’est traduit dans une tribune bien connue appelée la « tribune des 3000 », mais qui a été en réalité signée par plus de neuf‑mille personnes à l’automne 2021 ! Et ce n’est pas du tout un constat corporatiste puisque c’est un constat qui rejoint celui que font nos concitoyens. Je lisais encore récemment des sondages sur l’opinion qu’ont les Français de la justice : il en ressort que plus de 60 % des personnes interrogées la trouvent trop lente, complexe, peu accessible, autrement dit un peu « à côté de la plaque ».
Le constat n’est donc franchement pas très bon. Je pense que l’on paye le prix d’un certain nombre de choses qui se sont cumulées et qui ont toutes une part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre aujourd’hui. D’abord, il y a peut-être certainement le fait que l’on a adopté une logique trop productiviste. Ce sont les conséquences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui a peut-être fait apparaître l’institution judiciaire comme une institution publique ordinaire. Or, la justice n’est pas un service public ordinaire ! Il s’agit d’un service public à valeur constitutionnelle et qui doit s’exercer dans le respect de certains principes. Cet élément essentiel a trop été oublié au cours des quinze dernières années.
Ensuite, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent tout cela et que nous avons fortement dénoncés dans le cadre du comité des États généraux auquel j’ai participé. C’est ce que l’on appelle le légicentrisme et la « fait diversisation » du droit pénal. Le fait qu’il y a un légicentrisme forcené, qu’il y a beaucoup trop de textes et qu’on légifère trop ! Par conséquent, on légifère mal avec des textes qui ne sont pas toujours cohérents, qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas lisibles, et qui en réalité procèdent d’une absence de vision puisqu’il n’y a pas derrière tout cela de vision systémique de la justice et de la mise en œuvre des réformes. Du reste, il y a trop de réformes, elles ne sont pas correctement mises en œuvre, elles ne sont pas accompagnées des moyens adéquats. Le ministère de la Justice n’est pas très bien organisé puisque son organisation est dénoncée depuis quatre ou cinq ans par la Cour des comptes qui a stigmatisé un certain nombre de failles et de dysfonctionnements qui devraient être corrigés, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la charge de travail réelle des magistrats. Tous ces éléments ont contribué à créer une situation devenue problématique et qui voit effectivement les conditions de travail se dégrader, et surtout les délais de traitement des procédures se détériorer, aussi bien au pénal qu’au civil. Le constat n’est donc pas réjouissant et, sur ce point, je vous renvoie à tout ce qui a été fait dans le cadre du comité des États généraux car il y a un vrai travail de fond à mener. J’attends maintenant de voir le plan d’action. Quel sera le contenu du plan d’action que le ministère a annoncé ? Répondra-t-il effectivement à l’ensemble des problèmes de fond qui sont posés et qui ont été posés par le comité des États généraux, j’espère que ce sera le cas aussi bien en ce qui concerne les moyens que les réformes de fond indispensables.

Les difficultés liées aux conditions de travail dégradées qui sont donc aujourd’hui dénoncées ne peuvent donc pas se résoudre simplement par des augmentations budgétaires. Il faudrait donc que les pouvoirs publics, les autorités prennent leur responsabilité et le temps de la réflexion en proposant une réforme en profondeur plutôt que de multiplier l’adoption de textes en donnant l’impression de résoudre un problème alors qu’en réalité cela ne fait que complexifier le système.
Vous avez exactement compris ce que je voulais dire. Il n’y a pas qu’une question de moyens, il faut avoir une vision systémique qui réponde aux problèmes de fond qui sont posés en termes de procédures, en termes d’organisation. Si la réponse se réduit à des moyens budgétaires supplémentaires, on court le risque d’arroser du sable, c’est tout ; c’est-à-dire que l’on disposera d’un effectif accru mais dans la mesure où l’on n’aura pas traité les problèmes de fond, ceux-ci ne seront pas réglés et les moyens ne suffiront pas. Il faut donc privilégier le courage de faire du fond – même si c’est plus long de faire du fond – et ne pas privilégier la communication au détriment du fond. Au XXIe siècle, on devrait se le permettre !

Vous avez choisi de consacrer votre carrière aux fonctions de magistrat du parquet : pour quelles raisons ? Quel regard portez-vous sur les liens qui unissent les deux professions qui font l’autorité judiciaire française ? Le maintien de cette unité de corps est-il vraiment indispensable selon vous ?
Je voulais être magistrat parce que cela correspondait, dans ma tête, à une exigence particulière propre à cette profession, de vérité, de rigueur, de pureté et d’exigence morale. Je n’ai pas toujours voulu être procureur. Quand je suis sorti de l’école de la magistrature, je voulais être juge d’instance ou substitut. Seulement voilà, j’ai été parquetier. Et en réalité, j’ai fait du parquet toute ma vie et je ne l’ai en effet jamais regretté. Je crois qu’en fait j’ai choisi le parquet parce qu’il y avait pour moi, derrière le parquet, une image de dynamisme qu’il n’y a pas derrière la fonction de juge. Le juge est totalement indépendant, c’est là, je pense, sa plus grande qualité mais il est un peu en service commandé dans la mesure où il ne répond qu’aux questions qui lui sont posées, ce n’est pas lui qui choisit les litiges qu’il juge. Au niveau d’un parquet, c’est tout à fait différent : quand on est procureur, on a des compétences multiples qui sont notamment de mettre en œuvre une politique pénale et de l’adapter à un ressort territorial d’où les fonctions de direction de la police judiciaire. J’ai toujours eu la conviction que c’était une fonction dans laquelle – si on faisait bien son métier et si on avait un peu de réussite – on pouvait espérer influer sur les choses et avoir un effet de levier pour améliorer la situation, notamment en termes de délinquance peut-être plus facilement qu’en étant au siège. Peut-être que je me trompe, mais c’est une vision que j’ai toujours eue parce qu’on est en prise directe avec les choses. Même s’il y a une complémentarité entre les fonctions de magistrats du parquet et du siège qui servent le même intérêt, les métiers du parquet sont extrêmement actifs et dynamiques.

De votre expérience, les relations magistrats du parquet et du siège fonctionnent-elles bien ?
Globalement, cela fonctionne bien. Certes, il y a eu des tensions ces dernières années car l’unité du corps ne suscite pas l’unanimité chez tous les magistrats. Il est vrai que le côté ouvert sur l’extérieur et le côté actif du parquet qui l’amène à travailler avec de nombreuses administrations et partenaires – beaucoup plus que les magistrats du siège – a pu parfois susciter certaines tensions à l’intérieur des juridictions.
Mais, il y a quand même, je pense, un courant majoritaire qui reconnaît ses bienfaits. Les relations sont donc globalement bonnes et elles le sont car, que l’on soit au siège ou au parquet, nous sommes des magistrats qui obéissons à une éthique et une déontologie qui nous sont communes. Cela nous rapproche naturellement et nous rend en réalité complémentaires. Pour autant, il faut aussi savoir cultiver et affirmer les différences : un juge, c’est un juge, et un procureur, c’est un procureur, le procureur ne doit pas être un juge.

Au cours de votre carrière, vous avez été directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces et directeur du cabinet du ministre de la Justice. Que pensez-vous des récentes consultations qui sont initiées par le gouvernement pour améliorer notre justice ? Cette méthode collaborative mise en place dans le cadre des chantiers de la justice, et plus récemment dans le cadre des États généraux de la Justice, est-elle selon vous sincère, pour permettre de rétablir la confiance des citoyens dans la justice, ou est-elle au contraire guidée par des objectifs purement politiques, voire électoralistes ?
Je serais tenté de vous répondre que l’avenir nous le dira parce que la technique du groupe de travail est bien connue. Quand on a un problème et que l’on veut le traiter, on fait toujours un groupe de travail ou on demande un audit, ou encore on met en place une inspection. Mais tout dépend ensuite ce que l’on fera du rapport. Je connais de nombreux groupes de travail dont les bons rapports ont pourtant totalement été enterrés. Le risque est donc toujours là. Nous verrons donc ce qu’il en est avec le rapport du comité nommé dans le cadre des États généraux de la justice. Il y a eu effectivement beaucoup de concertations au nom des États généraux. Là, visiblement, le ministère a souhaité faire le point sur les préconisations des États généraux donc un deuxième tour de concertations a eu lieu. Nous verrons si effectivement, comme je l’ai compris, un plan d’action sera déposé et si cette concertation aura été utile. Je pense que dans la justice tout le monde l’espère, tous les acteurs l’espèrent et souhaitent que cela serve à quelque chose et que le plan d’action permette de réparer l’Institution.

Mais parfois, à la suite de ces réflexions, certains rapports sont rendus et ne sont pas suivis d’effets du moins à court terme. Puis, à plus long terme, les recommandations de ces rapports sont prises en compte et deviennent du droit positif. À propos de la justice et des médias, je pense notamment au rapport de la Commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires dits rapport LINDEN rendu le 22 février 2005 dont certaines recommandations se trouvent désormais dans la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Oui, tout à fait. Des rapports sont suivis immédiatement et sont traduits par des réformes législatives dans les semaines ou les mois qui suivent leur publication alors que d’autres vont « dormir » un certain temps pour ne réapparaître que quelques années après et d’autres encore sont complètement oubliés. Sur ce dernier point, il y en a un notamment, c’est le rapport sur l’attractivité des fonctions civiles qui avait été déposé il y a deux ans au ministère et dont on n’a plus jamais entendu parler alors que pourtant les idées étaient très intéressantes. Peut-être ressortira-t-il un jour ? En tout cas, il faut l’espérer !

S’agissant plus précisément de la participation citoyenne, quel regard portez-vous sur les réformes qui visent d’un côté à réduire le champ d’intervention du jury populaire par la mise en place des Cours criminelles départementales et de l’autre à introduire, notamment à des fins pédagogiques, les procès filmés ?
Je pense qu’il ne faut pas remettre en cause le principe du jury populaire et des Cours d’assises dans notre pays, tout le monde y est très attaché et tout le monde en reconnaît les vertus et les bienfaits. Pour autant, j’ai toujours été favorable au principe des Cours criminelles départementales parce que je pense qu’il faut savoir ce que l’on veut. Il n’est plus possible de se voiler derrière des principes. Fonctionner aujourd’hui avec la seule Cour d’assises, c’est accepter le fait que des dossiers criminels ne soient audiencés que deux ans et demi, trois ans plus tard, ou parfois encore plus et, en conséquence, des accusés et des parties civiles attendent pendant des années l’issue d’une procédure pénale. Je trouve que cela n’est pas tenable et que cela justifie – en tout cas, c’est mon opinion – de confier à des Cours criminelles départementales le bas du spectre des affaires criminelles c’est-à-dire les affaires qui sont punies des peines les moins sévères, l’idée étant de mieux traiter d’une part ces dossiers et d’accélérer l’audiencement, et d’autre part, de mieux traiter certains crimes sexuels car l’on sait que la délinquance sexuelle, notamment criminelle, est mal traitée en France et que beaucoup de dossiers sont correctionnalisés. Si la Cour criminelle départementale peut permettre de lutter contre ces phénomènes abusifs de correctionnalisation, je trouve cela très bien.
S’agissant de l’enregistrement des audiences, j’y suis favorable à condition que cela soit fait correctement, en poursuivant et en respectant des objectifs pédagogiques. Si le dispositif est mis en œuvre dans des conditions d’organisation, de diffusion et donc de choix d’audience qui répondent à ces objectifs, je pense que cela ne peut que contribuer à mieux faire comprendre le fonctionnement de la justice à nos concitoyens.
Selon moi, il ne s’agit pas là d’une démarche contradictoire car il est tout à fait cohérent d’être favorable aux deux dispositifs.

Que pensez-vous dans ce cas de la tribune récemment publiée dans Le Monde et signée par un certain nombre d’universitaires et d’avocats sur les dangers de la généralisation des Cours criminelles ? Il est vrai que l’on s’interroge et s’inquiète de la possible disparition à moyen terme du jury populaire du fait de la restriction de son champ d’intervention en raison de la généralisation de ces juridictions. Mais il est vrai qu’il faudrait, encore une fois, avoir une réflexion plus globale et se demander pourquoi la justice est-elle si engorgée ? En matière pénale, elle l’est en matière correctionnelle et criminelle. Le nombre d’affaires à traiter a beaucoup plus important qu’il y a une dizaine ou il y a une vingtaine d’années, pour quelle(s) raison(s) ? L’augmentation des comportements tombant sous le coup de la loi pénale ? La libération de la parole et la hausse des dénonciations ainsi que l’hyperinflation normative sont sans doute des facteurs à prendre en compte. Et vous êtes, si j’ai bien compris, dans une logique pragmatique en affirmant que « c’est un moindre mal, si l’on veut apporter une réponse au justiciable qui ne soit pas trop lente. Pour ne pas perdre le sens de la décision, il faut nécessairement trouver des solutions, des alternatives à la Cour d’assises et les Cours criminelles départementales en sont une ». Pourriez-vous nous en dire plus ?
Oui. Même si je ne connais pas les statistiques et même s’il y a certainement une augmentation des dossiers qui passent aux assises depuis trente ou quarante ans, l’évolution que vous décrivez, est due surtout à une explosion du temps consacré à l’examen des affaires criminelles. De mon expérience, plus de quarante ans de carrière, j’ai pu constater cette évolution. Quand j’étais jeune substitut et que j’allais aux assises, la durée lambda – presque normée j’allais dire – d’une affaire simple aux assises, c’était une journée. Une journée ! Aujourd’hui, c’est minimum trois jours alors qu’à l’époque quand j’étais jeune magistrat, un dossier qui durait trois jours, c’était un gros et un long dossier. Je pense que c’est surtout ce phénomène qui explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
C’est donc l’explosion du temps consacré à l’examen des dossiers qui pourrait expliquer l’allongement des délais. Mais il y a bien évidemment des bons côtés aussi : écouter davantage, consacrer plus de temps et c’est intimement lié à l’évolution du procès pénal, à la place qui est donnée aux victimes, au temps que l’on prend. C’est une bonne chose de pouvoir prendre du temps mais il faut aussi arriver à juger les dossiers dans des délais qui soient efficaces et raisonnables. C’est pour cela que je trouve que la Cour criminelle départementale, si elle est bien normée, si elle répond à certaines conditions, peut apporter une plus-value au système. Il ne faut pas la généraliser à tous les crimes car il faut bien évidemment garder le jury populaire. Un rapport d’audit vient d’être rendu par un comité d’évaluation et de suivi. Des magistrats, des avocats et des parlementaires, préconisent un certain nombre de conditions qui sont en réalité autant de garanties permettant la généralisation de la cour criminelle départementale. Nous verrons ce que les pouvoirs publics vont faire.
Mais encore une fois, ce n’est pas tenable de dire à quelqu’un, après un arrêt de mise en accusation : « vous allez attendre trois ou quatre ans avant que votre affaire soit audiencée devant la Cour ». Je veux dire que cela n’a aucun sens. Pour l’accusé comme pour la victime, c’est insupportable pour les deux et le message envoyé par la société, par notre système, s’en trouve nécessairement déprécié.

Quelle lecture faites-vous de l’intervention constante et quasi instantanée de certains médias, notamment des réseaux sociaux, dans les affaires judiciaires ? La loi du 22 décembre 2021 essaye d’apporter une première réponse à ce phénomène, mais plus globalement, quelle est votre position là-dessus ?
J’en pense beaucoup de mal, mais quand on a dit ça, on n’a pas vraiment réglé le problème. Cela dit, je ne vois pas comment on peut maîtriser les réseaux sociaux car ce sont des espaces de liberté dans lesquels il y a de très bonnes choses mais il peut aussi y avoir le pire ! Il peut y avoir des contre-vérités absolues, de véritables mensonges qui sont colportés et je ne vois pas trop comment l’on peut empêcher cela. Bien évidemment, ces réseaux sociaux peuvent faire leur propre discipline et fermer les comptes de ceux qui exagèrent, mais est-ce suffisant ? Ce que je trouve assez inquiétant, c’est le développement de théories populistes, voire complotistes, avec ce nouveau regard qui est porté sur la justice et qui est parfois très critique. Il s’agit de la problématique – je n’ose même pas parler de lui parce qu’il ne le mérite pas – que j’appelle la problématique « Cyril Hanouna ». Je pense que ce sont des phénomènes de régression absolue avec des formes de retour au Moyen Âge et des formules telles que : « ah, mais il est coupable, il n’a pas besoin de procès. On ne comprend pas pourquoi ces gens sont défendus par des avocats », etc.
Je pense beaucoup de mal, à titre personnel, de cette évolution des choses car elle s’inscrit à l’opposé de l’idée même de Justice et d’État de droit. Mais ces idées infusent et les réseaux sociaux de même qu’un certain nombre d’émissions, pour des raisons bassement commerciales et pour faire de l’audience relayent ces propos. Les personnes qui vont dans ce type d’émissions, notamment certains responsables et certains politiques, seraient bien inspirés de réfléchir à deux fois avant d’y aller. Je pense donc qu’il faut essayer de combattre tout cela et pour ce faire, il faut être le plus pédagogique possible. Même si l’on n’est pas toujours entendu, il faut réaffirmer les choses, les répéter pour qu’elles soient intégrées et donner des grilles de lectures au public de sorte qu’il puisse comprendre et déjouer les pièges.

Pour terminer sur une note plus personnelle, la revue et ses lecteurs aimeraient recueillir votre avis et vos conseils sur la question suivante : fort de votre expérience, si vous pouviez rencontrer François Molins à l’âge de 20 ans, que lui diriez-vous ? Et plus généralement, quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux futurs étudiants en droit ?
En ce qui concerne les futurs étudiants en droit, la réponse est facile : je leur conseillerais de beaucoup travailler car c’est la clé de la réussite ! C’est certain ! Et moi, que me donnerais-je comme conseil(s) ? Je pense que je dirais ce que je dis de plus en plus souvent aux jeunes, je lui dirais qu’il a choisi un métier magnifique, un métier passionnant, et qu’il faut vraiment, dans cet exercice-là, un certain nombre de qualités au premier rang desquelles le courage. Il faut être courageux, porter haut cette qualité de courage et rester fidèle à ses idéaux.

Et après toutes ces années passées à pratiquer le droit, à gravir les échelons, vous imaginiez-vous que les métiers de la justice pouvaient avoir autant de facettes ? N’y a-t-il pas encore aujourd’hui une sorte d’émerveillement lors de l’accomplissement de certaines missions ?
Si bien sûr. Mais quand je suis rentré dans la magistrature, je n’étais pas un carriériste. Je ne me suis jamais dit : « un jour, je serai procureur de Paris », comme d’autres se disent : « un jour, je serai ministre ou président de la République. » Je n’ai jamais eu d’objectif carriériste et j’ai plutôt toujours eu, pendant quarante ans, le souci de privilégier l’intérêt de la fonction que j’allais occuper au-delà du grade ou des appellations. D’ailleurs, je suis comme tout le monde : j’ai des qualités, j’ai des tas de défauts, mais il y en a un que je n’ai pas, je n’ai jamais pris la « grosse tête » et malgré les fonctions importantes que j’ai occupées, je ne me suis jamais pris au sérieux. Pour cette raison, si je peux donner un dernier conseil, ce sera celui-ci : prendre les affaires au sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux.
Entretien réalisé par Akila Taleb-Karlsson, Maître de conférences, Université de Toulon, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, CDPC Jean-Claude Escarras, Toulon, France.
François Molins, « Entretien — Réflexions sur les défis de la justice pénale nationale et internationale ? », Confluence des droits_La revue [En ligne], 03 | 2023, mis en ligne le 31 mars 2023, URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2308.