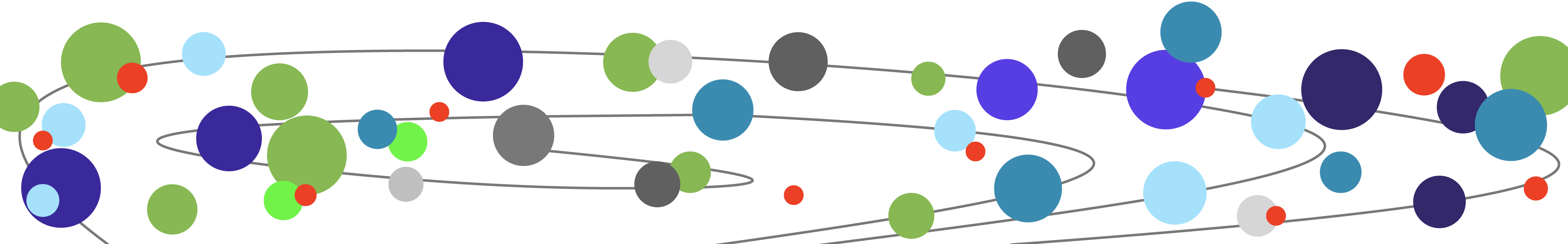Aurélie Mahalatchimy
Chargée de recherche au CNRS en droit, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
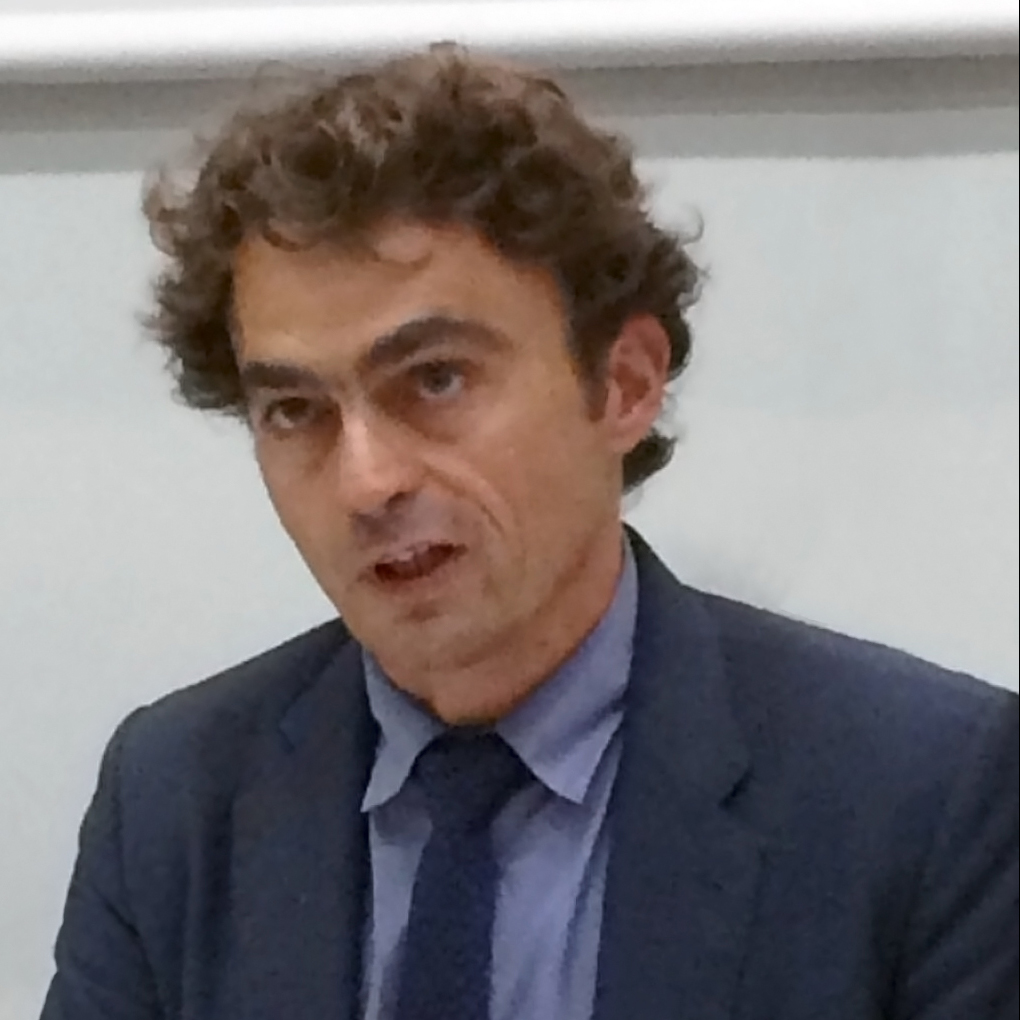
Xavier Magnon
Professeur de droit public, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

Marie Glinel
Maître de conférence en droit public à l’Université Lyon II Lumière
Les auteurs remercient grandement le professeur Tamara K. Hervey pour ses commentaires précieux lors de la rédaction de cet introduction du dossier.
Les concepts et les définitions jouent un rôle central en droit, en ce qu’ils permettent respectivement de nommer et de décrire, délimiter une chose réelle ou fictive, et de s’assurer d’une compréhension commune à son sujet, en vue de la qualifier pour lui associer un régime juridique. En inscrivant notre réflexion autour du « concept », nous entendons dépasser la seule réflexion notionnelle. Il sera, autant que possible, question de concepts et non pas de notions, la réflexion sur la « notion » étant considérée ici comme un préalable nécessaire à une réflexion sur le « concept ». Nous proposons de considérer que la réflexion notionnelle implique la recherche de tous les critères susceptibles d’être mobilisés pour identifier un élément du réel, avec exhaustivité, en identifiant et en discutant chaque critère, sans pour autant trancher entre eux dans leur pertinence à identifier le réel. Distinctement, la réflexion conceptuelle imposera de choisir parmi ces critères seulement ceux qui sont pertinents pour identifier le réel, et de situer chaque critère retenu à sa juste place pour révéler la typicité de l’objet décrit. Pour la science du droit en tant que discours savant sur le droit, l’opération de conceptualisation apparaît comme tenant au cœur de la démarche scientifique. Les études de théorie du droit, ou plus largement de recherche fondamentale en sciences juridiques, sont nombreuses sur le sujet[1].
Dans le domaine du biodroit, entendu ici comme le droit et les diverses questions juridiques relatives au biologique et/ou découlant des avancées technologiques liées à la biomédecine, et plus largement à la biotechnologie, les définitions et les concepts soulèvent des enjeux particuliers, rarement étudiés de façon frontale et transversale par la doctrine[2]. Pourtant, ils sont décisifs dans ce domaine face à des pratiques scientifiques évolutives et imprévisibles dans le temps et à des définitions scientifiques qui ne sont pas toujours consensuelles. Établir des définitions constitue donc un enjeu majeur pour le biodroit afin de saisir et d’orienter de manière satisfaisante ces pratiques. Si le biodroit peut lui-même être approché comme un concept de la science du droit, il est ici considéré en priorité comme un domaine, le champ d’étude de ce dossier. Les travaux intégrés à ce champ participent néanmoins à la conceptualisation du biodroit dont l’utilisation, à tout le moins comme expression doctrinale, gagnerait à être homogénéisée.
Le sujet soulève en effet tout un ensemble de problèmes concrets : est-il possible pour la loi ou la réglementation de définir de nouvelles innovations dans les domaines de la biomédecine ou de la biotechnologie dont le développement est en cours, ou des domaines scientifiques et technologiques présentant des risques inconnus ? Quel degré de liberté est-il possible de s’accorder dans les définitions légales ou réglementaires face à celles retenues par les scientifiques ? Quelle légitimité peut avoir le juriste à s’éloigner des définitions scientifiques ? Est-il préférable d’éviter de définir un objet à réglementer en raison de la difficulté à suivre un domaine technique et évolutif ? Quand et pourquoi la loi ou le règlement ont-ils choisi de définir ou de ne pas définir des innovations biomédicales ou des biotechnologies ? Quand et pourquoi la loi ou le règlement ont-ils choisi de définir et de réglementer en fonction de l’utilisation finale plutôt que de l’objet lui-même ?
Alors que la littérature juridique se concentre généralement sur les régimes juridiques à adopter et sur les défis posés à cette réglementation par les innovations biomédicales et biotechnologiques, ce dossier se concentre sur la manière dont la législation, ou la réglementation plus généralement, les définit ou ne les définit pas, et sur les conséquences des définitions et concepts sur le développement de ces innovations.
I. Les conventions de langage : « concept » et « définition »
Afin de structurer les échanges et la compréhension dans l’usage des termes « concept » et « définition », nous avons proposé aux contributeurs de retenir certaines conventions de langage autour du sens et des usages de ces termes.
Ainsi, nous proposons de désigner par :
- dénomination du concept, le nom donné au concept,
- intension ou définition du concept, la proposition formée d’un énoncé linguistique visant à identifier une réalité déterminée (celle qui entre sous la dénomination du concept) à partir de sa typicité,
- extension du concept, toutes les situations qui sont couvertes par le concept, que celui-ci permet de qualifier[3].
Ainsi, le mot « Chaise » est la dénomination du concept visant à décrire « un meuble avec dossier et sans accoudoir, conçu pour être utilisé par une seule personne pour s’assoir », ce qui constitue la définition du concept ; tous les meubles avec dossier et sans accoudoir, conçus pour être utilisé par une seule personne pour s’assoir sont des extensions du concept (ils sont des chaises).
Dans un énoncé linguistique se référant à un concept, il est possible d’identifier celui-ci dans ses trois dimensions : sa dénomination, sa définition ou son extension.
L’énoncé « je me suis assis sur une chaise » utilise la dénomination du concept, celui « je me suis assis sur un meuble avec dossier et sans accoudoir, conçu pour être utilisé par une seule personne pour s’assoir », sa définition et ce dernier, « je me suis assis sur la chaise de la salle à manger », une extension du concept. Le langage peut parfaitement mobiliser de manière dissociée la dénomination du concept, sa définition ou son extension, même si, dans notre exemple, la proposition qui constitue l’extension du concept use de sa dénomination (« la chaise de la salle à manger » est une « chaise », pour la désigner le terme de « chaise » est employé).
Le droit, en ce qu’il est formulé à partir d’énoncés linguistiques, peut donc soit user de la dénomination d’un concept, soit poser sa définition, soit en constituer l’extension. En effet, si le droit applicable définit parfois les concepts qu’il utilise pour déterminer l’étendue des droits et obligations juridiques qu’il établit, il contient également de nombreux concepts qui sont mobilisés sans être définis. Dans ce contexte, le droit de l’Union européenne (UE) est un bon exemple de cette démarche pour définir divers concepts juridiques au début des directives et des règlements, avant les articles qui les constituent, même si tous les concepts mobilisés ne sont pas toujours définis. Pour illustrer cette situation, dans le domaine du biodroit où la législation de l’UE sur les médicaments est parfois applicable, la proposition de réforme de la législation pharmaceutique montre de manière significative la volonté de définir les concepts et de les rendre accessibles en augmentant le nombre de définitions disponibles de 33 dans le code communautaire actuel[4] à 70 définitions dans la révision proposée[5]. Certaines de ces définitions existent déjà mais sont dispersées dans divers autres textes juridiques, y compris des lignes directrices, comme pour les « vaccins »[6], tandis que d’autres sont actuellement nommées sans être définies, comme pour le terme « non-clinique » que la proposition de réforme prévoit de définir[7]. Contrairement à la proposition de réforme de la législation pharmaceutique, le règlement (UE) 2024/1938 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine (ci-après « règlement SoHO »)[8] fera disparaître les définitions juridiques actuelles de sang, cellules et tissus, au bénéfice d’un nouveau concept juridique « les substances d’origine humaine ».
Ainsi, l’article 3.1 du règlement SoHO prévoit « Aux fins du présent règlement, on entend par : “substance d’origine humaine” ou “SoHO” : toute substance prélevée du corps humain, qu’elle contienne ou non des cellules et que ces cellules soient vivantes ou non, y compris les préparations à base de SoHO issues de la transformation d’une telle substance. » Il contient ainsi la dénomination du concept avec le terme « substance d’origine humaine », tout en le définissant. Concernant l’extension du concept, toute substance prélevée d’un corps humain contenant ou non des cellules, vivantes ou non, peut être qualifiée de « substance d’origine humaine ». Ainsi, en sera-t-il, par exemple, du sang, de ses composants, des cellules, des tissus, du microbiote, de l’urine ou des fèces d’origine humaine ou encore du lait maternel.
Cette précision faite, les énoncés susceptibles de mobiliser chacun des éléments du concept sont de plusieurs types : les énoncés du droit d’une part, qui sont directement énoncés dans un texte juridique[9], doivent être distingués, d’autre part, des énoncés sur le droit, qui proviennent d’un discours au sujet du droit[10]. En ce sens, nous suggérons, lorsque le concept (sa dénomination, sa définition ou son extension) est dans le droit, qu’il soit considéré comme un concept juridique (du moins sa dénomination, sa définition ou son extension est-elle juridique, déclinaisons valables pour les différentes catégories de concept distinguées après). Si le concept est dans les énoncés sur le droit, du moins dans le discours savant sur le droit, nous suggérons de dire qu’il est un concept de la science du droit. Ainsi en est-il, par exemple, du concept « d’innovation biomédicale », utilisé dans le cadre du projet ANR I-BioLex, mentionné ci-dessous. Le terme n’est pas mobilisé par le droit positif mais par la science du droit.
Compte tenu du sujet, nos analyses doctrinales incluront également d’autres discours susceptibles de mobiliser les concepts dans leurs trois dimensions. Tout d’abord, et plus particulièrement, les discours scientifiques en général, autres que ceux de la science du droit, pourront être mobilisés. Nous suggérons alors de parler de concept scientifique, l’adjectif qualificatif pouvant être décliné selon les disciplines (discours scientifique de la médecine (concept médical), de la philosophie (concept philosophique), de la sociologie (concept sociologique), etc.). À l’opposé, nous proposons de qualifier de communs, les discours qui mobilisent le sens commun et/ou intuitif d’une réalité déterminée, et qui ne relèvent d’aucune démarche scientifique : ils seront donc qualifiés de concept commun.
Ainsi, un concept, dans sa dénomination, sa définition ou son extension peut être qualifié de :
- concept juridique s’il est contenu dans des dispositions de droit positif (texte juridique applicable quelle que soit sa source ou son statut (loi, décret, décision de justice…) à un moment donné dans un ordre juridique donné) ;
- concept de la science du droit lorsqu’il est mobilisé par le discours savant sur le droit ;
- concept scientifique (de philosophie, de médecine, de sociologie, etc.) lorsqu’il est posé par un discours scientifique autre que celui qui porte sur le droit ;
- concept commun lorsque les dimensions connues (dénomination, définition, et/ou extension) de ce concept reposent sur des éléments communs, non scientifiques.
Les concepts juridiques peuvent mobiliser des concepts scientifiques, des concepts communs et des concepts de la science du droit. Par exemple, le concept juridique de « substance d’origine humaine » mobilise à la fois d’autres concepts juridiques comme les « préparations à base de SoHO »[11] et la « transformation »[12], qui seront ainsi appelés à devenir des concepts de la science du droit, les concepts scientifiques de « cellules vivantes ou non », et le concept commun de « corps humain ».
II. Le contexte : un dossier s’inscrivant dans le projet I-BioLex
Ce dossier s’inscrit dans le cadre du projet ANR I-BioLex « Fragmentation et défragmentation du droit des innovations biomédicales » (2021-2025) dont les objectifs consistent à explorer et à expliquer les processus de fragmentation et de défragmentation du droit et d’en décrypter les développements dans le temps dans le domaine du droit européen des innovations biomédicales[13]. À ces fins, le projet s’appuie sur l’état de l’art dans trois domaines principaux qui nourrissent les réflexions sur les définitions et concepts du biodroit contenues dans ce dossier.
En premier lieu, alors que l’ensemble des travaux juridiques du domaine atteste des enjeux liés à l’encadrement juridique des innovations biomédicales ou biotechnologiques, ou de technologies de santé complexes[14], deux tendances principales peuvent être identifiées. D’une part, les innovations remettent en question les cadres juridiques existants[15]. D’autre part, les innovations sont façonnées par la manière dont le droit est construit et mis en œuvre[16]. Alors que la plus grande partie de la littérature juridique relève de la première tendance, le projet I-BioLex embrasse ces deux tendances en prenant en compte ce double mouvement entre le droit et les innovations biomédicales (connu sous le nom de « coproduction » dans les études socio-juridiques)[17] ainsi que le contexte dans lequel le droit est adopté.
Dans le cadre de ce dossier, cela implique que les travaux réalisés portent sur des définitions juridiques et des concepts juridiques du biodroit qui sont non seulement remis en question par le développement des innovations biotechnologiques, mais qui ont également une influence sur celui-ci.
En deuxième lieu, la temporalité du droit positif est souvent remise en question par le développement des innovations biomédicales ou biotechnologiques (soi-disant « retard du droit ») : la durée de création, d’adoption et de mise en œuvre du droit menant à son obsolescence précoce pour l’encadrement d’innovations en perpétuelle évolution. Alors que de nombreux auteurs défendent, en sciences juridiques, la position selon laquelle le droit doit suivre ou réagir au développement de ces innovations[18], d’autres ont souligné le potentiel d’anticipation du droit[19]. Le lien temporel entre la création, la mise en œuvre et l’évolution du droit et le développement des innovations biomédicales est un autre aspect important du projet I-BioLex. Dans ce contexte, les définitions et concepts juridiques du biodroit peuvent être considérés comme révélateurs des liens entre les objectifs d’adaptabilité et de cohérence du biodroit et ses fonctions de réaction, d’anticipation ou d’abstention au regard de l’encadrement des innovations biomédicales ou biotechnologiques.
En troisième et dernier lieu, le projet I-BioLex explore les processus de fragmentation et défragmentation du droit des innovations biomédicales. Alors que le phénomène de fragmentation du droit est particulièrement discuté en droit international, principalement sous l’angle des problèmes qu’il engendre[20], le projet I-BioLex considère la fragmentation et la défragmentation comme des processus coexistant plutôt que comme des forces antagonistes. Les processus de fragmentation et de défragmentation sont ainsi considérés soit comme des stratégies juridiques pour répondre au développement des innovations biomédicales, soit comme des réponses plus contingentes reflétant l’évolution des contextes politiques et juridiques. À ce titre, ils révèlent la tension entre la volonté de soutenir le développement d’une innovation biomédicale ou biotechnologique, notamment par l’établissement de définitions et de concepts juridiques particuliers, et celle de ne pas entraver le développement d’autres innovations via d’autres définitions et concepts juridiques liés à des catégories juridiques, procédures ou régimes communs à d’autres objets du biodroit. Évolution, complémentarité, chevauchement, opposition, existence ou absence des définitions et concepts du biodroit participent ainsi à la mise en œuvre des processus de fragmentation et de défragmentation de ce droit.
III. Le contenu et l’évolution de ce dossier
Au-delà des conventions de langage proposées aux contributeurs, ce dossier est construit sur la base de trois orientations principales.
En premier lieu, le domaine est celui du biodroit, entendu au sens large, comme le droit relatif au biologique, qu’il s’agisse du matériel biologique humain, animal ou végétal, que celui-ci soit règlementé en tant que tel ou transformé en produit de santé, innovation biomédicale, ou plus largement innovation biotechnologique, au-delà du champ médical. Les contributions ne sont donc pas limitées au domaine médical ou à celui de la santé même si celui-ci reste majoritaire[21], puisqu’elles peuvent aussi être associées au domaine de l’environnement en particulier[22]. Dans tous les cas, elles relèvent toutes de la règlementation du domaine biologique.
En deuxième lieu, ce dossier entend couvrir plusieurs ordres juridiques, qu’il s’agisse des niveaux européens ou internationaux, ou même nationaux, l’approche comparée étant favorisée, sans être imposée. Ainsi, la plupart des contributions à ce dossier couvrent le droit de l’Union européenne[23], mais certaines couvrent à la fois le droit de l’Union européenne et le droit issu du Conseil de l’Europe[24], et parfois même aussi un droit national[25], ou le droit de l’Union européenne et celui issu du Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)[26].
En troisième lieu, ce dossier entend combiner des analyses de droit positif sur une ou plusieurs définitions ou concepts du biodroit[27], et des analyses de la science du droit, plus transversales et relatives à des réflexions sur l’ensemble ou plusieurs de ces définitions ou concepts[28].
Par ailleurs, il convient de souligner que ce dossier présente deux caractéristiques.
D’une part, les contributions sont soit en anglais soit en français, car les coordinateurs ont souhaité regrouper des analyses provenant de plusieurs cultures juridiques sur le thème de ce dossier. Si la plupart des juristes ayant initialement participé sont issus d’une culture juridique continentale, l’ouverture à la langue anglaise a permis la contribution de chercheurs non issus de cette culture. Elle permet également, à tout le moins, l’extension des discussions futures au-delà du monde francophone, celui-ci étant fortement marqué par la place centrale de la « qualification » juridique, qui ne correspond qu’imparfaitement à l’opération de « subsomption », terme de la traduction en anglais à laquelle la qualification pourrait être rattachée.
D’autre part, ce dossier est voulu dynamique. Il s’agit ici de tenir compte du lien temporel particulier qui existe entre le droit et les innovations biomédicales ou biotechnologiques, ou plus largement le biodroit, comme expliqué ci-dessus. À ce titre, la publication en ligne et en libre accès permise par Confluence des droits_La Revue offre la possibilité d’un enrichissement de ce dossier au gré de la communauté des sciences juridiques, ou même plus largement de celles des études en science et technologie. Les discussions sur les définitions et concepts juridiques du biodroit sont en effet initiées et regroupées au sein de ce dossier, mais ce dernier est destiné à être complété et à évoluer dans un espace accessible à tous.
[1] Voir notamment, pour quelques illustrations particulières : L.-M. Schmit, Les définitions en droit privé, Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2017 ; D. Truchet, « Les définitions législatives », in R. Drago (dir.), La confection de la loi, PUF, 2005, p. 193 ; C. Eiseinmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », APD, 1966, p. 25-43 ; C. Wolmark, La définition prétorienne. Étude en droit du travail, Thèse, Univ. Paris 10, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2007 ; A. Rey, « Polysémie du terme définition », in La définition, Colloque du Centre d’étude du lexique, Larousse, coll. Langue et Langage, 1990.
[2] À titre d’exception, on mentionnera en particulier : M. Glinel, Qualification juridique et délimitation des compétences normatives de l’Union européenne : l’exemple des biotechnologies, Thèse Droit, Université Toulouse Capitole, 2023.
[3] Nous reprenons ici une distinction, le triangle conceptuel, généralement attribuée à C. K. Ogden et I. A. Richards, The Meaning of Meaning, Hartcourt, Brace & World, 1923.
[4] Article 1, Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67–128.
[5] Article 4, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/83/CE et la directive 2009/35/CE, 26.04.2023, COM(2023)192 final.
[6] EMA, Guideline on clinical evaluation of vaccines, 16 January 2023, EMEA/CHMP/VWP/164653/05 Rev. 1.
[7] Article 4(11), Proposition de directive, COM(2023)192 final, op. cit.
[8] Règlement (UE) 2024/1938 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE, JO L, 2024/1938, 17.7.2024.
[9] Par exemple, « Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée par l’autorité compétente de cet État membre », Article 6(1), Directive 2001/83/CE, op. cit.
[10] Par exemple, sur le même sujet : « The obligation to secure a marketing authorisation, warranting safety and efficacy of medicines, was introduced for all medicines marketed within the then European Economic Community (EEC), setting in motion the EU’s precautionary approach to risk of harm from medicines ». T. K. Hervey, “Health law”, in S. Garben, L. Gormley, The Oxford Encylopedia of EU Law [OEEUL], June 2022.
[11] « Un type de SoHO qui : a) a été soumis à une transformation et, le cas échéant, à une ou plusieurs autres activités SoHO visées à l’article 2, paragraphe 1, point c); b) a une indication clinique spécifique; et c) est destiné à une application humaine à un receveur de SoHO ou est destiné à être distribué ». Article 3(37) du Règlement SoHO, op. cit.
[12] « “transformation” : toute opération intervenant dans le traitement des SoHO, y compris, mais sans s’y limiter, le lavage, la mise en forme, la séparation, la décontamination, la stérilisation, le stockage et le conditionnement, à l’exception du traitement préparatoire de SoHO en vue d’une application humaine immédiate lors d’une intervention chirurgicale, sans que les SoHO soient retirées du champ chirurgical avant leur application ». Article 3(23) du Règlement SoHO, op. cit.
[13] Pour plus d’informations sur ce projet, voir le site internet du projet (dernier accès le 03/11/2024).
[14] En ce sens, voir notamment : M. Flear, A.-M. Farrell, T. Hervey, T. Murphy, European Law and New Health Technologies, Oxford University Press, Oxford 2013, 477 p.
[15] En ce sens, voir notamment : A. Mahalatchimy, E. Rial-Sebbag (dir.), L’Humain médicament, Quaderni n° 81, printemps 2013, Éditions de la Maison des sciences de l’homme Paris, 194 p.
[16] En ce sens, voir notamment : C. Chabannon et al., « Les unités de thérapie cellulaire à l’épreuve de la règlementation sur les médicaments de thérapie innovante », Médecine/Sciences, mai 2014, 30 (5),
p. 576- 583.
[17] S. Jasanoff, States of knowledge : the co- production of knowledge and social order, Routledge 2004.
[18] R. Brownsword, K. Yeung, Regulating Technologies: Legal futures, regulatory frames and technological fixes, Hart Publishing, 2008, p. 3-22.
[19] A. Faulkner, Regulatory policy as innovation: constructing rules of engagement of a technological zone for tissue engineering in the European Union, Research Policy, 2009, 38, p. 596- 615.
[20] A.-C. Martineau, Le débat sur la fragmentation du droit international – Une analyse critique, Bruylant, 2015.
[21] Il s’agit ici des contributions de Matthieu Guerriaud ; Katrina Peherudoff et Elena Pires ; Audrey Lebret ; Gauthier Chassang, Lisa Feriol et Noémie Dubruel ; Adrien Bottacci ; Éloïse Gennet et Aurélie Mahalatchimy.
[22] En ce sens, voir les contributions d’Estelle Brosset et de Valentine Delcroix.
[23] En ce sens, voir les contributions d’Estelle Brosset ; Valentine Delcroix ; Katrina Peherudoff et Elena Pires ; Éloïse Gennet et Aurélie Mahalatchimy.
[24] En ce sens, voir les contributions d’Audrey Lebret, Gauthier Chassang, Lisa Feriol et Noémie Dubruel.
[25] En ce sens, voir les contributions de Xavier Bioy et d’Adrien Bottacci.
[26] En ce sens, voir la contribution de Matthieu Guerriaud.
[27] Ainsi en est-il des contributions relatives aux substances d’origine humaine, à la substance, aux organoïdes, aux médicaments de thérapie génique, aux innovations biomédicales, aux organismes génétiquement modifiés, mais aussi à l’espèce humaine, la vie privée, ou aux besoins médicaux non satisfaits.
[28] Concernant cette approche, voir la contribution de Marie Glinel et la synthèse de Xavier Magnon.
Aurélie Mahalatchimy, Xavier Magnon, Marie Glinel, « Pourquoi un dossier sur les définitions et les concepts du biodroit ? », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4175.
The authors deeply thank Professor Tamara K. Hervey for her useful comments on a previous version of this paper. The authors also thank Victoria Burakova-Lorgnier for her helpful support in the translation of this paper from French to English.
Why a special issue on definitions and concepts in biolaw?
Concepts and definitions play a central role in law as they allow, respectively, to name and describe, as well as delimit a real or fictional entity, and ensure a common understanding of it, with a view to legally qualifying it in order to associate it with a legal regime. By focusing on the conceptual dimension, we intend to go beyond an approach based purely on notions. As far as possible, the discussion will focus on concepts, rather than notions, the latter being regarded here as a necessary preliminary step to any reflection on the former. We offer to consider that a notional analysis entails the identification of all criteria that may be used to recognize an element of reality, in an exhaustive manner, by identifying and examining each criterion, without necessarily determining their relative relevance for identifying that reality. In contrast, a conceptual analysis requires selecting only those criteria that are relevant for identifying the element of reality, and assigning to each selected criterion its proper weight and position in order to reveal the typical features of the object described. For the science of law—as a scholarly discourse on law—the act of conceptualization lies at the core of the scientific approach. Numerous studies in legal theory, or more broadly in fundamental legal research, have addressed this topic.[1]
In the field of biolaw—understood here as the body of legal norms and legal questions pertaining to the biological domain and/or arising from technological advances in biomedicine, and more broadly in biotechnology—definitions and concepts present particular challenges that have rarely been addressed directly and transversally within legal scholarship.[2] Yet, definitions and concepts are of critical importance in this area, given the continuously evolving and unpredictable nature of scientific practices, and the absence of consensus around many scientific definitions. The establishment of definitions thus constitutes a fundamental concern for biolaw, as it enables the law to apprehend and orient such practices in a coherent and effective manner. While biolaw may itself be approached as a concept within the science of law, it is considered here, first and foremost, as a domain of legal inquiry, forming the subject matter of the present study. Nevertheless, the scholarly work produced within this domain contributes to the conceptual framing of biolaw, whose usage—as a doctrinal category—would benefit from greater consistency and theoretical refinement.
This thematic raises a series of concrete and pressing legal questions: Can legislation or regulation meaningfully define emerging innovations in biomedicine or biotechnology while these developments remain in flux, or in fields characterized by scientific and technological uncertainty? To what extent may legal or regulatory definitions diverge from those adopted by the scientific community, and under what conditions is such divergence justified? What normative legitimacy does the legal scholar or legislator possess in departing from scientific definitions? Is it preferable, in certain contexts, to refrain from defining a given object of regulation, due to the inherent difficulties in tracking developments within dynamic and highly technical fields? Under what circumstances, and for what reasons, have legislators or regulatory authorities chosen to define—or to abstain from defining—biomedical innovations or biotechnologies? When and why has the law opted to regulate on the basis of the intended use of a given technology rather than the intrinsic nature of the object itself?
While legal literature generally focuses on the legal or regulatory frameworks to be adopted and on the challenges posed to such regulation by biomedical and biotechnological innovations, this special issue focuses instead on how legislation—or regulation more broadly—defines or fails to define these innovations, and on the consequences that definitions and concepts may have for their development.
I. Language Conventions: “Concept” and “Definition”
In order to structure discussions and understanding in the use of the terms “concept” and “definition”, we suggest that authors retain certain conventions of language around the meaning and uses of these terms in this special issue.
Thus, we suggest to call:
- name of the concept, the designation given to the concept,
- definition of the concept, the proposition formed by a linguistic statement aimed at identifying a given reality (which comes under the name of the concept) on the basis of its typicality,
- the extension of the concept, all the situations covered by the concept, which it can be used to qualify.[3]
For instance, “Chair” is the name of the concept used to describe “a piece of furniture with backrest and no arms that is designed for one person to sit”, which is the definition of the concept. All the pieces of furniture with backrest and no arms that are designed for one person to sit are extensions of the concept (they are chairs). In a statement referring to a concept, it is possible to identify the concept in its three dimensions: its name, its definition or its extension.
The statement “I sat on a chair” uses the name of the concept, the statement “I sat on a piece of furniture with backrest and no arms that is designed for one person to sit”, its definition, and the statement “I sat on the dining room chair”, an extension of the concept. Language can perfectly well use the name of the concept, its definition or its extension separately, even if, in our example, the proposition that constitutes the extension of the concept uses its name (“the chair in the dining room” is a “chair”, so the term “chair” is used to designate it).
Law, insofar as it is formulated on the basis of linguistic statements, can therefore either use the name of a concept, define it or extend it. Indeed, while applicable law often defines the concepts it uses as a fundamental method to determine the scope of legal rights and obligations it establishes, it is also full of concepts that are named without being defined. In that context, European Union (EU) law is a good example of the efforts made to define various legal concepts in a dedicated article at the beginning of directives and regulations although one can wonder about the definitions of those that are named without being defined. For instance, in the field of biolaw where the EU medicines legislation may apply, the proposal of reform of the pharmaceutical legislation is significantly showing the efforts made to define concepts and make them accessible in increasing the number of definitions available from 33 in the current community code[4] to 70 definitions in its proposed revision.[5] Some of these definitions already exist but are scattered in various other law texts including guidelines such as ‘vaccines’,[6] while other are currently being named without being defined such as ‘non-clinical’. Nevertheless, it should be highlighted that the proposed reform of pharmaceutical legislation provides for a definition of this latter term.[7] In contrast to the proposed reform of pharmaceutical legislation, Regulation (EU) 2024/1938 on quality and safety standards for substances of human origin intended for human application (hereinafter the “SoHO Regulation”)[8] will eliminate the existing legal definitions of blood, cells, and tissues, in favor of a new legal concept: “substances of human origin.”
Thus, Article 3(1) of the SoHO Regulation provides: “For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: ‘substance of human origin’ or ‘SoHO’ means any substance collected from the human body, whether it contains cells or not and whether those cells are living or not, including SoHO preparations resulting from the processing of such substance.” The provision thereby introduces the name of the concept with the legal term “substance of human origin” while also providing its definition. As to the extension of the concept, any substance retrieved from the human body—regardless of whether it contains cells, and whether those cells are living or not—may fall within the definition of a “substance of human origin.” This would encompass, for example, blood and its components, cells, tissues, microbiota, human-origin urine or feces, and breast milk.
With this clarification, there are several types of statements that can mobilise each of the elements of the concept. Statements of the law, which are directly stated in a legal text[9] have to be distinguished from statements about the law. The latter comes from a discourse about the law.[10] Hence, we suggest that when the concept is in the law (when the law uses the word designating—or naming—the concept, when it defines or extends the concept), it is a legal concept. If the concept is in statements about the law, or at least in scholarly discourse on the law, we suggest to say that it is a concept of the science of law. This is the case, for example, with the concept of ‘biomedical innovation’, used in the ANR funded I-BioLex project mentioned below. The term is not used by positive law but by the science of law.
Given the subject of this special issue, our scholarly discussions will also include other discourses that may mobilise concepts in their three dimensions. In particular, we will use general scientific discourses, not only those of the science of law. Here, we suggest to write scientific concept to refer as a qualifier that may be applied according to discipline (scientific discourse in medicine (medical concept), philosophy (philosophical concept), sociology (sociological concept), etc.). On the other hand, discourse that can be described as common (that uses the common and/or intuitive sense of a given reality, and that is not based on any scientific approach) will be described as a common concept.
Thus, a concept, in its name, definition or extension, may be qualified as:
- a legal concept if it is contained in provisions of positive law (an applicable legal text whatever its source or status is (Act, Decree, Decision of a court. . .) at a given time in a given legal order);
- a concept of the science of law when it is used in scholarly discourse on the law;
- a scientific concept (of philosophy, medicine, sociology, etc.) when it is used by a scientific discourse other than legal discourse;
- a common concept when the known dimensions (name, definition and/or extension) of this concept are based on common, non-scientific elements.
Legal concepts can draw upon scientific concepts, common concepts, and concepts from the science of law. For instance, the legal concept of “substance of human origin” incorporates not only other legal concepts such as “SoHO preparations”[11] and “processing”[12] which will thus become concepts within the science of law, but also scientific concepts such as “living or non-living cells” and the common concept of “human body”.
II. Context: A special issue within the I-BioLex Project
This special issue is part of the ANR funded I-BioLex research project titled “Fragmentation and Defragmentation of the Law of Biomedical Innovations” (2021-2025), which aims to explore and explain the processes of fragmentation and defragmentation of law, as well as to analyze their developments over time within the field of European law concerning biomedical innovations.[13] To this end, the project draws on the state of the art in three main areas that inform the discussions on the definitions and concepts of biolaw contained in this special issue.
First, while much of the legal scholarship in this domain highlights the issues related to the legal regulation of biomedical or biotechnological innovations, or complex health technologies,[14] two main trends can be identified. On the one hand, innovations challenge existing legal frameworks.[15] On the other hand, innovations are shaped by the way in which law is constructed and implemented.[16] While the majority of legal literature aligns with the first trend, the I-BioLex project embraces both trends by considering this dual movement between law and biomedical innovations (known as “co-production” in socio-legal studies),[17] as well as the context in which the law is adopted. Regarding this special issue, this means that the work undertaken addresses legal definitions and concepts in biolaw that are not only questioned by the development of biotechnological innovations but also exert an influence on these very innovations.
Second, the temporality of positive law is frequently called into question by the pace of biomedical or biotechnological innovations (often referred to as the so-called “law lag”): the time required for the creation, adoption, and implementation of legal norms may lead to their early obsolescence in regulating constantly evolving innovations. While many scholars in legal science argue that the law must follow or respond to the development of such innovations,[18] others have highlighted the anticipatory potential of law.[19] The temporal relationship between the creation, implementation, and evolution of legal norms and the development of biomedical innovations constitutes another key dimension of the I-BioLex project. In this context, legal definitions and concepts in biolaw may be understood as indicators of the relationship between the objectives of adaptability and coherence in biolaw, and its regulatory functions—whether reactive, anticipatory, or abstentionist—in the governance of biomedical or biotechnological innovations.
Third and finally, the I-BioLex project explores the processes of fragmentation and defragmentation in the law governing biomedical innovations. While the phenomenon of legal fragmentation has been widely discussed in international law—primarily from the perspective of the problems it generates[20]—the I-BioLex project approaches fragmentation and defragmentation as co-existing processes, rather than as antagonistic forces. These processes are thus understood either as legal strategies employed in response to the development of biomedical innovations, or as contingent responses reflecting shifts in political and legal contexts. In this respect, they reveal a fundamental tension between, on the one hand, the objective of supporting the development of a particular biomedical or biotechnological innovation—often through the creation of specific legal definitions and concepts—and, on the other, the desire not to hinder the development of other innovations by maintaining alternative definitions and legal concepts tied to broader legal categories, procedures, or regulatory regimes applicable to other biolaw-related objects. The evolution, complementarity, overlap, opposition, presence, or absence of legal definitions and concepts within biolaw thus contribute directly to the implementation of fragmentation and defragmentation processes in this area of law.
III. Content and Development of this special issue
Beyond the language conventions suggested to contributors, this special issue is structured around three main orientations.
First, the domain in question is that of biolaw, understood in a broad sense as the body of law relating to the biological realm—whether concerning human, animal, or plant biological material—whether regulated in its natural state or transformed into a health product, a biomedical innovation, or, more broadly, a biotechnological innovation extending beyond the medical field. Contributions are therefore not limited to the medical or health sectors, even if those remain predominant;[21] they may also pertain to other areas, notably environmental law,[22] insofar as they fall within the regulatory governance of the biological domain.
Second, the dossier seeks to engage with multiple legal orders, whether European, international, or national levels, with a preference—though not a requirement—for comparative approaches. Accordingly, while most contributions address European Union law,[23] some extend to cover both EU law and that of the Council of Europe,[24] and in some cases also integrate national legal frameworks,[25] or examine EU law alongside the legal standards developed by the International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH).[26]
Third, this special issue aims to combine positive legal analyses focused on one or more definitions or concepts in biolaw[27] with more cross-cutting analyses stemming from the science of law, addressing broader reflections on several or all of these definitions and concepts.[28]
In addition, two key features characterize this special issue.
First, the contributions are published in either English or French, as the editors deliberately sought to gather analyses from a diversity of legal cultures on the special issue’s central theme. While most of the legal scholars involved at the project’s inception come from a continental legal tradition, the use of English has opened the door to contributions from researchers outside that tradition. It also facilitates, at the very least, the expansion of future discussions beyond the Francophone world, where legal discourse is particularly shaped by the centrality of the concept of qualification—a term that only partially aligns with the notion of subsumption, often used in English-language legal theory.
Second, the special issue is intended to be dynamic. This reflects the specific temporal relationship between law and biomedical or biotechnological innovations—or more broadly, biolaw—as outlined above. In this regard, the online and open-access format provided by Confluence des droits_La Revue offers the opportunity for this special issue to be enriched over time, through contributions from the legal scholarly community and, more broadly, from the field of science and technology studies. While the special issue initiates and brings together discussions on the legal definitions and concepts of biolaw, it is designed to be progressively expanded and continuously developed in an accessible and collaborative space.
[1]* For some specific examples, see : L.-M. Schmit, Les définitions en droit privé, Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2017, https://doi.org/10.4000/books.putc.2335; D. Truchet, « Les définitions législatives », in R. Drago (dir.), La confection de la loi, PUF, 2005, p. 193 ; C. Eiseinmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », APD, 1966, pp. 25–43 ; C. Wolmark, La définition prétorienne. Étude en droit du travail, Thèse, Univ. Paris 10, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2007; A. Rey, “Polysémie du terme définition”, in La définition, Colloque du Centre d’étude du lexique, Larousse, coll. Langue et Langage, 1990.
[2] By way of exception, particular mention should be made of M. Glinel, Qualification juridique et délimitation des compétences normatives de l’Union européenne : l’exemple des biotechnologies, Thèse Droit, Université Toulouse Capitole, 2023.
[3] Here we take up a distinction, the conceptual triangle, generally attributed to C. K. Ogden and I. A. Richards, The Meaning of Meaning, Hartcourt, Brace & World, 1923.
[4] Article 1, Directive 2001/83/CE of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (6 November 2001) [2001] OJ L311/67.
[5] Article 4, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC, COM(2023) 192 final.
[6] EMA, Guideline on clinical evaluation of vaccines, 16 January 2023, EMEA/CHMP/VWP/164653/05 Rev. 1.
[7] Article 4(11), Proposal for a Directive, COM(2023) 192 final, op. cit.
[8] Regulation (EU) 2024/1938 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC (13 June 2024) [2024] OJ L1938.
[9] For instance, “No medicinal product may be placed on the market of a Member State unless a marketing authorisation has been issued by the competent authorities”, Article 6(1), Directive 2001/83/EC, op. cit.
[10] For instance, on the same topic: “The obligation to secure a marketing authorisation, warranting safety and efficacy of medicines, was introduced for all medicines marketed within the then European Economic Community (EEC), setting in motion the EU’s precautionary approach to risk of harm from medicines.” T. K. Hervey, Health law, in S. Garben, L. Gormley, The Oxford Encylopedia of EU Law [OEEUL], June 2022.
[11] “A type of SoHO that: (a) has been subjected to processing and, where relevant, one or more other SoHO activities referred to in Article 2(1), point (c); (b) has a specific clinical indication; and (c) is intended for human application to a SoHO recipient or is intended for distribution”. Article 3(37), SoHO Regulation, op. cit.
[12] “‘Processing’ means any operation involved in the handling of SoHO, including, but not limited to, washing, shaping, separation, decontamination, sterilisation, preservation and packaging, except for the preparatory handling of SoHO for immediate human application during a surgical intervention, without the SoHO being removed from the surgical field before they are applied”. Article 3(23), SoHO Regulation, op. cit.
[13] For more information on this project, please visit the project website here.
[14] In this respect, see in particular: M. Flear, A.-M. Farrell, T. Hervey, T. Murphy, European Law and New Health Technologies, Oxford University Press, Oxford 2013, 477 p.
[15] In this respect, see in particular: A. Mahalatchimy, E. Rial-Sebbag (dir.), L’Humain médicament, Quaderni n° 81, printemps 2013, Éditions de la Maison des sciences de l’homme Paris, 194 p.
[16] In this respect, see in particular: C. Chabannon, et al., Les unités de thérapie cellulaire à l’épreuve de la règlementation sur les médicaments de thérapie innovante, Médecine/Sciences, mai 2014, 30 (5),
pp. 576–583.
[17] S. Jasanoff, States of knowledge: the co- production of knowledge and social order, Routledge 2004.
[18] R. Brownsword, K. Yeung, “Regulating Technologies: Legal futures, regulatory frames and technological fixes”, Hart Publishing 2008, pp. 3–22.
[19] A. Faulkner, Regulatory policy as innovation: constructing rules of engagement of a technological zone for tissue engineering in the European Union, Research Policy, 2009, 38, pp. 596–615.
[20] A.-C. Martineau, Le débat sur la fragmentation du droit international – Une analyse critique, Bruylant, 2015.
[21] See the contributions of Matthieu Guerriaud; Katrina Peherudoff and Elena Pires; Audrey Lebret; Gauthier Chassang, Lisa Feriol, and Noémie Dubruel; Adrien Bottacci; Éloïse Gennet and Aurélie Mahalatchimy.
[22] See the contributions of Estelle Brosset and Valentine Delcroix.
[23] See the contributions of Estelle Brosset, Valentine Delcroix, Katrina Peherudoff and Elena Pires, Éloïse Gennet and Aurélie Mahalatchimy.
[24] See the contributions of Audrey Lebret, and of Gauthier Chassang, Lisa Feriol, and Noémie Dubruel.
[25] See the contributions of Xavier Bioy, and Adrien Bottacci.
[26] See the contribution of Matthieu Guerriaud.
[27] This is the case not only of contributions relating to substances of human origin, organoids, gene therapy medicinal products, biomedical innovations and genetically modified organisms, but also to the human species, privacy and unmet medical needs.
[28] On this approach, see Marie Glinels contribution and Xavier Magnons synthesis.
Aurélie Mahalatchimy, Xavier Magnon, Marie Glinel, “Why a special issue on definitions and concepts in biolaw? ”, Définition et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4175.