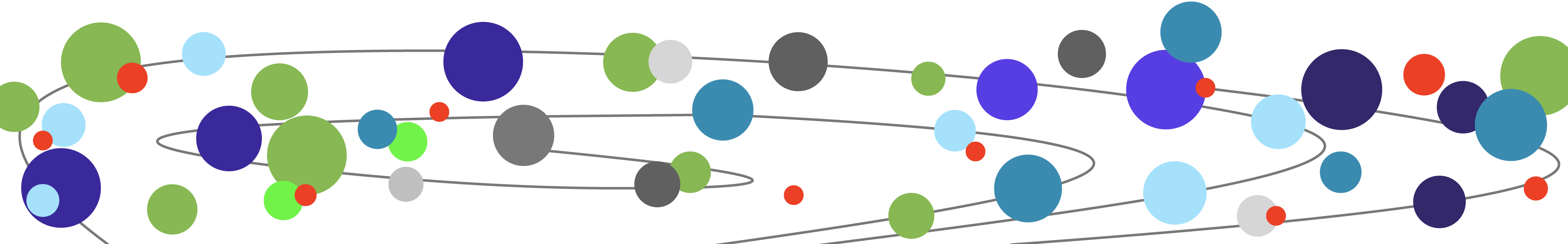Estelle Brosset
Professeure en droit public, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France, Institut universitaire de France
À la différence d’autres concepts du biodroit, les biotechnologies et plus spécifiquement les organismes génétiquement modifiés ont ceci de particulier qu’ils font, en droit (principalement en droit de l’Union européenne) l’objet d’une définition, définition d’ailleurs ancienne et stable. Cependant, y compris dans ce contexte, la simplicité n’est qu’apparente et la question de la définition demeure toujours une question ouverte. Le domaine des OGM en atteste comme d’autres. Il a toutefois ceci de spécifique qu’à son sujet, les positions sont très antagonistes – entre celles ceux qui envisagent les OGM comme une opportunité (notamment commerciale) et celles et ceux qui les considèrent comme une menace nouvelle pour la santé, pour l’environnement, voire pour l’humanité. De ce fait et parce que la définition déclenche l’application d’un régime juridique exigeant, les divergences d’interprétation à propos des critères de définition ont été particulièrement régulières et intenses à tel point qu’elles ont conduit récemment, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et, en réaction aux réponses de la Cour, pourraient conduire à une modification prochaine de la définition ce qu’a en effet proposé la Commission européenne.
Il y a cinquante ans, le mot même de « biotechnologie » était inconnu1. Il fait partie, depuis les années 1970, du vocabulaire courant. Composé de deux termes grecs, « bios » (la « vie ») et « technologia » (« technologie »), ce mot a été inventé pour désigner – même si les définitions (et c’est bien l’objet de cette contribution) peuvent varier – « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique »2.
La biotechnologie prise dans cette large acceptation est très ancienne. L’utilisation de micro-organismes dans l’agriculture, l’alimentation ou la santé est en effet millénaire. Les Mésopotamiens, 6 000 ans avant Jésus-Christ, utilisaient les propriétés des micro-organismes comme ferment de la bière. Les Égyptiens, vingt siècles avant l’ère chrétienne, se servaient des levures dans la fabrication du pain. Le rôle de ces micro-organismes dans le domaine de la santé n’est plus à démontrer depuis les travaux de Pasteur et la production d’antibiotiques. Ainsi, depuis très longtemps, des micro-organismes, c’est-à-dire des éléments du vivant, ont fourni à l’homme des biens dans des domaines variés
La biotechnologie a toutefois changé de nature lorsque sont apparues les techniques de génie génétique3. Les techniques de génie génétique permettent d’introduire dans une cellule un gène qu’elle ne possédait pas à l’origine, ce qui a pour conséquence la production, par la cellule receveuse, d’une protéine qui n’était pas antérieurement fabriquée par cette cellule. Ces techniques ont ceci de particulier qu’elles ouvrent la possibilité de s’affranchir des barrières d’espèces puisqu’il devient alors possible « pêcher dans n’importe quel règne du vivant le gène dont on a besoin pour le faire s’exprimer dans un autre règne »4. « Insérer un gène humain, un gène de chien ou de microbe dans du maïs devient réalité. Jamais association n’a été bouleversante à ce point et susceptible de toucher toutes les espèces »5. Sous l’effet de ces techniques, les biotechnologies ont subi un changement en profondeur, pour certains, une véritable « révolution »6. Les qualificatifs n’ont d’ailleurs pas manqué : les biotechnologies seraient alors devenues « modernes »7, de « seconde génération »8. Elles donnent lieu à la création d’organismes qualifiés de « génétiquement modifiés » (OGM).
À ce premier changement s’en est ajouté un autre récemment, lorsque sont apparues des nouvelles techniques (les techniques d’édition génomique) fondées, sauf exception9, non pas sur l’insertion d’un gène étranger dans un organisme, mais sur la régulation de l’expression des propres gènes d’un tel organisme. Dans le domaine végétal où ces nouvelles techniques sont, pour l’heure, appliquées principalement, celles-ci sont désignées sous leur acronyme anglais NBT « New Breeding Technic » ou NGT « New Genomic Technic ». Ces techniques, très hétérogènes10, consistent, pour la plupart, à cibler une partie de l’ADN pour la couper et la supprimer définitivement et pour, éventuellement, la remplacer par une copie du gène normal ou altéré. Certaines de ces techniques ont été tout à fait médiatisées : c’est le cas de la technique CRISPR-Cas9 ou technique du « ciseau moléculaire » qui consiste à introduire dans une cellule l’endonucléase Cas9 qui est capable d’induire une cassure du double brin de l’ADN en un site choisi du génome. Ces techniques – parfois aussi désignés aussi sous le terme de techniques de « mutagénèse dirigée » ou « ciblée » – ont attiré toute l’attention, car elles permettent de modifier un gène ou de moduler son expression et ce, de façon ciblée11 et surtout sans transgénèse.
La question qui nous était posée par les coordinateurs de ce numéro spécial était la suivante : celle de savoir si et, le cas échéant, de quelle manière, le droit de l’Union a ou non défini les biotechnologies et plus précisément les organismes qui en sont issus : les OGM. La réponse n’est pas à première vue difficile, elle est, au contraire, assez simple : à la différence d’autres « concepts du biodroit » (pour reprendre les termes retenus dans l’ouvrage), il existe bien une définition donnée par le droit et d’ailleurs, celle-ci est ancienne et s’est révélée pérenne. Cependant, y compris dans ce contexte, la simplicité n’est qu’apparente, car les éléments retenus pour définir sont toujours susceptibles d’être interprétés de façon variable. Le domaine des OGM ne déroge pas à cette constante. Il a toutefois ceci de particulier qu’à son sujet, les positions sont très antagonistes – entre celles ceux qui envisagent les OGM comme une opportunité (notamment commerciale) et celles et ceux qui les considèrent comme une menace nouvelle pour la santé, pour l’environnement, voire pour l’humanité. « Nulle part ailleurs dans le monde ne sont aussi fortes les réactions, violentes les oppositions, vives les passions sur le sujet des OGM qu’en Europe »12 au point d’ailleurs de transformer les OGM en un « des mots-réflexes qui suscitent aussitôt l’ire et la peur du consommateur européen »13. Or, loin de contenir ces oppositions entre des positions (voire des visions du monde) quasiment irréductibles, le droit de l’Union, a tout au contraire constitué le lieu d’expression de ces oppositions14 : il a fonctionné « comme ressource et comme objet de la lutte »15. Cela explique sans aucun doute que les divergences d’interprétation à propos des éléments de la définition aient persisté, qu’ils aient même été portées devant le juge puis, en réaction aux réponses de la Cour, qu’une modification de la définition soit désormais proposée.
Dans ce domaine, la fixité de la définition (I) n’a donc pas empêché que les divergences d’interprétation demeurent intenses au point même de solliciter à deux reprises le juge de l’Union (II). Elles expliquent également qu’en réaction à ces arrêts la modification des éléments de la définition soit envisagée (III).
I. Fixité de la définition
Les premiers textes en la matière ont plus de quarante ans avec l’adoption, en 1982, d’une recommandation n° 82/472/CEE du Conseil16 concernant l’enregistrement des travaux relatifs à l’ADN recombinant17. En 1985, un Comité interservice de Réglementation de la biotechnologie (BRIC) est constitué, en application d’une Communication de la Commission, en vue d’évaluer les besoins en matière de législation communautaire dans ce domaine18. En 1988, deux propositions de directives du Conseil concernant respectivement l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM)19 et la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement20 étaient publiées. Les deux directives sont finalement adoptées le 23 avril 1990 sous le n° 90/219/CEE pour la première21 et sous le n° 90/220/CEE pour la seconde22. Depuis lors, les directives initiales ont été révisées : la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement est par exemple23 venue abroger la directive 90/220/CEE24.
D’emblée, dans ces directives, une définition de ce qu’est un OGM a été donnée. Il faut dire que les deux directives avaient vocation à couvrir l’une l’ensemble des MGM25, l’autre l’ensemble des OGM26. Aucune limite par type de MGM ou OGM n’étant prévue, il fallait dès lors nécessairement, pour délimiter le champ d’application de ces deux textes, libeller la définition d’un MGM et d’un OGM. Il est d’abord précisé ce qu’est un micro-organisme (« toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire »27) et un organisme (« toute entité biologique »28, à l’exception toutefois des êtres humains29). Et il est surtout précisé ce qu’est un MGM ou OGM : un micro-organisme ou un organisme « dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle »30. Pour délimiter de tels procédés de recombinaison « non naturels », les directives apportent un complément : elles renvoient à une liste de techniques31 celles visées dans l’annexe I-A (première partie) de ces directives32. Précisons aussi que sont prévues des exemptions. Certes, dans ces cas-là, l’on dépasse la question de la définition : en effet, si l’on exempte c’est précisément parce qu’il s’agit d’organismes qui sont des OGM. Cependant, ces exemptions sont essentielles, car précisément elles conduisent à modifier le lien entre définition et champ d’application en permettant à des organismes qualifiés d’OGM de ne pas être soumis au champ d’application de la directive. Deux dispositions mentionnent des exemptions. D’abord, le considérant 17 de la directive 2001/18 énonce que « la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps »33. Par ailleurs, l’article 3-1 de cette même directive prévoit que « la présente directive ne s’applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I-B à condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ». Deux techniques sont visées (d’une manière ici exhaustive) dans l’annexe I-B : la mutagenèse et la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles.
D’emblée le critère retenu pour la définition avait été remarqué. Ce critère était en effet clairement imbriqué à un objectif, celui de la précaution34 : « au seul motif que les biotechnologies sont des techniques nouvelles et que toute technique nouvelle engendre sinon un risque certain du moins une incertitude scientifique […], la prudence est obligatoire tant que l’innocuité des OGM n’a pas été démontrée »35. Parce que « c’est la technique utilisée […] qui, dans l’esprit de la Commission européenne, produit l’incertitude scientifique qui caractérise les OGM », c’est en conséquence elle qui doit « faire la différence »36 et constituer le critère de définition.
Remarquons que la définition n’a pas été modifiée lors des révisions de ces directives. En plus, elle a été reprise, telle quelle, dans les textes sectoriels qui ont été progressivement adoptés à la suite des directives. Pour comprendre, rappelons que, d’emblée, il est « apparu qu’une législation horizontale ne saurait s’avérer suffisante pour satisfaire les besoins de réglementation émanant de secteurs économiques aussi divers que ceux dans lesquels la biotechnologie trouve ses applications » et qu’il fallait donc prévoir « une législation adaptée aux différents types de produits ». L’article 10 de la directive 90/220/CEE prévoyait donc de remplacer l’évaluation des risques pour l’environnement prévue par la directive 90/220/CE par celles prévues dans des législations sectorielles en imposant toutefois que ces dernières soient « analogues » à celle qu’elle instaure ce que l’article 12 de la directive 2001/18 a réitéré37. Il était dès lors attendu que les critères de définition soient les mêmes. Certes textes sectoriels préexistaient à la directive et en ont simplement importé les principales dispositions. Tel a été le cas pour les OGM destinés à des fins pharmaceutiques38 ou pour les variétés végétales génétiquement modifiées39. D’autres ont été instituées ex nihilo : cela a été le cas pour les aliments génétiquement modifiés qui, d’abord soumis au règlement n° 258/97/CE « nouveaux aliments »40, ont, à partir de 2003, fait l’objet d’un règlement dédié, le règlement n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés41.
À noter que, en ce dernier cas42, si la définition a été reprise, cela ne s’est pas fait aisément, attestant déjà alors de divergences politiques à propos des critères de la définition. Dans le domaine alimentaire, le premier texte adopté et applicable aux aliments génétiquement modifiés était en effet le règlement « nouveaux aliments »43. Or, d’emblée, à sa lecture, on pouvait constater que l’approche choisie était tout à fait différente de celle suivie par les directives. D’abord, au lieu de viser spécifiquement les aliments issus de procédés biotechnologiques, le texte énumérait plusieurs catégories de produits alimentaires dits « nouveaux » entrant dans le champ d’application de ce texte dont ceux génétiquement modifiés. Ensuite, le règlement exemptait de la plupart des obligations prévues certains types d’aliments parmi lesquels on trouvait les aliments produits à partir d’OGM, mais n’en contenant pas et qui pouvait être considéré comme « substantiellement équivalents à des aliments traditionnels en ce qui concerne leur composition, leur valeur nutritive, leur métabolisme, leur usage et leur teneur en substances indésirables »44. Au travers de cette notion d’équivalence substantielle45 (qui impliquait la comparaison entre les aliments génétiquement modifiés et les aliments « traditionnels »46), l’on assistait alors à un changement manifeste d’optique vis-à-vis des premières directives : les produits issus d’OGM n’étaient plus considérés comme présentant a priori des risques particuliers liés à l’utilisation de la biotechnologie moderne pour leur fabrication. Au contraire, ils pouvaient, en fonction de leurs caractéristiques finales, être traités comme des produits classiques du point de vue de la sécurité. Le règlement 1829/2003 a toutefois remplacé, finalement assez rapidement, ce règlement n° 258/97/CE. Or, s’il présente quelques points communs avec le règlement précédent (puisqu’il s’applique aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux contenant ou consistant en des OGM, mais aussi produits à partir d’OGM47), il s’en distingue sur presque tout le reste. D’abord, il est dédié aux produits alimentaires génétiquement modifiés48. Ensuite et surtout, il abandonne clairement l’approche fondée sur la substantielle équivalence. Une explication est donnée au considérant 6 : « si l’équivalence substantielle49 est une étape essentielle du processus d’évaluation de l’innocuité des aliments génétiquement modifiés, elle ne constitue pas une évaluation de l’innocuité en soi ». Aucune procédure simplifiée n’est donc prévue en cas d’équivalence substantielle ; au contraire « pour assurer la clarté, la transparence et un cadre harmonisé d’autorisation des aliments génétiquement modifiés » elle est « abandonnée »50.
Ce premier épisode avait toutefois démontré combien la définition constituait un enjeu au plan politique et donc un point de divergence possible au plan juridique ce que deux affaires contentieuses ont nettement confirmé.
II. Intensité des divergences d’interprétation
Y compris lorsqu’une définition est fixe et plutôt précise (ici assortie d’une liste de techniques dites de modification génétique), les divergences d’interprétation sont toujours possibles. Elles le sont, car les critères utilisés dans la définition sont toujours susceptibles d’interprétations variables. Ces divergences sont d’autant plus importantes que la définition détermine le champ d’application d’obligations substantielles à propos duquel les oppositions politiques sont importantes.
Pour illustrer, on rappellera la formule employée dans l’article 2-2 de la directive : est un OGM un organisme « dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Or, presque tous les éléments de cette formule sont susceptibles d’être interprétés avec des variations. C’est le cas de l’expression « qui ne s’effectue pas » qui peut être appréciée de façon différente selon qu’on la considère d’une manière absolue, sans comparaison (en soi qui « ne s’effectue pas » naturellement) ou d’une manière relative (qui « ne peut pas s’effectuer » [naturellement] ou au contraire « aurait pu s’effectuer » [naturellement])51. Il n’est pas non plus impossible de considérer que la formule – qui énonce qu’est un OGM un « organisme dont le matériel génétique a été modifié » – contient un second critère (et donc une définition cumulative). L’OGM devrait faire apparaître des altérations génétiques et la question serait alors celle de savoir si un « seuil » dans ces altérations devrait être exigé ou si la modification d’une seule « paire de bases » est suffisante pour déduire une modification au sens de la directive. La liste des techniques de modifications génétiques qui permet de définir ce qui n’est pas une multiplication ou recombinaison naturelle est aussi susceptible d’interprétations diverses. D’abord, elle est libellée d’une manière non exhaustive puisqu’il est bien précisé que « la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe IA, première partie »52 qui, sont « entre autres »53 les suivantes. En utilisant ce terme « entre autres », l’objectif est de permettre à des techniques non encore connues ou bien établies d’être ajoutées ce que la Commission a elle-même confirmé54. Par ailleurs, s’agissant des techniques visées, il est mentionné plusieurs critères qui peuvent eux aussi, tous, ouvrir des discussions. C’est le cas des techniques de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique qui sont celles qui permettent « l’insertion de molécules d’acide nucléique » produit « hors d’un organisme » « dans un organisme hôte » « où elles peuvent se multiplier de façon continue ». Or, par exemple, le critère de la multiplication « de façon continue » n’est pas univoque. Lorsque les molécules sont transitoires et ne se multiplient donc pas à travers l’organisme hôte de façon durable, peut-on considérer que l’exigence de « multiplication continue » est remplie ?
La situation est logiquement identique pour les exemptions. En effet, les interprétations peuvent également varier à propos des techniques exemptées visées par l’annexe I-B. C’est clairement le cas de la première qui désigne, sans plus de précision, la mutagénèse. La mutagenèse, particulièrement dans le domaine végétal peut-être, en effet, de différents types. Elle peut être (les qualificatifs varient) aléatoire, conventionnelle ou traditionnelle55. Elle peut être ciblée/dirigée ce que permettent précisément les techniques d’édition du génome évoquées plus haut. Or, à la lecture de l’annexe, il est possible de considérer, conformément au principe de l’interprétation stricte des exceptions et au considérant 17, que seules les mutagénèses conventionnelles utilisées traditionnellement et dont la sécurité est depuis longtemps avérée sont visées et donc exemptées. Il est toutefois également possible de considérer que la mutagénèse couvre tous types de mutations et donc, les mutations conventionnelles et les mutations ciblées/dirigées, car le terme est employé de façon générique et, car le considérant 17 ne fait pas partie du dispositif obligatoire (et a été adopté après l’article 3-1).
Avec l’apparition des techniques de mutagénèse dirigée, ces questions d’interprétation (des éléments de la définition comme des exemptions)56 se sont posées au plan contentieux. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet été interrogée par le Conseil d’État français57 afin de savoir si les techniques de mutagénèse dirigée produisaient ou non des OGM entrant dans le champ d’application de la directive 2001/18. Il faut dire que, dans ce nouveau contexte, ces questions (théoriques) devenaient pratiques et déterminantes, tout à la fois pour le public et pour les acteurs économiques, puisqu’il en dépendait la soumission ou non de ces techniques aux mesures substantielles de précaution établies par la directive 2001/18. On comprend donc que la Cour ait rendu un arrêt en grande chambre. On comprend également que pas moins de six gouvernements ainsi que les trois institutions que sont la Commission, le Conseil et le Parlement aient présenté des observations.
À la question posée, la Cour a répondu (par la positive)58. Elle a conclu que les organismes obtenus par des techniques/méthodes de mutagénèse dirigées sont bien des OGM, et que de tels OGM ne font pas partie des organismes exemptés de l’application de la directive. Précisons que la question de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse dirigée étaient des OGM au sens de la directive n’était pas vraiment la question la plus difficile59. En effet, les mutations provoquées par les techniques/méthodes telles que celles en cause satisfont à la définition d’un OGM et ce, dans ses deux éléments. D’abord, elles « constituent des modifications apportées au matériel génétique d’un organisme » ; ensuite, elles « impliquent, pour certaines d’entre elles, le recours à des agents mutagènes chimiques ou physiques, et, pour d’autres, au génie génétique », mais dans tous les cas, à des techniques ou méthodes qui « modifient le matériel génétique d’un organisme d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement »60. Certes, la mutagénèse dirigée n’est pas listée, en annexe, parmi les techniques considérées comme entraînant une modification génétique. Et pour cause, en 2001, elle n’existait pas encore. Toutefois, la Cour rappelle bien que les techniques dites de modification génétique listées le sont clairement d’une manière non exhaustive, ce qui n’empêche donc pas d’en inclure d’autres.
C’est la seconde question posée à la Cour qui était la plus délicate : celle de savoir si, en dépit de cette qualification, de tels OGM étaient soumis ou au contraire exemptés de l’application de la directive. La Cour a considéré que de tels OGM étaient soumis à la directive et ne pouvaient pas être considérés comme entrant dans l’exemption « mutagénèse ». De son point de vue, lorsque le libellé ne fournit pas d’indication, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de la directive « mais également de son contexte et des objectifs de la réglementation dont elle fait partie »61. Or s’agissant du contexte précisément, le considérant 17 est, selon la Cour, décisif : ce que le législateur de l’Union a voulu exempter, ce sont en effet, suivant ce considérant, les OGM utilisés de longue date et en toute sécurité62. Cela ne peut être le cas, selon la Cour, des organismes obtenus au moyen de techniques de mutagénèse dirigée « qui sont apparues ou qui se sont principalement développées depuis l’adoption de ladite directive »63. Retenir une autre interprétation « conduirait à méconnaître l’intention du législateur de l’Union »64, intention également confortée par l’objectif général de protection contre « les effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement qui pourraient résulter de la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d’OGM »65 et par le principe de précaution dont il doit être tenu compte « dans la mise en œuvre de la directive »66.
On relèvera que cette affaire a mis en lumière l’importance du rôle du juge dans les opérations d’interprétation. Que le rôle du juge, ici du juge de l’Union soit important n’est pas original. Lorsqu’il s’agit d’interpréter une directive, c’est en effet précisément la mission de la Cour via la question préjudicielle. Par ailleurs, lorsque la directive ne donne pas de définition de certains termes employés dans une disposition de la directive et n’effectue pas non plus de renvoi aux droits nationaux, il est nécessaire qu’elle en fasse une interprétation en propre : en effet, « il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme »67. En revanche, parfois l’importance de ce rôle est sans doute accentuée. C’est le cas lorsque les discussions sont intenses, car les enjeux au plan politique sont cruciaux (ici l’application d’un régime de précaution) et lorsque, juridiquement, des arguments – plutôt équilibrés – en faveur de l’une ou de l’autre interprétation peuvent être repérés. Dans l’affaire en cause, rappelons que l’Avocat général68 avait défendu une position exactement inverse à celle de la Cour. Cela confirme bien que l’interprétation du juge procède parfois d’« un choix, d’un authentique acte de volonté »69. On le sait bien, « la prétention d’effectuer […] une interprétation […] dont serait évacuée toute nécessité pour l’interprète de choisir »70 est vaine. Mais, parfois, le choix est plus manifeste et c’est ici le cas.
Il faut rappeler qu’à la suite du premier arrêt Confédération paysanne, le Conseil d’État français, à l’origine de la question préjudicielle a rendu sa décision le 7 février 202071. Sans surprise, suivant l’arrêt de la CJUE, il a conclu que les organismes issus de mutagenèse dirigée, mettant en jeu de telles techniques de génie génétique développées après 2001, relevaient de la directive. Mais le Conseil d’État avait été également interrogé sur le régime juridique applicable à la culture et à la commercialisation des variétés de plantes, notamment de colza, rendues tolérantes aux herbicides. De telles variétés ne sont pas issues de techniques de mutagénèse dirigée, mais proviennent de techniques conventionnelles de mutagénèse in vitro. Dans la réponse apportée, le Conseil d’État français va considérer que ces techniques se sont principalement développées depuis l’adoption de la directive 2001 et donc que, pour cette raison, conformément au critère retenu par la Cour, devaient « être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive »72.
En application de cette décision, le Gouvernement avait notifié à la Commission un projet de décret venant modifier le Code de l’environnement (l’article L-531-273) et reprenant, de façon très littérale l’arrêt74. Le projet précisait que les techniques exemptées de l’application des obligations OGM devaient être « les techniques de mutagenèse aléatoire, à l’exception de la mutagénèse aléatoire in vitro consistant à soumettre des cellules végétales à des agents mutagènes chimiques ou physiques »75. Toutefois, à la suite d’une telle notification, la Commission avait émis une objection,76 car, selon elle, l’arrêt et donc le projet de décret opéraient une distinction entre mutagenèse aléatoire in vitro (non exemptée) et in vivo (exemptée) qui n’était pas étayée, ni par l’arrêt de la Cour, ni par la directive 2001/18. Par ailleurs, la distinction n’était pas scientifiquement justifiée, ce que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) saisie sur ce point a confirmé77. Dans ce contexte, l’adoption du projet n’avait pas eu lieu. C’est cette situation d’inexécution qui a été à l’origine d’une seconde question préjudicielle à la Cour78 à nouveau à propos de l’interprétation de l’exemption prévue par la directive 2001/18. Le juge explique que, pour interpréter le considérant 17 et déterminer les techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, il existe bien « deux approches » qui « s’opposent »79, celle de la Commission européenne (et de l’EFSA), et celle du Conseil d’État et que dès lors, il revient au juge de l’Union de trancher ce point80.
Dans l’arrêt Confédération paysanne 281, la Cour apporte une réponse au Conseil d’État, réponse peu développée et qui ne devrait pas régler toutes les discussions futures sur l’interprétation. La CJUE commence par indiquer qu’opérer une distinction, comme le fait le Conseil d’État, entre les techniques de mutagénèse in vivo et in vitro n’est pas, dans son principe, injustifié. En effet, étendre le bénéfice de l’exemption à tous les organismes obtenus par l’application d’une technique/méthode de mutagenèse parce qu’elle est fondée sur les mêmes modalités de modification « ne respecterait pas l’intention du législateur de l’Union »82, car « ces modalités peuvent se combiner avec d’autres caractéristiques distinctes »83, qui peuvent « impliquer des effets négatifs, le cas échéant irréversibles et affectant plusieurs États membres, sur la santé humaine et l’environnement »84. On pourrait à ce stade imaginer que la Cour soit amenée à conclure à l’instar du Conseil d’État, en écartant le bénéfice de l’exemption pour les techniques de mutagénèse in vitro… Cependant, elle ne fait rien de tel. Elle souligne en effet que « les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas, en tant que tels, que soient exclus de cette exemption les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse »85. Autrement dit, si dans son principe, une distinction entre des techniques fondées sur des mêmes modalités de modification génétique peut être justifiée, en l’espèce ce n’est pas le cas. Notons qu’une telle conclusion est énoncée en un seul point, au terme d’une explication tout à fait concise (« les effets inhérents » aux cultures in vitro sans dire davantage), explication qui d’ailleurs n’est pas reliée à l’arrêt précédent dans lequel « tout » dépendait de la date d’apparition de la technique ou de son principal développement (pour mémoire selon la Cour, les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes apparues ou principalement développées depuis l’adoption de la directive 2001/18 ne pouvaient être exclus du champ d’application de cette dernière).
Ces deux affaires Confédération paysanne ont révélé combien le processus d’interprétation est toujours un processus complexe qu’il est parfois difficile de clore. Elles démontrent aussi que, lorsque les oppositions sont vives86, il n’est pas impossible que l’interprétation retenue par le juge soit « dépassée » par un changement du droit positif et de la définition elle-même.
III. Possibilité d’une modification (à venir) de certains éléments de la définition
Les suites de l’arrêt du 25 juillet 2018 attestent de cette possibilité pour l’avenir. Pour rappel, très rapidement après87 son rendu, l’arrêt a fait l’objet de critiques et pas uniquement au plan doctrinal88, mais y compris du côté des autres institutions de l’Union. Les premières critiques ont été émises par le groupe des conseillers scientifiques principaux de la Commission européenne qui, par voie de déclaration89, a fait état, sans détour « des problèmes et questions découlant de l’arrêt de la Cour et de l’application de la directive OGM ». Elles se sont ensuite, exprimées du côté du Conseil de l’Union européenne qui, le 8 novembre 201990, a invité la Commission « à soumettre, pour le 30 avril 2021 au plus tard, une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice […] concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union ». Elles se sont retrouvées dans l’étude91 publiée le 29 avril 2021 par la Commission en réponse précisément à l’invitation du Conseil92.
À la suite de cette étude, la Commission, après avoir réalisé une analyse d’impact93 puis une consultation électronique94, a publié une proposition de règlement le 5 juillet 202395. Son objet est clair. Partant des conclusions de l’étude selon lesquelles la législation de l’Union sur les OGM n’est pas adaptée à la réglementation de la dissémination volontaire de certains organismes et produits obtenus au moyen de certaines NTG, compte tenu « de la quantité de données probantes scientifiques déjà disponibles, notamment sur leur innocuité » et en vue d’assurer le « développement de produits innovants et bénéfiques »96, la proposition est d’établir un cadre particulier97 pour eux. La proposition, c’est logique, comporte plusieurs dispositions relatives au champ d’application qui elles-mêmes prévoient plusieurs définitions. La proposition prévoit d’abord, dans son article 1, que le texte devrait être limité aux végétaux (à l’exclusion des micro-organismes, des champignons et des animaux pour lesquels les connaissances disponibles sont plus limitées). Elle précise ensuite que le texte ne devrait couvrir que les végétaux obtenus au moyen de NTG. Ces différents termes soient définis. L’article 3 qui est consacré aux définitions comporte d’ailleurs un nombre important de paragraphes. On y apprend qu’un « végétal NTG » est « un végétal génétiquement modifié obtenu par mutagenèse ciblée ou cisgenèse, ou une combinaison des deux, à condition qu’il ne contienne aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs ». La « mutagenèse ciblée » est définie (les techniques causant une ou plusieurs modifications de la séquence d’ADN à des endroits précis du génome d’un organisme) ainsi que la « cisgenèse » (les techniques causant l’insertion, dans le génome d’un organisme, de matériel génétique déjà présent dans le pool génétique des obtenteurs)98. On peut aussi lire que le « pool génétique des obtenteurs » désigne la totalité des informations génétiques disponibles dans une espèce et d’autres espèces taxonomiques avec lesquelles elle peut être croisée.
Le présent règlement propose, à partir de ces définitions, d’établir une distinction entre deux catégories de végétaux NTG, le « végétal NTG de catégorie 1 » et le « végétal NTG de catégorie 2 ». Le végétal NTG 1 est celui qui remplit les critères d’équivalence avec les végétaux conventionnels énoncés à l’annexe I (principalement lorsqu’il diffère du végétal récepteur/parental d’un maximum de 20 modifications génétiques99) ; le végétal NTG autre qu’un végétal NTG de catégorie 1 est de catégorie 2. Le raisonnement est explicité dans le considérant 14 : « Les végétaux NTG qui pourraient également apparaître naturellement ou être produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles et leur descendance obtenue au moyen de techniques d’obtention conventionnelles (ci-après les “végétaux NTG de catégorie 1”) devraient être traités comme des végétaux apparaissant naturellement ou produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles, étant donné qu’ils sont équivalents et que leurs risques sont comparables, ce qui permet de déroger entièrement à la législation de l’Union sur les OGM et aux exigences relatives aux OGM prévues par la législation sectorielle ». En revanche « les végétaux NTG qui ne relèvent pas de la catégorie 1 (les “végétaux NTG de catégorie 2”) restent soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM, car ils présentent des ensembles plus complexes de modifications du génome »100. Les premiers ne nécessiteront pas d’autorisation préalable à leur dissémination volontaire ou leur mise sur le marché, les exigences de coexistence avec l’agriculture non génétiquement modifiée sont inapplicables, les obligations d’étiquetage sont réduites. Il est seulement prévu la mise en place d’une base de données publiques répertoriant les plantes NGT 1. Les plantes et produits NGT de catégorie 2 restent soumis à la directive, et donc aux obligations susmentionnées, mais avec une évaluation des risques assouplie, des délais raccourcis et une surveillance réduite.
Pour l’heure la proposition est à l’état de proposition. Le Parlement européen a adopté, le 7 février 2024, son avis101 sur la base du rapport de sa Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire102 (de justesse 307 voix pour, 263 contre et 41 abstentions). Au Conseil, un document de compromis103 avait été mis au point mais, pendant plusieurs mois, aucune majorité qualifiée n’avait été trouvée104. Le 14 mars 2025, les États membres de l’Union ont finalement adopté, de justesse105, un document, plus exactement le mandat pour négocier avec la Commission et le Parlement. Dans le mandat, certaines modifications de la proposition (par exemple l’interdiction de classer les végétaux tolérants aux herbicides dans la catégorie 1 des NGT ou encore la possibilité pour les États d’adopter des mesures, afin d’éviter la présence accidentelle de végétaux NGT de catégorie 1 dans l’agriculture biologique) sont avancées. Le processus de négociation va dès lors débuter…
La discussion promet d’être intense, car ce que propose la Commission consiste, pas moins, en un changement de définition (et donc ce faisant de philosophie). Ainsi, la proposition de règlement se réfère non pas à des techniques de modification génétique – ce qui est le cas depuis 1990 dans le domaine des OGM – mais aux caractéristiques du produit final, dans lequel des modifications génétiques particulières ont été générées (à savoir des mutations ciblées et une insertion de matériel génétique provenant du pool génétique des obtenteurs). Qu’elle provoque autant des réactions n’est donc pas surprenant. Celles-ci se focalisent particulièrement (mais pas seulement106) sur le principe d’équivalence qui est central dans la proposition, mais qui est loin de faire consensus. Le terme n’est d’ailleurs pas défini dans la proposition (ni d’ailleurs celui de végétaux « conventionnels » vis-à-vis desquels l’équivalence sera envisagée). Certes, l’annexe I de la proposition le décompose en critères concrets, mais les critères proposés ont déjà été contestés. Selon la proposition107, l’équivalence est présumée si la plante NGT ne diffère pas des plantes conventionnelles par plus de 20 modifications génétiques. Mais le Parlement a proposé d’autres critères,108 ce qui atteste bien du fait que ce choix est davantage le résultat d’un compromis politique que d’une base purement scientifique109. Et d’autres, par exemple l’ANSES en France, ont d’ores et déjà émis de fortes critiques110. Elle affirme d’abord que le postulat de base liant équivalence et absence de risque est « sans fondement scientifique »111. Elle critique également les critères en eux-mêmes de l’équivalence qui, selon elle, ne font l’objet d’aucune « justification scientifique » qu’il s’agisse « d’accepter (au sens de l’équivalence) des substitutions ou insertions sur la base de leur taille » ou qu’il s’agisse de retenir comme pertinent « le seuil maximal de 20 nucléotides »112.
La discussion devrait être d’autant plus rude que si en théorie, ce texte n’a pas vocation à remplacer la législation OGM préexistante dont il constitue une « lex specialis » (et d’ailleurs, tous les végétaux NTG qui ne relèvent pas de la catégorie 1 restent soumis aux exigences de cette législation de l’Union), en pratique, le remplacement pourrait avoir lieu. Il est en effet estimé113 que pour une très grande majorité de végétaux issus de l’édition du génome (plus de 90 %), les changements ne dépassent pas quelques paires de bases, ce qui permettrait de les qualifier de NGT catégorie 1 et donc de les exempter totalement de la législation OGM. Une telle perspective est d’autant plus réaliste que, dans l’article 5.3 de la proposition, il est prévu d’habiliter la Commission « à adopter des actes délégués pour modifier les critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels établis à l’annexe I afin de les adapter au progrès scientifique et technologique en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle ».
En conclusion, la définition des OGM démontre deux choses, peu originales, mais tout de même notables à considérer dans le domaine – au centre de ce numéro spécial – du biodroit. La première est qu’en certains cas, le droit définit les concepts et les définitions sont anciennes et pérennes. C’est particulièrement le cas lorsque, comme s’agissant des OGM, de la définition dépend toute la philosophie d’un régime juridique. La seconde est que, même dans ces cas, lorsque les oppositions politiques sont vives, une telle définition ne permet jamais de totalement contenir les divergences d’interprétation : ce domaine est ici très révélateur puisque les divergences – originelles – se sont toujours maintenues et ont été telles qu’elles ont débouché sur deux arrêts de la CJUE et une proposition de la Commission qui devrait revenir sur certains éléments de la définition…
1 Ce mot est intervenu comme étant un anglicisme probable substitué à biotechnique. Jusque dans les années 1970, l’« on parlait de microbiologie industrielle, d’industrie de fermentation, de pharmacologie », F. Gros, « Histoire des biotechnologies », in D. Douillet et G. Jorland (dir.), Des technologies pour demain, Seuil, 1992, p. 11. Notons toutefois que l’apparition de ce terme est plus ancienne puisqu’elle remonte à 1919, date à laquelle un agronome hongrois Karl Ereki l’a utilisé pour la première fois.
2 Article 2 de la Convention sur la diversité biologique.
3 En 1944, les travaux d’une équipe de chercheurs ont notamment permis de démontrer qu’un caractère particulier pouvait être conféré à un micro-organisme par transfert d’ADN, montrant ainsi le rôle essentiel de ce dernier. La génétique est dès lors devenue « moléculaire », c’est-à-dire que la notion de gène a été précisée par la référence au support moléculaire précis de l’information génétique. L’étape la plus connue des découvertes qui se succédèrent ensuite à un rythme rapide est la présentation, en 1953, par Watson et Crick, de la structure « en double hélice » de l’acide désoxyribonucléique. Dans les années 1960, la correspondance entre l’information contenue dans l’ADN et la nature des protéines, constitutives des organes et des tissus et donc essentielles à la structure et à la vie de toute cellule, était établie, de même que le rôle d’intermédiaire entre l’ADN et ces protéines joué par l’ARN messager, qui permet de décoder l’information génétique contenue dans l’ADN et d’assurer son expression. À partir de 1975, sont mises au point les premières techniques de « recombinaison » d’ADN permettant d’obtenir puis de transférer d’une cellule à une autre n’importe quel gène.
4 M.-A. Hermitte et Chr. Noiville, La dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, une première application du principe de prudence, RJE, 3-1993, p. 392.
5 G.-E. Seralini, OGM, le vrai débat, Dominos, Flammarion, 2000, p. 8.
6 F. Gros, intitulant le chapitre II de son ouvrage « la révolution biotechnologique », in La civilisation du gène, Hachette, Paris, 1989, 134 p.
7 Voir parmi d’autres D. Chevallier, Rapport sur les applications des biotechnologies à l’agriculture et à l’industrie agro-alimentaire, OPECST, 1990, Assemblée nationale, n° 1827, Sénat, n° 148, p. 11 et s.
8 J.-P. Clavier, Les catégories de la propriété intellectuelle à l’épreuve des créations génétiques, Logiques juridiques, L’Harmattan, 1998, p. 44.
9 Par exemple celles permettant la transplantation d’un greffon non génétiquement modifié sur un porte-greffe génétiquement modifié (ou l’inverse) ou celle permettant, par le recours aux ségrégants négatifs, d’éliminer un transgène une fois que celui-ci n’est plus utile.
10 On y trouve, selon l’avis du Haut Conseil des biotechnologies du 12 novembre 2017, les techniques suivantes : la mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides (ODM) ; les nucléases site-spécifiques (SDN pour Site directed Nuclease) (CRISPR-Cas9, Doigts de zinc, Talen…) ; la cisgénèse et l’intragénèse ; le greffage sur des porte-greffes génétiquement modifiés ; l’agro-infiltration ; la méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM) et les ségrégants négatifs. Pour une définition de chacune, voir le rapport du groupe de travail du Comité scientifique du HCB, 7 juillet 2016.
11 Par exemple, dans la technique CRISPR-Cas9, l’endonucléase Cas9 qui est introduit dans la cellule est capable de couper l’ADN à un endroit précis grâce à un guidage par un ARN spécifique du gène à cibler. Cependant, le processus de réparation de la coupure ne permet pas d’exclure l’apparition de séquences d’ADN non désirées.
12 J. Bizet, Transgéniques : pour des choix responsables, Rapport d’information du Sénat, n° 440, 1998, Commission des affaires économiques, voir troisième partie, point B). La comparaison entre l’opinion publique européenne et américaine est, sur ce point, très instructive. Pour une analyse détaillée sur ce thème, voir C. Marris et P.-B. Joly, Mise sur agenda et controverses : une approche comparée du cas des OGM en France et aux États-Unis », cité in B. Chevassus-au-Louis (dir.), OGM et agriculture : options pour l’action publique, Rapport du Commissariat général au Plan, La Documentation française, Paris, 2001, p. 110.
13 Y. Jeanclos, « La sécurité alimentaire à l’orée du XXIe siècle », Annuaire français des relations internationales, 2002, vol 3, p. 881.
14 Jurisclasseur Environnement et développement durable, Fasc. 4100, « Organismes génétiquement modifiés (OGM) », Chr. Noiville, M.-A. Hermitte, E. Brosset, août 2009, § 5.
15 F. Chateauraynaud, Les OGM entre régulation économique et critique radicale, rapport final du programme ANR, EHESS Paris.
16 JOCE n° L 213, 21/07/1982, p. 15-16.
17 Ce texte recommandait aux États membres d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que tout laboratoire désireux de mettre en œuvre des projets impliquant des recombinaisons in vitro d’ADN en fasse déclaration à l’autorité nationale ou régionale compétente.
18 Voir la Communication de la Commission au Conseil : « Un cadre communautaire pour la réglementation des biotechnologies », COM (85)573 final, Bruxelles, 4 novembre 1986, non publié au JOCE.
19 COM (88) 160 final, part 1-SYN 131, JOCE n° C 198 du 28/07/1988, p. 9.
20 COM (88) 160 final, part 2-SYN 131, JOCE n° C 198 du 28/07/1988, p. 19.
21 Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, JOCE n° L 117, 8/05/1990, p. 1-14.
22 Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, JOCE n° L 117, 8/05/1990, p. 15-27.
23 Voir aussi la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, JO L 125 du 21.5.2009, p. 75-97.
24 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, JOCE L 106 du 17.4.2001, p. 1-39.
25 Selon l’article 1 de la directive 90/219/CEE : « La présente directive établit des mesures communes pour l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement ».
26 L’article 1 de la directive 90/220/CEE indique que l’objectif de la présente directive est de « rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement en ce qui concerne la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite à une dissémination volontaire dans l’environnement ».
27 Article 2 a), Directive 90/219/CEE.
28 Article 2-1), Directive 90/220/CEE.
29 Notons toutefois que de ce point de vue, la directive 2001/18/CE a apporté une modification non négligeable. Soulignant, dans le considérant 9, la nécessité de respecter les principes éthiques, elle apporte une définition des OGM quelque peu révisée. D’après l’article 2-2), un OGM est « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle ». Ainsi, il est expressément spécifié que les êtres humains ne devraient pas être considéré comme des organismes et que donc cette directive ne comprend dans son champ d’application que les microorganismes, les plantes et animaux mais non les êtres humains.
30 Article 2-b, Directive 90/219/CEE et article 2-2), Directive 90/220/CEE. Mêmes articles dans les directives révisées.
31 Article 2-2), i), Directive 90/220/CEE et article 2-2 a) de la directive 2001/18. Ces techniques sont énumérées à l’annexe I-A, première partie des directives.
32 « 1) les techniques de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l’insertion de molécules d’acide nucléique, produit de n’importe quelle façon hors d’un organisme, à l’intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue ;
2) les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l’extérieur de l’organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la microencapsulation ;
3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle ».
33 La directive 2001/18/CE prévoit aussi d’ailleurs la possibilité d’établir des procédures allégées qualifiées de « procédures différenciées » lorsqu’il s’agit de disséminations de « certains OGM dans certains écosystèmes » pour lesquelles il existe une expérience suffisante (article 7-1).
34 Voir ainsi l’article 1er, Directive 2001/18/CE qui souligne que « conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement ».
35 Ibid., p. 203.
36 Chr. Noiville, Ressources génétiques et droit, Essai sur les régimes juridiques des ressources génétiques marines, Pedone, 1997, p. 217.
37 Selon l’article, la procédure standard d’autorisation prévue par la directive ne s’applique pas aux OGM « dans la mesure où ils sont autorisés par une législation communautaire qui prévoit une évaluation spécifique des risques pour l’environnement […] et des exigences en matière de gestion de risques, d’étiquetage, de surveillance, le cas échéant d’information du public et de clause de sauvegarde au moins équivalentes à celles contenues dans la présente directive ».
38 Règlement n° 2309/93/CEE, 22 juill. 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, JOCE n° L 214, 24 août 1993, p. 1, remplacé par le Règlement n° 726/2004/CE du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30 avril 2004, p. 1.
39 Directive 98/95/CE, 14 déc. 1998, modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : JOCE n° L 25, 1er févr. 1999, p. 1.
40 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JOCE n° L 43 du 14/02/1997, p. 1-7.
41 JOCE L 268, 18.10.2003, p. 1-23.
42 Voir par exemple l’article 2-5) du règlement n° 1829/2003 : « on entend par “organisme génétiquement modifié” ou “OGM”, un organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE […] ». Une extension de son champ d’application a même eu lieu puisque dans les directives, ne sont visés que les MGM et OGM capables de se reproduire et de transférer du matériel génétique ainsi que certains produits, mais uniquement ceux dans lesquels l’OGM est encore biologiquement actif (Article 2-4, Directive 90/220/CEE et article 2-7, Directive 2001/18 : « “produit” : une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant, mise sur le marché »).
43 Règlement n° 258/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, précité.
44 Article 3-4, Règlement n° 258/97/CE.
45 La notion d’équivalence en substance a émergé au début des années 1990 à Genève au cours d’une consultation conjointe de la FAO et de l’OMS, Stratégies d’évaluation de la salubrité des aliments produits par biotechnologies, 66 p. La définition exacte de ce concept a été donnée trois ans plus tard en 1993 par l’OCDE dans le cadre d’une mission d’experts chargés de réfléchir sur la sécurité des biotechnologies : Voir OCDE, Évaluation de la sécurité des denrées alimentaires issues de la biotechnologie moderne : concepts et principes, 1993, Paris, 87 p. D’après l’OCDE, le concept d’équivalence substantielle est la concrétisation du principe selon lequel les organismes existants utilisés comme aliment ou source d’aliment peuvent servir de base pour la comparaison, sur le plan de l’innocuité de la consommation par l’homme avec un aliment ou un constituant alimentaire modifié ou nouveau.
46 Point 3-3, annexe I, Recommandation n° 97/618/CE de la Commission du 29 juillet 1997 concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des informations requises pour étayer des demandes d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires et l’établissement des rapports d’évaluation initiale, JOCE, n° L 253 du 16/09/1997, p. 1-36 : la Commission rappelle que « la notion d’équivalence substantielle exprime l’idée que les organismes existants qui sont utilisés en tant qu’aliments ou source d’aliments peuvent servir de base à une comparaison lors de l’évaluation de l’innocuité d’un aliment ou ingrédient alimentaire nouveau ou modifié ».
47 Article 3-1, Règlement n°1829/2003/CE.
48 D’ailleurs, il s’efforce de les couvrir le plus largement possible, bien au-delà de ce que prévoyait le règlement de 1997. Son objectif étant d’établir une procédure communautaire unique d’autorisation pour tous les produits alimentaires qui ont été génétiquement modifiés, logiquement, il ne vise pas seulement les produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine mais aussi ceux destinés à l’alimentation animale. Le règlement s’appliquera donc aux OGM utilisés en tant matière d’origine pour l’obtention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ainsi qu’aux denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant cet OGM, consistant en cet OGM, ou produit à partir de cet OGM (Articles 3 et 15, Règlement n°1829/2003/CE).
49 Le principe d’équivalence substantielle conserve une place dans l’évaluation des risques. Par exemple, il est prévu que l’évaluation des risques se fonde sur un examen des informations et données soumises par le demandeur pour montrer que les caractéristiques de la denrée alimentaire ne diffèrent pas de celles de son produit conventionnel de référence, compte tenu des limites autorisées de variation naturelle de ces caractéristiques : Articles 6-3-e) et 18-3-e), Règlement n°1829/2003/CE.
50 Considérant 6 du règlement.
51 Voir la formulation en anglais qui pourrait conforter cette interprétation « genetic material altered in a way that does not occur naturally… ».
52 Article 2-2 a), Directive 2001/18/CE.
53 Première phrase de l’annexe I-A première partie, Directive 2001/18/CE.
54 « Therefore, the possibility of adapting all annexes of the Directive through a Regulatory Committee Procedure, could enhance flexibility and permit timely adaption of these highly technical parts of the Directive to rapidly advancing scientific and technical progress » : Rapport de la Commission concernant la révision de la directive 90/220/CE (Bruxelles, le 10.12.1996, COM (96) 630 final).
55 En ce cas elle consiste à exposer des cellules végétales à des agents physiques (des rayonnements ionisants : rayons gamma, rayons X…) ou chimiques, agents qui vont provoquer dans le matériel génétique des lésions dont la réparation crée les mutations. Pratiquée tout d’abord sur les plantes entières ou sur des parties de plantes (in vivo), la mutagenèse a été ensuite appliquée à des cultures in vitro d’organes, de tissus, d’amas de cellules indifférenciées, de cellules isolées et de protoplastes. La culture in vitro aboutit à la régénération d’une plante entière à partir du matériel végétal ainsi cultivé.
56 D’ailleurs les études sur ce point ont été nombreuses :
– « Legal Briefing paper, The regulatory status of plants resulting from new breeding technologie »s, NBT Platform (plateforme d’entreprises et d’institutions de recherche), 9 juin 2014
– « The regulatory status of New Breeding Techniques in countries outside the European Union », Schuttelaar & Partners, La Haye, Juin 2015
– « New Breeding Techniques », European Academies Science Advisory Council (EASAC), juillet 2015
– « Legal Analysis of the applicability of Directive 2001/18/EV on genome editing technologies » commissioned by the German Federal Agency for Nature Conservation and prepared by Professor Dr. Tade Matthias Spranger, october 2015.
– « Statut juridique des produits issus des « nouvelles techniques de modification » », GIET, Fondation Sciences Citoyennes, FNE, France Nature Environnement, Nature & Progrès, OGM dangers, UNAF, Union Nationale de l’Apiculture Française, 12 novembre 2015
– Analyse juridique et décision du Swedish Board of Agriculture concernant la technique CRISPR-Cas9 : « GMO decision from the Swedish Board of Agriculture provides hope to plant scientists », 17 novembre 2015
57 Un contentieux avait en effet été initié en 2015 par plusieurs organisations environnementales et agricoles françaises qui avaient enjoint le Premier ministre d’abroger l’article D531.2 du Code de l’Environnement et de prononcer une interdiction des variétés de colza rendues résistances à un herbicide obtenue grâce à cette technique. Suite à l’absence de réponse du Premier ministre, valant refus, ces associations avaient saisi le Conseil d’État. Ce dernier, le 3 octobre 2016, avait considéré que les questions soulevées posaient des difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne et adressé à la CJUE différentes questions préjudicielles, qui, loin de ne porter que sur les variétés de colza tolérantes à un herbicide, concernaient en fait l’ensemble des techniques dites de mutation dirigée.
58 E. Brosset et Chr. Noiville, « Les nouvelles techniques d’édition du génome donnent-elles naissance à des OGM couverts par la directive 2001/18 : la Cour de justice de l’Union dit deux fois oui ! », Cahiers Droit Science et technologies, 8/2019, p. 197-212. https://doi.org/10.4000/cdst.866.
59 Pour rappel, ce qu’est un OGM est en effet défini dans l’article 2-2 du texte de la directive 2001/18 : il s’agit d’un « organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». En s’arrimant à un tel libellé, la CJUE a considéré que les mutations provoquées par les techniques/méthodes telles que celles en cause au principal (celles de mutagénèse dirigée) satisfaisaient à la définition d’un OGM et ce, dans ses deux éléments. D’abord, elles « constituent des modifications apportées au matériel génétique d’un organisme » (pt 27) ; ensuite, elles « impliquent, pour certaines d’entre elles, le recours à des agents mutagènes chimiques ou physiques, et, pour d’autres, le recours au génie génétique », mais dans tous les cas, à des techniques ou méthodes qui « modifient le matériel génétique d’un organisme d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement » (pt 28). Certes, la mutagénèse dirigée n’est pas listée, en annexe, parmi les techniques considérées comme entraînant une modification génétique. Et pour cause, en 2001, elles n’existaient pas encore. Toutefois, la Cour rappelle bien que les techniques dites de modification génétique qui sont listées le sont clairement d’une manière non exhaustive ce qui n’empêche donc pas d’y inclure d’autres techniques. Il est ainsi précisé, dans l’article 2-2 a), que « la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe I-A, première partie » qui, sont, selon l’annexe I-A (première partie) « entre autres » les suivantes. La version anglaise de la directive, qui emploie les mots « inter alia » va dans un sens similaire.
60 Pts 27 et 28 de l’arrêt.
61 Pt 42 de l’arrêt.
62 Pt 44 de l’arrêt.
63 Pt 47 de l’arrêt.
64 Pt 51 de l’arrêt.
65 Articles 1 et 4 § 1 de la directive 2001/18.
66 Considérant 8. Une telle référence est réitérée dans le corps du texte à l’article 1er souligne que « conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement ».
67 CJCE, 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec., p. 107, point 11 ; arrêt de la Cour du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec., p. I‑4319.
68 Dans ses conclusions, il avait suggéré que le critère exclusif de l’exemption soit l’emploi ou non d’acide nucléique recombinant. Pour lui, quelle qu’ait été leur utilisation à la date d’adoption de la directive et leur degré de sécurité (et donc indépendamment du considérant 17 qui ne pouvait être une « distinction pertinente » (pt 79), les OGM obtenus par mutagénèse devaient être exemptés lorsqu’ils n’impliquaient pas « l’emploi de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’organismes génétiquement modifiés autres que ceux obtenus par mutagénèse » (pt 107). Selon l’Avocat général, le considérant 17 ne vise pas l’exemption qu’est celle de la mutagénèse et, réciproquement, l’annexe I-B ne renvoie pas au considérant. De plus, ils n’ont pas été rédigés au même moment, un tel considérant ayant été rédigé avant l’annexe I-B, insérée en 2001 et donc « introduite qu’ultérieurement et indépendamment du considérant 17 » (pt 94 de ses conclusions).
69 S. Hennette-Vauchez, L’embryon de l’Union, RTDE, 2012, p. 355.
70 O. De Schutter, Les mots du droit : une grammatologie critique du droit international public, Revue québécoise de droit international, vol 6, n° 2, 1989-1990, p. 127.
71 Conseil d’État, 07/02/2020, 388649, Publié au Recueil Lebon. Pour un commentaire : E. Brosset et Chr. Noiville, OGM et mutagénèse, « L’arrêt du Conseil d’État comme vrai-faux épilogue », Cahiers Droit Science et technologies, n° 10/ 2020, p. 195-201. https://doi.org/10.4000/cdst.1786.
72 Considérant 6 de l’arrêt.
73 L’article L 531-2 du Code de l’environnement prévoit que « ne sont pas soumis » aux dispositions du présent titre « les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui […] ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement ». L’article D 531-2 dudit code liste ces techniques dont « 2° À condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux : « a) La mutagenèse ».
74 Voir la notification par les autorités françaises à la Commission, le 6 mai 2020, du projet de « décret relatif à la modification de la liste des techniques d’obtention d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement » (notification 2020/280/F).
75 Décret n° [ ] du [ ] relatif à la modification de la liste des techniques d’obtention d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement.
76 Avis circonstancié de la Commission (article 6, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive (UE) 2015/1535).
77 Le 20 mai 2020, la Commission a d’ailleurs saisi l’EFSA pour obtenir « une analyse scientifique robuste quant à savoir si la distinction entre in vivo et in vitro est scientifiquement justifiée ». L’avis de l’EFSA a été rendu le 29 septembre 2021 et conclut que « la même mutation et le trait dérivé dans une espèce végétale peuvent être obtenus potentiellement en utilisant des mutagénèses aléatoires in vivo et in vitro et les mutants obtenus seraient indistinguables » et que dès lors « une distinction entre plantes obtenues par des approches in vitro ou in vivo n’est pas justifiée ».
78 Conseil d’État, 8 novembre 2021, N° 451264.
79 Considérant 12 de l’arrêt.
80 Les questions concernaient les deux critères du considérant 17 :
– celui de sécurité : faut-il « ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme » ou, au contraire, « prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement » ? (L’expression « variations somaclonales » désigne en substance les mutations résultant de l’impact de la culture in vitro elle-même sur le matériel végétal).
– celui de l’utilisation traditionnelle sans risque : faut-il ne prendre en compte « que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique » ou également « les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures » » ? Le Conseil d’État avait, dans son premier arrêt, exclu que la mutagénèse aléatoire in vitro soit une méthode traditionnellement utilisée au sens de l’arrêt de la CJUE car très peu d’éléments attestaient de la culture en plein champ de variétés issues de cette méthode au cours des années 1980 et 1990, soit avant l’adoption de la directive OGM. Cette question a vocation à faire préciser à la Cour si les seules cultures en plein champ de plantes obtenues par ces techniques sont pertinentes pour considérer comme remplie la condition de « méthode traditionnellement utilisée » ou si les nombreuses recherches conduites à partir des années 1980, antérieurement à ces cultures, sur la mutagenèse aléatoire in vitro devaient aussi être considérées.
81 Arrêt du 7 février 2023, affaire C-688/21, ECLI: ECLI:EU:C:2023:75.
82 Pt 51 de l’arrêt.
83 Ibidem.
84 Pt 54 de l’arrêt.
85 Pt 64 de l’arrêt.
86 Les arguments à l’appui de ces oppositions sont, d’une certaine manière, bien résumés par l’Avocat général M. Bobej dans ses conclusions dans l’affaire. Ce dernier évoque un « problème constitutionnel » car, ce faisant, il ne s’agirait pas tant « d’interpréter la directive OGM mais de la réécrire » tout autant que des « problèmes pratiques » car « c’est au législateur expert, et non aux juridictions, qu’il appartient d’effectuer une telle appréciation » (pts 104 et 105).
87 Les conclusions opposées de l’Avocat général M. Bobej dans l’affaire sont déjà, d’une certaine manière, une fois l’arrêt rendu, des arguments critiques. Ce dernier évoque notamment un « problème constitutionnel » car, ce faisant, il ne s’agirait pas tant « d’interpréter la directive OGM mais de la réécrire » et car « c’est au législateur expert, et non aux juridictions, qu’il appartient d’effectuer une telle appréciation » (pts 104 et 105).
88 Voir par exemple le propos très critique de R.-M. Borges, « Le statut des nouvelles techniques de sélection des plantes : entre incohérences juridiques et démission politique », Droit rural, n° 471, mars 2019, étude 8 à propos de l’arrêt : « Décidément, l’Union européenne n’en finit plus de se déliter. Adepte des règlementations insignifiantes mais oublieuse des grands sujets, elle vient de tirer une balle supplémentaire dans le pied de l’innovation européenne, déjà bien gangréné ».
89 Statement by the Group of Chief Scientific Advisors, A Scientific Perspective on the Regulatory Status of Products Derived from Gene Editing and the Implications for the GMO Directive, 13 novembre 2018.
90 Décision (UE) 2019/1904 du Conseil du 8 novembre 2019 invitant la Commission à soumettre une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-528/16 concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union, et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, JO L 293, 14.11.2019, p. 103-104.
91 Commission Staff Working Document, Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16, Brussels, 29.4.2021 SWD(2021) 92 final. Voir la synthèse en français, Étude concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-528/16, SWD (2021) 92.
92 Certes, cette longue étude est principalement une synthèse des réponses reçues des États membres et des parties prenantes à un questionnaire que la Commission leur avait adressé. Toutefois, à plusieurs endroits, la Commission exprime son point de vue et ce dernier consiste principalement à mettre en exergue les difficultés de l’application de la directive OGM à ces nouvelles techniques. Selon la Commission, ces difficultés proviennent non seulement de l’ambiguïté quant à l’interprétation de certains concepts (et de l’incertitude réglementaire qui en découle), mais également des problèmes de mise en œuvre (notamment en ce qui concerne la détection des produits issus de ces techniques qui ne contiennent pas de matériel génétique étranger : « Bien que les méthodes de détection existantes puissent permettre de détecter des modifications même légères du génome, cela ne confirme pas nécessairement que l’on est en présence d’un produit réglementé ; pareille modification pourrait avoir été obtenue par sélection classique et ne pas être soumise à la législation sur les OGM. C’est un problème pour les autorités chargées de faire appliquer la législation et pour les opérateurs » [Synthèse en français]).
93 Le 24 septembre 2021, la Commission a publié une « analyse d’impact initiale » à propos d’une nouvelle « législation applicable aux végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques » et a recueilli les avis du public sur ce document : voir le lien vers la plateforme.
94 À partir d’un questionnaire à propos de ce qui devrait être « une initiative stratégique sur les végétaux obtenus par mutagenèse ciblée et par cisgenèse » (qui portera également sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dérivés de ces végétaux), la Commission a effectivement ouvert une consultation publique du 29 avril au 22 juillet 2022.
95 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, 5 juillet 2023, COM (2023) 411 final.
96 Document de travail des services de la Commission SWD (2023) 412 final du 5 juillet 2023, Rapport d’analyse d’impact accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux végétaux obtenus par certaines nouvelles techniques génomiques et à leurs denrées alimentaires et aliments pour animaux, et modifiant le règlement (UE) 2017/625.
97 Considérant 8 de la proposition.
98 L’intragenèse est un sous-ensemble de la cisgenèse qui consiste à insérer dans le génome une copie réarrangée du matériel génétique composé de deux ou plusieurs séquences d’ADN déjà présentes dans le pool génétique des obtenteurs.
99 Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel lorsqu’il diffère du végétal récepteur/parental d’un maximum de 20 modifications génétiques des types visés aux points 1 à 5, dans toute séquence d’ADN partageant une similarité de séquence avec le site ciblé qui peut être prédite au moyen d’outils bio-informatiques ».
100 Considérant 15 de la proposition.
101 European Parliament, Amendments adopted on 7 February 2024, P9_TA(2024)0067
102 European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI report 2024), Compromise Amendment 2023/0226 (COD)
103 Council of the European Union (2023) Interinstitutional File 2023/0226 (COD) 16443/23, 07.12.2023.
104 Lors de première réunion du 7 février 2024 des représentants permanents des États membres (Coreper), du tour de table qui a eu lieu, la présidence belge a estimé qu’une mise au vote formelle n’aboutirait pas à une majorité qualifiée. Aucun vote n’a donc eu lieu. Les choses se sont répétées en juin 2024. Puis lorsque la Hongrie, peu favorable au texte, a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne (1er juillet 2024 – 1er décembre de cette année), elle a choisi de ne pas s’aligner sur l’avis de l’EFSA et de s’inscrire dans le sillage de l’ANSES et à rebours de la précédente présidence belge en adressant aux délégations nationales un document officieux reprenant les principales critiques faites à la proposition et demandant une discussion sur les critères de l’équivalence ainsi que sur les obligations (notamment d’évaluation des risques mais aussi d’étiquetage) qui devraient être applicables aux variétés NGT 1 Elle a été soutenue par l’Autriche, la Croatie, la Grèce, la Slovaquie et la Roumanie. Mais un groupe d’États (Belgique, Finlande, Lettonie, Espagne, Suède, République tchèque, Danemark, Lituanie et Pays-Bas) se sont néanmoins opposés, arguant de la justification scientifique, à une telle discussion.
105 Les désaccords étaient pourtant encore nombreux mais l’abstention de l’Allemagne et le vote finalement favorable (et parfois assortie de déclarations) de la Grèce et de la Belgique ont permis de réunir la majorité qualifiée.
106 G. Winter évoque ainsi de nombreux points de discussions : 1/ il est scientifiquement indéfendable de supposer qu’il n’y a pas de risques en dessous de la limite indiquée à l’annexe I ; 2/ la définition des NGT n’est liée qu’aux différences génétiques, bien que les propriétés – et les risques – des plantes ne soient pas uniquement déterminés par la génétique ; 3/ le champ d’application des plantes et produits NGT 1 exemptés de la loi actuelle sur le génie génétique est extrêmement large ; 4/ toute évaluation des risques est exclue pour les plantes NGT 1 ; 5/ lorsqu’une plante NGT 1 commercialisée s’avère dangereuse, aucune clause de sauvegarde n’est prévue ; 6/ le modèle réglementaire précédent, qui consistait à se renseigner sur les risques incertains par le biais de la surveillance, est largement abandonné. G. Winter, « The European Union’s deregulation of plants obtained from new genomic techniques: a critique and an alternative option », Environmental Sciences Europe (2024) 36:4.
107 Document technique des services de la Commission 14204/23 du 16 octobre 2023, Justification des critères d’équivalence de l’annexe I de la proposition de règlement relatif aux végétaux obtenus par certaines nouvelles techniques génomiques.
108 European Parliament, Amendments adopted on 7 February 2024 , P9_TA(2024)0067 : le Parlement européen propose une autre limite pour les modifications, à savoir trois par séquence codant pour une protéine (annexe I de l’avis du Parlement européen).
109 J. Kahrmann et G. Leggewie, « European Commission’s Plans for a Special Regulation of Plants Created by New Genomic Techniques », European Papers, vol. 9, 2024, n° 1, p. 21-38
110 Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’analyse scientifique de l’annexe I de la proposition de règlement de la Commission européenne du 5 juillet 2023 relative aux nouvelles techniques génomiques (NTG) – Examen des critères d’équivalence proposés pour définir les plantes NTG de catégorie 1, 29 novembre 2023.
111 Ibid., pt 3.2.3.2 : « il n’y a pas de fondement scientifique sous-tendant une équivalence de type de caractères ou de niveau de risques entre deux catégories de plantes sur la base d’un contenu équivalent en variations ou modifications génétiques qui seraient uniquement définies par leur type, leur taille et leur nombre ». Dans cette logique, elle ajoute que « l’absence de considération des modifications potentielles hors des sites ciblés et des séquences similaires (à l’exception des éléments transgéniques, de par la définition du végétal NTG) n’est pas justifiée non plus ».
112 Ibidem, pt 3.2.2.2, conclusion.
113 Voir les données produites par EU-SAGE (European sustainable agriculture through genome editing), réseau représentant des scientifiques spécialisés sur les plantes et ayant vocation à fournir des informations sur l’édition du génome et son utilisation en agriculture.
Estelle Brosset, « Observations à propos de la définition des organismes génétiquement modifiés en droit de l’Union européenne », Définitions et concepts du biodroit [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 07 | 2025, mis en ligne le 7 juillet 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=4179.