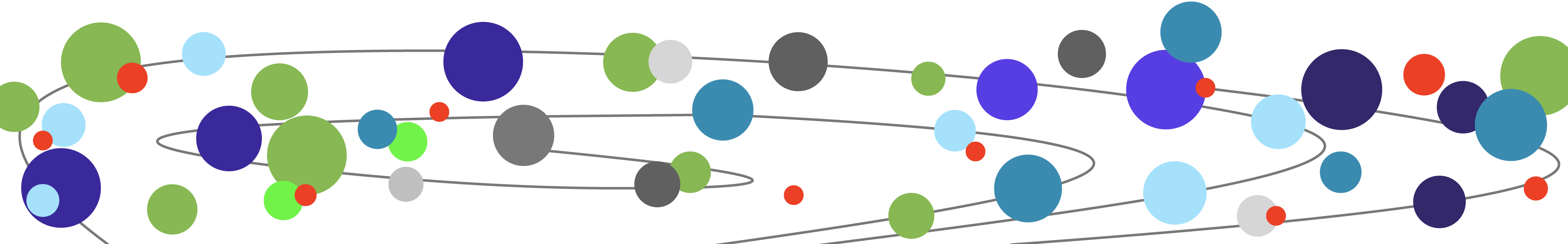Sara Brimo
Professeur junior à l’Université Paris Panthéon Assas, Chaire Ose Ajir, CRDA (EA-1477)
Résumé : Alors même qu’ils partagent des finalités communes, droit à un environnement sain et approche One Health connaissent des traductions juridiques distinctes. One Health envisage, en effet, les rapports entre santé et environnement comme un objet de politique publique mondiale, alors que le droit à un environnement sain appréhende cette question comme une problématique contentieuse – bien davantage justiciable.
Travailler sur l’approche One Health et ses liens avec le droit à un environnement sain constitue un vrai défi pour les internistes. Beaucoup d’entre eux sont, en effet, souvent frileux quand il s’agit d’analyser les normes issues de l’Organisation mondiale de la santé, qui plus est quand elles se nomment « approche émergente » ! À première vue, mettre en miroir une « approche » et un « droit à » paraît donc un peu effrayant.
Alors comment approcher l’approche One Health et comment la rapprocher du droit à un environnement sain ? Telles seront les premières interrogations ; objets de cette introduction.
Pour reprendre les mots de Laurence Warin, l’approche One Health « porte, avec des habits neufs, un message en réalité millénaire »[1]. On pourrait en dire autant du droit à un environnement sain. La mise en lumière des liens entre santé humaine, santé animale et environnement (qui sont communs à l’approche One Health et au droit à un environnement sain) ne date effectivement pas d’hier.
Déjà, sous l’Antiquité, Hippocrate les avait mis en évidence dans son célèbre traité Air, Eaux, Lieux[2]. Par la suite, c’est évidemment le mouvement hygiéniste qui, à partir du xixe siècle, a illustré la relation inséparable qui lie santé des hommes et les divers environnements et milieux dans lesquels ils évoluent.
L’approche One Health vise à mettre (ou à remettre donc) en lumière les relations entre santé humaine, santé animale et écosystèmes et à faire le lien entre l’écologie et la médecine humaine et vétérinaire.
Le droit à un environnement sain témoigne pratiquement des mêmes ambitions. Il est formalisé explicitement pour la première fois dans la Convention d’Aarhus[3] qui énonce, en 1998, dans son préambule que « chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ».
En France, c’est à la suite des crises sanitaires et environnementales des années 2000, et notamment de la crise de l’amiante, que le législateur et le pouvoir constituant consacrent (enfin ![4]) les interactions entre environnement et santé humaine dans des normes juridiques. Le premier Plan national santé environnement a, ainsi, été élaboré en 2004. Par la suite, la loi Grenelle II[5] énonce que « la réduction des atteintes à l’environnement contribue à l’amélioration de la santé publique […] »[6].
Au-delà de ces consécrations législatives, c’est évidemment l’adoption constitutionnelle du « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé », dans l’article 1er de la Charte de 2005, qui vient confirmer la nécessité de traiter ensemble les problématiques environnementales et sanitaires.
Au niveau du Conseil de l’Europe, aucun texte n’y reconnaît ce droit de manière autonome[7]. Même si les juges de Strasbourg ont reconnu par ricochet le droit à la protection d’un environnement sain, la Convention de 1950 et ses textes additionnels demeurent en effet muets sur cette question. La France est d’ailleurs régulièrement sollicitée pour porter les initiatives nécessaires au sein du Conseil de l’Europe en vue de consacrer le droit à un environnement sain dans un instrument juridique contraignant, tel qu’un Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme[8]. Reprenant cette idée, le 28 septembre 2023, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) recommande l’adoption d’un instrument contraignant reconnaissant de manière explicite le droit à un environnement sain qui prendrait la forme d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme[9].
La proposition d’adopter un tel traité n’est pas nouvelle. Évoquée dès les années 1970[10], relancée à trois reprises par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe[11], l’idée d’un protocole additionnel est régulièrement réactivée[12]. Preuve que la formalisation expresse du droit à un environnement sain dans un texte juridique n’est pas qu’une question cosmétique. On peut se demander pourquoi.
Là où l’approche One Health apparaît comme un concept intégrateur, mobilisé par la communauté scientifique et internationale comme prisme d’analyse de l’état sanitaire de tous les organismes vivants sur la planète, le droit à un environnement sain, lui, a surtout une dimension subjective. Il semble aujourd’hui devoir se réduire à la promotion d’un droit individuel invocable devant les juridictions nationales, européennes et internationales.
Si l’on postule l’utilité de l’approche One Health, pour une meilleure protection de la santé et de l’environnement, ne doit-on pas chercher d’autres instruments que la reconnaissance d’un « droit à » pour concrétiser cette idée consistant à lier santé humaine, animale et environnement ? Car quand l’approche One Health envisage les rapports entre santé et environnement comme un objet de politique publique mondiale, le droit à un environnement sain réduit la question à une simple problématique contentieuse.
Alors même qu’ils partagent des finalités communes, que nous évoquerons dans un premier temps, environnement sain et One Health connaissent donc des traductions distinctes, que nous traiterons dans un second temps.
I. Des finalités partagées
L’approche One Health et le droit à un environnement sain partagent des finalités évidentes. En témoigne, d’une part, la concomitance chronologique de leur reconnaissance respective (A) et, d’autre part, leurs objectifs communs (B).
A) Une apparition concomitante
La consécration de l’approche One Health entre 2004 et 2008 au sein, d’abord, de la Société de conservation de la faune sauvage, puis au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fait suite (comme l’a souligné Stefania Negri) au constat que 60 % des maladies infectieuses humaines proviennent du monde animal et 70 % de ces maladies sont transmises par les animaux sauvages.
Si pendant longtemps, la France a semblé indifférente à ces chiffres et à l’approche, les choses ont rapidement changé avec le Covid-19. En pleine pandémie, l’Assemblée nationale française a, dans une résolution du 9 novembre 2020, invité le Gouvernement, d’une part, à agir en faveur d’une plus forte coopération internationale pour la mise en œuvre du concept décloisonné et transdisciplinaire d’une seule santé, et, d’autre part, à intégrer l’approche One Health dans toutes les politiques et tous les processus décisionnels[13].
Suivant cette logique, le Conseil européen encourage aussi les États membres à participer au Réseau européen intersectoriel – « One Health Network » – d’échanges et de coordination des politiques de santé humaine et animale, notamment dans le cadre des politiques de résistance aux antimicrobiens[14].
Dans le même sens, pendant l’été 2021, les ministres de la Santé du G7 puis ceux du G20 promeuvent clairement l’approche One Health et recommandent notamment le renforcement des actions de surveillance intégrées et d’analyses de données en santé humaine, santé animale, alimentation et environnement, y compris pour la prévention des émergences. Car l’OMS souhaite, avec l’approche One Health, concevoir et mettre en œuvre des programmes, politiques et travaux de recherche visant ensemble la sécurité sanitaire des aliments, la lutte contre les zoonoses et la lutte contre la résistance aux antibiotiques.
Mais cette approche intégratrice va bien au-delà des maladies susceptibles de se transmettre de l’animal à l’homme et de l’antibiorésistance. Elle met en perspective la santé avec les grands enjeux environnementaux et climatiques auxquels le droit doit désormais faire face[15].
C’est aussi l’ambition du droit à l’environnement sain qui apparaît à peu près à la même période, dans la Convention d’Aarhus, on l’a dit, puis qui est constitutionnalisé en France dans la Charte de 2005.
Qu’en est-il au niveau européen ? Le droit à un environnement sain n’est reconnu explicitement comme un droit fondamental dans aucun texte.
Au sein de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux et les Traités font bien mention du niveau élevé de protection de la santé et du niveau élevé de protection de l’environnement qui doivent être intégrés dans les politiques de l’Union, mais nul droit à un environnement sain, consacré en tant que tel[16]. Il en va de même, on l’a dit, au sein de la Convention européenne des droits de l’homme.
On le comprend, tandis que l’approche One Health est partout promue ou recommandée depuis le milieu des années 2000 et plus encore depuis le Covid-19, le droit à un environnement sain est, quant à lui, depuis la même époque, consacré en France et très indirectement protégé par le Conseil de l’Europe, alors que beaucoup réclament sa formalisation au sein d’instruments juridiques contraignants. Les deux concepts poursuivent pourtant des objectifs communs.
B) Des objectifs communs
Outre leurs origines communes, l’approche One Health et le droit à un environnement sain visent, tous deux, à répondre aux inquiétudes contemporaines de la société mondialisée qui portent sur les conséquences sanitaires et environnementales de la globalisation économique et de la libéralisation des circulations des personnes et des marchandises.
Pour ce faire, ils ambitionnent, tous deux, de tirer les conséquences politiques et juridiques du constat scientifiquement établi selon lequel l’homme est interdépendant avec le reste des organismes vivants présents sur la planète. Tant l’approche One Health que le droit à l’environnement sain de l’article 1er de la Charte formalisent ainsi une vision englobante de la santé. Rappelons, en effet, que la Charte française entend l’environnement dans une acception des plus larges en y intégrant « la diversité biologique, les ressources et les équilibres naturels ».
Les deux concepts visent, aussi, à décloisonner une gouvernance sanitaire et environnementale traditionnellement organisée en « silos », c’est-à-dire divisée en thématiques distinctes pour mettre en lumière leur proximité.
Dans la gouvernance française actuelle, le rattachement, compréhensible, des vétérinaires au ministère de l’Agriculture ne facilite pas les décisions communes. Si l’on veut mettre en pratique « Une seule santé », une structure interministérielle pluridisciplinaire s’impose à l’évidence. C’est d’ailleurs ce que préconisait le Conseil scientifique français en février 2022 dans un avis consacré à One Health[17] afin d’associer différentes expertises scientifiques.
On retrouve la même logique pour la réalisation du droit à un environnement sain qui suppose une prise en compte de tous les déterminants environnementaux de la santé, et qui, dès lors, s’inscrit donc dans l’approche onusienne.
Il convient de remarquer qu’il n’en constitue toutefois qu’un des éléments. Indéniablement moins vaste que l’approche One Health, le droit à un environnement sain se focalise sur la santé humaine avant tout. La santé animale n’est, quant à elle, appréhendée que comme une composante de l’environnement susceptible d’affecter la santé humaine.
La question de la santé animale apparaît dès lors seconde dans le cadre du droit à un environnement sain, alors qu’elle est centrale dans l’approche One Health qui aspire à analyser et caractériser le risque zoonotique pour le limiter et identifier les risques émergents.
De surcroît, l’approche One Health est orientée vers la prévention et la préparation des réponses aux crises et urgences sanitaires, là où le droit à un environnement sain s’inscrit dans une démarche pérenne et ne se limite pas à la question des crises. Deux prises de position récentes témoignent de cet aspect de l’approche One Health : celle du ministère des Affaires étrangères et européennes français[18], qui considère que l’approche One Health est axée sur les « menaces pour la santé humaine » et donc sur l’anticipation des maladies qui circulent entre les différentes espèces et, ensuite, la prise de position du Directeur général de l’OMS qui, lors du lancement en octobre 2022 du Plan d’action conjoint « Une seule santé » a souligné que : « de toute évidence, l’approche “Une seule santé” […] vise à renforcer les moyens de la planète de lutter contre des épidémies et des pandémies telles que la Covid-19. C’est pourquoi l’approche est l’un des principes directeurs du nouvel accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies »[19].
On le comprend, les efforts d’amélioration de la qualité de vie humaine, la promotion d’habitudes de vie équilibrées et celle d’une alimentation responsable – caractéristiques du droit à l’environnement sain – ne sont donc pas au cœur de l’approche onusienne qui demeure centrée sur la réponse aux urgences sanitaires.
Malgré des objectifs voisins, l’approche One Health et le droit à un environnement sain ne s’appuient donc pas sur les mêmes outils. Dès lors, leurs traductions institutionnelle et normative diffèrent largement en pratique.
II. Des traductions distinctes
Politique publique ambitieuse, car « holistique » comme nombre d’auteurs l’ont souligné ici, l’approche One Health n’en demeure pas moins encore aujourd’hui peu opérationnelle, alors même que le droit à un environnement sain apparaît, quant à lui, comme un outil contentieux plus facilement mobilisable, dont le potentiel pourrait, par ailleurs, encore s’enrichir à l’avenir.
A) One Health : une politique publique préventive, mais limitée
Jusqu’à une période récente, l’approche One Health, bien que promue depuis une vingtaine d’années, péchait par son manque de concrétisations. Une des raisons qui peut expliquer que peu de choses se sont passées depuis les années 2000 résulte du fait que l’approche n’était précisément pas « sacralisée » en tant que telle dans un texte juridique. Elle ne disposait pas d’une définition stabilisée, claire et mobilisable par les juristes. Les choses ont récemment évolué.
Une déclaration présidentielle franco-allemande en octobre 2020 au Forum de la paix a lancé politiquement l’idée de conseils d’experts One Health. Cette idée a ensuite été reprise par l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et la FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) auxquelles s’est joint le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ainsi, le « One Health High Level Expert Panel » (OHHLEP) a été mis en place officiellement le 20 mai 2021[20].
Une déclaration présidentielle franco-allemande en octobre 2020 au Forum de la paix a lancé politiquement l’idée de conseils d’experts One Health. Cette idée a ensuite été reprise par l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et la FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) auxquelles s’est joint le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Ainsi, le « One Health High Level Expert Panel » (OHHLEP) a été mis en place officiellement le 20 mai 2021[20].
L’une des premières tâches du Panel a été de proposer une définition commune de One Health. À son sens, « Une seule santé consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ». Pour ce faire, l’approche doit mobiliser de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler à lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes.
Malgré cette ambition, les conséquences normatives et institutionnelles que l’on déduit de l’approche One Health paraissent, aujourd’hui encore, bien insatisfaisantes. D’abord, à l’échelle internationale, s’il existe bien un plan d’action conjoint, il n’existe pas de convention-cadre destinée à mettre en œuvre concrètement l’approche. Ensuite, Estelle Brosset l’a démontré, à l’échelon de l’Union, les avancées sont encore timides. Enfin, les textes nationaux faisant référence à One Health sont principalement des documents de faible valeur juridique. Ainsi, en France, le quatrième Plan national santé environnement (PNSE 2021-2025) fait, pour la première fois, mention de l’approche « Une seule santé ». Toutefois, outre son absence de force obligatoire, le Plan ne précise pas quelles actions s’inscrivent réellement dans l’approche onusienne, donnant ainsi raison au Conseil scientifique qui écrivait en 2022 que la « stratégie One Health, qui commence à s’imposer dans la continuité des réflexions autour de la santé mondiale, est culturellement peu partagée, actuellement mal structurée, pas suffisamment opérationnelle et peu lisible ». La critique est virulente, mais exacte.
La pandémie de Covid-19 offrait un bel exemple de ce qu’est concrètement « Une seule santé ». Elle aurait pu constituer une opportunité pour penser une réponse institutionnelle coordonnée qui fasse intervenir les spécialistes des trois santés : animale, végétale et humaine. Cela n’a pas été le cas. Contrairement à l’Allemagne, dans notre pays, les vétérinaires n’ont pas été sollicités pendant la crise alors même que le Covid-19 est une zoonose et que ces derniers avaient des compétences pour analyser la pandémie. De surcroît, sur le plan opérationnel, ils revendiquaient même le droit de participer aux campagnes de tests.
Politique publique qui englobe le droit à un environnement sain, mais qui le dépasse, l’approche One Health est donc encore aujourd’hui peu en mesure d’être mise en œuvre. À l’inverse, le droit à l’environnement sain, bien que moins englobant que l’approche onusienne s’avère un outil contentieux plus exploitable bien qu’encore perfectible.
B) Le droit à un environnement sain : un outil contentieux évolutif, mais perfectible
Les potentialités de cet outil qu’est le droit à un environnement sain s’apprécient tant en droit interne qu’en droit de la CEDH. Concernant le droit français, le juge administratif considère depuis 2022 que le droit à un environnement sain constitue une liberté fondamentale, invocable dans le cadre du référé liberté[21] et qu’il est, par ailleurs, directement invocable à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir[22]. Ce faisant, le juge administratif admet de sanctionner les carences du pouvoir réglementaire dans la prévention des risques sanitaires et environnementaux dont il a connaissance. Cela l’a conduit, dans certaines affaires célèbres (telles celle des Amis de la Terre en 2017[23] ou celle portée par la commune de Grande Synthe en 2021[24]) à prononcer des injonctions d’agir à destination des autorités administratives.
La question qui se pose désormais est celle de savoir si l’on va pouvoir à l’avenir obtenir la sanction des carences, non pas seulement du pouvoir réglementaire, mais également du législateur en cas de non-respect du droit à un environnement sain. On peut en douter a priori. En effet, le Conseil constitutionnel estime, depuis 2012, qu’il ne lui appartient pas : « de substituer son appréciation à celle du Parlement sur les moyens par lesquels ce dernier entend mettre en œuvre ce droit de chacun à vivre dans un environnement sain »[25].
Des progrès récents témoignent néanmoins peut-être de la volonté du juge constitutionnel de se faire plus grand protecteur du droit à un environnement sain. En des termes inédits, le Conseil a en effet jugé dans sa décision QPC n° 2023-1066 rendue le 26 octobre 2023 qu’il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard[26]. En attendant de savoir si cette innovation jurisprudentielle ne restera pas lettre morte, les regards se tournent aujourd’hui vers la Cour européenne des droits de l’homme qui est régulièrement appelée à se prononcer sur les obligations étatiques résultant du droit à un environnement sain.
Bien que la Cour ait pu affirmer dans une décision Fieroiu c. Roumanie du 23 mai 2017[27], que la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain, on sait que les juges de Strasbourg ont pu développer une jurisprudence audacieuse sur la base de l’article 2 relatif au droit à la vie et sur celle de l’article 8 relatif au respect de sa vie privée et familiale et du domicile. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les activités polluantes qui causent des dommages sont susceptibles, depuis la décision Cordella de 2019, de caractériser une atteinte à la vie privée et familiale[28], ou encore que la responsabilité de l’État peut être recherchée en l’absence d’une réglementation appropriée visant un secteur privé source directe de pollution[29]. À ce titre, le juge européen considère, dans l’arrêt Tatar de 2009, que l’État a le « devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des dommages à l’environnement et à la santé humaine »[30]. De plus, sur le fondement de l’article 2 de la Convention, la CEDH reconnaît depuis 2002 et la décision Öneryildiz que le droit à la vie « est envisageable en relation avec des questions environnementales »[31].
Malgré cela, et compte de tenu de la grande marge d’appréciation que la Cour laisse aux États en la matière[32], il convient de souligner que, comme la Charte de l’environnement française, la jurisprudence européenne ne se concentre que sur la reconnaissance de droits subjectifs et la reconnaissance d’intérêts personnels (la santé, le domicile, la vie privée et familiale, etc.) dans sa jurisprudence sanitaire et environnementale.
Dans le même sens, on peut regretter que l’actio popularis n’existe pas devant la Cour[33]. Ceci constitue évidemment un obstacle sérieux à la protection de l’environnement[34]. Seul l’intérêt individuel des requérants est admis, ce qui demeure inadéquat dans la mesure où cet intérêt individuel n’assure la représentation de la nature que par le prisme des intérêts personnels du requérant[35]. Également, la spécificité de la réparation des atteintes à l’environnement n’a pas été prise en compte par la Cour. Celle-ci ignore en effet toujours le préjudice écologique et ne connaît que la réponse pécuniaire, alors que « la remise en état »[36] constitue une réparation plus adaptée aux atteintes portées aux écosystèmes. En outre, faut-il le rappeler, la Convention n’admet pas les requêtes contre les acteurs privés, lesquels sont souvent les premiers responsables des atteintes environnementales. Enfin, la question des droits des générations futures et celle de l’application extraterritoriale des obligations étatiques en matière de changement climatique devront être tranchées.
Car ces questions demeurent toujours en suspens, malgré le prononcé des arrêts relatifs au changement climatique, en Grande Chambre, le 9 avril 2024[37]. La juridiction strasbourgeoise était, en effet, saisie par six requérants portugais (dont des mineurs) qui se plaignaient du non-respect par trente-trois États de leurs obligations positives en vertu des articles 2 et 8 de la Convention, lus à la lumière des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015. Compte tenu du fait que quatre requérants étaient des enfants, la question de leur droit d’action se pose ainsi que celle du caractère déjà avéré[38] de la violation de leurs droits. Parallèlement, se posait également la question de la responsabilité solidaire des États. Si le principe en droit international public veut que l’État ne réponde que des dommages commis sur son territoire, on sait que cette règle ne correspond plus à la réalité du changement climatique, qui se caractérise justement par sa non-territorialité. Comme l’a montré Laura Canali dans sa thèse[39], la nature planétaire des effets du changement climatique imposait donc à la Cour de statuer sur le point de savoir si les obligations des États parties s’étendent au-delà des frontières classiques de souveraineté. En considérant irrecevables les requêtes infantiles en raison du non-épuisement des voies de recours internes des trente-trois États actionnés, la Cour ne tranche pas les questions qui lui étaient, en l’espèce, posées.
Décevante cette décision l’est tout autant que celle, du même jour, qui admet la recevabilité de la demande d’une association de femmes âgées qui considérait que l’inaction de la Suisse en matière de changement climatique violait les droits reconnus par la Convention[40]. Tout en reconnaissant « un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie »[41], la Cour estime, sur le fondement de l’article 8, que les États ont une obligation positive d’adopter des mesures pour faire face efficacement au changement climatique, tout en conservant une marge d’appréciation certaine dans la détermination de ces mesures.
On le comprend, le droit à un environnement sain, parce qu’il ne vise que la protection contre les atteintes à la nature nous environnant et ayant un impact négatif déjà caractérisé sur notre propre santé ou celle des générations présentes, est encore envisagé par le juge du Conseil de l’Europe de manière trop réductrice. Sauf à perdre son rôle moteur en matière de protection des droits humains, la Cour de Strasbourg ne pourra donc pas continuer à appliquer à la protection de l’environnement ses cadres classiques et historiques d’analyse.
Le droit à un environnement sain devra dès lors, dans un avenir que l’on sait proche, être appréhendé différemment à Strasbourg. Il devra également l’être en France où certains auteurs proposent déjà de le dépasser pour consacrer un droit plus mixte, autant individuel que collectif conciliant homme et nature. Ainsi, on a vu apparaître des propositions destinées à ce que soit reconnu un droit à un climat durable ou stable[42], voire un droit à un environnement écologiquement viable[43].
Dépassant la dimension subjective du droit à un environnement sain, ces propositions témoignent d’une approche plus holistique de l’environnement où la prise en considération des enjeux de la santé humaine s’élargit dans une perspective où les facteurs environnementaux sont désormais pleinement intégrés. Cela nous ramène évidemment à la définition de l’approche One Health qui, si elle était déclinée en un droit opposable et justiciable, deviendrait, justement et à n’en pas douter, ce droit à un environnement sain, ainsi renouvelé.
[1] L. Warin, « One Health et l’approche “santé dans toutes les politiques” : de quoi parle-t-on ? », Journal de droit de la santé et de l’Assurance maladie, 2023, n° 36.
[2] Hippocrate, Airs, eaux, lieux, Rivages Poche, 1996, p. 9 : « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants ».
[3] Convention internationale sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à la justice en matière d’environnement signée le 25 juin 1998, Nations unies, Recueil des traités, vol. 2161, p. 447.
[4] H.-J. Scarwell, I. Rousselle, L. Charles, « Environnement et santé : quels enjeux, quels acteurs, quelle intelligibilité ? », Développement durable et territoires, 2013, vol. 4, n° 2, § 1.
[5] O. Legendre, « Grenelle 2 : un engagement national pour la santé environnementale ? », Environnement n° 10, octobre 2010, étude 27.
[6] Article 36 de la loi n° 2009-967, 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, JO du 5 août 2009, p. 13031.
[7] CEDH, 23 mai 2017, Fieroiu e.a. c. Roumanie, § 18.
[8] Cette recommandation a été reprise par la CNCDH dans la Déclaration Climat, environnement et droits de l’Homme (Assemblée plénière du 25 novembre 2021, JORF n° 0283 du 5 décembre 2021).
[9] Déclaration pour la reconnaissance d’un droit à un environnement sain dans le cadre d’un instrument contraignant du Conseil de l’Europe (D – 2023 – 3)
[10] Au sein du Conseil de l’Europe, en 1970 déjà, la Conférence européenne sur la protection de la nature clôturait ses travaux en proposant que cette organisation « élabore un protocole à la Convention européenne des droits de l’homme garantissant à chacun le droit de jouir d’un environnement sain et non dégradé » : Cité in P.‑M. Dupuy, « Le droit à la santé et la protection de l’environnement », in R.‑J. Dupuy (dir.), Le droit à la santé en tant que droit de l’homme, Colloque de l’Académie de droit international de La Haye, La Haye, 27-29 juillet 1978, p. 408. Voy. aussi J.‑P. Jacqué, « La protection du droit à l’environnement au niveau européen ou régional », in P. Kromarek (dir.), Environnement et droits de l’homme, Unesco, Paris, 1987, p. 71.
[11] Une proposition de Protocole a été faite en 1977 par le gouvernement allemand (en ce sens voy. J.‑P. Marguénaud, « La Convention d’Aarhus et la Convention européenne des droits de l’homme », RJE, 1999, hors-série, p. 78). De plus, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a lancé à trois reprises l’idée d’un tel protocole (Assemblée parlementaire, Recommandation 1431 (1999), « Action future du Conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement », 4 novembre 1999 ; Recommandation 1614 (2003), « Environnement et droits de l’homme », 27 juin 2003 ; Recommandation 1885 (2009), « Élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un environnement sain », 30 septembre 2009. Sur la question, voy. É. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH, 2020, p. 616).
[12] En 2003, un projet de Charte européenne sur les principes généraux pour la protection de l’environnement et du développement durable a été soutenu par Alexandre Kiss notamment ; voy. É. Lambert, « Rapport introductif à la Conférence de haut niveau Protection environnementale et droits de l’homme », 27 février 2020, p. 31 et 32.
[13] Proposition de résolution n° 3532 invitant le Gouvernement à agir en faveur d’une plus forte coopération internationale pour la mise en œuvre du concept décloisonné et transdisciplinaire d’une seule santé.
[14] [https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/conclusion_du_conseil.pdf].
[15] C. Bourillet, « Vers le développement d’un environnement plus favorable à la santé au sens du concept internationale « Une seule santé », Annales des mines, « Responsabilité et environnement », octobre 2021, n° 104, p. 47.
[16] N. Le Bonniec, « La reconnaissance d’un droit fondamental à un environnement sain dans l’ordre juridique de l’Union européenne : simple possibilité ou réelle nécessité ? », Revue de l’Union européenne 2016, p. 211. Voir aussi : D. Misonne, Droit européen de l’environnement et de la santé. L’ambition d’un niveau élevé de protection, LGDJ, Anthemis, 2011.
[17] Avis du 8 février 2022 du Conseil scientifique Covid-19, « One health – une seule santé, santé humaine, animale, environnement : les leçons de la crise ».
[18] Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, « Position française sur le concept ‘‘One Health/Une seule santé’’ », août 2011.
[19] Cité par A. Michelot, « Quelle loi pour « une seule santé » en France ? Les propositions de la SFDE pour l’Alliance Santé Biodiversité », Revue juridique de l’environnement, 2023/1 (Volume 48), p. 105‑138.
[20] Composé de 26 experts indépendants, le panel est chargé de regrouper, analyser, diffuser et donner plus de visibilité aux informations scientifiques disponibles sur les liens entre santés humaine, animale et environnementale, avec comme objectif d’aider les responsables politiques et les organisations internationales à prendre les décisions utiles pour prévenir et répondre aux futures crises sanitaires, d’éclairer les citoyens sur les enjeux entourant ces questions et alerter sur les risques sanitaires émergents.
[21] CE, 7/2e ch. réunies, 20 sept. 2022, n° 451129, Époux Panchaud et antérieurement : TA Châlons-en-Champagne, 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel, Ligue de protection des oiseaux, Fédération des conservatoires d’espaces naturels c/ Préfet de la Marne, AJDA 2005, p. 1357.
[22] CE, 26 février 2014, Association Ban Asbestos France et autres, n° 351514 : « les requérants peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la Charte pour contester la légalité du décret attaqué » et « il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l’argumentation dont il est saisi, si les mesures prises pour l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n’ont pas elles-mêmes méconnu ce principe ».
[23] CE, 12 juillet 2017, Assoc. Les Amis de la Terre France, n° 394254, AJDA 2018. 167, note A. Perrin et M. Deffairi.
[24] CE, 19 nov. 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301, AJDA 2021, p. 2115, note H. Delzangles.
[25] Considérant n° 8 de la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre. Le commentaire officiel de la décision QPC n° 2012-282 du 23 novembre 2012 relève que le Conseil constitutionnel « n’a pas fait du droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé un droit subjectif invocable en tant que tel ».
[26] CC, n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs] ; comm. S. Brimo, Gazette du Palais 2024, n° 2, p. 26.
[27] Voir note de bas de page 7.
[28] CEDH, 24 janv. 2019, Cordella c/ Italie, n° 54414.
[29] CEDH, 9 déc. 2014, Lopez Ostra, n° 16798/90.
[30] CEDH, 27 janv. 2009, Tatar c. Roumanie, n° 67021/01, § 88.
[31] CEDH, 18 juin 2002, Oneryildiz c. Turquie, n° 48939/99, § 64. Par ailleurs, « l’adoption de mesure propre à assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause » constitue une exigence découlant de la Convention : CEDH, Gr. Ch., 30 nov. 2004, Oneryildiz c. Turquie, n° 48939/99.
[32] CEDH, 24 janvier 2019, Cordella c/ Italie, req. n° 54414/13 et 54264/15, D. 2019, p. 674, comm. S. Nadaud et J.-P. Marguénaud.
[33] CEDH, 19 juin 2018, Bursa Barosu Baskanligi e.a. c. Turquie, § 115.
[34] D. Shelton, « Complexities and Uncertainties in Matters of Human Rights and the Environment, Identifying the Judicial Role », in J.H. Know et R. Pejan (éd.), Human Right to a Healthy Environment, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 104.
[35] M.‑P. Camproux Duffrène, « La représentation de l’environnement devant le juge : approches comparative et prospective. Avant-propos », VertigO, 2015, Hors-série n° 22, § 22.
[36] APCEF, Commission « Préjudice écologique » présidée par L. Neyret, La réparation du préjudice écologique en pratique, 2016, p. 27.
[37] CEDH, 9 avr. 2024, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et autres, n° 39371/20.
[38] Comm. eur. dr. h., décision Noel Narvii Tauira et 18 autres c. France, 4 décembre 1995, requête no 28204/95 : le recours individuel n’a « pas, sauf exception, pour objet de prévenir une violation de la Convention ». Voy. aussi Com. dr. h., constations Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo c. France, 22 juillet 1996, communication n° 645/1995, en particulier § 5.5.
[39] L. Canali, Le procès et le changement climatique, Th. AMU, 2022, § 486.
[40] CEDH 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c/ Suisse, n° 53600/20.
[41] CEDH, 9 avr. 2024, n° 53600/20, § 519.
[42] M. Torre-Schaub, « L’émergence d’un « droit à un climat stable » : une construction interdisciplinaire », in Droit et changement climatique : Comment Répondre à l’urgence climatique ?, Mare et Martin, 2020. p. 63.
[43] É. Lambert, « Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l’Europe ? », RTDH, 2020, p. 616.
Sara Brimo, « One Health et droit à un environnement sain : du global au justiciable ? », One Health en droit international et européen [Dossier], Confluence des droits_La revue [En ligne], 03 | 2025, mis en ligne le 6 mars 2025. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=3776.