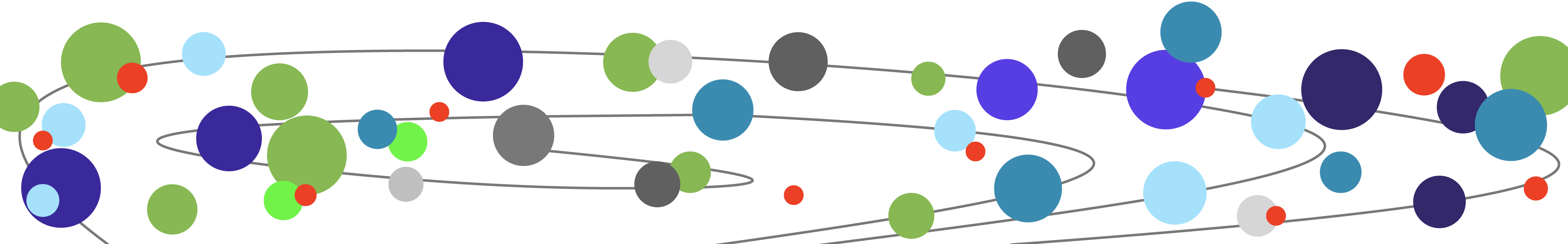Entretien avec Marine Fleury, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne, Membre du Comité légistique de la Convention citoyenne pour le climat

Confluence des droits_La revue : La Convention citoyenne pour le climat est présentée comme une expérimentation démocratique inédite. Comment évaluez-vous la méthode suivie et l’organisation de la Convention de ce point de vue ?
Je suis toujours un peu mal à l’aise quant au côté inédit de l’expérimentation. En réalité, il y a une part d’inédit et une part de processus déjà existants dans la Convention. L’assemblée citoyenne, c’est un modèle qui s’est imposé depuis les années 80, à côté du sondage délibératif, comme un moyen de renouveler les méthodes démocratiques. Ces mini-publics de citoyens tirés au sort associés à la définition des politiques publiques se sont d’ailleurs largement diffusés dans le monde, voire ont déjà été institutionnalisés dans certains pays. Le cas le plus proche et le plus médiatisé est le celui de l’Irlande, où des assemblées citoyennes ont été convoquées successivement selon des modalités d’organisation assez différentes d’ailleurs. Les travaux de Dimitri Courant sont sur ce point particulièrement éclairants. Aux côtés de ces mini-publics ad hoc, il existe aussi des formes institutionnalisées de mini-public. Ce fut d’abord le cas en Colombie-Britannique où le mini-public s’est imposé depuis les années 2000 comme un préalable à la convocation de référendum tout comme en Oregon. Plus près de nous en Allemagne ou en Belgique[1], des assemblées citoyennes qui disposent d’une mission consultative sont déjà adossées aux organes du gouvernement représentatif.
Le recours au mini-public n’est donc pas un phénomène inédit dans le monde ni en France d’ailleurs. La première expression remonte à la conférence de consensus qui s’est tenue sur les OGM en 1998. Depuis, des citoyens tirés au sort sont présents dans le cadre de la politique de la ville pour essayer de refaire venir en politique un ensemble d’habitants qui désertent les modes d’expression classiques de la citoyenneté électorale. De même, la Commission nationale du débat public, dans le cadre de débats publics qu’elle avait pu organiser, a déjà eu recours à ce mode de participation du public, tout comme le Conseil économique social et environnemental. Il existe donc des antécédents de mini-publics en France qui font que cette procédure n’est pas si nouvelle. D’ailleurs, les instigateurs de la Convention citoyenne pour le climat l’ont clairement inscrite dans une forme de filiation avec les dispositifs mis en place récemment en Irlande et en Islande.
En revanche, la Convention citoyenne a pris place dans un moment participatif particulier. Cette dernière s’inscrit clairement dans la continuité temporelle du Grand débat national tout en s’en distinguant fortement. En effet, à l’issue du Grand débat, des conférences territoriales de citoyens dont les membres étaient tirés au sort avaient déjà été réunies. Néanmoins, les missions dévolues à ces conférences étaient assez obscures, voire énigmatiques, et peu de travaux ont depuis été publiés pour en éclairer le fonctionnement. Au contraire, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat le mandat des citoyens était clair : identifier les mesures législatives et réglementaires de nature à permettre de réduire les émissions de GES de -40 % à l’horizon 2030, dans un esprit de justice sociale. Ensuite, la convocation de la CCC a sans doute bénéficié de l’apparente conversion du chef de l’État aux bienfaits du tirage au sort en démocratie. En effet, le président de la République avait annoncé, quelques mois plus tôt, dans son discours au Congrès à Versailles, une réforme institutionnelle dont l’objet aurait été de constituer une assemblée du futur composée de citoyens tirés au sort. Cette proposition marquait alors sans doute l’influence que pouvait exercer Nicolas Hulot en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, puisque ce projet est soutenu par la fondation dont il était le directeur.
La part d’inédit de la Convention citoyenne sur le climat, de mon point de vue, c’est qu’il s’agit d’un dispositif « hors normes ». Hors norme d’abord au regard de son fonctionnement. À ma connaissance, c’était la première fois qu’en France un mini-public réunissait autant de citoyens, disposait d’autant de moyens financiers — 5 millions d’euros —, d’une grande visibilité médiatique, du pouvoir d’exprimer ses recommandations sous la forme de textes juridiques et avait pour commanditaire politique du chef de l’État. De même, la durée de convention est assez insolite. Initialement, la CCC devrait être dissoute en février 2021. Finalement, ses réunions se sont étendues à la faveur des grèves de décembre 2020 puis du confinement, jusqu’en juin 2021. Elle aura donc duré neuf mois, une durée qui a participé sans aucun doute à l’enrichissement des travaux des citoyens.
Hors normes ensuite, car organisée en dehors du droit. Hormis la lettre de mission du Premier ministre donnant mandat au CESE d’organiser une convention, on ne trouvera sur Légifrance aucun acte formalisant le processus ou la désignation des membres constituant ses organes internes. De ce point de vue, elle se distingue du Grand débat national qui donna lieu tout de même à un embryon de formalisation juridique. D’ailleurs, l’examen du site de la Convention permettra à l’observateur de constater le peu de formalisation des décisions ou recommandations des organes internes à la Convention. Ainsi s’y trouvent le mandat donné par le comité de gouvernance à comité légistique, la lettre de cadrage du groupe d’appui, la lettre de mission du Premier ministre et les décisions du comité de garants. Aucune décision du comité de gouvernance, aucun règlement de procédure exposant les règles de la discussion, listant les experts auditionnés ou dressant des comptes-rendus des séances, n’est disponible. Cela ne signifie pas nécessairement que de telles règles ou documents n’aient pas existé, seulement qu’il a été jugé préférable de ne pas le formaliser ou/et les rendre publics. Enfin, il est intéressant de relever qu’il n’a pas été envisagé d’arrimer ce dispositif à la CNDP, qui constitue pourtant une terre d’accueil idoine en raison de ses compétences et de son expérience dans l’organisation de débats publics.
[1] Il s’agit de la « Bürgerversammlungen » mise en place en 2019 dans la communauté germanophone.

Il semble que cela ait été assez mal vécu à la CNDP.
Je ne sais pas, je n’ai pas une compréhension exacte de ce qui s’est passé, seulement des intuitions. J’imagine que depuis que la CNDP a refusé d’organiser le Grand débat, les relations qu’elle entretient avec l’exécutif sont complexes. D’autant que La CNDP, par la voix de sa présidente, Chantal Jouano, a publiquement exposé, dans le cadre d’un article publié dans MEDIAPART, les termes du désaccord qu’il l’avait conduite à refuser d’organiser le Grand débat national. En tout cas, la situer dans l’enceinte du CESE a sans doute contribué à la perception du caractère inédit du dispositif.

Peut-être est-ce le fait que ce soit organisé au niveau national français, et non local, sur une thématique bien particulière, qui a poussé à parler de caractère inédit.
Oui, sans doute, même si j’insiste, ce n’était pas la première fois quand même qu’un mini-public d’envergure nationale était réuni. En préparant un article sur le sujet, j’ai même découvert qu’un mini-public de 16 personnes avait déjà été réuni en 2002 sur le changement climatique par la Commission française sur le développement durable !
En revanche, la mission confiée à ce mini-public était inédite : il était tenu de faire des propositions, pour résoudre, par des décisions, les controverses relatives à la manière de remplir des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et même, ce qui était vraiment inédit c’est que, par là même, le commanditaire semblait dire aux citoyens : « allez-y, vous pouvez écrire des règles de droit ». La faculté reconnue aux citoyens de formuler leurs propositions sous la forme de règle de droit — réglementaires et législatives — constitue une vraie originalité de ce dispositif. À ma connaissance, aucun autre mini-public n’avait été investi d’une telle tâche. Généralement, l’issue des mini-publics consiste soit en l’expression par le mini-public de l’ensemble des arguments examinés et d’une appréciation de leur pertinence soit en l’écriture de recommandations, assez générales. En aucun cas on ne leur suggère d’aller jusqu’à écrire de façon technique leurs propositions sous la forme d’un énoncé juridique. Cette habilitation était d’autant plus forte que, dans le cadre de la CCC, elle portait symboliquement sur des normes générales et impersonnelles. De ce point de vue, la CCC organisait une forme insolite d’association du citoyen à l’écriture du droit convoquant la figure d’un citoyen législateur. Néanmoins, le fait de laisser penser que des citoyens vont exercer un tel pouvoir dans le cadre d’un dispositif ad hoc démontre quand même une forme de déviance de notre système politique. En effet, cette pseudo habilitation provenait du président de la République, lequel est bien sûr incompétent pour modifier les règles de répartition des compétences définies par la Constitution ! Car, prise au sérieux, la proposition du « sans filtre » signifiait que le Président accordait, en violation de la Constitution, un pouvoir d’initiative législative ou réglementaire à une assemblée qui n’est pas habilitée à l’exercer, ni lui à le déléguer d’ailleurs.

Oui, c’est vrai que c’est un contexte très particulier. Et que pensez-vous de la méthode suivie et de l’organisation de la Convention ?
Je n’ai pas participé aux discussions sur la méthode, puisque c’est le Comité de gouvernance qui s’en chargeait et que les travaux de ce collège étaient tenus secrets. En revanche, je peux vous dire comment j’ai vécu la méthode, en tant que participante. De mon point de vue, la méthode a été très impressionniste. La démarche m’a vraiment semblé, de ce point de vue, expérimentale. En somme, les grandes lignes de la méthode étaient assez claires. Il s’agissait d’abord de former les citoyens sur le sujet du changement climatique et de leur présenter outre les actions de politiques publiques mises en œuvre pour y faire face, les controverses sur les solutions supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs. Ensuite, il incombait aux citoyens de construire, par le débat, une opinion sur les différentes options pour proposer celles qui leur paraissaient à la fois les plus efficaces et les plus justes. En revanche, la mise en œuvre concrète de ces intentions semblait tâtonnante. Plusieurs phénomènes ont participé à ces hésitations et notamment la remise en question régulière, par les citoyens, de la méthode ! Ces questionnements conduisaient les équipes d’animation et le comité de gouvernance à reprendre ses orientations, car une manière de procéder n’apparaissait plus, finalement, comme appropriée.
Ce fut le cas, par exemple pour le groupe de travail de l’escouade. Au sein de la Convention, une division du travail proche de celle à l’œuvre dans les assemblées parlementaires a été instituée. En effet, l’enquête et les délibérations se construisaient principalement dans de petits groupes de travail thématiques — se loger, se nourrir, consommer, produire et travailler et se déplacer — chaque groupe rendant compte de son travail en plénum. Les citoyens furent répartis aléatoirement dans ces groupes de travail, pour favoriser leur faculté délibérative. L’idée est d’éviter qu’ils choisissent les groupes pour lesquels leurs préférences seraient déjà trop formalisées. En sus de ces groupes thématiques, un groupe transversal, l’escouade également composé de citoyens tirés au sort, traitait de questions qui intéressaient l’ensemble des groupes. Il s’agissait principalement des questions financières et fiscales puis de la révision de la Constitution. Toutefois, ce groupe s’est heurté à une forme de rejet par certains citoyens qui l’interprétaient comme un « super » groupe, contraire à l’égalité procédurale. Ce groupe a donc été dissous et les citoyens qui en étaient membres, réintégrés dans les groupes thématiques de travail.
Voilà un des exemples de l’impressionnisme de la procédure qui n’a cessé d’être adaptée aux difficultés rencontrées et son appropriation par les citoyens. En revanche, un point a alerté mon attention : l’absence d’harmonisation des méthodes de la discussion au sein des groupes de travail. En effet, si les grands temps de la discussion, le cadre général du travail était identique, les animateurs exerçaient assez différemment leur rôle de médiateurs dans la discussion. Ainsi, à l’intérieur même des groupes de travail, l’organisation de la discussion, la place des experts et donc les dynamiques de groupe étaient très différentes. J’ai d’abord compris ces différences en raison de la diversité des entreprises mobilisées pour assurer l’animation de la CCC. Elles me sont ensuite apparues en partie nécessaires pour tenir compte des spécificités de chaque groupe. Toutefois, cette hétérogénéité illustre aussi l’influence qu’exerce l’animation sur la qualité de discussion. De mon point de vue, certains groupes de travail ont pu aller plus loin que d’autres dans l’appropriation des controverses sur les solutions pour exprimer leurs recommandations.
Finalement, l’impressionnisme de la procédure m’apparaît comme la marque d’une volonté d’adaptation, de ne pas se sentir lié par une procédure, qui finalement ne s’avérerait pas être la plus opportune. Je pense également, ce n’est qu’une intuition, qu’il résulte aussi des dissensus au sein du comité de gouvernance. En effet, la tardiveté de certains arbitrages peut sans doute être lue à la lumière de ces désaccords notamment sur le livrable impliqué par le mandat. Un article de Bernard REBER, publié dans les Archives de philosophie du droit, évoque les différentes perceptions que peuvent avoir eues les membres du Comité gouvernance du mandat des CCC et du rôle du comité légistique. Il n’est pas impossible que ces désaccords aient rejailli sur la difficulté à produire des règles de procédure stables tout au long du processus.

De ce point de vue, le problème ne venait-il pas de l’absence de juristes dans le Comité de gouvernance ? Les juristes ont tendance à focaliser leur attention sur les règles, la procédure alors que les politistes, et des spécialistes de la démocratie délibérative tels que Loïc Blondiaux, portent leur attention sur le débat et non sur les règles de procédure qui peuvent apparaître comme un carcan.
En effet, le but premier d’un tel dispositif est d’organiser une délibération qui assure l’inclusion de tous les points de vue et qui assure l’autonomie des jugements individuels, moins de la formaliser dans des règles procédurales. Les juristes, véritables obsédés textuels, ont plutôt tendance à s’inquiéter de la formalisation de telles règles. Votre question me rappelle une réflexion que j’avais faite à Philippe MARZOLF, à l’époque où il était vice-président de la CNDP. Je m’étais étonnée du fait que la manière dont la CNDP encadre les débats relève de la pure discrétion de l’institution. Il m’avait répondu : « mais alors ça, c’est bien une préoccupation de juriste », en considérant qu’en fait, ce qui compte, c’est que des garanties soient apportées à ceux qui débattent. Ce qui est le cas, pour la CNDP qui s’est dotée d’une doctrine interne pour assurer l’inclusion des points de vue dans le débat public. Cette doctrine se résume d’ailleurs en trois principes — impartialité, équivalence des positions, argumentation — qu’elle décline dans les méthodes qu’elle élabore discrétionnairement.
Je pense que la bonne posture est sans doute intermédiaire. En effet, la formalisation juridique très précise de la discussion n’est pas nécessaire comme elle l’est dans le cadre d’une délibération parlementaire. La finalité principale du règlement des assemblées est de protéger les droits de la minorité politique et, de plus en plus, la célérité de la discussion. De tels objectifs ne sont donc pas adaptés au mini-public. En revanche, ce qui me paraît pertinent, c’est au moins de donner aux citoyens une forme de lisibilité sur leur place dans la procédure, sur l’organisation du cadre général du dispositif et de formaliser les garanties dont ils disposent. La formalisation de tels principes me paraît tout à la fois être un gage de la confiance pour les citoyens rassemblés, mais aussi du grand public vis-à-vis de ces dispositifs. Aller plus loin serait compliqué dès lors que le cadre de la procédure était lui-même un sujet de discussion entre le comité de gouvernance et les citoyens. Le comité de gouvernance a cherché à répondre aux demandes des citoyens qui souhaitaient la mise en place de procédures particulières. Ce fut par exemple le cas, au moment du vote, pour la reconnaissance de la faculté d’émettre une opinion dissidente.
Finalement, la difficulté à formaliser des règles précises s’explique peut-être par la difficulté pour le comité de gouvernance de les imposer aux citoyens et pour l’assemblée de les produire seule… Pour qu’elle le fît, il aurait fallu organiser une première discussion sur la procédure elle-même ! Sans doute que les désaccords au sein du comité de gouvernance ont entretenu ce silence procédural qui démarque la convention citoyenne des autres dispositifs équivalents. Finalement, la conséquence la plus dommageable concerne sans doute le grand public qui peut difficilement comprendre le fonctionnement réel du dispositif.

C’est peut-être surtout cela que les juristes reprochent au dispositif, le manque de transparence, et le fait que dans d’autres types d’assemblées, dont les assemblées parlementaires, effectivement, pour aboutir à une décision, on prend en compte la sincérité des débats et leur bonne organisation. Il est vrai que, dans la réalité, la sincérité n’est pas toujours assurée, mais les juristes s’attendent quand même à ce qu’il y ait un minimum de règles, avec en toile de fond la crainte de la manipulation.
Une nouvelle fois, une assemblée parlementaire n’est pas le même forum qu’un mini-public. On n’y trouve pas les mêmes enjeux de pouvoir entre une majorité qui tient les clés de la procédure et une minorité à laquelle sont concédés des droits. La sincérité et la clarté des débats y sont d’ailleurs très mal protégées : ce sont des standards qui servent surtout au juge constitutionnel pour ne pas tirer de conséquences juridiques des irrégularités procédurales… S’agissant des mini-publics, ce sont les organes internes qui garantissent la sincérité et la clarté des débats, l’égal accès de l’ensemble des participants au pluralisme des informations relatives au sujet qu’ils ont à traiter. La question de l’impartialité se pose donc surtout dans le cadre des relations entre les organes internes et les participants, celle de leur indépendance vis-à-vis du commanditaire.
Cette impartialité était censée être assurée par le pluralisme des opinions des personnes siégeant au comité de gouvernance et par l’absence de manifestation, par ses membres, de leurs opinions auprès des citoyens. En effet, cette diversité est la meilleure garantie qui puisse être apportée à la diversité de l’expertise amenée et discutée par les citoyens puisque chacun voudra voir sa chapelle entendue. Une autre solution est de construire le comité de pilotage avec des figures d’impartialité : des universitaires ou d’anciens magistrats, comme ce put être le cas en Irlande.
En revanche, l’absence de formalisation de règles a sans doute entamé la perception qu’ont pu avoir les parlementaires et le grand public du dispositif. Car la non-formalisation laisse planer l’illusion d’un secret et donc le soupçon sur la procédure. De ce point de vue, la formalisation de la procédure aurait pu participer à la légitimation du dispositif. D’un point de vue pratique, je ne suis pas sûre que cela aurait changé grand-chose. En tout état de cause, l’impressionnisme procédural rendait impossible la formalisation détaillée de règles de procédure stabilisées. Seuls de grands principes auraient pu être exprimés et rendus publics. Car en fait, des règles de procédure, il y en eut et, parfois, elles ont même été formalisées. Ce fut notamment le cas pour les conditions d’expression du vote et la recevabilité des amendements. Pour ces deux opérations, un règlement de procédure a été élaboré, car il a été perçu comme nécessaire. En revanche, à ma connaissance, il n’a pas été rendu accessible au grand public.
Si des règles de procédure devaient être formalisées, elles devraient selon moi évoquer outre le régime de publicité des travaux et des débats, les critères de sélection des experts et des informations remises aux citoyens, formaliser les garanties reconnues aux citoyens pendant la procédure et exposer les conditions de production de leur recommandation finale. Au cours du processus, la méthodologie suivie par le comité de gouvernance mériterait d’être exposée, tout comme la liste des experts entendus. De même, la publication de comptes-rendus analytiques des discussions en plénum pourrait être intéressante. En revanche, pour les modalités pratiques de la discussion, je ne vois pas l’intérêt de formaliser des règles et pourtant, j’ai réalisé ma thèse sur la délibération en droit public !

N’est-ce pas parce que l’on considère que l’assemblée citoyenne est, certes, une autre forme de représentation, mais qu’elle demeure une représentation des citoyens ?
Mais de quelle représentation s’agit-il ? La représentation est une fonction en droit. Elle tient au fait d’avoir reconnu à une personne ou un groupe la faculté d’adopter des actes juridiques pour le compte d’un autre. Les mini-publics n’exercent donc aucune fonction de représentation au sens juridique du terme, du moins tant qu’ils ne sont pas habilités par le droit à l’exercer ! De même, ils ne constituent pas non plus un échantillon statistique représentatif de la société française. Les conditions du tirage au sort ne permettent pas de les regarder comme tels. L’intérêt de ces mini-publics — et ce que permet le recours au tirage au sort — c’est tout à la fois de recruter des gens impartiaux, présentant une diversité cognitive importante pour les mettre en situation de produire une opinion publique contrefactuelle grâce à un processus particulier de discussion. L’opinion alors exprimée est bien plus qualitative que celle que l’on peut trouver dans les sondages, et bien plus lisible que celle qui serait exprimée par une manifestation de rue. Et c’est ça la valeur de ces dispositifs : donner à voir ce que pourrait être le choix impartial du public sur un sujet faisant l’objet de controverses.
Les effets politiques de ce choix, eux, restent à déterminer. Les commanditaires doivent savoir quoi faire de l’opinion qu’ils suscitent. Plusieurs options sont possibles selon le degré de transformation que l’on juge désirable du gouvernement représentatif. En tout état de cause, ces dispositifs peuvent tout à fait s’arrimer aux institutions du gouvernement représentatif, telles qu’elles existent. Ils ne les concurrencent pas nécessairement. Ils pourraient par exemple, augurer une nouvelle forme de division du travail politique entre les citoyens qui préparent et les gouvernants qui modifient les propositions des citoyens en exposant les raisons qui les y conduisent. On pourrait aussi imaginer, que comme dans l’Oregon ou en Colombie-Britannique, les travaux du mini-public servent de point de départ à une campagne référendaire, renvoyant à l’ensemble des citoyens, le soin d’endosser ou de rejeter leurs résolutions. Même, sans aller jusque-là, le simple fait de donner à voir une opinion publique impartiale sur un sujet controversé paraît utile.

Vous nous livrez l’analyse d’une personne avertie qui travaille sur la démocratie citoyenne et les questions environnementales, mais, de la part du public, ce n’est pas forcément perçu comme cela.
Oui, mais c’est un problème qui est lié à l’espace public et au peu de culture civique dans nos sociétés. Évidemment, comme toute pratique, celle du mini-public peut faire l’objet de manipulation, être instrumentalisée à des fins peu nobles. En revanche, nier l’existence des raisons sérieuses qui justifient l’intérêt pour les démocraties de ce type de processus me paraît malhonnête. En revanche, la place qui est assignée à ce type de dispositif est une question éminemment politique qui renvoie aux représentations plurielles qui existent de la légitimité en démocratie. Pour ma part, je défends la nécessité d’une refonte non pas de la représentation comme technique, telle que je l’ai décrite supra, mais des institutions en charge d’exercer cette fonction. Toutefois, mon honnêteté me pousse à affirmer qu’il est inutile de partager ce point de vue pour reconnaître à ces mini-publics une valeur démocratique.

Pensez-vous que les experts sollicités pour exposer les diverses problématiques ont été bien choisis, de même que ceux auditionnés par la Convention citoyenne ? Quels ont été les critères et étaient-ils, selon vous, représentatifs ?
À vrai dire, je ne sais pas comment les experts ont été choisis. De l’extérieur, il me semble qu’il n’y a pas eu autant d’experts qu’il y aurait pu en avoir. Mais, cela tient sans doute au mandat qui était donné aux citoyens. Le dispositif me paraît avoir été pensé pour les mettre en situation d’examiner l’ensemble de solutions proposées pour diminuer les GES de manière à atteindre à l’objectif de -40 % de GES en 2030 afin qu’ils les évaluent et choisissent celles qui, dans un esprit de justice sociale, étaient les plus pertinentes. Dans cette logique, les experts qui ont été auditionnés sont principalement ceux qui étaient porteurs de solutions, qui proposaient des changements. Forcément, un tel cadrage crée des biais de sélection dans les personnes choisies et favorise ceux qui sont porteurs de solutions… Tous ceux qui portent des discours sans solution ou qui affirment qu’ils sont pour le statu quo, ou qu’il faut attendre seront défavorisés par rapport à ceux qui au contraire ont des choses à proposer. Ce biais explique, je pense, la surreprésentation des ONG parmi les experts auditionnés ou les porteurs d’informations. Mais les experts porteurs de discours plaidant pour le statu quo ou l’attente ont également été présentés aux citoyens.
Le comité de gouvernance m’a sollicitée une fois, pour l’aider à identifier des experts aux opinions contradictoires à propos de la révision de la Constitution. En effet, les citoyens avaient choisi d’entendre une personne qui portait un point de vue, et le comité de gouvernance voulait qu’un autre point de vue leur soit présenté. J’imagine que la démarche a été la même pour tous les sujets pour permettre ensuite aux citoyens de tester la robustesse de chaque point de vue.
Un des mystères pour moi de la Convention a été la manière dont certains experts ont influencé la convention sans y être invités. Il existe deux écoles sur la nature des relations qu’il est souhaitable que les citoyens entretiennent avec l’espace public. Certains défendent l’idée que les assemblées doivent être ouvertes sur l’espace public, et donc être au cœur de la cité, même pendant leurs travaux. D’autres, en revanche, estiment qu’elles devraient être protégées de l’espace public pour pouvoir délibérer sereinement pendant leurs travaux. Selon ce schéma, l’assemblée, coupée du monde extérieur, s’informe puis auditionne des experts (qu’elle peut choisir elle-même), et travaille ensuite collégialement et seule pour peser, évaluer chacune des expertises. La Convention citoyenne pour le climat n’a pas obéi à ce modèle. Au contraire, les citoyens sont allés rencontrer des gens, ont discuté avec des parlementaires, des experts de leurs travaux en dehors de sessions de l’assemblée. Je ne sais pas comment les contacts ont été établis, mais ces experts ont pu influencer les travaux de l’assemblée. Il est certain que les contacts privilégiés noués en dehors de l’assemblée avec des experts créent un vice entre les membres du mini-public qui ne disposent pas tous des mêmes informations. Ces prises de contact présentent aussi un défi pour le dispositif qui doit trouver comment organiser la controverse avec ces experts fantômes. Ce qui reste toutefois rassurant c’est que l’irruption de ces individus n’était pas tenue secrète, puisque je peux vous en parler. Cependant, les conditions de leur mise en relation avec les citoyens restent très mystérieuses.

Peut-être parce que ce sont des personnes un peu plus médiatiques ?
Sans doute. Cette dimension a sans participer de leur influence dans la formation des opinions des citoyens. En étant à l’extérieur, ces experts semblaient plus influents, car ils créaient des relations privilégiées avec certains citoyens leur conférant en retour un poids particulier au sein de la Convention. Très peu de ces cas ont existé, mais ils ont quand même existé.

S’agissant des propositions qui ont été présentées par les citoyens, elles ont été évaluées très diversement comme soit très timorées, soit complètement utopistes, ou par peut-être une majorité comme, dans l’ensemble, assez raisonnables. De votre côté, comment les jugez-vous ? Les trouvez-vous pertinentes ? Est-ce que vous avez été surprise ?
Je vais avancer mon carton rouge. D’un point de vue déontologique, je n’engage à ne porter publiquement aucune évaluation sur la pertinence des mesures des citoyens. Cette posture de neutralité à l’égard de leurs travaux est celle que la posture à laquelle je me suis astreinte tout au long du dispositif et à laquelle je continue de m’astreindre à l’issue du dispositif.
Ce que je peux dire sur l’issue de la CCC, c’est le tableau d’ensemble proposé par la Convention. Les citoyens ont souvent relevé que l’espace pertinent dans lequel il fallait agir était l’espace européen. Ils ont également exprimé que la protection du système climatique était liée à la protection de la biodiversité et ont inclus, dans leurs travaux, des questions qui débordent le champ de la politique de réduction des émissions de GES. Ils ont ensuite exprimé l’idée qu’un engagement plus fort des finances publiques pour soutenir les politiques de la transition était nécessaire. Ils ont également pointé l’insuffisance des institutions chargées de la protection de l’environnement, de leurs moyens pour accomplir leur mission. Par là même, ils ont exprimé leur croyance dans la capacité des institutions à changer la donne et proposé de les renforcer. Enfin, plus généralement, ils ont exprimé leur croyance dans la capacité du droit à mener cette politique de transition, à transformer la société. Cette croyance partagée les a conduits à certaines déceptions. Quand, dans certains cas, on leur a dit : « non, mais ça, en fait, cela ne relève pas d’un acte juridique » ou « ce dispositif existe déjà », ils étaient interloqués. La question de l’effectivité des règles juridiques leur est apparue dans toute sa réalité !
Voilà l’analyse que je peux proposer de leurs recommandations.

Comment analysez-vous la phase de réception des propositions de la Convention citoyenne, à la fois par l’exécutif et par le législatif ? Pensez-vous que soumettre la totalité des propositions au référendum aurait été une bonne chose ?
Je vais prendre la question à l’envers. Je ne sais pas si cela aurait été une bonne chose, mais en tout cas, je pense que cela aurait été impossible pour la bonne et simple raison que le formalisme juridique nécessaire n’était pas rempli. Un référendum porte, quand même, sur une proposition ou un projet de loi. Or, en l’occurrence, il n’y avait pas de projet de loi ! De nombreuses recommandations n’étaient pas juridiquement transcrites ou l’étaient de manière incomplète. Certains arbitrages n’avaient pas été faits par les citoyens, des vérifications restaient à apporter, des consultations à organiser…
En tout état de cause, le livrable ne pouvait pas aboutir en l’état à un projet de loi susceptible d’être immédiatement soumis à un référendum.
Ensuite, sur la manière dont l’exécutif a reçu les propositions, je pense que l’équivoque due sans filtre a été très dommageable. Les citoyens m’avaient interrogée à ce propos. Je leur avais répondu que pour moi le sans filtre était une énigme. Je n’ai aucune idée de la signification de ce terme dès lors qu’évidemment il y a sinon des filtres, des règles qui s’imposent à l’exécutif lorsqu’il élabore des règles de droit ! Et d’ailleurs, heureusement qu’il y en a. C’est le message que nous avions cherché à faire passer aux citoyens moi et Delphine HEDARY. Lors de la première session, nous étions intervenues pour leur expliquer comment fonctionne un système juridique : qu’est-ce que le droit, à quoi ça sert, de quoi ça nous protège. Les « filtres » posés par le système juridique leur en donc été présentés.
Toutefois, cette expression a fait naître une équivoque qui a été entretenue par l’exécutif, les médias, et les citoyens eux-mêmes. Il faut dire que cette expression pouvait servir les intérêts de chacun. C’était une sorte d’expression creuse qui pouvait tout dire et son contraire et donc ne rien vouloir dire.
Alors qu’est-ce que cela aurait pu être le sans filtre ? À mon sens, le Gouvernement aurait pu se cantonner à préciser, ajuster, consulter, vérifier les mesures des citoyens pour ensuite remettre la discussion des arbitrages au Parlement. En somme, il aurait pu adapter ses manières de faire habituelles à l’origine particulièrement des propositions dont il était saisi, notamment dans le cadre des négociations interministérielles. En fait, il aurait pu renoncer à une partie du travail gouvernemental qui s’opère dans l’ombre, celle des arbitrages. Au contraire, ce dont témoignent les citoyens qui ont pris part aux réunions interministérielles, c’est qu’il a mis en discussion les arbitrages de la CCC. Les citoyens ont découvert cet univers opaque et ont exprimé s’être sentis assez démunis entre les grandes directions des ministères représentées par des technocrates et les représentants d’intérêts. À ce stade, ils sont redevenus des observateurs ou au mieux, des porteurs d’intérêt bien moins armés que leurs interlocuteurs.

Justement, c’est là qu’il y a eu peut-être une ambiguïté par rapport au rôle du Comité légistique. De l’extérieur, on a l’impression que ce Comité a véritablement aidé les citoyens à rédiger des propositions concrètes, qui auraient pu être soumises, par exemple, directement au référendum, qui auraient pu être directement adoptées. Mais cela ne s’est pas produit de cette façon d’après ce que vous nous expliquez. Quel a été le rôle exact du Comité de légistique ? Et plus précisément quelle était la part d’orientation, ou non, par rapport aux règles existantes ou par rapport justement à ce qui peut se faire ou à ce qui ne peut pas se faire ?
Notre positionnement était très délicat parce que nous n’avions pas le droit de donner notre opinion personnelle sur l’opportunité des mesures. Seule notre opinion sur la faisabilité juridique au sens ou l’inscription dans le système juridique de la règle était attendue. Même les questions de l’efficacité n’étaient pas dans notre mandat. C’est pour cela que beaucoup de transcriptions sont précédées de points d’attention, pour expliquer aux citoyens que parfois, ce qu’on va écrire mériterait peut-être une réflexion un peu plus approfondie ou une étude plus large du cadre européen ou même une autre concrétisation.
En effet, en raison de la diversité des sujets abordés, du nombre limité de nos moyens humains et du temps dont nous avons bénéficié, nous n’avions pas le temps de mener les enquêtes de faisabilité jusqu’au bout. Donc, parmi les propositions de transcription, il y en a qui sont abouties, mais il y en a d’autres qui ne le sont pas et dont on signale qu’elles ne le sont pas. Dans d’autres cas, les incomplétudes résultaient des travaux des citoyens. Dans ce cas, on les informait de ces lacunes et du caractère très peu précis de la transcription qui s’en suivait.

Quoi qu’il en soit, au bout du compte, cela a permis à l’exécutif, comme vous le disiez, de garder la main sur les propositions concrètes.
Oui, c’est sûr. Même si le principal intérêt des transcriptions a été de montrer le décalage entre ce que nous pouvions écrire et ce que l’exécutif a finalement choisi d’écrire. Cela a permis aux citoyens de percevoir plus facilement les décalages d’intention, d’ambition, de mise en œuvre, etc. Mais, d’une certaine manière, l’existence de ces transcriptions a aussi obligé l’exécutif à y répondre. En effet, dans le projet de loi Climat et Résilience, la quasi-intégralité des dispositions s’inspirait des propositions des citoyens qui avaient fait l’objet de transcription. Je pense que le fait que l’on ait démontré que c’était possible a contraint le Gouvernement à le considérer, en le modifiant le cas échéant. En revanche, les 60 % de recommandations qui n’ont pas été transcrites sont passées à la trappe… même si certaines propositions sont finalement réapparues dans les travaux parlementaires. Je pense au cas de la rénovation énergétique des bâtiments. Il avait été signalé aux citoyens la nécessité de définir des notions comme « rénovation globale » de manière exigeante. Finalement, le Parlement est intervenu pour procéder à cette définition.
L’intérêt de la transcription semble donc d’obliger à une réponse — une réponse que les citoyens jugeront peut-être insatisfaisante, mais une réponse quand même.
Du côté des effets pervers, les transcriptions ont replié la réponse de l’exécutif aux seules propositions transcrites ou presque. Elles ont conduit à focaliser l’attention médiatique sur des mesures précises, là où, à mon avis, les enseignements généraux étaient sinon plus du moins aussi intéressants que les mesures particulières.

Étiez-vous suffisamment nombreux dans le Comité légistique ?
Je pense qu’il y a eu des équivoques qui expliquent que nous n’étions pas nombreux. Le fait d’écrire les propositions, de transcrire en droit les propositions des citoyens ne faisait pas l’objet d’un consensus parmi les membres du comité de gouvernance. Ces dissensus expliquent la faiblesse des moyens qui ont été alloués au Comité légistique je pense.
Effectivement, si le but avait été de rédiger un avant-projet de loi, il aurait fallu construire le dispositif autrement et disposer de plus de juristes, tout au long de la phase de production par les citoyens. Les moyens alloués au comité légistique me paraissent correspondre à une certaine représentation de la fonction dudit comité. On était vraiment une fonction support, c’est-à-dire présents à titre accessoire, pour supporter les travaux qui sont par ailleurs produits par les citoyens. On a travaillé pour eux, pour que leurs propositions soient mieux comprises, mieux transmises, mieux acceptées peut-être aussi, mais c’est tout.
À la fin, je pense qu’il y a eu une équivoque sur notre rôle : quand ils ont vu qu’on arrivait à produire quand même pas mal de textes, ils se sont dit qu’ils auraient peut-être pu faire autrement. Mais c’était trop tard. Le dispositif était terminé.
Le droit proposé par le comité légistique n’a pas été coécrit avec les citoyens. Il a travaillé collégialement, mais dans l’opacité à côté des citoyens, et non avec eux. Si nous avons observé et écouté les citoyens pendant la Convention, le travail de juristes a été accompli entre juristes. Après une forme d’appropriation de notre travail a été rendue possible par des webinaires au cours desquels le comité légistique est venu expliquer mesure par mesure, groupe de travail par groupe de travail, les différentes propositions. Certaines fois, les citoyens se sont dit qu’ils auraient pu préciser nos transcriptions, mais c’était trop tard. Le dispositif n’était pas taillé pour cela même si écrire le droit était son originalité principale. C’est assez paradoxal, mais c’est l’interprétation que j’en ai, vraiment.

Pensez-vous que ce type de consultation est appelé à se multiplier dans le futur ? Quelles améliorations pourrait-on y apporter ? Quelles leçons peut-on tirer de processus similaires dans d’autres pays ?
Alors les leçons qu’on peut en tirer ? La leçon générale, c’est que cela fonctionne. Ces dispositifs démontrent que les citoyens ordinaires sont dotés de compétences délibératives. Entrer en discussion n’est pas l’apanage des plus méritants, des aristoï, de ceux que l’on a élus pour assumer la fonction de représentation. Et de ce point de vue, je pense que malgré tout, ces dispositifs, nous familiarisent avec l’idée d’une raison publique participative, qui serait différente peut-être, ou autre, que la raison publique classique des gouvernants… Ce qui constitue qui conduit à s’interroger sur la division du travail politique, c’est certain.
Deuxième point qui me paraît important, c’est que ces dispositifs donnent à voir dans l’espace public que chaque citoyen dispose de cette compétence délibérative.
Le troisième enseignement est que les citoyens ne sont pas dégoûtés de la politique et au contraire. Quand on place les gens dans une situation d’oisiveté civique, comme ont été placés ces citoyens, ils s’investissent, ils s’intéressent, ils s’engagent. Ce qui m’a interpellé est qu’ils disaient ne pas vouloir faire de la politique alors même qu’ils entraient en politique, en participant à la définition d’un monde commun désirable. Il est d’ailleurs intéressant de relever que l’expérience de la CCC a bouleversé le parcours, les engagements civiques de certains. Ce constat me paraît très encourageant dans un moment où justement on sent les démocraties fragilisées en Europe, et en Occident même, plus largement. Voilà pour les enseignements.
Est-ce que c’est appelé à se développer dans le futur ? Je le souhaiterais à titre personnel. Je pense que c’est indispensable, en fait, de repenser nos manières de faire de la politique, de repenser nos institutions. Elles sont inaptes, dans leur forme actuelle, à prendre en charge les demandes sociales ou à susciter le changement social. Ce constat explique, de mon point de vue, le désamour des citoyens pour ces dernières, voire leur désintérêt pour elles.
Il faut que les institutions se pensent et qu’on les pense autrement. Ces assemblées tirées au sort me paraissent être un outil intéressant pour le faire. D’ailleurs, l’institutionnalisation de mini-publics est une voie envisageable. La grande difficulté à laquelle ces assemblées se confrontent dans leur forme ad hoc c’est le côté arbitraire de leur convocation et de leur fonctionnement. Cette situation présente même un risque démocratique : celle de les voir utilisées aux fins d’instituer une démocratie plébiscitaire. D’ailleurs, cette tentation ne m’apparaît pas comme une pure hypothèse d’école. Ces derniers mois, l’image d’un président qui discute directement avec le « peuple » en dépassant les contre-pouvoirs semble avoir exercé une certaine attraction, que l’on pense au Grand débat national ou au tour de France des mairies… Le risque de la non-institutionnalisation est la réappropriation des dispositifs par une figure charismatique qui parce qu’elle parlerait avec le « peuple », prétendrait se draper d’une légitimité.
En revanche, institutionnaliser ces dispositifs supposerait de trancher un ensemble de questions éminemment politiques : celle de leur finalité. Est-ce qu’il s’agit d’arrimer ces assemblées aux institutions des démocraties représentatives, pour créer de nouveaux espaces d’interpellation, de critique ? Finalement, s’agit-il de renouveler la forme, mais pas le rôle classiquement attribué au public dans le cadre des démocraties représentatives ? Ce serait la première option. Ou, et c’est la deuxième option, est-ce qu’il convient de repenser la répartition des rôles entre gouvernants et gouvernés ? La division du travail politique ? Pourrait-on leur assigner une fonction de représentation de la nature, des générations futures ? Ces questions font l’objet de propositions diversifiées dans la théorie politique. Mais pour l’heure, ce débat n’a pas pénétré l’espace public alors qu’il est indispensable si l’on souhaite institutionnaliser ces dispositifs de se mettre d’accord sur les raisons de le faire.

Ce qui a été proposé dans le cadre de la réforme constitutionnelle, c’est que le CESE puisse mettre en place, de manière un peu discrétionnaire là aussi, de telles conventions citoyennes. Qu’en pensez-vous ?
Il me semble que c’est assez révélateur de la première option. Et c’est logique, puisque pour qu’une réforme plus ambitieuse soit possible, il aurait fallu réviser la Constitution. Cette réforme révèle un choix. Le choix est celui de ne pas donner beaucoup de poids à ces assemblées citoyennes. En effet, une des questions que posent ces assemblées est que faire de l’opinion publique citoyenne, participative et contrefactuelle, exprimée par ces assemblées ? En les plaçant au CESE une assemblée marginalisée par l’exécutif et le Parlement, le législateur donne une réponse implicite à cette question. Comme le relevait Denis Baranger dans un article du blog Juspoliticum, ni l’exécutif, ni le Parlement n’associent le CESE à leurs travaux qui, à titre principal, s’autosaisit. Il me semble que ce constat en dit long du rôle que ces assemblées pourront jouer à l’avenir. L’institutionnalisation des assemblées citoyennes au CESE aurait pu avoir la vertu de normaliser la valeur de la délibération du public, mais elle n’y parviendra peut-être pas dans une assemblée marginalisée.
C’est un constat que l’on peut également faire dans le cadre des procédures de participation de la démocratie environnementale lato sensu. Souvent, le législateur met en place des dispositifs, mais fait en sorte que ces dispositifs soient inoffensifs, c’est-à-dire qu’ils n’engagent rien : ni la volonté des commanditaires, ni les motifs ou les raisons de leurs actions, ni même la régularité formelle de leur décision.
Enfin, le choix du CESE pose question : une nouvelle fois, pourquoi la convocation de ces assemblées n’a-t-elle pas été confiée à la CNDP qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité et une expérience pour organiser même cette consultation du public ?

N’est-ce pas parce que le CESE a insisté pour ne pas disparaître ?
Effectivement, c’est une institution qui était fragilisée au moment même où la Convention a été convoquée par une réforme qui entendait notamment en diminuer le nombre de membres. Pour elle, il y avait un intérêt à se positionner comme une terre d’accueil de ces nouveaux dispositifs, le recours à la participation du public participant déjà à la légitimation de l’institution. Organiser des assemblées citoyennes pourra donc participer à relégitimer le CESE, l’exécutif en a une certaine expérience. Mais est-ce que cela contribuera à faire progresser l’idée d’une légitimité délibérative ? Pas si sûr.
Entretien réalisé avec Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Sandrine Maljean-Dubois, Directrices de recherche au CNRS (Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, Aix-en-Provence, France)
Pour citer cet article : Marine Fleury, « Entretien – Retour sur l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat », Confluence des droits_La revue [En ligne], 01 | 2022, mis en ligne le 19 janvier 2022. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1632