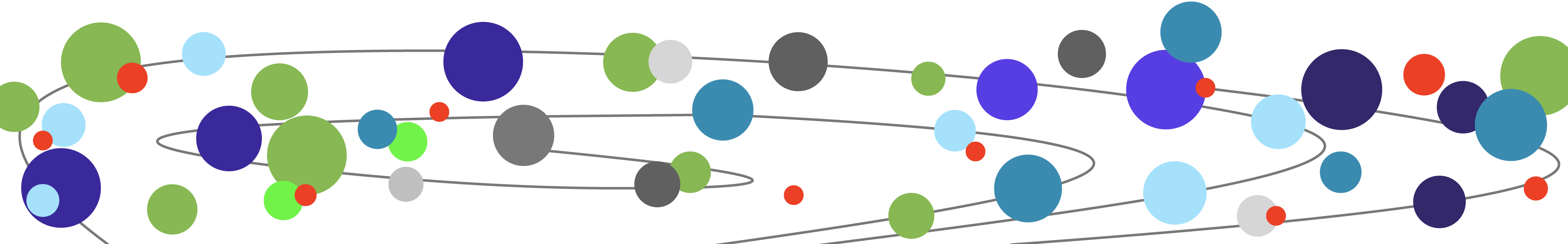Entretien avec Mireille Delmas-Marty, Professeure émérite au Collège de France


Confluence des droits_La revue : Cet entretien ouvre une nouvelle revue en ligne que nous avons appelée Confluence des droits _ La revue. Qu’évoque pour vous la « confluence des droits » ? Quel est l’intérêt de diriger notre regard à la confluence des droits, là où les frontières se brouillent, que ce soit entre droit dur et droit mou, droit international et national, entre droits nationaux peut-être, emportés dans un processus d’internationalisation ?
« Confluence des droits » est une très belle expression. Elle me suggère une méthode, d’échange et d’interactions, et un lieu, où se rencontrent et se croisent les différentes catégories de droits que vous mentionnez (droit dur/mou, droit international/national…). Mais la confluence évoque aussi pour moi une dynamique, un mouvement. En leur confluent, deux fleuves se rencontrent et leurs eaux vont progressivement se mêler pour ne plus faire qu’un seul grand fleuve. C’est différent des « frontières brouillées ». La frontière sépare avant de réunir et l’adjectif « brouillées » est plutôt péjoratif, alors que la confluence exprime la rencontre, dans ce qu’elle produit de positif. Elle se rapproche peut-être de la pensée du poète Édouard Glissant : « Je peux changer en échangeant avec l’Autre, sans me perdre pourtant ni enfin me dénaturer » [1].

Vous-même avez utilisé de nombreuses métaphores dans vos travaux pour décrire l’évolution du droit et du phénomène juridique (les nuages, la rose des vents, la boussole…). Vous avez vu dans le juriste un jardinier-paysagiste, un navigateur….
Qu’apporte la métaphore à la science juridique ?
Dans les périodes de grands changements comme la nôtre, on a davantage besoin de métaphores, sans doute parce que le lexique ne comporte pas les mots pour décrire ces changements, de l’ancien au nouveau droit qui apparaît seulement par fragments, alors que le langage ne s’est pas encore adapté. Par exemple, quand on passe de la vision traditionnellement stato-centrée, centrée sur l’État, à un droit polycentré, alors que le langage est resté celui d’un droit étatique, les mots nous manquent pour penser des notions comme le territoire, la souveraineté ou la citoyenneté. La métaphore permet d’échapper à cet enfermement, dans la mesure où elle transforme le sens des mots existant en se projetant vers l’avenir : le territoire devient espace juridique, la souveraineté solitaire des États devient solidaire, la citoyenneté se décline à différents niveaux. Cela dit, tout dépend de ce que l’on choisit comme métaphore car il y a là une grande part d’intuition. Quand j’ai proposé la métaphore des nuages ordonnés, puis des vents et de la rose des vents, enfin de la boussole, les images me sont venues spontanément, presque comme une évidence. Mais j’avais un objectif assez clair : sortir de l’enfermement dans les représentations habituelles du droit. Car le vocabulaire, et surtout les métaphores utilisées en matière juridique, sont statiques, immobiles. Qu’il s’agisse des piliers, socles, fondations, fondements ou bien sûr de la fameuse pyramide des normes, la plupart des images habituelles obligent à penser un droit statique. Pour montrer que le droit était devenu dynamique, fait de processus transformateurs plus que de concepts fondateurs, il fallait donc une métaphore nouvelle, donnant à voir que même les droits de l’homme, qu’on a tendance à voir comme des piliers, ou comme des socles, sont en réalité des processus transformateurs. Si l’on se représente la Déclaration universelle des droits de l’homme comme un socle posant des concepts fondateurs, on en vient à un constat d’échec, car aucune de ses dispositions n’est parfaitement respectée. En revanche, si l’on y voit le point de départ d’un mouvement d’humanisation, on découvre qu’en effet d’importantes transformations sont venues de cette déclaration.
Il est vrai que la nouvelle métaphore des réseaux exprime bien la complexité du droit actuel, opposée à la pyramide des normes [2]. En proposant de mon côté, les nuages, les vents et la boussole, mon objectif était apparemment le même : montrer le passage du simple au complexe, du droit dur au droit souple, etc. Toutefois le linguiste brésilien, José Garcia Ghirardi, qui a observé le travail de notre groupe de recherche « Sur les chemins d’un jus commune universalisable » [3], suggère que ces métaphores sont différentes des réseaux. Certes, les unes et les autres introduisent à la fois la complexité de relations interactives et horizontales et l’idée d’un assouplissement, mais les nuages soulignent davantage l’instabilité des systèmes de droit. Alors que les réseaux peuvent contribuer à la stabilité, le nuage change de forme à tout moment. En outre, il invite à considérer un ensemble, et pas seulement des mouvements disparates, tandis que les réseaux renvoient à des relations entre éléments, mais pas à la construction d’un ensemble. Certes le nuage est volatil, il change à tout moment de forme. Mais, par sa forme, Même éphémère, il évoque une nouvelle unité et suggère le thème du « pluralisme ordonné », la possibilité de concilier l’un et le multiple. Façon de se représenter une unité qui ne supprime pas la diversité, mais crée, à partir de la diversité, du commun. Le nuage amène enfin à la question de ce qui lui donne forme, question qu’il devenait nécessaire, à l’heure de la mondialisation et de ses contradictions, de transposer aux systèmes de droit. C’est ainsi que s’est imposée à moi la métaphore des « nuages ordonnés », dont j’ai parlé pour la première fois en 1994 dans Pour un droit commun. Les vents sont apparus plus récemment, dans Aux quatre vents du monde (2016). Sans équivalent, me semble-t-il, avec les réseaux où le droit reste plus dispersé, les nuages introduisent l’idée que les formes dépendent à la fois de facteurs endogènes – la composition physico-chimique des gouttes d’eau dans l’atmosphère – et de facteurs exogènes – qui sont précisément les vents. Les nuages sont la résultante de ces deux facteurs. Quand on utilise une métaphore, il faut être conscient de ce qu’elle porte. Celle des nuages conduit à celle des vents et finalement de la boussole, nécessaire, lorsque les vents sont contraires, pour choisir un cap et trouver un chemin. La boussole traditionnelle, qui privilégie un pôle magnétique indiquant une seule direction, nous ramène à une vision assez traditionnelle du droit. Le pôle nord, c’est ce que l’on appelle le dogme dans les systèmes de droit nationaux : une référence faite de croyances communes au groupe et qui s’impose à tous ses membres. Mais quand le droit s’étend à la planète entière, quand il devient global, il n’y a plus de dogme unique. Si boussole il y a, elle est d’un type nouveau. Au lieu d’indiquer le nord magnétique, elle comporte un centre d’attraction où la régulation se fait à partir des principes inspirés par les différentes visions de l’humanité. Il y a une sorte d’interaction entre la métaphore et les faits observés. Les faits suggèrent la métaphore et la métaphore invite à regarder les faits autrement : on découvre que les humanismes évoluent en spirale et que les principes régulateurs forment un octogone.

« Que peut le droit » est une question qui vous a animée durant toute votre carrière. Diriez-vous qu’il gagne en force ou s’affaiblit ? Qu’il peut plus ou qu’il peut moins que dans le passé ? À quelles conditions le droit peut-il résister au développement de normativités concurrentes comme l’économique ou le numérique ?
Je suis un peu gênée par votre opposition de la force et de la faiblesse. Quelquefois, un droit, apparemment plus faible, a un impact plus durable et plus profond qu’un droit coercitif imposé par la force. La distinction force/faiblesse n’est donc pas évidente. En s’affaiblissant, le droit peut s’étendre davantage. Pour se renforcer, il faut peut-être qu’il reste circonscrit. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Par rapport à ce qu’on peut observer, j’ai plutôt l’impression que le droit s’est élargi, qu’il a gagné en extension. A vrai dire, je ne suis pas sûre qu’il se soit affaibli. Il s’est complexifié. Mais est-il devenu moins effectif ? Ou, aussi effectif, mais moins efficace ? Nous n’avons pas vraiment d’instruments pour repérer et mesurer les effets. Il y a beaucoup de subjectivité dans une évaluation en termes de force ou de faiblesse. De manière générale, le droit s’est internationalisé. Or, classiquement, on considère que le droit international a moins de force que le droit national. Il est moins coercitif, car il n’y a pas d’organe exécutif au plan mondial, ni les mêmes outils qu’au plan national. A première vue, on pourrait dire qu’un droit qui « s’internationalise » gagne en étendue, mais perd en efficacité.
Mais cette réponse est trop simple parce que, dans la mesure où les défis deviennent mondiaux, le droit national est largement désarmé. Prenons le changement climatique, le droit national est apparemment plus facile à appliquer. Mais en pratique, il est beaucoup moins efficace, car il est clair qu’on ne règlera pas le problème du climat à partir d’un seul pays. Par rapport au monde réel, ce droit national, qui peut paraitre plus efficace en théorie est en pratique inadapté au problème posé. Cette observation vaut non seulement pour les changements climatiques, mais aussi pour tous les défis mondiaux, les crises financières, sanitaires, nucléaires, le terrorisme global, les migrations… Les grands problèmes de société ont quasiment tous une dimension mondiale. Le droit national n’a alors qu’une apparence d’efficacité. La solution doit en réalité être cherchée au plan mondial. Ce qui complique l’analyse, c’est que ce droit mondial peut, lui, être appliqué par interaction entre le niveau national et le niveau international. Faute de juridiction internationale, c’est souvent le juge national qui applique le droit mondial. Comme vous le disiez dans votre première question, les frontières entre le droit national et le droit international se brouillent et sont peut-être même appelées à disparaitre dans le droit fil des évolutions actuelles. Ainsi, pour revenir à la question « que peut le droit ? », je crois que, pour avoir des conséquences pratiques, c’est-à-dire agir sur les faits et changer les comportements, il faut qu’il soit adapté aux pratiques. Dans la mesure où les pratiques se mondialisent, le droit ne pourra agir que s’il se mondialise. La question étant de savoir comment le droit devra se mondialiser, car il ne sera pas efficace à n’importe quelle condition.
Quant à savoir si le droit peut résister aux normativités concurrentes, économiques et numériques, c’est une question difficile et inquiétante. Surtout si l’on ajoute aux normativités économiques et numériques ce que Catherine Thibierge a appelé « normativité sensorielle ». Cela commence lorsqu’on monte en voiture sans attacher sa ceinture de sécurité, la sanction sonore est immédiate. Et cela continue avec les objets dits « intelligents », voire les villes intelligentes smart cities qu’on veut transformer en safe cities… En somme il s’agit de toutes ces normativités qui évoluent en dehors du droit, d’autant plus vite qu’elles progressent par auto-engendrement, sans que la volonté humaine soit nécessaire. Comment résister ? Il faudrait d’abord éviter de mettre en place des normativités qui échappent à tout contrôle. Or, c’est ce qu’on peut craindre avec le numérique qui permet des formes de coopération en maillage : ce n’est pas l’esprit de coopération qui se développe, mais la coopération sans esprit, car des automatismes se mettent en place. Il y a tout un débat à l’heure actuelle sur la reconnaissance du visage et de l’identification par le visage. On découvre que des expérimentations sont déjà lancées par de grandes villes, alors même que le législateur national n’est pas encore intervenu. On peut se demander si, à un certain stade, la décision n’échappera pas complètement à la volonté humaine, qu’elle soit politique ou citoyenne. En revanche, ce sont des marchés extrêmement fructueux pour les entreprises qui pratiquent ces nouvelles technologies. Au risque, en combinant la logique du marché avec la logique technoscientifique de neutraliser l’idée même de règle de droit. Comment résister ? Peut-être, en évitant de créer un tel engrenage qui, une fois engagé, est très difficile à stopper. On le voit déjà avec la politique de surveillance et la surenchère qui l’accompagne. Les politiques sont en compétition comme sur un marché. Si la France n’est pas performante sur la reconnaissance du visage, les voisins anglais ou allemands vont conquérir le marché, la Chine ayant déjà plusieurs longueurs d’avance. Sur la capacité de résistance du droit, ma réponse est donc pessimiste.

Sur la place du droit dans nos sociétés, il est certes difficile de prévoir l’avenir, mais diriez-vous que nous allons vers plus ou moins de droit ?
Tout dépend de ce qu’on appelle droit. Nous allons vraisemblablement vers plus de normes. Mais toutes les normes ne sont pas juridiques. Depuis le début de cet entretien, nous prenons le droit comme une boite noire, sans essayer de le définir, probablement parce que la définition n’est pas facile – et peut-être même impossible. En tout cas, si le droit est à la fois normatif et institutionnel, nous allons sans doute vers une inflation de normes. Seront-elles toujours juridiques ? Il faudrait mieux cerner les limites du juridique par rapport au numérique ou à l’économique. Probablement l’institution d’un tiers impartial et indépendant – qu’on le dénomme « juge » ou autrement – est l’une des conditions permettant de différencier la norme juridique de la norme non juridique. Au regard de cette condition, la disparition du droit n’est pas inéluctable mais elle est possible. Je n’en dirai pas plus car les sociétés humaines restent largement imprévisibles.

Que pensez-vous des revendications d’une participation citoyenne accrue dans la prise de décisions politiques ?
Ce qui émerge, c’est ce qu’on peut appeler le croisement des savoirs. Cette expression, qui avait été lancée par ATD Quart Monde, a pris une signification nouvelle. Alors que les pouvoirs publics (législatif, exécutif et judiciaire) se confondent de plus en plus, les contre-pouvoirs viennent de l’extérieur, de la société civile, et notamment d’une participation citoyenne, ainsi que d’un rôle accru des scientifiques. En revanche, du côté des pouvoirs, je ne mettrais pas seulement le pouvoir politique des États, mais j’ajouterais le pouvoir économique des grandes entreprises. À l’échelle mondiale, c’est encore plus évident qu’à l’échelle nationale. Les entreprises transnationales (ETN) sont de véritables acteurs sur la scène internationale, même si traditionnellement elles ne sont pas des sujets de droit international. Elles commencent à le devenir de facto dans presque tous les domaines, et même de jure dans certains domaines comme le droit des investissements. Donc il y a une sorte de recomposition vers un nouvel équilibre (démocratique ?) à l’échelle du monde, ou d’une région comme l’Europe. C’est ce que j’appelle la « gouvernance SVP », pour Savoir Vouloir et Pouvoir. Ajoutons que le croisement est très important aussi à l’intérieur de chacune de ces trois catégories. Il n’y a pas seulement le savoir des savants, des scientifiques, des érudits. Il y a aussi le savoir de ceux qu’on appelle parfois les « sachants », c’est-à-dire de ceux qui ont l’expérience, du «vécu ». C’est en croisant les savants et les sachants qu’on peut sans doute faire avancer la connaissance. Il y a des exemples frappants dans le domaine de l’environnement. En matière de changement climatique, le rôle clé est joué par les climatologues, mais on a découvert aussi que les populations autochtones avaient des connaissances et un savoir tirés de leur expérience ancestrale. Porteur de réponses inédites aux problèmes environnementaux actuels, le savoir des populations autochtones doit être croisé avec le savoir des scientifiques. De même dans d’autres domaines. S’agissant de la pauvreté, notamment quand elle est héréditaire, les critères pertinents pour lutter contre ce fléau sont déterminés par des juristes, des sociologues ou des psychologues, alors que l’expérience des personnes en situation de grande pauvreté infirme le savoir d’en haut, de ceux qui n’ont pas vécu eux-mêmes dans la pauvreté. D’autres croisements sont observables à propos des vouloirs, complexifiant encore la prise de décision. La volonté citoyenne peut se situer au niveau de l’individu, isolé ou dans son village, sa ville, son pays, sa région comme l’Europe, ou du citoyen du monde. Ils se mêlent les uns aux autres. De même les pouvoirs politiques ne sont pas seulement les pouvoirs centraux, les gouvernements, le Législateur avec un L majuscule ou l’Exécutif, mais aussi les pouvoirs territoriaux. Dans le domaine du climat, qui est une sorte de laboratoire pour la mondialisation dans les autres domaines (on pense notamment aux migrations), les collectivités territoriales jouent un rôle majeur, que ce soit les grandes villes qui se sont mises en réseau ou un État fédéral comme la Californie qui a pris une longueur d’avance. Quant au pouvoir économique, il est déjà très différencié d’une entreprise à l’autre, d’un secteur à l’autre. Un tel panorama est intéressant à évoquer ici, car il explique les difficultés de la prise de décisions politiques dans un univers complètement chamboulé où les les défis, sont déjà planétaires, alors que les décisions se prennent au niveau national ou, au mieux, à plusieurs niveaux.

Notre droit, nos systèmes juridiques, auraient-ils pu nous aider à éviter l’entrée dans l’anthropocène ? Comment le droit peut-il faire face aux nouveaux défis qui, au-delà des États, concernent l’humanité toute entière ? Est-il un instrument suffisant face à ces défis ?
L’anthropocène est décrit par des géologues comme cette phase de l’histoire où l’humanité devient en quelque sorte une force géologique, par sa capacité transformatrice, et potentiellement perturbatrice, de l’écosystème. Pour éviter d’entrer dans cette phase, il aurait fallu que le droit intervienne très en amont, de façon préventive. Or, le droit n’intervient de façon préventive que lorsqu’un dommage a été réalisé et que l’on tente de prévenir son renouvellement. Mais tant que le dommage n’est pas apparu, que peut faire le droit ? Pas grand-chose ! Car il n’y a pas de demande sociale. Tant qu’on n’est pas entré dans l’anthropocène, tant que ce phénomène n’est pas visible, il est difficile de concevoir un droit préventif très en amont. Il faut un minimum de visibilité pour que la règle de droit intervienne. D’ailleurs, prétendre tout prévenir peut amener à un système totalitaire. On commence déjà à observer, avec inquiétude pour les libertés, les glissements de la répression à la prévention, de la prévention à la précaution et même de la précaution à la prédiction. La justice prédictive, accompagnée d’une police prédictive, menace, au nom de la sécurité, de mettre les populations sous contrôle permanent. Nous sommes tous plus ou moins suspects, aucun individu ne pouvant démontrer qu’il n’est pas dangereux. Il est impossible de prédire l’absence totale de dangerosité. Dans la mesure où nous sommes donc tous dangereux, au moins potentiellement, introduire une fonction non seulement préventive, mais aussi prédictive dans le système juridique, transformerait l’Etat de droit en Etat policier, et mènerait tout droit au totalitarisme, avec ou sans Etat. Personnellement, je préférerais que l’on ne s’engage pas dans cette voie. En revanche, dès lors que nous sommes informés des causalités, même si elles sont multiples et complexes, et des risques quand ils sont graves et potentiellement irréversibles, la règle de droit peut sans doute intervenir pour poser des limites, c’est-à-dire pour limiter les effets négatifs, mais sans prétendre tout prévenir. C’est un rôle non négligeable, mais moins ambitieux et plus modeste que celui qu’on attribuerait à un droit tout puissant qui résoudrait tous les problèmes, alors qu’il s’agit d’un instrument humain, donc imparfait. Pour imparfait et insuffisant qu’il soit, je crois néanmoins que le droit est nécessaire, à moins de transformer les humains en robots prédéterminés. Et encore, je vois mal comment organiser une gouvernance mondiale à l’échelle des grands défis de société sans avoir recours à une règle de droit garantie par une autorité impartiale et indépendante qui laisse l’avenir ouvert. A défaut, la gouvernance se refermera sur un monde purement économique (le Tout marché), purement technique (le Tout numérique) ou purement politique (le monde total d’un Empire Monde)… Il me semble préférable de chercher une sorte d’équilibre, utilisant le droit comme instrument de stabilisation temporaire toujours recommencée. Ce n’est qu’un outil parmi d’autres, mais il est nécessaire. La difficulté, quand on est juriste, est de ne pas surévaluer le droit, et quand on n’est pas juriste de ne pas sous-évaluer son rôle. Dans les discussions avec des collègues scientifiques, j’ai parfois l’impression qu’ils sous-estimer le droit ou alors, basculant à l’autre extrémité, qu’ils s’imaginent au contraire que la règle de droit va régler tous les problèmes.

Quelle lecture faites-vous de l’explosion des procès climatiques dans le monde ?
C’est une prise de conscience du fait que le climat ne relève pas d’un seul État. C’est aussi une reconnaissance, à travers les changements climatiques, de notre appartenance à une communauté de destin, c’est-à-dire une communauté qui sera unie par son avenir, même sans histoire commune à l’échelle de la planète. Nous avons une histoire commune à l’échelle des nations ou autres collectifs humains, mais pas à l’échelle de la planète. Or voici que nous nous découvrons, à travers ce la « crise climatique », un même destin. Nous formons en quelque sorte, une communauté par anticipation, qui s’ajoute à la communauté nationale construite sur la mémoire ou plus précisément sur le couple mémoire-oubli, puisqu’on ne se souvient pas de tout. La communauté mondiale, elle se construira sans doute autour de l’anticipation couplée avec l’imprévisibilité. De même qu’on peut se rappeler certains faits, mais en oublier d’autres, on peut anticiper sans tout prévoir. Ce couple « anticipation / imprévisibilité) nous donne seulement une certaine prise sur un destin qui reste ouvert. « L’explosion des procès climatiques » dans le monde témoigne de cette prise de conscience et elle s’est faite très vite, probablement parce que les informations circulent à une très grande vitesse depuis l’Internet. Pour moi, cette prise de conscience de notre appartenance à la même communauté, est un signe positif. Et même rassurant face à la montée des « populismes », car cette prise de conscience du fait que nous appartenons tous à la même planète est la négation de la vision souverainiste et populiste qui a tendance à envahir le monde politique, pour des raisons probablement liées à une angoisse croissante qui fait que les peurs se propagent d’un secteur à l’autre.

Comment percevez-vous la reconnaissance de droits à la nature ?
Je suis un peu perplexe devant ce phénomène, qui va de pair avec la reconnaissance de la personnalité juridique. Une décision récente de la Cour suprême de Colombie reconnaît la personnalité juridique à l’Amazonie. C’est intéressant comme piste parce que c’est une manière de construire un droit global dans ce domaine très important des changements climatiques liés à une région comme l’Amazonie qui compte beaucoup dans le réchauffement, ou sa limitation. Ce qui me rend perplexe, c’est l’apparition de droits sans responsabilités, des droits sans devoirs. La nature peut être victime, mais elle ne peut pas être coupable. On ne va pas faire un procès à une rivière qui a inondé un village. En revanche, on peut faire un procès à un village qui a pollué la rivière. Donc il y a dissymétrie.
A-t-on vraiment besoin d’attribuer des droits à la nature ? Ne suffirait-il pas de parler de « devoir » humain vis-à-vis des êtres non humains ou non encore nés comme les générations futures? Car le terme de « droits » crée une fausse impression de symétrie. Un droit sans devoir, c’est la possibilité d’être victime sans jamais être responsable. Il me semble qu’on peut arriver à un résultat assez voisin en utilisant plutôt la nouvelle catégorie des « biens communs mondiaux » – et non biens communs « de l’humanité », de façon à englober d’autres vivants que les humains. Si l’on considère l’Amazonie comme un bien commun mondial, donc non appropriable, il me semble qu’on peut arriver au même résultat, et peut-être même à un meilleur résultat en ce qui concerne la situation des populations autochtones. J’étais en Colombie en septembre 2019, un moment où la région était menacée par de terribles incendies. Nous avons eu des rencontres avec des associations de défense des indiens autochtones, qui étaient poursuivis pénalement pour avoir porté atteinte aux « droits de la nature ». Alors que dans une perspective de « bien commun mondial », les mêmes populations participeraient à la jouissance, à l’usufruit de ces biens communs. La qualification de « bien commun mondial » semble préférable à la reconnaissance de droits de la nature. Elle montre en tout cas la limite de ces catégories qu’on bricole, en faisant du nouveau avec de l’ancien. Mieux vaut répondre par des catégories juridiques nouvelles à ces nouvelles questions que les catégories juridiques traditionnelles ne permettent pas de résoudre.

La prise en cause des enjeux environnementaux de l’environnement nécessite-t-elle une remise en cause de la conception individualiste de la protection des droits fondamentaux ? Dans quelle mesure une conciliation entre ces différents intérêts est possible ?
Les droits de l’homme et les enjeux environnementaux ne sont pas toujours parfaitement conciliables. Il n’y a pas nécessairement conflit, mais il peut y avoir des tensions qui remettent en effet en cause une certaine conception individualiste des droits fondamentaux. Mais il y a longtemps que les droits humains sont affirmés comme à la fois civils et politiques et économiques, sociaux et culturels. La tension entre la conception individualiste et une conception plus collective n’est pas un phénomène qu’on découvre avec les problèmes environnementaux. En revanche, il y a là une difficulté supplémentaire, car l’environnement est en réalité un milieu de vie qui va bien au-delà du monde humain, c’est la maison commune, au sens d’un habitat commun aux humains et aux autres êtres vivants. Il y a donc en réalité deux tensions à résoudre, l’une, dans le monde humain, entre les droits individuels et collectifs, l’autre entre les humains, leurs droits et leurs devoirs envers les non-humains. Il y aura probablement des moments où il faudra faire des choix. Mais pour l’essentiel on peut encore arriver à concilier les intérêts humains et non-humains, à condition d’être conscients d’une tension, donc conscient du fait que les droits de l’homme ne garantissent pas la protection de l’écosystème et inversement.

Vous avez ouvert un nouveau chantier, celui de la construction d’un droit commun « universalisable ». N’est-ce pas utopiste ? Quels sont les chemins qui pourraient nous y conduire ?
Un droit commun « universel » est une utopie. Mais un droit commun « universalisable » est plus réaliste, car évolutif. Un tel intitulé désigne une direction, mais pas un résultat. Il n’y aura probablement jamais un droit parfaitement universel, mais l’adjectif « universalisable » suggère que les différences deviennent conciliables. Elles ne disparaissent pas mais sont peu à peu mises en compatibilité, harmonisées sans être unifiées. C’est un objectif d’autant plus réaliste qu’il commence à se mettre en place mais le panorama mondial est très éclaté selon les domaines du droit et selon les niveaux où l’on situe la question. Les constructions au niveau régional, comme l’Union européenne, l’organisation des États américains, l’Union africaine ou l’ASEAN, introduisent bien l’idée d’un rapprochement sans unification. Si l’objectif est clairement reconnu, le rapprochement peut commencer avec une marge nationale d’appréciation importante, de manière à engager une dynamique. Le pari étant que la marge nationale se réduira au fil de réalités elles-mêmes évolutives.
Quels sont les chemins qui pourraient nous conduire à ce droit commun ? La réponse se trouve en partie dans le livre que nous préparons à partir d’un groupe de recherche associant le Collège de France et l’IEJP (CNRS /Université de Paris 1). Intitulé « Sur les chemins d’un universalisable », cet ouvrage, dont la publication est annoncée pour 2020 [4], est parti de la description de fragments de droit commun, pris dans le tourbillon de vents contraires, dans quelques domaines (justice pénale, justice sociale, justice climatique, droit des investissements, droit de la santé, droit des migrations, etc. ) Ensuite nous avons tenté d’écouter « Ce que nous disent les vents de l’histoire ». Car des formes de Jus commune ont existé à certaines époques dans différentes parties du monde. Nous présentons quelques exemples : Jus commune chinois, entre la loi et les rites ; puis européen, entre droit romain et droit canon ; Common law anglo-américain, entre Equity et Statute Law ; droit islamique, entre la loi civile et la Sh’aria ; enfin, entre coutumes précoloniales, acculturation imposée et droit post-colonial, une sorte de droit commun des pays colonisés.
L’hypothèse que nous tentons de vérifier est qu’à certaines conditions, le Jus commune, dans ses diverses formes, se situerait « entre les règles et l’esprit des règles ». Les règles elles-mêmes pouvant être différentes, du moment qu’elles sont appliquées dans un esprit commun. C’est en partant de cette hypothèse que nous avons essayé de trouver les conditions d’un droit commun universalisable. La première condition est l’art de la gouvernance : un art de la séparation des pouvoirs devenant un art de l’agrégation SVP, selon la trilogie mentionnée ci-dessus.
Une deuxième condition est que les véritables responsables soient reconnus comme tels, et sanctionnés le cas échéant. L’obligation de mise en conformité (compliance) étant parfois plus efficace que la sanction. Par exemple, une entreprise qui ne respecte pas les contraintes environnementales sera obligée de se mettre en conformité, selon un agenda dont le respect est contrôlé. Les processus de responsabilisation doivent atteindre les acteurs les plus puissants, les États et les ETN, à une échelle globale, dans la mesure où ils disposent d’un pouvoir lui-même global. Or, le droit international n’est pas fait pour les entreprises. Elles ne sont pratiquement jamais responsables en droit international. Même les dispositifs sur les droits de l’homme, qui rendent les États responsables des transgressions, ne visent pas les entreprises.
Une troisième condition concerne donc les normes juridiques. Il ne suffit ni de créer de nouveaux concepts, ni de former un ensemble cohérent, alors que des normes surgissent à tous les niveaux (international, mondial ou régional, mais aussi national et même infranational), allant du droit dur avec des règles précises, obligatoires et sanctionnées au droit souple, c’est-à-dire flou (imprécis), mou (facultatif) et doux (non sanctionné), en passant par toutes les catégories intermédiaires. En revanche se met déjà en place une dynamique qui commence à dessiner un espace normatif à géographie variable et un temps normatif à plusieurs vitesses. Elle résulte moins d’une hiérarchie des normes que d’interactions « entre » droit national et droit international. Il faut donc réussir à délimiter un ordre commun, puis à articuler le commun sur le particulier.
Une dernière condition serait d’aménager la relation entre ces règles et l’esprit des règles. Il faut des règles pour délimiter le commun et pour articuler le commun et le particulier. Certaines techniques juridiques peuvent être utilisées comme la marge nationale d’appréciation évoquée ci-dessus, ou les responsabilités communes, mais différenciées dans la terminologie climatique : les États ont des objectifs communs. S’ils ne les atteignent pas, ils sont responsables, mais leurs responsabilités sont différenciées pour tenir compte du contexte économique, culturel, géographique…
Entre les règles et l’esprit des règles, il faut réussir à créer une sorte de synergie afin d’éviter que les règles deviennent autonomes, à tel point qu’on ne sache plus par qui ni pourquoi elles ont été instaurées, ni même à quoi elles servent. C’est ainsi que nous en sommes venus à l’idée d’une boussole de la mondialisation, une boussole des humanismes.

Les nouveaux équilibres internationaux ne sonnent-ils pas au contraire le glas de la conception humaniste développée en Europe et qui se voulait universelle ?
Pour qui sonne le glas ? Est-ce pour l’Europe ? Ou pour les États-Unis qui, après avoir été une sorte d’Empire monde depuis l’après-guerre, sont en train de se retirer du jeu, tout au moins en apparence ? En revanche, la Chine est de plus en plus présente, de façon très structurée et très pragmatique. Son programme « Les nouvelles routes de la soie », qui comporte un agenda jusqu’en 2050, témoigne d’une volonté de limiter l’imprévisible autant que possible, essentiellement sur la base du marché et des nouvelles technologies. Reste à savoir, avec un marché annonçant la croissance et le développement pour tous les peuples, comment échapper au risque de renforcer la crise environnementale, notamment climatique. Une autre interrogation concerne l’usage des nouvelles technologies pour instituer un contrôle permanent des populations, au détriment des libertés fondamentales
Dans la configuration qui se met en place, la Chine est sans doute le seul pays qui a pris conscience que les humains forment une communauté de destin. Les Chinois ont inscrit dans leur constitution, à l’occasion de la réforme de 2018, une disposition prévoyant que la Chine « contribue à construire le destin commun de l’humanité ». Il est urgent que d’autres pays, ou unions comme l’Europe, s’intéressent aussi à ce destin commun de l’humanité afin d’éviter l’émergence ou la résurgence d’un Empire monde, d’où qu’il vienne. Il est grand temps que l’Europe se lève et se relève de toutes ses tentations souverainistes pour prendre en charge une partie du destin commun de l’humanité. Le Green Deal du climat, lancé par la présidente de la commission européenne le 11 décembre 2019, pourrait amorcer cette confluence inédite.
En conclusion, la « confluence des droits » vient à son heure si elle accompagne l’objectif ambitieux de pacifier le monde autour de la spirale des humanismes. Après tout, la Chine et l’Europe font partie d’un même continent. Pourquoi ne proposeraient-ils pas ensemble une gouvernance mondiale, ouverte et évolutive, qui aurait l’efficacité du projet chinois et emprunterait à l’Europe son expérience d’un pluralisme ordonné autour de valeurs communes ?
Entretien réalisé par Sandrine Maljean-Dubois et
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrices de recherche au CNRS
Pour citer cet article : Mireille Delmas-Marty, « Le grand entretien », Confluence des droits_La revue [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 17 février 2020. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=636

[1] La Cohée du Lamentin, Gallimard 2005, p. 35
[2] F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide aux réseaux, Bruxelles, F.U.S.L., n°94, 2002, 596 p.
[3] José Garcia Ghirardi « Contrepoint sémantique », in Sur les chemins d’un Jus commune universalisable, Mare & Martin, Paris, à paraître, 2020.
[4] Précité note 3.