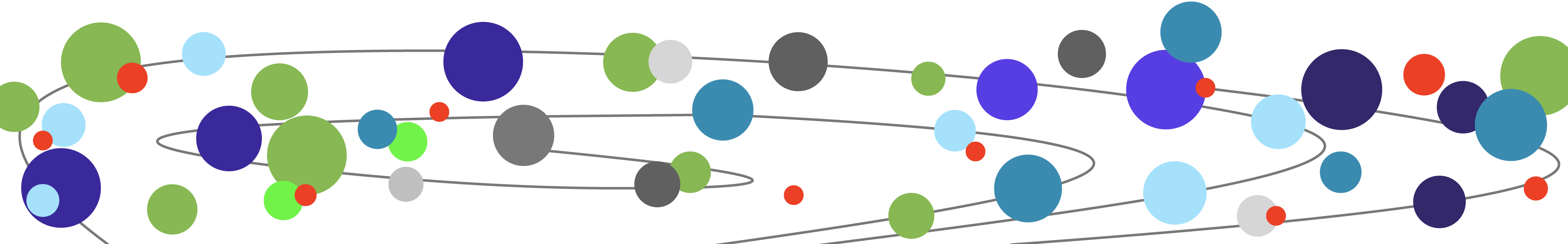Entretien avec Jorge Viñuales,
Professeur à l’Université de Cambridge


Confluence des droits_La revue : Qu’est-ce que l’anthropocène ?
Du point de vue des temps géologiques, nous vivons dans une époque appelée l’Holocène, qui a commencé avec la fin de la dernière glaciation, il y a quelque 12.000 ans en arrière, ce qui a permis le développement de l’agriculture et la sédentarisation. Cependant, l’impact de l’activité humaine a été tel dans les derniers 250 ans, en particulier après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l’humanité est devenue une force à l’échelle géologique. Les efforts en cours pour appeler l’époque géologique que nous vivons ‘l’Anthropocène’ visent à refléter le rôle déterminant de l’humanité comme processus géologique. Un tel changement est relativement complexe à effectuer, car il faut sélectionner des ‘marqueurs’ ou, en d’autres termes, des traces qui permettent de marquer le passage d’une époque à une autre. Ce processus est à l’examen au sein de la Commission internationale de stratigraphie, dont la Sous-commission sur la stratigraphie de la période quaternaire a formé un groupe de travail sur l’Anthropocène. La proposition d’une nouvelle ‘époque’ des temps géologiques n’est pas encore formalisée, et son acceptation ne va pas de soi.
Cela dit, la notion et, plus généralement, le ‘récit’ relatif à l’Anthropocène ont déjà largement influencé la recherche aussi bien en sciences naturelles qu’en sciences humaines, depuis une vingtaine d’années. Le terme en soi a été attribué à l’écologiste Eugene Störmer et au chimiste Paul Crutzen. Le dernier publia en 2002 un bref texte dans la revue Nature intitulé ‘Géologie du genre humain’ (Geology of mankind). Mais l’idée est bien plus ancienne, du moins en germe, et peut-être retracée aux travaux des savants naturalistes à partir du dix-huitième siècle. Dans la première moitié du vingtième siècle, le savant russe Vladimir Vernadsky, auteur d’un ouvrage de biogéochimie (à savoir de l’étude des processus chimiques régulés par la vie sur terre, comme la photosynthèse oxygénique, qui ont une importance fondamentale a l’échelle géologique) intitulé La Biosphère, a mis lui aussi le doigt sur des processus qui seront plus tard conceptualisés d’autres manières, telles que l’hypothèse Gaia de James Lovelock et Lynn Margulis ou la notion d’Anthropocène. Ce qui est peut-être nouveau dans cette dernière est qu’elle repose sur le constat non seulement de l’importance de la vie pour les processus géochimiques mais aussi de l’immense niveau d’interférence des activités humaines dans ces processus. C’est le deuxième constat qui est nouveau ou, comme l’a écrit l’historien John R. McNeil, qui constitue véritablement quelque chose de nouveau sous le soleil.
En d’autres termes, l’être humain est devenu une force de disruption des processus naturels de proportion géologique. Les nombreux constats qui en sont donnés, de plus en plus fréquemment, par des rapports et des publications scientifiques, que ce soit sur les changements climatiques, la perte effrénée de la biodiversité, la création de ‘zones mortes’ (pauvres en oxygène) dans les océans, parmi tant d’autres, peuvent être vus comme de multiples visages de l’Anthropocène, dans la mesure où ils sont le produit de l’activité humaine.

En quoi un juriste doit-il s’intéresser à ces évolutions ?
La réponse à une telle question peut être donnée à deux niveaux. D’une manière très simple, il s’agit d’un défi majeur, peut-être le plus grand défi auquel l’humanité ait été confrontée, et le juriste ne peut donc pas rester à l’écart. D’une manière plus spécifique, le juriste doit comprendre que la structure du droit occidental qui a été façonnée au cours des siècles a été une partie prenante à l’organisation des processus qui ont érigé l’humain en force géologique. À ce deuxième niveau se posent des questions de causalité historique impossibles à résoudre d’une fois pour toutes, mais tout de même importantes pour comprendre la nature du phénomène. En particulier, ce qui a rendu possible l’action humaine d’une telle ampleur est la maîtrise des combustibles fossiles, d’abord du charbon, puis du pétrole, dans ce qui a été appelé la révolution thermo-industrielle. Or, les processus de production dans l’Angleterre de la fin du dix-huitième siècle n’auraient pas pu se développer de la même manière si l’Angleterre n’avait pas pu bénéficier des matières premières produites aux États-Unis, ce qui à son tour s’appuyait sur l’organisation de l’esclavage en provenance de l’Afrique ainsi que du commerce dit ‘triangulaire’ entre le Royaume-Uni, les États-Unis et les colonies africaines. Il est impossible de savoir ce qu’aurait le monde d’aujourd’hui sans la révolution industrielle ou si un processus similaire à celle-ci aurait eu lieu en l’absence d’un tel commerce triangulaire. Il ne s’agit, d’ailleurs, que d’un exemple.
Cependant, cet exemple permet de voir que le droit y joue un rôle capital, que ce soit pour permettre l’octroi de droits de propriété intellectuelle sur des inventions (ex. le machine à vapeur), l’institution de l’esclavage (c’est-à-dire des droits de propriété sur des êtres humains), le commerce intra-colonial et international, l’organisation d’opérations de financement massif, notamment par la création d’entités juridiques pouvant emprunter et accumuler des montants de capital suffisants pour mener de telles opérations. Les progrès de l’humanisme depuis ont permis de bannir des institutions telles que l’esclavage, même s’il subsiste dans l’illégalité dans nombre de pays, mais l’essentiel des autres structures juridiques est encore à l’œuvre. À titre d’exemple, la notion juridique de souveraineté est le principal bouclier juridique qui permet au gouvernement brésilien de répondre aux critiques, à mon sens totalement justifiées, à l’encontre du ‘développement’ économique de l’Amazonie.
Les juristes n’ont, pour l’instant, pas saisi l’importance du droit pour les processus qui ont rendu possible l’Anthropocène, ceci avec de très rares exceptions, telles que les travaux du professeur Davor Vidas, qui est membre du groupe de travail sur l’anthropocène. Il faut dire, à leur décharge, que les travaux de recherche en sciences naturelles et humaines sur l’Anthropocène omettent, eux aussi, presque totalement de se référer au droit. C’est comme si cette technologie d’organisation sociale qu’est le droit était perdue de vue, même dans les travaux les plus englobants et interdisciplinaires sur l’Anthropocène. Cela est dû, il me semble, a plusieurs raisons. Tout d’abord, les juristes ont de longue date réclamé une place distincte et propre au sein des savoirs, ce qui les a séparés, historiquement, des sciences naturelles et, plus récemment, des sciences sociales. Ensuite, la manière dont les juristes pratiquent l’interdisciplinarité est encore très rudimentaire. Le plus souvent, on se saisit d’approches scientifiques qui sont dépassées. Par exemple, l’école de ‘law and economics’ s’appuie sur une économie dépassée – l’économie néoclassique – qui, elle-même, s’appuie sur la logique de la physique classique du dix-neuvième siècle, dépassée depuis longtemps. De même, les approches critiques du droit sont souvent des réverbérations des débats philosophiques des années 1960 ou 1970, voire bien plus anciens, si l’on pense aux racines marxistes de ces débats. Enfin, lorsque la question de l’Anthropocène est posée en droit, il s’agit souvent – mais pas toujours – d’une autre manière de parler de droit de l’environnement, alors même qu’il devrait s’agir de tout autre chose. L’Anthropocène met en cause la structure même des systèmes juridiques, dont le droit de l’environnement n’est qu’un épiphénomène, un palliatif des effets des transactions façonnées par des normes de nature constitutive, telles que la personnalité juridique, la propriété, la souveraineté, l’héritage, la responsabilité limitée, les contrats, et bien d’autres

Nos systèmes juridiques ont-ils permis de limiter les dommages à l’environnement ? Ou ont-ils contribué à leur aggravation ?
Nos systèmes juridiques sont, à mon avis, une condition nécessaire – même si pas suffisante – de la dégradation environnementale. À nouveau, il est impossible de démontrer une relation causale claire tant les variables indépendantes et dépendantes sont larges et construites. Mais, l’échelle des processus de production qui ont conduit à la dégradation de l’environnement global n’aurait vraisemblablement pas été atteinte si certaines transactions n’avaient pas été rendues possibles par des concepts juridiques fondamentaux. Cela est aussi important pour comprendre pourquoi, à mon avis, le droit de l’environnement, tel qu’il est conçu de nos jours, n’est qu’un droit des ‘externalités négatives’ ou, en d’autres termes, une couche supplémentaire que l’on ajoute une fois que des transactions (des processus de production) ont été façonnées par une couche plus profonde des systèmes juridiques, et cela dans le seul but d’‘atténuer’ les effets indésirables de ces transactions sans pour autant ‘interférer’ avec elles. Pour employer une analogie, certes imparfaite, c’est comme si l’on tentait d’améliorer les conditions de vie des esclaves sans pour autant bannir l’esclavage. C’est là, également, la principale difficulté du concept de développement durable, qui est bâti sur cette structure dualiste selon laquelle la durabilité n’est pas censée interférer avec le développement.

Quels sont les défis pour nos systèmes juridiques dans les années à venir ? Quelles pistes et solutions ?
Il est possible d’ajuster notre organisation juridique de manière à entraver les processus les plus dommageables. Cela exige d’accomplir quatre actes, chacun d’eux extrêmement difficile, mais pour des raisons différentes. Le premier est de cartographier de manière claire la structure dualiste des systèmes juridiques pour dénicher cette constante qui donne priorité à certains éléments de la réalité (qui sont ainsi constitués en ‘transactions’) par rapport à d’autres (par là même constitués en simples ‘externalités négatives’, sorte de dommages collatéraux qui doivent se satisfaire des politiques de l’atténuation). Le deuxième est d’identifier, au sein de cette cartographie, les points d’action stratégiques, ce que j’appelle des ‘points d’acupuncture’ pour souligner le fait qu’en touchant des points qui ne sont pas hors portée, on pourrait déclencher des effets systémiques. Cela est extrêmement difficile, non pas parce qu’on ne peut pas émettre des hypothèses sur l’identité de ces points, ce qui ne présente pas de difficulté particulière, mais parce que cela ne suffit pas pour les reconnaître. Le troisième est de créer des outils de modélisation qui permettent, d’une manière relativement proche de la réalité, de représenter les effets de chaîne déclenchés par des interventions sur ces points. Quatrièmement, il faut construire un consensus pour passer à l’acte. On me demande souvent ce qu’on peut faire pour lutter contre la dégradation de l’environnement. Il y a de nombreuses choses que l’on peut faire mais, dans l’état actuel de notre organisation politique, les deux actions les plus importantes sont de bien voter et de bien consommer, c’est-à-dire d’exprimer par ces deux voies l’importance que l’on attache à la protection de l’environnement. Le reste, même l’innovation technologique, est à mon avis un complément.
Cambridge, 10 décembre 2019
Pour citer cet article : Jorge Viñuales, « Le droit et les juristes au défi de l’anthropocène », Confluence des droits_La revue [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 11 février 2020. URL : http://confluencedesdroits-larevue.com/?p=272